No hay productos en el carrito.
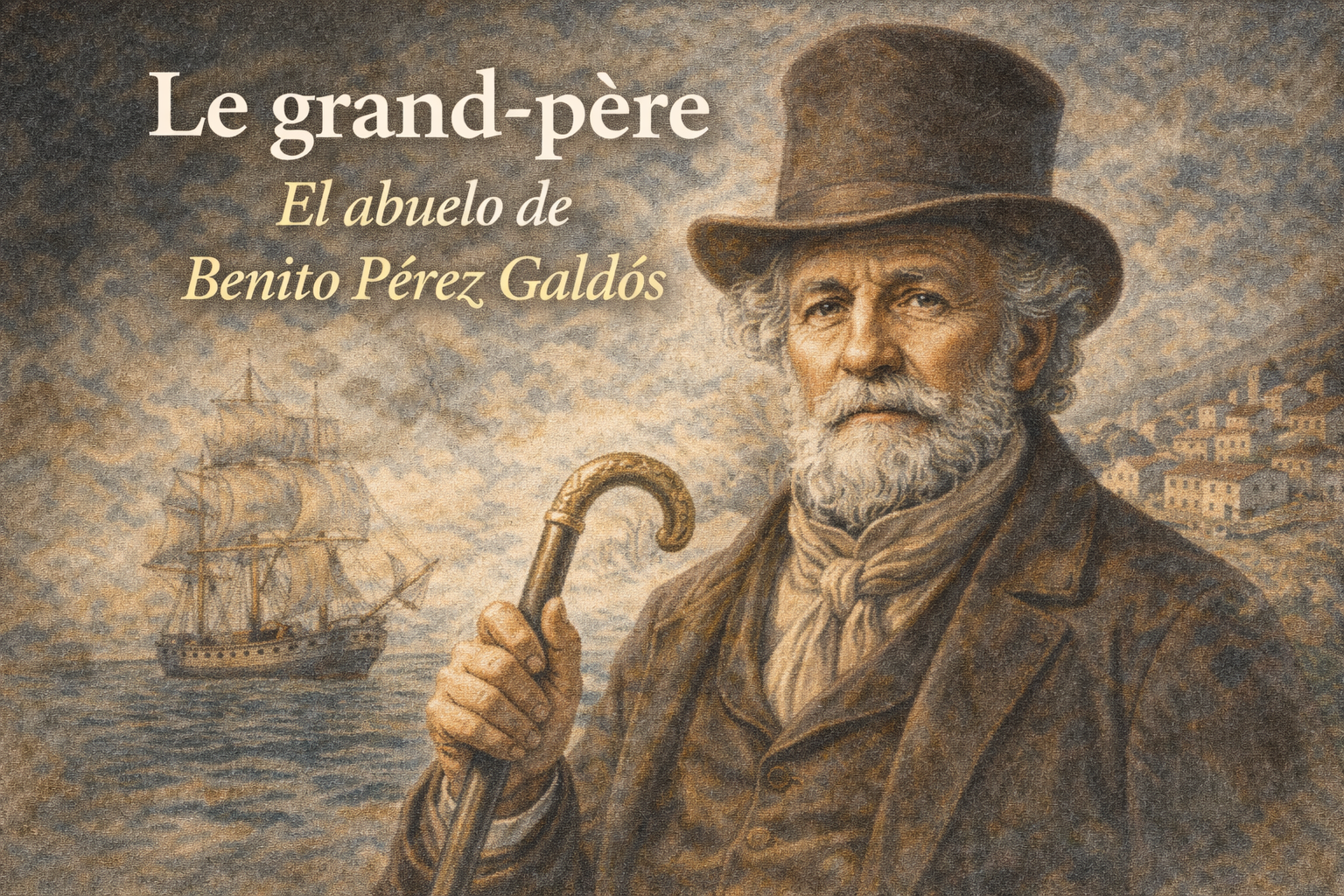
Traduction Daniel Gautier
Prologue de l’auteur
Je veux dire à mes fidèles lecteurs, qui ont envers moi tant d’indulgence, que dans la composition de Grand-père[2] j’ai voulu flatter mon goût et le leur, en donnant, pour cette fois, le plus grand développement possible au dialogue tout en réduisant au minimum les descriptions et la narration. Ils vont sans doute croire comme moi que ces histoires de formes artistiques ou littéraires sont des choses faciles et qu’on ne doit se montrer sourcilleux que pour ce qui serait niais, inutile ou ennuyeux. Il est clair que si moi j’avais péché par bêtise ou vulgarité, ici ou là, je supporterais volontiers le mépris de mes lecteurs ; cependant, en médisant mon impéritie je ne dirais pas que le chemin est mauvais mais que je ne sais pas le parcourir.
La forme dialoguée, déjà utilisée dans Réalité[3], rend plus libre et plus concrète la formation des caractères. Ceux-ci se font, se structurent, imitent plus facilement, disons-le ainsi, les êtres vivants, révèlent ainsi leur personnalité, en utilisant leurs propres paroles, ainsi, comme dans la vie ordinaire, cela met en relief plus ou moins profondément et sûrement leurs actions.
La parole de l’auteur qui narre ou décrit n’est pas, en règle générale, si efficace et ne donne pas si directement l’impression de la vérité spirituelle. C’est toujours une référence, quelque chose comme l’Histoire qui nous raconte les événements et nous trace des portraits et des scènes. Avec la mystérieuse vertu du dialogue, on croit voir et entendre sans intermédiaire l’événement et ses acteurs et on oublie plus facilement l’artiste caché qui nous offre une bonne imitation de la Nature. On aura beau dire, l’artiste est plus ou moins caché, il ne disparaît jamais, les décors ne l’excluent jamais totalement du tableau, même s’ils sont bien faits. L’objectivité de l’auteur, préconisé aujourd’hui par certains comme système artistique, n’est qu’une vague bannière littéraire qui s’agite peut-être de manière triomphante, mais n’existe que par la vigoureuse personnalité des chefs qui l’ont en mains.
Celui qui propose un sujet et lui donne une vie poétique, dans le Roman comme dans le Théâtre, est toujours présent : présent dans les élans lyriques, présent dans le récit passionné ou dans l’analyse, présent dans le Théâtre même. Son esprit est le creuset indispensable pour qu’entrent dans le moule artistique les êtres imaginés qui imitent le battement du cœur de la vie.
Bien que par sa structure et la division en journées et scènes Grand-père semble une pièce de théâtre, je n’ai pas hésité à en parler comme d’un roman, sans donner aux appellations une valeur absolue, car là comme dans tout ce qui fait partie du règne infini de l’art, il vaut mieux fuir toutes les mises en cases, les classifications en catalogues de genres et de formes. Dans tout roman où les personnes parlent bat une œuvre théâtrale. Le Théâtre n’est que la condensation et l’assemblage de tout ce qui dans le Roman moderne constitue les actions et les caractères.
L’art scénique proprement dit est venu s’enfermer à notre époque (par égarement ou fatigue du public et aussi pour des raisons sociales et économiques qui donneraient matière à une étude approfondie) dans un cadre si étroit et si pauvre que les grandes œuvres des grands dramaturges nous paraissent des romans parlés. Passant de nos petites œuvres aux grands exemples, je me dis: Le Richard III de Shakespeare, cadre colossal de vie et de passions humaines, peut-il être aujourd’hui considéré comme une œuvre théâtrale pratique ? Garrick[4] le représentait intégralement et il y avait un public capable de le comprendre et de sentir les choses, d’assimiler sa riche sève hautement poétique. Aujourd’hui cette œuvre-là et bien d’autres immortelles appartiennent au théâtre idéal, lu, sans être représenté ; c’est un art qui, à cause de la foule et de ses différentes réactions, à cause de son intensité passionnelle, à un niveau tel qu’il ne supporte plus ce que nous appelons public (des milliers de femmes et de gentilshommes bien assis dans une salle), admet difficilement l’intermédiaire entre l’ingénieux créateur et l’ingénieux lecteur, les deux devenant ingénieux pour que jaillissent l’émotion et le goût délicat pour les belles choses.
Est-ce que La Célestine est un roman ou une pièce de théâtre ? Si quelqu’un le sait qu’il me le dise. Son auteur l’a appelée une tragi-comédie ; drame de lecture en réalité et, sans doute, le plus grand et le plus beau des romans parlés. Bref, les noms qui existent ne signifient rien et, en littérature, la variété des formes s’imposera toujours à la nomenclature des rhétoriciens capricieux. Je ne veux dire qu’une chose à mes bons amis, sans se soucier de savoir comment appeler cette pièce, qu’ils accueillent avec bienveillance cet humble essai sous une forme que je crois appropriée pour notre époque, elle qui aime tant ce qui est synthétique et expéditif.
B.P.G.
Dramatis personae
Don Rodrigo de Arista-Potestad, comte[5] d’Albrit, seigneur de Jerusa et de Polan, etc,
grand-père de Leonor (Nell) et Dorotea (Dolly).
Lucrecia, comtesse de Laín, mère de Nell et Dolly, et belle-fille du comte
Senén, domestique de la famille des Laín puis employé
Venancio, ancien métayer de La Pardina, actuellement propriétaire
Gregoria, sa femme
Le curé de Jerusa (don Carmelo)
Le médecin (don Salvador Angulo)
Le maire (don José M. Monedero)
La femme du maire (Vicenta)
Don Pío Coronado, précepteur des enfants Nell et Dolly
Consuelo, riche veuve, cancanière
La Marquise[6], veuve, pauvre, campagnarde
Le prieur des Hiéronymites (Père Maroto)
L’action est supposée se passer dans la ville de Jerusa et ses environs ; les principales scènes dans La Pardina, propriété qui a appartenu à la famille des domaines de Laín. Le pays et la mer qui le baigne n’ont rien de bien précis, géographiquement parlant, nous manquons de repères. Tous les noms de villes et localités sont imaginaires. Epoque contemporaine.
Première journée
Scène I
Terrasse à La Pardina. A droite, la maison ; au fond, un luxuriant bosquet d’arbres fruitiers ; au loin, la mer. Gregoria, près de la table de pierre, égrène des haricots dans sa jupe ; Venancio, qui arrive par le jardin, discute avec un domestique tout en regardant les arbres fruitiers.
Sur la table, un panier de légumes.
Gregoria – Eh bien !… Venancio, je suis là !
Venancio – J’arrive… Plus de cinquante ‘duchesses’ sont tombées à cause du coup de vent d’hier soir.
Gregoria – Allons bon ! Laisse tes poires et viens me raconter… Est-il vrai que…? (Venancio se présente, respirant fort et épongeant la sueur de son crâne rasé. Gregoria attend impatiemment la réponse.)
Ils sont mari et femme, cinquante ans bien tassés, tous les deux de petites tailles et assez enveloppés, sains d’aspect, le teint de couleur sanguine et le regard inexpressif. Ils font partie de la classe ordinaire, qui a su gagner avec patience, bassesse et astuce, une position confortable et qui se repose dans l’indifférence des passions et la parfaite ignorance des grands problèmes de la vie. Son visage à elle ressemble à une pomme, le sien à une poire avec sa peau ternie et tachetée. Ils sont sans enfants et fatigués de les désirer, ils commencent à se réjouir de ne point en avoir vu naître. Ils s’aiment par routine et se rendent à peine compte de leur bonheur : un bien-être amassé dans la fadeur méthodique d’une vie sans accidents. Ils rouspètent parfois et ronchonnent pour de petites contrariétés qui altèrent la normalité du rythme de leur existence placide. A l’âge de la maturité, ils vivent là où ils sont nés et sont propriétaires des lieux où ils ont été métayers. Leur unique ambition est de vivre, de continuer à vivre, sans qu’aucun grain de sable ne vienne troubler le courant de leur onde vitale. Aujourd’hui n’est pour eux que la série d’actions qui a pour seul but de reproduire un lendemain entièrement égal au jour d’hier. Ils sont habillés de façon courante et banale, à la ville comme à la campagne, bien arrangés, bien propres et modestes. Gregoria est besogneuse, excellente cuisinière, touchée par le même fanatisme économique que son mari. Ce dernier s’y connaît en labours et en horticulture, c’est un amateur de chasse et de pêche, il a des notions d’industrie agricole et n’est pas ignorant de la jurisprudence hypothécaire, ni de tout ce qui touche à la propriété, le bail, le service, etc. Pour tous les deux, la Nature est une patronne ponctuelle et une honnête dépensière ; elle est prosaïque, avare, conservatrice, comme eux.
Venancio – Brrr… !
Gregoria – Mais, voyons, ôte-moi d’un doute. Est-ce vrai ce qu’on dit ? On va avoir une mégère ?
Venancio – Oui. As-tu vu des fois une mauvaise nouvelle qui ne se réalise pas ?
Gregoria – (Interrogative.) Et quand est-ce qu’arrive madame la comtesse ?
Venancio – Aujourd’hui… Mais ne t’en fais pas ; elle logera chez monsieur le maire.
Gregoria – Encore heureux. (Se remettant à égrener ses haricots.) Bon, autre chose… Si monsieur le comte arrive aussi, ce sera vraiment l’alliance de l’eau et du feu.
Venancio – Ils vont sans doute se disputer comme hier… Beau-père et bru ne peuvent pas se voir. Si on pouvait ne retenir d’eux que la particule, quelle joie !… Evidemment, nous devrons loger monsieur le comte !
Gregoria – Il n’y a pas de doute ! Il ne manquerait plus que ça… Je me demande : viennent-ils ici se retrouver par hasard ou bien se sont-ils donné rendez-vous pour régler l’affaire de la maison ?… Parce que, après la mort du petit comte, ça doit être un imbroglio…
Venancio – Je n’en sais rien ! La comtesse Lucrecia va venir, comme toujours, jeter un coup d’œil sur ses filles.
Gregoria – Et nous payer la pension annuelle non acquittée pour les deux demoiselles que nous gardons et alimentons… Ah ! Quelle pimbêche celle-là ! Elle les met ici en exil pour pouvoir papillonner et s’amuser toute seule dans ces «Paris» ou ces «Angleterres» de Dieu ou du diable ! Quelle friponne ! Tu sais, Venancio, je comprends que son beau-père, monsieur le comte d’Albrit, de la plus grande famille d’Espagne (qu’on se le dise !), garde une dent contre cette étrangère dont le fils est tombé sottement amoureux (Dieu ait son âme !)… Ce que je n’arrive pas à comprendre c’est qu’il vienne encore ici, puisqu’il sait qu’il va encore l’affronter… A moins qu’il ignore tout… Qu’en penses-tu ?
Venancio – (En farfouillant encore dans le panier de légumes.) On va vite savoir s’ils viennent tous les deux exprès, ou si c’est le hasard qui les fait se retrouver à Jerusa… En espérant qu’ils ne viennent pas, ni lui ni elle, toutes griffes dehors !… Tu peux me croire, on va retrouver des touffes de barbes blanches, des cheveux blonds et des morceaux de peau… parce que, si le comte don Rodrigo aime sa belle-fille comme on aime une rage de dents, elle le paie de la même monnaie.
Gregoria – Je pense comme toi : le pauvre don Rodrigo vient pour qu’on lui donne à manger.
Venancio – C’est ce que j’ai pensé en apprenant qu’il arrivait.
Gregoria – C’est du tout vu, il n’apporte pas d’Amérique la poudre d’or qu’il est allé chercher.
Venancio – ça a été le jour et la nuit. Quand il a embarqué pour là-bas, il avait dépensé toute sa fortune… Il espérait en trouver une autre que le Gouvernement du Pérou lui avait offerte contre les mines d’or que son grand-père avait eues là-bas en tant que vice-roi… Mais, il n’a eu que des ennuis et il est revenu pauvre comme Job, malade et pour ainsi dire aveugle, sans autre bagage que les ans… C’est qu’il a maintenant plus de soixante-dix printemps ! Ensuite, il y a eu la mort de son fils qu’il adorait…
Gregoria – Pauvre monsieur… Venancio, il nous faut le protéger.
Venancio – Oui, oui. Qu’on n’aille pas dire que nous ne nous comportons pas en bons chrétiens. Peut-on imaginer ça !… Nous, Gregoria, on donne à manger au comte d’Albrit, ce grand, ce puissant, et toute sa kyrielle d’ascendants, rois et princes, cet homme qui, il n’y a pas encore vingt ans, était le maître des domaines de Laín, Jerusa et Polan !… La roue tourne, qu’on ne me dise pas le contraire…
Gregoria – (Ponctuant d’une poignée de haricots.) Tu entends ce que je dis ? Il nous faut le protéger. C’est notre devoir.
Venancio – (Tout en philosophant il prend une tomate du panier.) Que de chutes et de faux pas, Gregoria ! Les puissants sont renversés et les humbles sont élevés ! Bien sûr que nous allons le protéger et le secourir. Il a été notre maître ; nous avons mangé chez lui, nous avons travaillé chez lui… C’est avec les miettes de sa table que nous avons pétri notre passé. (Il se lève, l’air protecteur.) Eh oui : On est ici en terre chrétienne, on a de la délicatesse… (Il prend une autre tomate et admire sa taille et sa beauté.) ça, c’est de la tomate, Gregoria !… Le curé peut bien venir avec les siennes, saperlipopette !… Oui, bien sûr : j’ai pitié du bon don Rodrigo.
Gregoria – (Répondant à l’apologie de la tomate.) Mais les haricots ne s’égrènent pas bien. (Elle les montre.) Regarde moi ça… Moi aussi, ça m’afflige de voir monsieur le comte. On dirait un châtiment… ou au moins une bonne leçon.
Venancio – Un châtiment, bien dit. Tout ça pour n’avoir pas été économe, ne faire que mener la grande vie sans penser au lendemain. Voilà le problème, Gregoria, et balance ça à tous ceux qui viennent me critiquer parce que je suis en faveur de l’épargne. Les fêtes, les voyages, les chevaux, le train, les invitations et autres mille vanités, tous les biens de la maison d’Albrit y sont passés, et une partie des biens des Laín, famille de sa mère. La maison était déjà mise en gages depuis longtemps, l’histoire raconte qu’aucun des comtes d’Albrit n’a su gérer ses affaires. Tu te rends compte, ce malheureux monsieur paie pour tous. Tu vois bien : les créanciers l’ont laissé sur la paille, le négoce d’Amérique qui rate, Dieu lui enlève son fils et voilà notre homme en fin de vie, pauvre et misérable, malade, sans aucune affection… C’est triste, non ?
Gregoria – Maintenant que j’y pense, il vient voir ses petites filles ; mais oui, Venancio, il est à la recherche de quelqu’un qui lui donne un peu de consolation dans sa solitude…
Venancio – (En prenant une aubergine dans le panier.) C’est possible… Qu’est-ce que tu penses de ces aubergines ?
Gregoria – Elles ne sont pas mal… Pour moi, c’est la chaleur familiale qui attire notre monsieur le comte.
Venancio – On verra bien : mon don Rodrigo à la recherche de prévenance, il met la main dans le nid, touche une chose froide et glissante… Ah ! C’est la mère cette couleuvre, c’est l’étrangère la mauvaise ombre de la famille, car depuis que le comte Rafael s’est marié avec cette vaurienne, la maison a commencé à sombrer. (En remettant dans le panier l’aubergine qu’il a en main.) Enfin, pour ce qui est des tomates et des aubergines, nous sommes imbattables. Mais nous ne savons pas quel vent pousse le comte d’Albrit à venir ici.
Gregoria – C’est lui qui nous le dira. Et s’il ne le dit pas, les faits parleront d’eux-mêmes. (Considérant son travail terminé elle transvase les haricots de sa jupe dans un panier.) Ne te tracasse pas, Gregoria ; peu importe la raison de sa venue, tu dois lui préparer une bonne table… C’est déjà un soulagement de savoir que l’étrangère ne va pas venir chez nous.
Venancio – Et même si elle venait… Elle n’est jamais plus de deux ou trois jours. Jerusa est tout petit et elle a besoin de grands espaces pour se démener à son aise.
Gregoria – (Assaillie par une idée.) Ah ! Venancio de mon cœur, j’ai une idée ! On n’y avait pas pensé avant, ni toi ni moi ! M’est avis que doña Lucrecia vient récupérer ses petites ?
Venancio – (En restant longtemps bouche bée.) Tu as peut-être raison… Elles sont grandes désormais… Ce sont des jeunes filles maintenant. Eh bien, écoute, elle nous embête bien…
Gregoria – Mon cœur, quand aurons-nous une autre aubaine comme celle-là ?
Venancio – (Il marchait de long en large tout en réfléchissant.) Ce n’est pas qu’elle nous accorde une belle somme par trimestre pour qu’on s’en occupe mais c’est toujours ça, une petite rente régulière, c’est une garantie… Non, non, tu vas voir, elle ne va pas nous les prendre.
Gregoria – Allez, on ne va pas se creuser la cervelle pour deviner aujourd’hui ce que nous allons apprendre demain. (Elle s’apprête à entrer dans la maison.)
Venancio – Tu sais qui va nous le dire ? C’est Senén. Il est ici depuis hier.
Gregoria – Senén ?… Le fils de la «Coscoja» ?… Ah ! Oui. Les petites m’ont dit qu’elles l’avaient vu, c’est devenu un vrai gentilhomme.
Venancio – Employé public, fonctionnaire, autant dire employé du Trésor Public de la province de Durante[7]. Il a été domestique de la comtesse qui, en remerciements de ses loyaux services, lui a donné des lettres de créances, de l’avancement ; enfin, d’un rustre elle a fait un homme.
Gregoria – Elle le protège, d’après ce qu’on dit, parce qu’il lui servait d’entremetteur et d’escamoteur d’embrouilles dans ses…
Venancio – Chut… Attention… il peut arriver… Je l’attends… On s’est mis d’accord, il m’apporte des nouvelles.
Gregoria – (En baissant la voix.) D’escamoteur dans ses histoires amoureuses… C’est que chaque fois que madame nous rend visite, Senén pointe son nez, il ne la laisse pas vivre et est toujours à mendier de manière impertinente : qui une recommandation, qui une lettre pour son chef, qui une lettre pour le ministre ou le diable en personne… Et comme madame la comtesse a beaucoup d’entregent et qu’elle mène tout le monde là-bas par le bout du nez…
Venancio – Senén est malin ; il passerait par le trou d’une aiguille. Eh bien, il m’a dit que doña Lucrecia est partie de Madrid le 12, et que d’ici elle ira visiter les Donesteve dans leur propriété de Verola. Il sait tout, le bougre. C’est lui qui a dit au maire que madame arrivait aujourd’hui, et… Ah ! Mais j’oubliais la meilleure ! On va bien lui faire une grande réception pour toutes les améliorations et les aides que Jerusa lui doit.
Gregoria – Des festivités ! Et nous, ici, on n’en savait rien !… Mais, la visite du comte, Senén était au courant ?
Venancio – Eh bien non ! On a dû le moucher… à force de fourrer son nez partout, dans tous les petits secrets de la maison où il a servi avant de s’installer dans les bureaux. Il a des contacts avec les marmitons et les cochers de la maison des Laín et là-bas, pas une mouche ne vole sans qu’il le sache.
Gregoria – (Toute joyeuse.) C’est bien ça, ce fouineur de la vie des autres va nous mettre au parfum.
Venancio – Mais, il en met du temps… Il m’a dit à dix heures. Il est allé télégraphier au chef de gare de Laín et au maire de Polan…
Gregoria – (En regardant dans le jardin.) Je crois bien que c’est lui… Quelqu’un marche dans le jardin, il t’appelle.
Venancio – C’est lui… (Il l’appelle.) Senén, Senén, eh là, mon garçon !…
Scène II
Gregoria, Venancio et Senén, vingt huit ans, plutôt plus que moins, habillé à la mode, d’une élégance affectée de plébéien qui a voulu remplacé rapidement et sans même le vouloir la grossièreté par les bonnes formes. De petite taille, les traits encore poupins, beaux de près mais dont l’ensemble donne un aspect extrêmement antipathique. Les cheveux frisés, des couches de rouge sur les joues, la moustache blonde, entortillée en boucle. Il lutte pour vivre sur le terrain de l’intrigue, flairant les bonnes occasions et utilisant la protection et la gratitude des gens à qui il a rendu quelques menus services et qu’il garde jalousement pour lui. Il ne se souvient plus du temps où il allait pieds nus et en haillons dans les rues mal empierrées de Jerusa. Né de la Coscoja, pauvre veuve qui oubliait ses malheurs en s’enivrant, Senén a vécu de la charité publique jusqu’à ce qu’il soit recueilli par les comtes de Laín, qui l’ont envoyé à l’école et l’ont pris ensuite à leur service. Il a été garçon de cuisine, employé aux écritures, valet de chambre jusqu’à ce que son habileté, ainsi qu’un vif désir d’argent, l’émancipent de la servitude. C’est dans différents travaux et trafic qu’il a dû tenter sa chance : voyageur de commerce, courtier en vins, administrateur de journaux, et, enfin, la comtesse lui a ouvert les portes de l’Administration publique avec un destin au Trésor, où les avancements, les commissions et autres aubaines se sont poursuivis. Il compense la pauvreté de son intelligence par sa constance et sa clairvoyance dans la flatterie, son intuition dans les bonnes affaires et son art d’être toujours à quémander des appuis. Son égoïsme prend des formes plus sournoises que brutales et pour mieux se cacher, son instinct plus que sa volonté, lui suggère l’économie et toute restriction compatible avec l’éclat et l’artifice de sa personne. Il garde son argent et s’empare de tout ce qui peut devenir sien sans danger. Pour ce qui n’est pas ostentation, c’est-à-dire, la nourriture, il ne mange que ce qu’il faut, conservant presque tout son pécule pour la coram vobis[8]. Son vice : les belles tenues, et sa passion : les bijoux. Il porte constamment trois bagues de pierre fine au petit doigt de la main gauche, et en arrivant à Jerusa il a mis en évidence une épingle à cravate qui est, allez, gênant pour ses compatriotes des deux sexes.
Senén – J’arrive. J’étais en train de regarder les poires… (Il vient sur la terrasse.) Bonjour, Gregoria ; vous êtes toujours aussi rayonnante.
Gregoria – Et toi, qu’il est beau… et qu’il sent bon ! Oh, le bandit, tu es devenu un vrai prince.
Senén – Il faut bien se peinturlurer un peu, Gregoria. Je suis esclave de ma position.
Venancio – (Impatient.) Allez vite, quoi de neuf ?
Senén – La comtesse va arriver à Laín par le train de douze heures cinq. J’ai eu un faire-part. (Il le montre.) Je l’ai porté au maire qui n’était pas sûr de l’heure d’arrivée.
Gregoria – Et don José va aller l’attendre avec sa voiture.
Venancio – Sûrement.
Senén – (S’assoyant nonchalamment. Il s’efforce d’employer à tout prix un langage raffiné.) Et la municipalité lui prépare une grande réception, une ovation enthousiaste.
Gregoria – A ta patronne !
Senén – A celle qui fut ma patronne. Il ferait bon qu’on ne lui rende pas les honneurs qui lui sont dus à cette illustre dame, grâce à qui Jerusa a obtenu la station télégraphique, la route de Jorbes, ainsi que les deux remises de dettes !
Gregoria – Il est bien possible qu’avec toutes ces festivités, on ait doña Lucrecia plus longtemps que d’habitude.
Senén – Je crois que non. Elle est invitée à passer quelques jours à Verola chez les Donesteve.
Venancio – Et qu’est-ce que tu sais à propos du comte ?
Senén – Que son Excellence a dû arriver à Laín hier soir ou ce matin par le premier train. De sorte que je ne m’explique pas… je veux dire que je ne m’explique pas, mon cher Venancio, qu’il ne soit pas encore chez toi.
Gregoria – Pour sûr, il a dû aller à Polan visiter la tombe de son épouse la comtesse Adelaida.
Venancio – Bon, Senén. Toi qui sais tout… naturellement, tu as vécu dans l’intimité de la famille, tu connais leurs coutumes, la manière de penser des uns et des autres, leurs désaccords et leurs disputes, dis-nous… don Rodrigo et sa bru, vont-ils se retrouver ici par hasard ou bien… ?
Senén – (Sûr de lui, se donnant beaucoup d’importance.) Non ; ils se sont donné rendez-vous à Jerusa.
Gregoria – Comment ça ? Et pourquoi donc ceux qui se détestent se donnent-ils rendez-vous ? Qu’est-ce qu’ils font ?
Senén – Le contraire de ce que font ceux qui s’aiment. Les amants se caressent ; eux se mordent.
Venancio – Bon, c’est comme un défi au fond… Ils se disent : «A tel endroit, à telle heure, nous nous retrouvons pour nous entredéchirer.»
Gregoria – C’est sans doute que monsieur le comte qui n’a pas vu sa bru depuis qu’il a embarqué pour le Pérou, veut régler quelque compte avec elle…
Venancio – Histoire d’intérêt ou d’affaires qui touchent l’honneur de sa famille, car ce n’est un secret pour personne… Ne te fâche pas, mon petit Senén, mais ta protectrice, madame la comtesse… Enfin : ce n’est pas bien que je le répète.
Senén – C’est cela, répéter est une vilaine chose. Qu’est-ce que ça peut vous faire à vous et qu’est-ce que ça peut me faire à moi, que monsieur le comte d’Albrit et sa bru, la comtesse, veuve de Laín, se disputent, s’égratignent, se tirent les cheveux pour un petit bout d’honneur par ci ou pour un grand… ? Mettons qu’il s’agisse d’une affaire d’honneur grande comme la maison.
Venancio – Senén a raison. Qu’il y ait vertu ou non, cela ne nous fait ni chaud ni froid.
Senén – Je ne sais qu’une chose, moi, c’est que le vieil Albrit, qui jusque-là, depuis la mort de son fils, n’a pas bougé de Valencia, a écrit à la comtesse…
Venancio – (En riant.) Pour lui demander de l’argent.
Senén – Allons, allons, non. Il lui propose une entrevue pour traiter d’affaires graves …
Gregoria – Des affaires de famille. Et comme la comtesse ne veut pas de démêlés à Madrid, parce que là, s’il y a un scandale, tout le monde finit par le savoir, cela peut même paraître dans les journaux, elle lui a donc donné rendez-vous dans ce coin perdu de Jerusa où ne vivent que quelques nigauds, parce qu’ici, on lave son linge sale en famille. Hein ? Monsieur le courtisan, je connais mes gens, n’est-ce pas ?
Venancio – Dis que ma femme n’est pas intelligente.
Senén – (Tout sourire et galant homme.) Elle connaît la musique ! Quel talent ! Et pour parvenir à avoir toute mon estime, elle va m’apporter un petit verre de bière, je suis assoiffé.
Gregoria – J’y vais tout de suite, tu aurais dû me le dire avant. (Elle va dans la maison tout en emportant les légumes.)
Venancio – Et toi, roi des fourmis, qu’attends-tu de ta patronne ? Un autre avancement, une meilleure place ?
Senén – Je veux de l’avancement, sortir de cette misère du registre du personnel et de ce triste travail que nous donne le Gouvernement pour nous ennuyer et ennuyer le pays qui paie.
Venancio – Tu vises haut. Quoi qu’on dise, tu as beaucoup de mérites. Je t’ai vu sortir de rien.
Senén – Et tu vas me voir monter, monter… Rien, c’est déjà ça, c’est un tremplin qui permet d’aller plus haut.
Gregoria – (Elle revient avec la bière et des verres, puis elle les sert.) Dis-moi, mon petit Senén, et pour tes progrès, tu ne t’accroches pas aux pans de monsieur le comte ?
Senén – Albrit n’a pas un sou et personne ne fait cas de lui, maintenant.
Venancio – Ce chêne ne donne plus d’ombre, il ne sert plus qu’à faire du feu.
Gregoria – (Elle s’assoie entre les deux buveurs de bière et passe la main dans le dos de Senén.) Voyons voir, mon garçon, pourquoi est-ce que tu ne nous dis pas le pourquoi et le comment des mésententes entre la comtesse et le grand-père ? Toi qui sais tout.
Venancio – Bien sûr qu’il le sait ! Mais le roquet ne mord pas la main qui lui donne à manger. (Senén savoure sa bière, se donnant des airs de Madrilène mais ne dit rien.)
Gregoria – Tu vois bien : muet comme une carpe. Autre chose, dis-nous : est-ce vrai tout ce qu’on raconte sur ta dame ?… Ce n’est pas vrai, n’est-ce pas ?
Senén – (Emphatique.) Mes chers amis, me permettrez-vous de ne pas dire du mal de ma bienfaitrice ? Je vous dirai seulement que c’est un cœur tendre, une volonté généreuse et franche jusqu’à l’extrême. Ne lui demandez pas d’être prude, ça non. C’est une femme très désinvolte… Elle a pitié des malheureux et elle console les affligés. Et il n’y a pas plus instruit qu’elle : elle parle quatre langues et dans toutes ces langues elle sait dire des choses qui enchantent et qui rendent amoureux.
Venancio – Toutes ces langues et d’autres… ne suffisent pas à raconter toutes les horreurs qu’on dit d’elle et qui sont en espagnol tout simplement.
Senén – (Imitant les sagesses qu’il a apprises dans les cafés.) Des horreurs !… N’y prêtez pas attention. L’honneur et le déshonneur, madame, monsieur, sont des choses élastiques que chaque pays et chaque civilisation… chaque civilisation, dis-je, mesure de manière différente. Vous voudriez que la morale soit la même dans ces villages patriarcaux, disons même primitifs, comme Jerusa, et les «grands centres»… Avez-vous vécu dans ces «grands centres» ?
Venancio – Pas besoin.
Senén – Eh bien, dans les «grands centres» vous verriez un autre monde, d’autres idées, une autre morale. La comtesse Lucrecia n’est pas une femme, c’est une dame, une grande dame. Quoi ? Elle aime s’amuser ? Sûrement que oui. Elle s’amuse la nuit, le matin et le soir… Non, ne venez pas me ramener la morale chrétienne. Moi, je vous le dis et je le prouve : c’est une chose essentielle dans les sociétés que les dames s’amusent parce que, du divertissement de ces dames et de ces messieurs, vient le luxe et le luxe est une bonne chose… (Il rit de l’étonnement de ses interlocuteurs.) Mais oui… nigauds, vous croyez que le luxe est un mal… Vous vivez dans la lune. Je vous le dis et je le prouve : le luxe soutient l’industrie… c’est grâce à l’industrie de ces «grands centres» que tout le monde peut manger, je le prouve. Réassumons : s’il y avait de la moralité, comme vous le voulez, les gens ne s’amuseraient plus et sans divertissement il n’y aurait plus de luxe et, par conséquent, il n’y aurait plus d’industries ; cinquante pour cent des gens qui mangent à leur faim mourraient et les cinquante autres n’auraient plus qu’à manger des trognons de chou.
Venancio – Quel baratineur, tu t’y connais en affaires !
Gregoria – (Imitant, sans le savoir, les sorcières de Macbeth.[9]) Senén, tu vas être ministre !
Senén – Ministre, moi ? Non, non. Mon ambition, sortie de rien, ne veut pas que du vent mais des riens, ces petits riens substantiels qu’on peut pétrir. Mes intuitions sont au positif ; je tends à gagner de l’argent, beaucoup d’argent. Je ne me satisfais pas d’une solde plus ou moins grande ; j’ambitionne davantage, j’ambitionne le travail libre…
Venancio – Les mains libres, veux-tu dire… (Il donne un cigare à Senén et ils se mettent tous les deux à fumer.) Ce que tu cherches, mon voyou, c’est une dote, tu es à la recherche d’une riche héritière.
Gregoria – C’est pour cela que tu es toujours si élégamment vêtu et que tu préfères t’enlever le pain de la bouche pour pouvoir t’habiller… C’est pour cela que tu portes des bagues et que tu as des mouchoirs parfumés. C’est vrai que tu sens bon ! (Elle le sent.) C’est quoi ? Un héliotrope ?
Senén – (Crevant d’orgueil.) C’est mon parfum préféré… Eh bien, je n’ai pas pensé à me marier et je le prouve. Bien entendu, s’il se présentait à moi une bonne aubaine matrimoniale, je ne la mépriserais pas. L’occasion fait le larron.
Gregoria – D’une façon ou d’une autre, tu seras riche.
Venancio – Au travail, a-t-on dit. A la Cour, il y a mille manières de se procurer l’assiette de pois chiches.
Gregoria – Là, c’est l’esbroufe, la débauche et les riches dépensent pour se loger plus d’argent qu’ils n’en ont, à ce qu’on raconte, et le pauvre qui amasse, qui est économe et débrouillard comme toi, sait trouver sa pitance. Tu as le cas de monsieur le comte. Toute sa richesse a été répartie entre de nombreux hommes qui n’en fichaient peut-être pas une ramée.
Venancio – Prêteurs, avocaillons, corbeaux, vautours et tous ces charognards désireux de chair morte.
Senén – (Dédaigneux.) Notre haut personnage a eu une fin bien triste. Allez, Gregoria, préparez une bonne marmitée de pommes de terre, des petites soupes au lait, il faut bien qu’il s’habitue à la frugalité et qu’il oublie ses habitudes gastronomiques.
Gregoria – Non, non ; en tous cas, aujourd’hui, s’il vient, je dois lui préparer un bon repas.
Venancio – S’il est retenu à Polan et s’il n’a pas pris la voiture qui est partie vers dix heures, il ne viendra que demain.
Senén – J’incline à penser que nous allons le voir arriver par la route, parce le brave monsieur est tellement sur la paille qu’il n’a pas eu de quoi prendre la voiture.
Gregoria – N’exagère pas… Ces nobles ruinés gardent toujours un petit pécule pour leurs derniers jours et je te le dis ils trouvent toujours un imbécile pour entretenir leurs vices.
Senén – Albrit n’a pas d’autres vices que la rage de se voir pauvre et son orgueil d’aristocrate qui s’est renforcé dans sa pauvreté.
Gregoria – (Inquiète.) Dis-moi, Senén, est-ce que monsieur le comte peut avoir l’idée de nous enlever les petites ?
Senén – Pour quoi faire ?… Et où les mettrait-il ?
Venancio – Dans un collège, en France.
Senén – N’ayez crainte, vous n’allez pas perdre cette affaire. Le comte n’a pas de quoi payer un bon collège et la maman n’est pas favorable à de telles dépenses qui grèveraient son budget. Rien n’est assez pour elle. En plus, la présence des filles dans la société, près d’elle, la vieillirait. Elle a une obsession : rester jeune ou le croire.
Venancio – Son… Comment as-tu dit ? Tu en as de ces mots délicats !
Gregoria – (Elle se fâche.) Mais elles sont grandes maintenant, gros malin !… Un jour ou l’autre, il faudra bien les montrer à la Cour et les marier…
Senén – Les marier ? Un peu difficile… et je le prouve.
Gregoria – Pourquoi pas, elles sont très jolies ?
Senén – Je vous concède leur joli minois. Mais n’importe qui ne va pas les prendre à sa charge. Elles ont été éduquées dans la niaiserie, selon des habitudes campagnardes, et par-dessus le marché, elles sont pauvres… parce que la comtesse a une fortune hypothétique et quand on voudra liquider ses biens elle n’a rien d’autre que des bons sans provision, des comptes non soldés et le déluge… Louis XV l’a déjà dit. (Escamotant le français.) : Après moua, le diluge.[10]
Gregoria – (Elle se fâche encore plus.) La mère peut être ce qu’on voudra : une rebelle, une canaille étrangère ; mais Dorotea et Leonor ne lui ressemblent pas, je dis qu’elles ne lui ressemblent pas et je le prouve moi aussi.
Venancio – Elles sont charmantes, bien qu’un peu espiègles : ce sont des âmes pures, des anges de Dieu, comme dit don Carmelo.
Gregoria – Tu peux le croire, Senén ; je les aime comme si c’étaient mes filles et le jour où on me les enlèvera, ça me coûtera bien quelques larmes.
Senén – (Un peu impertinent.) Et l’instruction ? Qu’est-ce que vous en faites ?
Venancio – Don Pío leur apprend quelques petites choses, c’est le maître d’école du village, il est en retraite. En plus de ne pas savoir grand-chose, il a peu de caractère et les filles en ont fait leur mascotte pour s’amuser.
Gregoria – Elles passent toute la journée à faire des bêtises. Ça se voit bien : elles ne sont pas de son milieu, comme dit Angulo, notre médecin.
Venancio – (Répétant une phrase du docteur.) La Nature est leur maîtresse ; la liberté, leur élégance ; le bois, leur salon. Elles dansent au rythme de la mer avec le vent comme orchestre.
Senén – (Il se lève, se souvenant, inquiet de quelque chose qu’il avait oublié.) Nous voilà bien !
Venancio – Qu’est-ce qui t’arrive ?
Senén – C’est que à force de discuter, j’ai oublié la commission de monsieur le maire.
Gregoria – Pour nous ?
Senén – Oui… Où ai-je la tête ? Il faut que vous lui emmeniez les petites immédiatement, la comtesse veut les voir en arrivant.
Venancio – C’est bien normal. Et elles mangeront là-bas.
Senén – Elles sont ici ?
Gregoria – Elles se promènent dans le bois. (Tout en regardant sur la gauche.) Je ne les vois pas.
Venancio – A force de courir et de jouer, elles ont dû s’éloigner d’une bonne lieue de Jerusa.
Senén – Et vous les laissez sortir seules dans le bois ?
Gregoria – Elles vont absolument toutes seules. Tout le monde les respecte.
Venancio – Il faut aller à leur recherche et vite.
Senén – Si vous voulez, je vais y aller, moi… Elles ne savent pas que leur maman arrive aujourd’hui ?
Gregoria – Elles ne le savent pas… Les pauvres filles !
Senén – Eh bien, je vais le leur dire et je les conduirai devant moi comme le marchand d’oie à Noël.
Venancio – Tu vas les trouver sûrement, en haut du bois, sur le sentier qui mène à Polan… Mais, écoute bien, mon vieux, ne leur fais pas la cour. Ce serait vraiment inutile…
Senén – (Il a envie de partir vite.) La cour ? Moi ?… Moi qui vis comme un curé ? Vous voulez rire ? Des demoiselles qui ne vivent pas dans leur milieu et qui rassemblent tout ce qu’il y a de mauvais : l’orgueil et la pauvreté !…
Gregoria – Elles sont encore jeunes.
Senén – Si quelqu’un en veut qu’il les fasse mûrir. Vous dites dans le bois ?…
Venancio – Vas-y et ramène-les-nous vite.
Gregoria – C’est cela !… (En le voyant partir.) Drôle de loustic !
Venancio – Un sacré débrouillard !
Scène III
Le bois, à proximité de Jerusa, est formé de chênes cossus, de hêtres et de chênes verts. Un sentier tortueux le traverse. On y voit les deux ornières formées par les chariots de la région. Au nord, une formidable falaise de roche agglomérée dont la base est battue par les vagues de la mer ; au sud, le paysage se referme sur l’épaisse végétation ; vers l’ouest, le sentier serpente et se divise pour traverser quelques clairières et d’épais maquis.
Leonor et Dorotea, des filles de, respectivement, quinze et quatorze ans, sont jolies, gracieuses, de type aristocratique, le teint bronzé par l’air marin et le soleil. Elles ont des yeux noirs, mélancoliques, en amande. Elles ont la chevelure noire aussi, relevée dans un haut chignon. Elles y ont fiché des fleurs sauvages qu’elles ont plantées comme des aiguilles dans un coussin à épingles. La différence d’âge, un an et demi, se voit à peine, et beaucoup les prennent pour des jumelles tant leurs visages se ressemblent et leur taille est identique. Elles sont agiles et espiègles, elles courent comme deux petits diables enchanteurs. Elles sont habillées avec une élégance et une simplicité toute naturelle, des vêtements clairs, coupés et cousus à Jerusa. La modestie met en valeur leur gentillesse pleine de vivacité et leur donne cette douce gravité quand elles sont au repos. Toutes petites déjà, leur mère, irlandaise, les appelait par leurs petits noms anglais Nell et Dolly, et ces noms exotiques ont prévalu à Madrid comme à Jerusa. Un petit chien les accompagne, joue et saute avec elles. C’est un chien couleur cannelle, à long poil fin, un museau très malin, une queue qui s’agite comme un éventail. Il répond au nom de Capitán.
Dolly – Je suis fatiguée ; je m’assois. (Elle se repose sur le tronc d’un chêne.)
Nell – Je suis engourdie ; je veux courir. (Elle part dans une course en cercle et revient au point de départ.)
Dolly – (Regardant la cime de l’arbre.) Qu’est-ce que j’aimerais bien pouvoir monter et me poser sur une branche !… Nell !
Nell – Que veux-tu ?
Dolly – Te dire une chose. Qu’est-ce que tu paries que je monte à cet arbre ?
Nell – Tu vas déchirer ta robe…
Dolly – Je la recoudrai… Je sais coudre aussi bien que toi… Je monte ?
Nell – Ce n’est pas bien. On va nous prendre pour des filles du peuple.
Dolly – (Suspendue à une branche, elle se balance.) Eh bien, être une fille du peuple ou faire comme si, tu crois que ça a de l’importance ? Dis-moi, Nell, tu marcherais pieds nus ?
Nell – Moi, non.
Dolly – Moi, si. Et je me moquerais bien des cordonniers. (Voyant que Nell s’assoie et sort un petit livre.) Qu’est-ce que tu fais ?
Nell – Je veux repasser ma leçon d’Histoire. On a suffisamment couru ; on va étudier un petit peu. Rappelle-toi, Dolly : hier, don Pío t’a dit que tu ne savais rien en Histoire ancienne, ni moderne d’ailleurs. Et il a eu raison de te traiter d’âne.
Dolly – Âne lui-même… Je sais une chose mieux que lui : je sais que je ne sais rien[11], et don Pío ne sait pas qu’il ne sait pas grand-chose.
Nell – C’est vrai… Mais nous devons étudier un peu, rien que pour voir la tête de notre petit maître quand on lui répondra correctement. C’est un brave homme.
Dolly – Il fait une meilleure tête quand on lui donne les friandises réservées à Capitán.
Nell – Allez, viens ; on va étudier un peu. Tu sais que l’histoire des rois goths est une terrible affaire ?
Dolly – Au diable les Goths. Ils sont cent et plus… avec des noms piquants comme des ronces quand on veut les mémoriser.
Nell – Il n’y en a aucun de plus antipathique et de plus bête que ce monsieur Mauregato[12].
Dolly – Quelle brute !
Nell – Tu parles… il fallait lui envoyer cent donzelles par an pour l’apaiser.
Dolly – Pour décrasser comme dit don Carmelo.
Nell – La vérité c’est que l’Histoire nous rapporte mille trucs et embrouilles dont on se moque pas mal.
Dolly – (Elle s’assoie près de sa sœur. Le chien vient se mettre entre les deux.) Figure-toi qu’il va falloir qu’on voie l’histoire d’un certain monsieur qui s’appelle Jules César, un vrai génie… Un autre monsieur l’aurait tué mais ça ne nous fait ni chaud ni froid. Son petit nom était Brutus… Qu’est-ce que vous me racontez là, à moi, madame Histoire ?
Nell – Mais, ma petite, la culture… ça ne te plairait pas d’être cultivée ?
Dolly – (Tout en caressant le petit chien.) Tu es cultivé, toi, Capitán ? A vrai dire, la culture, ça me fatigue depuis que j’ai vu que Senén est devenu quelqu’un de cultivé. Tu te souviens lorsqu’il est venu il y a deux mois ? Il croyait que maman allait venir.
Nell – Oui, à chaque instant il nous sortait le Moyen-âge et je ne sais quoi.
Dolly – Qu’est-ce que ça peut nous faire à nous que les âges soient moyens ou divisés !… Et un beau jour on va nous dire que Cléopâtre avait mal aux dents.
Nell – Ou bien que doña Urraca[13] a eu des engelures.
Dolly – Mais, enfin, nous nous cultivons un peu puisque maman, dans toutes ces lettres, nous recommande d’apprendre et d’être appliquées.
Nell – Maman nous adore mais elle ne nous prend pas auprès d’elle. (Avec tristesse.) Pourquoi cela ?
Dolly – Parce que… parce que… Elle nous l’a bien dit. Comme nous étions un peu rachitiques elle a voulu que nous grossissions un peu à l’air de la campagne. Maman sait bien ce qu’elle fait.
Nell – Maman est très bonne. Mais qu’elle vienne à la campagne avec nous prendre des forces, elle aussi.
Dolly – Que tu es bête ! Tu ne l’as jamais entendu dire qu’elle avait horreur de grossir et que ce qu’elle veut maintenant c’est maigrir ?
Nell – Enveloppée ou maigre, maman est très belle.
Dolly – C’est vrai… Elle nous prendra avec elle quand nous serons majeures. Moi, je ne suis pas pressée.
Nell – (En faisant des traits par terre avec un doigt.) Pressée, pressée, moi non plus je ne le suis pas.
Dolly – J’adore être à la campagne.
Nell – Et la solitude, qu’est-ce que cela me plaît bien !
Dolly – Dans la solitude je réfléchis mieux qu’au milieu des gens.
Nelle – Et toute cette liberté !…
Dolly – (Mettant le petit chien sur deux pattes.) Je vais te dire une chose : je crois que plus on est sauvage, mieux c’est.
Nell – Ah ! Ça non. La civilisation, Dolly…
Dolly – J’en ai marre de la civilisation depuis que j’ai entendu notre ami le maire, devenu riche personnage à fabriquer du vermicelle.
Nell – (En mordant dans la tige d’une petite fleur.) Moi, je ne veux pas être sauvage… ni civilisée comme don José Monedero. Je te fais savoir que dans le monde civilisé, il y a aussi la solitude que j’aime tant. Tu n’as jamais pensé à être religieuse ?
Dolly – Ah ! Non. Je n’ai jamais pensé à ça.
Nell – Moi, si. Surtout quand on nous emmène à la messe des Dominicaines. Quelle jolie église et si calme ! J’imagine que derrière ces grilles il doit y avoir une paix, une tranquillité…
Dolly – (En ramassant des petits cailloux.) La religion est une bonne chose… c’est vraiment ce qu’il y a de mieux. La prière est une consolation… Mais ne faire que prier, toujours et toujours, franchement… Et alors, être enfermée derrière des grilles, comme les religieuses, sans voir ni les arbres ni les fleurs…
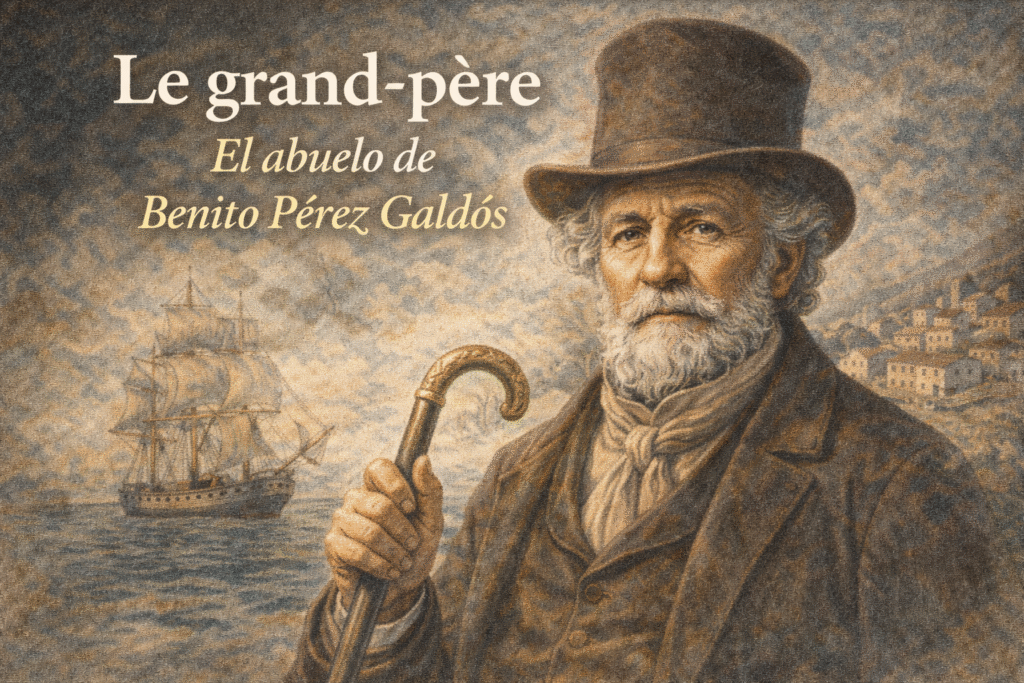
Nell – Tu es bête, mais il y a des jardins potagers et des parcs…
Dolly – Mais on ne voit pas la mer.
Nell – Bah ! On voit Dieu, c’est encore plus grand.
Dolly – Si Dieu est partout ! Tu crois qu’il est là aussi et qu’il entend tout ce qu’on dit ?
Nell – Mais nous ne le voyons pas et nous ne l’entendons pas.
Dolly – Il faut bien regarder, Nell et faire silence pour écouter. (Pause. Les deux gamines, silencieuses et un peu surprises, explorent lentement du regard l’horizon, la mer et le ciel, l’épais feuillage du bosquet.)
Nell – Tu n’entends pas ?
Dolly – Si, comme un souffle très fort. Tu vois quelque chose ?
Nell – Comme un regard très large. (Autre longue pause très longue. Brusquement, comme quelqu’un qui sort d’un rêve, elle se met debout.) Mais, le temps passe à bavarder et nous n’avons rien étudié, pas un mot.
Dolly – Le jour est si beau !
Nell – On est sorti avec le désir de lire. C’est toi qui as dit qu’on étudierait dans la nature mieux qu’à la maison.
Dolly – Parce que là-bas les beuglements de Venancio nous dérangeaient.
Nell- (Répétant une phrase de leur maître.) Allez, du courage, à vos livres ! (En donnant le livre d’Histoire à sa sœur.) Ecoute, lis à haute voix et comme ça nous nous instruirons ensemble.
Dolly – (Elle prend le livre et se lève d’un bond.) Donne-moi ça. Tu sais à quoi je pense ? C’est que les oiseaux aussi doivent s’instruire… Il ne faut pas garder toute cette science rien que pour nous. (Elle lance son livre en l’air vivement.)
Nell – Qu’est-ce que tu fais, tu es folle ? (Le livre ouvert dans les airs a les pages qui tournent au vent, il décrit une courbe et finit sur une branche de chêne vert, comme un oiseau qui se pose.)
Dolly – Tu vois bien. (Le chien passe son temps à une occupation innocente : chasser les mouches.)
Nell – C’est malin ! Et comment est-ce qu’on le récupère maintenant ?
Dolly – D’aucune façon. Les oiseaux vont ainsi être au courant de tout ce qu’ont fait don Alexandre Le Grand, monsieur Attila et le maure Moussa[14].
Nell – (En riant.) Mais les oiseaux se fichent pas mal de tout ça !
Dolly – Comme moi.
Nell – Nous voilà bien ! Si au moins un garçon passait par là, il pourrait monter le récupérer !
Dolly – Je vais monter, moi. (Elle s’apprête à grimper dans le chêne vert.)
Nell – (La tirant par la jupe.) Non, non, ne va pas te casser le cou.
Dolly – Attends un peu. Je vais lancer des pierres et on va bien voir si cet abruti retombe. (Elle fait ce qu’elle vient de dire.)
Nell – Il y a du vent… Il va peut-être faire voler le livre.
Dolly – Hélas ! Non. Il est lourd, tu sais ! (Lançant des pierres.) Allez, bandit, descends, par ici. (Le chien se croit obligé d’aboyer bruyamment sur le livre pour le faire descendre.)
Nell – (En entendant des pas.) ça suffit, Dolly ! Quelqu’un vient… Quelle honte ! On va te prendre pour une va-nu-pieds du village.
Dolly – Et alors ?
Nell – Arrête. (En regardant loin vers le sentier.) Il y a un monsieur qui vient, un homme… sur le chemin qui descend de Polan, tu le vois ?… Regarde. (Le comte d’Albrit apparaît au milieu des chênes, il marche d’un pas lent.)
Dolly – Je ne le vois pas.
Nell – Regarde… Il s’est arrêté en nous voyant, il est là, comme une statue. Il ne nous quitte pas des yeux…
[1] Toutes les notes sont du traducteur (sauf avis contraire).
[2] L’édition suivie est celle de Alianza Editorial, Madrid, 1986.
[3] Roman publié par Perez Galdós en 1890.
[4] David Garrick est un auteur et dramaturge britannique (1717-1779).
[5] Nous avons suivi la règle qui veut que le titre s’écrive avec une minuscule sauf lorsqu’on s’adresse directement aux personnes.
[6] Il ne s’agit pas à proprement parler d’une marquise mais d’un clin d’œil de l’auteur, car c’est la femme d’un certain Márquez qu’on surnomme la Marquise, Journée 3, scène IX.
[7] Note de l’auteur : capitale de la province.
[8] Coram vobis : la Cour en présence du roi. Ici, la galerie.
[9] William Shakespeare, Macbeth, Acte I, scène 3.
[10] Galdós est bien renseigné… Cette expression est attribuée à Louis XV ou à Mme de Pompadour, pour évoquer un certain fatalisme.
[11] Maxime attribuée au philosophe Socrate.
[12] Roi d’Asturies de 783 à 789. On lui attribue ce qu’on a appelé «le Tribut des cent demoiselles». D’après la légende, il aurait signé un pacte avec l’émir de Cordoue, Abderraman I, en échange d’un tribut annuel de cent demoiselles chrétiennes.
[13] Reine de Léon et de Castille de 1109 à 1126. Elle était la fille d’Alphonse VI.
[14] Moussa, gouverneur d’Afrique, lorsque les Maures entrèrent en Espagne en 711. Cf. le romancero : Don Manuel et le maure Moussa.




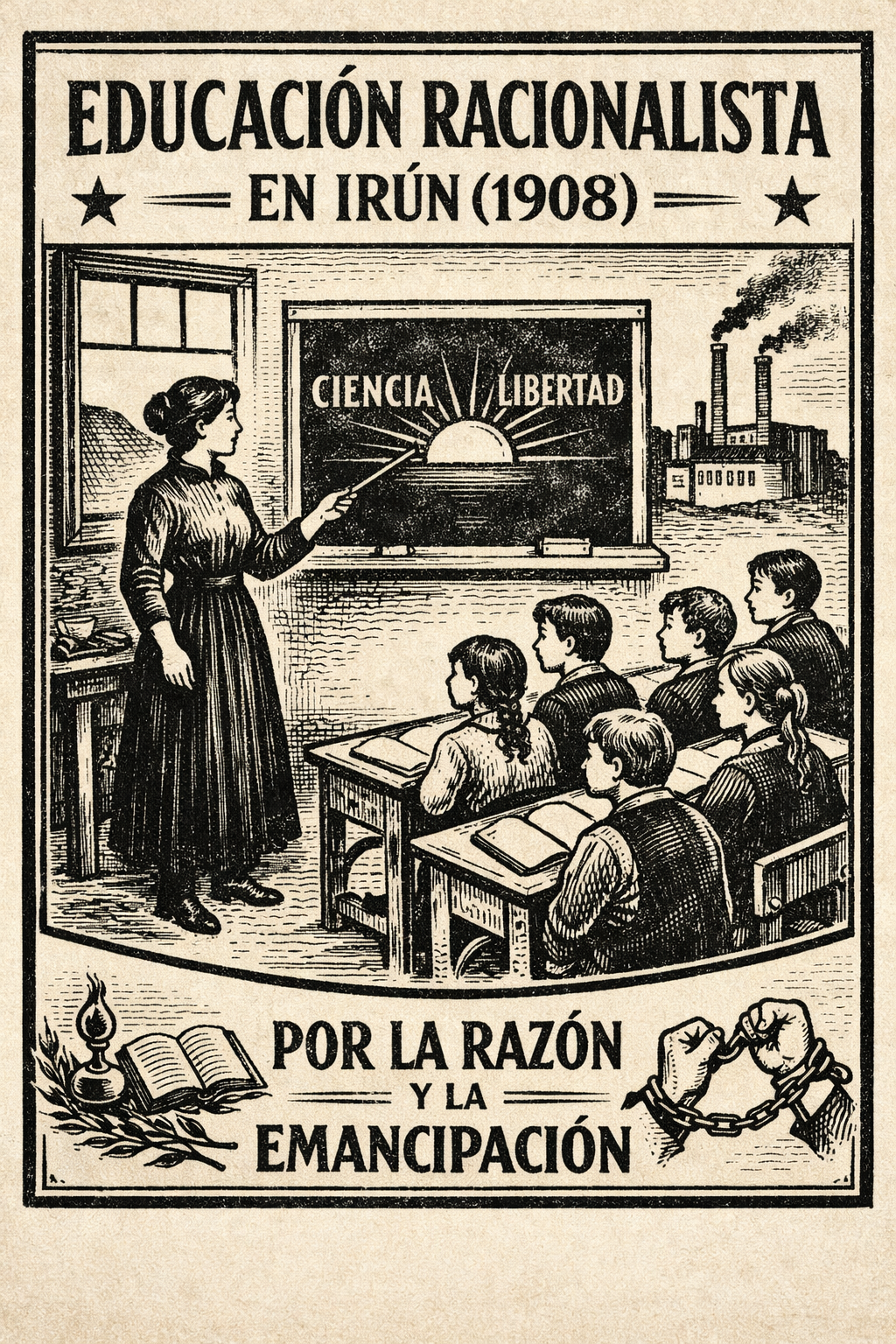











phfun27 bringing the good vibes! Lots of games to choose from. I’m here for the fun so lets go and enjoy phfun27
Superphgame has a lot going on! So many games it’s almost overwhelming. Gotta dig in and find my favorites. You should check this one superphgame
Alright mate, just gave Win55online a go. Site’s pretty smooth, found a few games that kept me hooked for a couple hours. Worth checking out if you’re looking for something new. Give it a whirl at win55online.
I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.