No hay productos en el carrito.

Troisième partie, Daniel Gautier
1
Il pressa le pas, une fois passée la Porte, impatient de s’éloigner le plus vite possible de la ville populeuse et d’aller jusqu’à ne plus apercevoir ses maisons serrées, ni entendre le tumulte de son inquiétant voisinage qui, à cette heure précoce, commençait à bouillonner, comme un essaim d’abeilles au sortir de la ruche. La matinée était belle. L’imagination du fugitif multipliait les enchantements du ciel et de la terre et y voyait, comme dans un miroir, l’image de son bonheur, par la liberté dont il jouissait enfin, sans autre maître que son Dieu. Ce n’est pas sans effort qu’il avait mené cette révolution, car c’était bien une révolution et il ne l’aurait jamais réalisée, lui, si soumis et obéissant, s’il n’avait pas entendu dans sa conscience la voix de son Maître et Seigneur qui le lui ordonnait sur un ton impérieux. Il n’avait aucun doute. Mais sa révolution, tout en admettant ce vilain mot, était purement formelle. Elle ne consistait qu’à s’éloigner de la réprimande du supérieur et éviter les chamailleries et les brimades d’une justice qui n’a strictement rien de juste… Qu’avait-il à voir, lui, avec un juge qui faisait attention à la déposition de canailles sans conscience ? Dieu, qui voyait l’intérieur, constatait qu’il n’avait fui ni l’intendant de la cathédrale, ni le juge par peur, car son âme courageuse n’avait jamais connu la couardise et les souffrances ou la douleur, quelles qu’elles soient et elles n’avaient jamais fait changer sa volonté droite. Il était homme à savourer par avance le mystérieux plaisir d’être victime d’une injustice et de la méchanceté des hommes.
Il ne fuyait pas les sanctions, mais il allait à leur recherche. Il ne fuyait pas l’inconfort ni la pauvreté, il marchait en quête de misère et des difficultés les plus rudes. Il fuyait, oui, un monde et une vie qui ne correspondaient pas à son esprit ivre, si on peut parler ainsi, de l’illusion de la vie de pénitence et d’ascèse. Et pour se confirmer l’insignifiance et presque l’innocence de sa rébellion, il pensait que dans l’ordre dogmatique de ses idées il ne différait pas d’un cheveu de l’éternel doctrine ni des enseignements de l’Eglise qu’il avait bien étudiés et qu’il connaissait sur le bout des doigts. Il n’était donc pas hérétique et on ne pouvait pas lui reprocher la moindre petite trace schismatique, même si pour lui, les accusations n’avaient pas été tendres, et tout le Saint Office du monde, il le portait dans sa propre conscience. Libre de tout cela, sans hésitation aucune, il entrait d’un pas décidé dans le désert, car c’était l’impression qu’il avait en voyant ces champs solitaires.
En passant le pont, quelques mendiants qui exerçaient leur adresse très librement, le regardèrent surpris et soupçonneux comme s’ils disaient : «Quel est cet oiseau qui vient sur nos terres sans notre permission ? On va bien voir…» Nazarín les salua d’un mouvement sympathique de la tête, et sans entamer de conversation, poursuivit son chemin, désireux de s’éloigner avant que le soleil ne commence à cogner. Tout en marchant, il ne cessait d’analyser dans son esprit la nouvelle vie qu’il commençait et son raisonnement dialectique la considérait par tous les côtés, la jugeant sous toutes ses faces et perspectives imaginables, soit favorables, soit défavorables pour parvenir, comme dans un jugement contradictoire, à la vérité la plus parfaite. Il finissait par s’absoudre de toute faute d’insubordination et ne conservait sur pied qu’un seul argument auquel son imagination accusatrice ne trouvait pas de réponse satisfaisante. «Pourquoi ne demandez-vous pas à entrer dans le Tiers Ordre ?» Et connaissant la force de cette observation, il se disait : «Dieu sait que si je trouvais sur mon chemin une maison du Tiers Ordre, je demanderais à ce qu’on m’y admette, et j’y entrerais avec joie, même en m’imposant le noviciat le plus pénible. Car la liberté à laquelle j’aspire, je la trouverais aussi bien en marchant seul par les collines et les ravins que soumis à la sévère discipline d’un saint institut. Restons-en à ce que je choisisse cette vie parce c’est la plus appropriée pour moi et celle que le Seigneur signale à ma conscience, avec l’impérieuse clarté que je ne peux ignorer.»
Il se sentit un peu fatigué, à moitié chemin vers le Bas Carabanchel et s’assit pour manger un quignon de pain, de ce bon pain épais que la Peluda lui avait mis dans sa besace. Un chien maigre, mélancolique et peu arrogant s’approcha et participa au festin, et pour obtenir quelques miettes devint son ami et lui tint compagnie pendant tout le temps du frugal repas. Une fois à nouveau debout, suivi du chien, avant d’arriver au village, il eut soif et demanda de l’eau à la première guinguette. Pendant qu’il buvait, trois hommes sortirent de la maison, l’air jovial, ils l’observèrent de façon indiscrète. Sans doute y avait-il dans sa personne quelque chose qui trahissait le prétendu mendiant ou le mendiant improvisé et cela lui causa quelque inquiétude. Il venait juste de dire «Dieu vous le rendra» à la femme qui lui avait donné de l’eau, quand un des trois hommes s’approcha et lui dit :
– Monsieur Nazarín, je vous ai reconnu au timbre de la voix. Vous parlez d’un déguisement. Peut-on savoir… sauf votre respect, où vous allez, habillé en pauvre ?
– Mon ami, je vais en quête de ce qui me manque.
– Bon vent… Mais, vous ne me reconnaissez pas ? Je suis celui qui…
– Oui, celui qui… Mais, je ne vois pas…
– Celui qui vous a parlé il y a quelques jours un peu plus bas… et vous a offert… sauf votre respect, un chapeau de curé.
– Ah ! Oui, chapeau que j’ai refusé.
– Eh bien, nous sommes là à votre service. Voulez-vous voir Ándara, votre révérence ?
– Non, monsieur… Dis-lui de ma part d’être bonne ou de faire tout son possible pour l’être.
– Ecoutez… Vous voyez ces trois femmes qui sont là-bas de l’autre côté de la route, proprement dite, en train de ramasser des chardons et des pourpiers ? Eh bien, celle qui a une jupe rouge, c’est Ándara.
– Mes respects. Bon. Va en paix… Ah ! Un moment, aurais-tu la bonté de m’indiquer un raccourci qui me ferait passer de ce chemin à l’autre là-bas qui part du pont de Ségovie et qui va à Trujillo ?…
– Eh bien, par ici, en suivant ce petit muret, vous continuez tout droit… Vous suivez le long du camp de base et toujours tout droit… le sentier y va, pas d’erreur possible… jusqu’aux maisons de Brugadas, justement. Là vous traversez la route d’Extremadura.
– Merci beaucoup, adieu.
Il se mit à marcher suivi du chien, qui apparemment restait avec lui pour toute la journée. Il n’avait pas fait cent mètres qu’il entendit derrière lui une voix de femme qui l’appelait de manière insistante.
– Monsieur Nazarín, don Nazario !…
Il s’arrêta et vit que courait rapidement vers lui une jupe rouge sur un corps grêle d’où sortaient des bras qui s’agitaient comme des ailes de moulin.
«Je parie que cette fille qui court, c’est la fameuse Ándara», se dit-il, en s’arrêtant.
En effet, c’était elle, et le marcheur aurait eu du mal à la reconnaître s’il n’avait pas su qu’elle était dans les parages. Sur le coup, on aurait pu croire qu’un épouvantail qu’on fait avec un piquet et de vieux habits pour éloigner les moineaux d’un terrain fraîchement semé, avait repris vie miraculeusement et se mettait à courir et à parler, car la ressemblance entre la fille et ces mannequins champêtres était complète. Le temps qui détruit les choses les plus solides, avait décollé et arraché de son visage la couche de poudre colorée et avait laissé la peau à nue, une peau variolée, ridée en certains endroits, tuméfiée en d’autres. Un de ses yeux était devenu plus grand que l’autre, mais laids tous les deux, ce n’était pourtant rien à côté de la bouche aux lèvres hémorroïdales, laissant apparaître des gencives rougies et des dents déchaussées et cariées. Le corps n’avait aucune rondeur, pas même de traces de chair maigre ; tout n’était qu’angles et articulations osseuses… Des mains noires, des pieds mal chaussés dans des sandales boueuses ! Mais ce qui surprit le plus Nazarín c’est que ce petit bout de femme, en arrivant près de lui, semblait tout confus, d’une timidité enfantine, c’est cela qui semblait le plus extraordinaire et nouveau dans le changement. Découvrir de la honte sur ce visage surprit le prêtre errant, mais le plus surprenant fut de voir que la Ándara ne semblait pas étonnée de le voir en mendiant. Sa transformation à lui ne la surprenait pas, comme si elle l’avait anticipée ou comme si c’était naturel.
– Monsieur, lui dit la criminelle, je ne voulais pas que vous passiez sans me parler… sans que je vous parle. Sachez que je suis ici depuis le jour de l’incendie et que personne ne m’a vue et je n’ai pas peur de la Justice.
– Très bien. Que Dieu t’accompagne. Que veux-tu de moi, maintenant ?
– Rien, sinon vous dire que la Canoniga est ma cousine, c’est pour cela que je suis venue ici où elle m’a traitée en princesse. Je les aide comme je peux et je ne veux pas retourner dans cette Madrid pestilentielle, lieu de perdition pour les honnêtes gens. Alors…
– Bonne journée… Adieu.
– Attendez un petit peu. Qu’est-ce qui presse ? Dites-moi : Vous avez eu à faire aux hypocrites de la Justice ? Quelle bande de voleurs ! J’ai l’impression qu’on vous a fait quelque chose. La Camelia est une pouffiasse, elle a dû aller raconter un tas d’histoires aux Visitandines.
– Je m’en fiche, moi de la Camelia, des hypocrites et de tout. Laisse tomber… Porte-toi bien.
– Attendez…
– Je ne peux pas rester plus longtemps, je suis pressé. La seule chose que je peux te dire, vilaine Ándara, c’est de ne pas oublier les avertissements que je t’ai faits chez moi, repens-toi.
– Plus repentie que maintenant !… Je vous jure que même si je redevenais belle ou disons passable, mais je n’aurai pas cette veine, le diable ne m’aurait pas. Mais, maintenant, je suis tellement affreuse qu’il en a peur, il ne s’approche pas le malin. Mais, bon… si vous ne vous fâchez pas, je vais vous dire une chose.
– Quoi ?
– Je veux partir avec vous… où que vous irez.
– Ce n’est pas possible, ma fille. Tu aurais trop de problèmes, tu souffrirais de la faim, de la soif…
– Peu importe. Laissez-moi aller avec vous.
– Tu es méchante. Ton repentir n’est pas sincère. Ce n’est qu’un reflet de ton état actuel, tu es vexée parce que tu n’es plus séduisante, mais dans ton cœur tu es toujours perverse, et sous une forme ou sous une autre, tu portes le mal en toi.
– Ah ! Non.
– Je te connais… Tu as mis le feu à ma maison alors que je t’hébergeais.
– C’est vrai, et je n’en ai aucun remords. Ils voulaient me trouver et cela aurait été votre perte, à cause du parfum, n’est-ce pas ? Eh bien, les mauvaises odeurs disparaissent par le feu.
– Voilà ce que je peux te dire à toi, purifie-toi par le feu.
– Quel feu ?
– L’amour de Dieu.
– Eh bien, si vous me prenez avec vous… je serai prise par ces flammes.
– Je n’ai pas confiance… Tu es méchante, méchante. Reste seule. La solitude est un grand maître pour l’âme. Moi, je suis à sa recherche. Pense à Dieu, et donne-toi à lui, souviens-toi de tes péchés et ressasse-les pour les haïr et en avoir horreur.
– Bon, laissez-moi aller…
– Non. Si un jour tu t’améliores, tu me retrouveras.
– Où ?
– Je te dis que tu me retrouveras. Adieu.
Et sans attendre d’autres raisons, il s’éloigna d’un bon pas. Ándara resta seule, assise sur un monticule. Elle ramassait des pierres et les jetait non loin de là sans quitter des yeux le sentier par où le prêtre s’éloignait. Celui-ci tourna la tête deux ou trois fois et la dernière fois, de très loin, il ne distinguait plus qu’un point rouge au milieu des vertes prairies.
2
Ce premier jour de pèlerinage, le fugitif fit des rencontres qui ne méritent pas vraiment d’être racontées mais c’étaient en quelque sorte les premières ou disons les débuts de ses nouvelles aventures chrétiennes. Peu après avoir quitté Ándara, il entendit des coups de canons qui se faisaient, à chaque instant, plus proches et plus terribles, ils déchiraient l’air et portaient des coups au cœur. En cherchant d’où venait tout ce bruit, il vit des groupes d’hommes armés qui allaient et venaient comme s’ils étaient en train de livrer bataille. Il comprit qu’il se trouvait près d’un terrain de manœuvres où notre Armée s’exerce à la pratique des combats. Le chien le regarda fixement comme pour lui dire : «N’ayez pas peur, monsieur, mon maître, tout ça c’est pour rire, ils font ça toute l’année, ils tirent et ils se courent après. Pour le reste, quand on s’approche de l’heure du repas, croyez-moi, il y a toujours quelque chose à prendre, ce sont des libéraux, amis des pauvres.»
Nazarín resta un petit moment à regarder ce petit jeu sympathique et après avoir vu comment se désagrégeaient les fumées de ces détonations et peut après avoir repris sa route, il rencontra un berger qui menait sa cinquantaine de chèvres. C’était un vieux rusé qui regarda l’aventurier d’un air méfiant. Cela n’empêcha pas le pèlerin de le saluer poliment et de lui demander s’il était encore loin du sentier qu’il cherchait.
– On dirait que vous êtes nouveau dans le métier, lui dit le berger. C’est la première fois que vous traînez par là ? D’où vient donc notre homme ? De Arganda ? Je vous fais savoir que les gardes civils ont l’ordre de récupérer tous ceux qui mendient et de les emmener dans des maisons d’accueil à Madrid. C’est vrai qu’ils les relâchent parce qu’ils n’ont pas les moyens d’entretenir tant de fainéants… Que Dieu soit avec vous, mon frère. Moi, je dois y aller.
– J’ai du pain, dit Nazarín, en fourrant sa main dans sa musette, si vous en voulez…
– Faites donc voir, brave homme ? répondit l’autre en examinant la demi-baguette de pain qu’on lui montrait. ça, c’est du pain de Madrid, du pain à croûte, hou là ! C’est du bon.
– Partageons ce morceau, j’en ai un autre que la Peluda m’a donné avant de partir.
– Eh bien, goûtons, mon brave ami. La part qui me revient… c’est bien. Donc, si vous continuez comme ça toujours… vous arriverez en vingt minutes au chemin qui mène à Móstoles. Mais, dites-moi, du vin, vous en avez ?
– Non, monsieur, ni du bon ni du mauvais.
– ça m’aurait étonné… Adieu, collègue.
Il rencontra ensuite deux femmes et un gamin qui étaient chargés de bettes, de salades et de feuilles de chou, ces feuilles qu’on arrache en bas du pied et qu’on donne aux cochons. C’est là que Nazarín commença son tout nouveau métier de mendiant et les paysannes furent si généreuses que, dès les premières paroles, elles lui donnèrent deux magnifiques salades et une demi-douzaine de pommes de terre que l’une d’entre elles sortit de son sac. Le pèlerin rangea tout cela dans son sac, pensant que, si ce soir, il trouvait un coin pour cuire ses pommes de terre, il avait son dîner assuré, un superbe dîner, surtout avec les deux salades par-dessus le marché. Sur la route de Trujillo, il vit un chariot embourbé et trois hommes qui forçaient pour sortir la roue du trou. Sans qu’on ne lui demande rien, il mit toute son énergie à pousser, ça ne faisait pas grand chose, mais quand l’opération fut terminée et bien terminée, ils lui jetèrent par terre une petite pièce. C’était le premier argent que ses mains de mendiant recevaient. Tout allait bien jusque-là et l’Humanité qu’il découvrait dans ces parages champêtres n’avait rien à voir avec celle qu’il avait laissée à Madrid. En pensant à tout cela, il reconnut bien volontiers que les événements du premier jour ne faisaient pas loi et qu’il y aurait forcément des déconvenues, des tribulations et d’horribles moments de souffrance. C’est d’ailleurs ce qu’il recherchait.
Il avança sur le chemin poussiéreux jusqu’à la tombée de la nuit et là, il vit des maisons mais ne savait pas s’il s’agissait de Móstoles ou autre chose, peu lui importait. Il lui suffisait de voir des présences humaines et il s’approcha pour demander le droit de dormir ne serait-ce que dans le bûcher, la cour ou un appentis. La première ferme était une grande maison avec une petite auberge ou guinguette adossée à la partie principale. Devant le grand portail, une demi-douzaine de cochons se vautrait dans la boue. Un peu plus loin, le marcheur vit un attelage de mules, un chariot, les deux limons vers le ciel, des poules qui entraient à la queue leu leu, une femme qui lavait des gamelles dans une mare, un tas de sarments de vigne et un arbre à moitié desséché. Il s’approcha humblement d’un petit vieux ventru, au visage vineux et à l’habillement correct. Il sortait du portail et Nazarín lui demanda s’il pouvait passer la nuit dans un coin de la cour. Il n’avait pas fini de parler que, Grand Dieu des Cieux ! Voilà le vieux qui commence à lâcher des injures… Les plus douces étaient qu’il en avait assez d’héberger des voleurs dans sa propriété. Don Nazario n’en demanda pas plus, il le salua, chapeau bas et s’éloigna.
La femme qui lavait dans la mare lui indiqua un terrain vague, entouré d’un muret en ruines ou d’une haie de ronces et d’orties. On y entrait par une brèche. A l’intérieur, il y avait un début de construction. Des piliers de briques d’un mètre de haut donnaient un semblant d’architecture à un abri couvert d’herbes jaunes. Par terre, poussait une espèce d’avoine de la hauteur d’une main et entre deux parois, appuyé au mur le plus haut, celui du fond, on voyait un bout de toit mal en point, soutenu par des piquets, de la terre glaise, un mélange de paille et de boue, suprêmement fragile mais pas complètement inutile, puisque dessous s’abritaient trois mendiants : un couple ou un ménage et un plus jeune avec une jambe de bois. Confortablement installés dans ce logis primitif, ils avaient fait un feu et leur frichti y cuisait. La femme enlevait le couvercle pour remuer le contenu tandis que l’homme avivait le feu en soufflant comme un malade. Le boiteux coupait des petits bouts de bois avec un couteau pour alimenter doucement le feu.
Nazarín leur demanda la permission de s’abriter sous ce toit, mais eux lui répondirent que le logis était en libre propriété et qu’il pouvait bien y entrer et en sortir sans papiers, tout autant qu’il le voudrait. Ils ne s’opposaient donc pas à ce que le nouveau-venu prenne une place, mais qu’il ne compte pas partager leur soupe chaude, car ils étaient pauvres comme Job et pensaient plus à recevoir qu’à donner. Le pénitent s’empressa de les rassurer et leur dit que ce qu’il demandait c’était juste le droit de faire chauffer quelques pommes de terre à leur feu, puis il leur offrit du pain qu’ils prirent sans faire de grimaces.
– Quelles sont les nouvelles de Madrid ? lui dit le plus vieux mendiant. Nous, après avoir passé par tous ces villages, nous pensions faire un tour par là-bas autour de la San Isidro. L’année se présente bien ? Il y a toujours la misère et les affaires continuent aussi mal ?… On m’a dit que Sagasta est en train de tomber. Qui est notre maire maintenant ?
Don Nazario répondit aimablement qu’il n’y connaissait rien au commerce ni aux affaires, qu’il se fichait éperdument que Sagasta soit au pouvoir ou non et qu’il connaissait monsieur le maire autant que l’empereur des Embrouilles. La conversation s’en tint là. Les autres dînèrent en piquant dans une casserole sans inviter le nouvel arrivant. Ce dernier se fit cuire ses pommes de terre et on ne pensa plus qu’à se coucher, chacun cherchant le coin le plus abrité. Au nouveau on laissa le pire endroit, presque hors du toit, mais rien ne pouvait entamer sa bonne humeur. Il chercha une pierre pour y reposer sa tête[1], s’enveloppa dans son manteau le mieux qu’il put et se coucha tout content, fort de la tranquillité de sa conscience et de la fatigue de son corps pour bien dormir. Le chien s’enroula à ses pieds.
A une heure avancée de la nuit, les grognements de l’animal le réveillèrent ; c’étaient des grognements qui devinrent vite de forts aboiements. Il leva la tête de son oreiller inconfortable et aperçut une silhouette, homme ou femme, ça il n’aurait pas su le dire dans un premier temps, mais il entendit une voix qui lui disait :
– N’ayez pas peur, père, c’est moi, Ándara. Même si vous ne le vouliez pas, je vous ai suivi tout l’après-midi.
– Qu’est-ce que tu viens faire ici, imbécile ? Tu ne vois pas que tu déranges ces… messieurs ?
– Non, laissez-moi terminer. Ce maudit chien s’est mis à aboyer, mais moi, je suis là sans rien dire. Je vous ai suivi, je suis venue et je vous ai vu entrer là… Ne vous fâchez pas… Je voudrais vous obéir et ne pas venir, mais mes jambes me poussent. ça se fait tout seul… Je ne sais même pas ce qui m’arrive. Il faut que j’aille avec vous jusqu’au bout du monde, ou alors qu’on m’enterre… Voilà, dormez encore… Je vais me coucher là dans l’herbe pour me reposer, pas pour dormir car je n’ai pas sommeil du tout, nom de nom !
– Va-t-en d’ici ou tais-toi, lui dit le bon prêtre, remettant sa tête endolorie sur la pierre. Que vont dire ces messieurs ! Tu entends ? Ils se plaignent déjà du bruit que tu fais.
En effet, l’homme à la jambe de bois, le plus près, commençait à grogner et le chien rappela à l’ordre l’importune. Enfin, il régna à nouveau un silence qui aurait pu être profond si les formidables ronflements du vieux couple ne venaient le troubler. A l’aube tout le monde se réveilla, y compris don Nazario qui s’étonna de ne pas voir Ándara. Il en vint à se demander s’il n’avait pas eu une apparition au beau milieu de la nuit. Les trois mendiants de l’équipe et le nouveau venu se mirent à bavarder et les vieux firent de l’année écoulée un tableau si sombre que Nazarín en eut de la peine et leur céda tout son capital, c’est-à-dire la petite pièce que lui avaient refilée les charretiers. Peu après Ándara entra sur le terrain vague, en donnant un tas d’explications sur sa soudaine absence peu avant son réveil. Comme elle ne pouvait pas dormir sur un lit aussi dur, elle s’était levée pour se dégourdir avant le jour et elle était sortie sur la route pour reconnaître les lieux. Elle avait vu que le village n’était rien d’autre que le gros bourg de Móstoles qu’elle connaissait bien parce qu’elle y était allée plusieurs fois de chez elle. Elle ajouta que si don Nazario lui donnait la permission, elle irait voir si habitaient encore là deux amies qui étaient sœurs, l’une s’appelait Beatriz et l’autre Fabiana. L’une d’elles avait eu des relations à Madrid avec un boucher, ils s’étaient alors mariés et avaient monté une auberge dans ce village, justement. Le prêtre ne vit aucun inconvénient à ce qu’elle aille voir ses amies, même si pour cela, elle devait aller au bout du monde et ne pas revenir, car il ne voulait pas emmener ce genre de femme avec lui. Mais une heure après, alors que le pèlerin était en discussion avec un chevrier, qui lui avait offert généreusement une soupe de lait, il vit revenir son alliée tout affligée, et, bon gré mal gré, dut écouter des histoires qui n’avaient, à première vue, aucun intérêt. Le boucher-tavernier était mort des suites d’un coup de corne donné par un taureau lors des fêtes de Móstoles, laissant son épouse et une petite fille de trois ans dans la misère. Les deux sœurs vivaient dans un boui-boui en ruines, près d’une étable. Elles vivaient si mal qu’elles seraient bien allées à Madrid gagner leur vie (chose qui n’aurait pas été difficile pour Beatriz qui était encore jeune et avait belle apparence) si la petite n’était pas tombée malade. C’était un accès de fièvre très dangereux et sûrement qu’avant vingt-quatre heures la petite pourrait bien partir pour le Ciel.
– Ange de Dieu ! s’exclama l’ascète en croisant les mains. Malheureuse mère !
– Et moi, continua la dévergondée, quand j’ai vu toute cette misère, la mère qui pleurait, Beatriz qui pleurnichait et la petite, le visage déjà marquée par la mort… j’ai eu beaucoup de peine… alors, j’ai eu un coup de cœur énorme, comme si les entrailles me poussaient à crier, vous savez ?… Ah ! ça ne trompe pas… Alors, je me suis réjouie de ressentir tout ça et je me suis dit : «Je vais raconter ça au père Nazarín, c’est sûr que s’il vient, s’il voit la petite, il va la guérir.»
– Mais, voyons, qu’est-ce que tu dis ? Suis-je médecin ?
– Médecin, non… mais, il s’agit d’autre chose, quelque chose de beaucoup mieux que toute leur médicamenterie… Si vous le voulez, don Nazario, la petite sera guérie[2]…
3
– Je vais y aller, dit l’Arabe de la Mancha, après avoir entendu pour la troisième fois la demande d’Ándara, je vais y aller, mais seulement pour consoler ces pauvres femmes par quelques bonnes paroles… Mes facultés ne vont pas au-delà. La pitié, ma fille, l’amour du Christ et du prochain ne sont pas des médecines pour le corps. Bon, allez, montre moi le chemin, mais non pas pour aller guérir la petite, car ça c’est le problème de la science et si le cas est désespéré, c’est l’affaire du Dieu Tout-Puissant.
– C’est à moi que vous racontez ça ? répondit la fille avec le même culot que lorsqu’elle était dans sa prison de la rue des Amazones. Ne jouez pas au minus avec moi, votre révérence, je sais, moi, que vous êtes un saint. Allez, allez ! Me raconter ça à moi !… Qu’est-ce que ça vous coûte de faire un miracle, si vous le voulez ?
– Ne blasphème pas, ignorante, mauvaise chrétienne, des miracles, moi !
– Eh bien, si vous, vous n’en faites pas, qui en fera ?
– Moi… idiote, moi, des miracles, le dernier des serviteurs de Dieu !… D’où sors-tu tout cela ? A moi, qui ne suis rien, qui ne vaux rien, Sa Divine Majesté aurait accordé ce que très peu d’élus sur la Terre ont pu faire ? Des anges plus que des hommes, d’ailleurs. Malheureuse, ôte-toi de ma présence, tes sottises ne sont pas nées de la foi, mais d’une croyance superstitieuse et elles me mettent en colère plus que je ne voudrais.
En effet, il était si en colère qu’il leva même son bâton comme s’il allait la battre, fait très rare chez lui et qui n’arrivait que dans des cas extrêmes.
– Pour qui me prends-tu, âme de damnée, esprit vicié, nature corrompue dans ton corps comme dans ton esprit ? Suis-je un imposteur ? Est-ce que j’essaie de tromper les gens ?… Reprends tes esprits et ne me parle plus de miracles, parce que je vais croire, ou que tu te moques de moi ou que ton ignorance et ta méconnaissance des lois de Dieu sont aujourd’hui pires que ta perversité.
Ándara n’était pas du tout convaincue et elle attribuait à la modestie les paroles de son protecteur, mais sans refaire allusion au miracle, elle insista pour l’emmener voir ses amies et la petite moribonde.
– ça oui… Visiter ces pauvres gens, les consoler et demander au Seigneur de les réconforter dans leurs tribulations… ça d’accord ! C’est ma plus grande joie. Allons-y.
Il ne leur fallut pas cinq minutes pour arriver. C’est à toute vitesse que la mégère l’emmena par des rues boueuses, pleines d’orties et de cailloux. Dans un réduit misérable, un sol en terre battue, des murs tout fissurés, on aurait dit des jalousies car l’air et la lumière passaient au travers, le toit presque invisible, caché par les toiles d’araignée et partout des barriques vides, des cruches cassées, des objets sans formes. Nazarín vit la triste famille, deux femmes emmitouflées dans leurs manteaux, les yeux rougis par les pleurs et les insomnies, qui frissonnaient et tremblaient.
La Fabiana portait sur la tête un foulard très serré au niveau des sourcils : elle était brune, vieillie prématurément, émaciée et misérablement vêtue. La Beatriz, passablement plus jeune, même si elle avait vint-sept ans passées, portait le foulard à la mode, arrangé avec grâce et ses vêtements, pauvres, c’est vrai, décelaient des habitudes élégantes. Son visage, sans être beau, était plaisant. Elle était bien proportionnée, grande, élégante, presque arrogante, les cheveux noirs, le teint pâle et les yeux pers étaient bordés d’un fard très sombre légèrement rougeâtre. Elle avait aux oreilles des boucles finement ajourées et ses mains soignées, plus citadines que campagnardes, exhibaient des bijoux de peu ou même d’aucune valeur.
Au fond de la pièce, elles avaient tendu une corde et une sorte de rideau de théâtre y était pendu. Derrière c’était la chambre et le lit ou plutôt le berceau de la petite malade. Les deux femmes reçurent l’ermite errant avec beaucoup de respect, sans doute à cause de ce qu’Ándara leur avait dit. Elles le firent asseoir sur un petit banc et lui servirent une tasse de lait de chèvre avec un peu de pain qu’il prit pour ne pas les contrarier, partageant le morceau de pain avec la mégère de Madrid qui n’avait pas grand appétit. Deux vieilles voisines se faufilèrent pour faire les indiscrètes et, accroupies par terre, elles observaient le bon Nazarín, plus par curiosité que par vénération.
Tout le monde parla de la maladie de la petite qu’on avait tout de suite pressentie comme grave. Le jour où elle tomba malade, sa mère eut un pressentiment, dès le matin, car en ouvrant la porte elle avait vu deux corbeaux qui volaient et trois pies s’étaient posées sur un piquet en face de la maison. Elle en eut mal au ventre. Ensuite, dans les champs, elle vit un passereau qui faisait des bonds devant elle. Tout cela était de très mauvais augure. En rentrant à la maison, la petite était brûlante de fièvre.
Comme don Nazario leur demanda si le médecin l’avait vue, elles répondirent que oui. Don Sandalio, le médecin attitré du village était venu trois fois et, la dernière fois, il avait dit que seul un miracle de Dieu pouvait sauver la petite. Elles avaient fait venir une guérisseuse qui soignait beaucoup. Elle lui avait mis un emplâtre de queues de salamandres attrapées à minuit pile… Après tout cela, on aurait dit que l’enfant réagissait, mais l’espoir dura bien peu. La guérisseuse, très ennuyée, leur avait dit que les queues de salamandres n’avaient pas fait d’effets, parce que c’était le dernier quartier de lune. Si ça s’était passé durant le premier quartier, aucun doute, ça aurait marché.
Nazarín les reprit avec sévérité et même avec colère. C’était stupide de faire confiance à de telles fariboles et il les pria de ne faire confiance qu’à la science et par-dessus tout, à Dieu. Elles firent d’ardentes démonstrations de soumission au bon prêtre et tout en pleurs, à genoux, le supplièrent de voir la petite et de la guérir.
– Mais, mes pauvres filles, comment voulez-vous que je la guérisse ? Ne soyez pas folles. L’amour maternel vous aveugle. Je ne sais pas soigner. Si Dieu veut vous retirer la petite, Lui seul doit bien savoir ce qu’Il fait. Soyez résignées. Mais s’Il décide de vous la laisser, Il ne le fera que si vous le lui demandez, mais je veux bien me joindre à vous.
Elles insistèrent tant que Nazarín passa derrière le rideau. Il s’assit près du lit de l’enfant et l’observa longtemps en silence. Carmencita avait un visage cadavérique, les lèvres toutes noircies, les yeux creux, la peau brûlante et tout son corps immobile et inerte laissait présager l’immobilité du sépulcre. Les deux femmes, la mère et la tante, éclatèrent de nouveau en sanglots comme des Madeleines et les voisines qui étaient entrées en faisaient autant. Au milieu de ce chœur de femmes angoissées, Fabiana dit au prêtre :
– Eh bien, si Dieu veut faire un miracle, n’est-ce pas le bon moment ? Nous savons que vous, mon père, vous êtes fait de pain d’ange, vous avez pris ce vêtement, vous allez pieds nus et vous demandez l’aumône pour être plus proche de Notre Seigneur Jésus-Christ qui était pieds nus aussi et qui ne mangeait que ce qu’on lui donnait. Je crois que ces temps-ci sont comme autrefois et, ce que le Seigneur faisait alors, pourquoi ne le referait-il pas ? Donc, si vous voulez sauver notre petite, vous pouvez nous la sauver, c’est aussi simple que bonjour. Je crois et entre vos mains je remets mon esprit, saint homme de Dieu.
Nazarín écarta les mains qu’elles voulaient baiser et sur un ton calme et reposé, leur dit :
– Mesdames, je ne suis qu’un pauvre pécheur comme vous, je ne suis pas parfait, j’en suis même à cent lieues et si vous me voyez dans cet humble accoutrement, c’est par goût pour la pauvreté, parce que je crois servir Dieu comme cela, en toute modestie, sans croire qu’en marchant pieds nus, je suis meilleur que ceux qui portent bas et chaussures. Je ne pense pas être meilleur que ceux qui thésaurisent par le seul fait d’être pauvre et même très pauvre. Je ne sais pas guérir, je ne sais pas faire de miracles, je n’ai jamais eu l’idée que Dieu pourrait faire cela par mon intermédiaire. Il est le seul à changer le cours des choses, s’il lui plaît ainsi, de changer les lois de la Nature.
– Si, vous le pouvez, vous le pouvez, vous le pouvez ! crièrent toutes ensemble les vieilles et les moins vieilles qui étaient là.
– Mais non… et vous allez même me fâcher, allons donc ! Ne vous attendez pas à ce que je me présente au monde revêtu d’attributs que je n’ai pas ni que j’usurpe un rôle qui dépasse mon humble personne. Je ne suis rien, je ne suis pas un saint, je ne suis même pas bon…
– Mais si, mais si.
– Arrêtez ! Si vous continuez à me contredire, je vous quitte… Vous offensez grandement Notre Seigneur Jésus-Christ en supposant que ce pauvre serviteur peut rivaliser, je ne dis pas avec Lui, ce serait une folie, mais ni même avec ces hommes choisis à qui il a remis les facultés de faire des merveilles pour l’édification des païens. Non, non, mes filles. Je reconnais votre innocence mais je ne veux pas fomenter dans vos têtes des espoirs que la réalité démentirait. Si Dieu a prévu qu’elle meure, c’est parce qu’il vaut mieux qu’elle meure et que vous, vous supportiez cette souffrance. Acceptez, l’esprit serein, la volonté de Dieu du ciel, ce qui ne veut pas dire qu’il est interdit de prier avec foi et amour, de demander avec ferveur au Seigneur et à sa très sainte Mère la santé pour cette petite. Pour ma part, savez-vous ce que je peux faire ?
– Quoi, monsieur, quoi ?… Faites-le vite.
– Voilà : Je vais demander à Dieu qu’il rende à cette petite fille innocente, la santé et la beauté et je lui offre ma santé, ma vie, sous la forme qu’il voudra. En échange de tout cela, qu’il m’envoie à moi les calamités, toutes les épreuves, tous ces malheurs qui s’abattent sur l’Humanité… Qu’il laisse tomber sur moi la misère sous ses formes les plus horribles, la triste cécité, la lèpre affreuse… tout, que tout soit pour moi et qu’en échange il rende la vie à ce petit être tendre et candide et qu’il vous accorde à vous, ce que vous souhaitez de plus cher.
Il dit toutes ces paroles avec un enthousiasme si ardent et une conviction si profonde et si ferme, fidèlement traduits par ces mots, que les femmes se mirent subitement à crier comme des folles. L’enthousiasme du prêtre se répandit comme une étincelle sur un baril de poudre. Et les voilà à pleurer de manière irraisonnée, à se tordre les mains, à confondre les supplications avec les spasmes de la douleur. Le pèlerin, lui, calme, serein, grave, mit sa main sur le front de la petite pour mesurer sa température, et resta ainsi un bon moment sans s’occuper des cris des femmes inconsolables. Il prit congé peu après, promit de revenir et demanda où se trouvait l’église de la localité, Ándara se chargea de lui indiquer et il y resta la journée tout entière. La mégère ne pénétra pas dans l’église.
4
Les premières personnes qu’il rencontra en sortant de l’église à la tombée de la nuit furent Ándara et Beatriz qui venaient à sa rencontre.
– L’état de la petite n’a pas empiré, lui dirent-elles. Elle semble même un peu plus détendue… Elle a ouvert les yeux un moment et elle nous regardait… Nous verrons bien comment elle va passer la nuit.
Elles ajoutèrent qu’elles lui avaient préparé un frugal dîner qu’il accepta pour ne pas passer pour un sauvage et pour leur faire plaisir. Une fois tous réunis dans la masure, la Fabiana paraissait un peu plus joyeuse après avoir noté un léger mieux chez sa fille, autour de midi, mais l’après-midi il y avait eu une rechute. Nazarín leur ordonna de continuer à lui donner le médicament prescrit par le médecin.
A la lueur d’un triste lumignon qui pendait au plafond, ils dînèrent même si l’invité voulait rester sobre allant jusqu’à ne prendre qu’un demi-œuf dur et une petite assiettée de bouillon pour accompagner sa maigre ration de pain. Du vin, n’en parlons pas. Bien qu’elles lui aient préparé un lit bien douillet avec de la paille et des couvertures, il refusa de passer la nuit malgré les insistances aimables de ces gens-là et il décida de dormir avec son chien sur le vaste terrain vague où il avait passé la nuit précédente. Avant de se retirer pour prendre du repos, ils discutèrent un moment, sans pouvoir parler d’autres choses que de la petite malade et du bien peu d’espoir de la voir délivrée de sa maladie.
– Mais celle-ci non plus, dit Fabiana en montrant Beatriz, n’est pas très en forme.
– ça ne se voit pas, observa Nazarín en la regardant plus attentivement qu’avant.
– C’est un problème nerveux, dit Ándara. Elle est comme ça depuis qu’elle est revenue de Madrid, mais ça ne se voit pas sur sa tête, n’est-ce pas ? Elle est de plus en plus belle… C’est à cause d’une frayeur, des nombreuses frayeurs que lui a faites cet individu.
– Tais-toi, espèce de folle.
– Bon, alors, je ne dis plus rien…
– Ce qui lui arrive, ajouta Fabiana, ce sont des troubles de cœur, disons-le, c’est un envoûtement parce que sachez-le bien, père Nazarín, dans les villages, il y a des chagrins d’amour qui font mal et des gens qui vous jettent des mauvais sorts en vous regardant du coin de l’œil.
– Je vous ai déjà dit de ne pas être superstitieuses et je vous le redis.
– Bon, ce que j’ai, affirma Beatriz, non sans timidité, c’est qu’il y a trois mois, j’ai perdu tout appétit, mais à un point que je ne pouvais même pas avaler la valeur d’un grain de blé. Savoir si on m’a envoûtée ou pas, je n’en sais rien. Mais après le manque d’appétit est venu le manque de sommeil et je passais mes nuits à faire les cent pas dans la maison avec un poids là, au creux de l’estomac, comme si j’avais avalé une pierre de granit, mais une énorme.
– Ensuite, ajouta Fabiana, elle avait des crises si fortes, mais si fortes, monsieur Nazarín, qu’à nous toutes on n’arrivait pas à la retenir. Elle braillait et écumait puis elle partait en poussant des cris et en disant des choses qui me faisaient honte.
– Ne soyez pas simplettes, dit Ándara réellement sincère, tout ceci s’appelle avoir le diable au corps. Moi aussi j’ai eu ça dans l’adolescence et je m’en suis guérie en prenant des poudres qui s’appellent… brome… de quelque chose… je ne sais plus.
– Que ce soient les démons ou pas, affirma Beatriz, je souffrais comme c’est pas possible, monsieur le curé, et, quand ça m’arrivait, j’aurais été capable de tuer ma mère, si elle avait encore été là, et j’aurais bien attrapé un enfant tout cru ou la jambe d’une personne pour me la manger ou je l’aurais déchirée à pleines dents… Mais, après, que de terribles angoisses, une immense envie de mourir ! Parfois, je ne pensais qu’à la mort et aux différentes façons qu’on peut trouver de se tuer. Le pire c’est quand j’avais horreur de tout. Je ne pouvais pas passer à côté d’une église sans que mes cheveux se dressent sur ma tête. Entrer dans cette église ? Plutôt mourir… Tout me faisait horreur : un curé en soutane, un merle dans sa cage, un bossu ou une truie suivie de tous ses petits. Les cloches ? Elles me rendaient folle.
– C’est bien cela, dit Nazarín, ce n’est pas de la sorcellerie, ni diablerie quelconque, c’est une maladie bien ordinaire et bien connue qui s’appelle l’hystérie.
– Hestérie, tout à fait. C’est ce que disait le médecin. J’avais des crises sans savoir pourquoi et ça se passait sans que je sache comment. Prendre quelque chose ? Ah ! Mon Dieu ! Si j’en ai pris… Les petits bâtons de sureau qui devaient tremper le vendredi, le sérum de vache noire, les fourmis écrasées avec des oignons ! Et puis, les croix, les médailles, les dents de défunts que je me suis accrochées au cou… !
– Et vous êtes guérie, maintenant ? lui demanda Nazarín en la regardant bien.
– Guérie, non. Cela fait trois jours, j’ai ressenti de l’antipathie, j’avais de la haine mais c’est moins fort qu’avant, ça va mieux.
– Eh bien, j’ai pitié de vous. C’est une bien mauvaise maladie. Comment s’en guérir ? Il y a une bonne part d’imagination là-dedans et c’est par là qu’il faut commencer.
– Comment ça, monsieur ?
– En essayant de bien se convaincre que tous ces troubles sont imaginaires. Ne disiez-vous pas que la sainte Eglise vous faisait horreur ? Eh bien, il faut vaincre cette peur et pénétrer dans l’église, demander avec ferveur au Seigneur de vous soulager. Je vous assure que vous n’avez aucun démon en vous, ce ne sont que d’étranges bizarreries de la sensibilité que produit notre système nerveux. Persuadez-vous que tous ces phénomènes ne signifient ni lésion, ni accident d’organe quelconque et vous n’en souffrirez plus. Repoussez la tristesse, allez vous promener, distrayez-vous, mangez de tout, éloignez de votre esprit toutes ces élucubrations, essayez de dormir et tout ira bien. Allez ! Mesdames, il est tard, je vais me retirer.
Ándara et Beatriz l’accompagnèrent jusqu’à son domicile, sur le terrain vague et elles restèrent là, après lui avoir arrangé avec des herbes et des cailloux le meilleur lit possible.
– Croyez-moi, père, lui dit Beatriz avant de s’en aller, vous m’avez apporté beaucoup de consolations avec tout ce que vous m’avez dit du mal dont je souffre. Si ce sont des démons, va pour les démons, ou bien les nerfs… en tous cas, j’ai plus confiance en vous qu’en tous ces médicaments possibles du monde entier… Bon, eh bien… bonne nuit.
Nazarín pria longtemps puis s’endormit comme un bienheureux jusqu’au petit matin. Le chant merveilleux des petits oiseaux qui avaient élu domicile dans ces broussailles, le réveilla et peu après, Ándara et son amie vinrent le complimenter. La petite allait mieux ! Elle avait passé une nuit bien tranquille et depuis l’aube, elle avait les yeux joyeux et heureux, c’était bien le signe qu’elle allait mieux.
– Si ce n’est pas un miracle, Dieu n’a qu’à venir, il verra bien !
– Ce n’est pas un miracle, leur dit-il gravement. Dieu a pitié de cette pauvre mère. Il l’aurait sans doute fait même sans nos prières…
Et les voilà tous là-bas, à la rencontre de Fabiana, folle de joie. Elle embrassa le petit prêtre, elle voulut même lui faire des bisous, mais lui s’y opposa résolument. Il y avait bien des espoirs, mais pas encore de raisons de croire à son total rétablissement. Il pouvait y avoir une aggravation, et alors, la peine de la pauvre mère serait encore plus grande. Enfin, peu importe le résultat, elles verraient bien, quant à lui, si elles n’avaient rien d’autre à demander, il allait partir tout de suite, après avoir pris un très frugal petit déjeuner. Les insistances et les amabilités des trois femmes pour le retenir furent inutiles. Il n’avait plus rien à faire là, il perdait son temps, sans raison aucune alors qu’il lui fallait repartir pour accomplir jusqu’au bout son projet d’un saint pèlerinage.
Les adieux furent affectueux et bien qu’il renouvelât à la vieille bête madrilène de ne pas l’accompagner, celle-ci lui dit, de son ton bourru, qu’elle irait jusqu’au bout du monde avec lui, avec joie et son cœur le lui demandait d’une telle façon que rien ne pouvait l’en empêcher. Ils sortirent donc tous les deux et derrière eux, une nuée de gamins et quelques vieilles de la localité. Il y avait tant de monde que pour s’en débarrasser Nazarín abandonna la route et s’en alla à travers champs sur la gauche de la grand-route en direction d’un bosquet qu’il voyait au loin.
– Vous savez ? lui dit Ándara, après le départ des derniers éléments du cortège. Beatriz m’a dit hier soir que si la petite va mieux, elle va faire comme moi.
– C’est-à-dire ?
– Eh bien, qu’elle va vous suivre partout où vous irez.
– Pas question. Je ne veux pas qu’on me suive. Je suis mieux tout seul.
– Mais, c’est ce qu’elle désire. Elle dit qu’elle veut faire pénitence.
– Si elle veut faire pénitence, qu’elle fasse pénitence, il est toujours temps, mais elle n’a pas besoin pour cela de venir avec moi. Qu’elle laisse tout ce qu’elle possède, à mon avis, ce ne sera pas un grand sacrifice et qu’elle aille mendier… mais toute seule. Chacun sa conscience, chacun sa solitude.
– Eh bien, moi, je lui ai dit que oui, qu’elle pouvait venir avec nous…
– Mais ça ne te regarde pas…
– Si, ça me regarde, parce que j’aime bien la Beatriz et je sais que ce genre de vie lui conviendra… Vu qu’elle aime bien faire pénitence pour se débarrasser d’un poids qu’elle a sur le cœur et ce poids c’est un homme, un méchant qui s’appelle Pinto ou bien el Pinton, je n’en suis pas sûre. Mais, je le connais : bon gars, veuf, avec un grain de beauté là. Eh bien, c’est lui qui la rend folle, c’est lui qui lui a mis le diable au corps. Il l’a trompée. Un jour, il la laisse tomber et le lendemain, il lui fait mille mamours, voilà pourquoi ça la rend estérique. Ce qui lui faut, si si, ce qui lui faut, c’est d’aller en pèlerinage pour se vider la tête de toutes ces horreurs et si ce ne sont pas des démons qu’elle a dans le ventre, le cœur ou les cavités, c’est dans la tête qu’ils sont et ils sont légion. Et tout ça depuis une fausse couche et on dit même qu’il y en avait deux…
– Et pourquoi tu me racontes tout ça ? Tu n’es qu’une bavarde et une impertinente, lui dit Nazarín en colère. Qu’est-ce que j’ai à voir moi avec Beatriz ou avec el Pinto ou je ne sais quoi… ?
– Parce que vous devez la protéger, parce que si elle ne fait pas très vite pénitence avec nous, en s’occupant un peu de son âme, elle va retourner à sa mauvaise conduite, à s’occuper de son corps, nom de nom ! Elle a été à un doigt de partir ! Quand la petite est tombée malade, elle avait déjà fait sa malle pour partir à Madrid. Elle m’a montré la lettre de la Seve qui la réclamait et…
– Ne me raconte pas d’histoires, allez !
– J’ai bientôt fini… La Seve lui disait d’y aller très vite… et là-bas… eh bien…
– Tais-toi !… Que Beatriz aille au diable… Non, pas ça, non… Il ne faut pas qu’elle réponde à l’appel de cette débauchée… Il ne faut pas qu’elle morde à l’hameçon que le diable lui tend, avec l’appât des vanités futiles… Dis-lui de ne pas y aller, parce que là-bas, c’est le péché qui l’attend, la corruption, le vice et une mort infâme si elle n’a pas le temps de se repentir.
– Mais, comment je lui dis tout cela, petit père, si nous ne retournons pas à Móstoles ?
5
– Tu peux y aller, toi, moi, je t’attends ici.
– Elle ne sera pas convaincue par ce que je vais lui dire. Si vous y allez vous, en lui parlant comme il faut, à coup sûr elle n’ira pas à sa perte. Elle a confiance en vous, le si peu qu’elle vous a entendu à propos de sa maladie a suffi pour la guérir, elle n’est plus indisposée, elle n’a plus ses crises. Donc, si vous le voulez, on y va.
– Laisse-moi réfléchir.
– Et comme ça on pourra voir si la petite est morte ou non.
– Le cœur me dit qu’elle vit.
– Eh bien, allons-y, monsieur, ne serait-ce que pour voir ça.
– Non, tu y vas toi et tu dis à ton amie… Enfin, je déciderai de cela demain.
C’est dans une petite cour de ferme qu’ils trouvèrent à se loger, après avoir tenté de dîner avec les maigres sous de la récolte de ce jour-là etcomme le lendemain matin Nazarín s’apprêtait à reprendre le même chemin que la veille, Ándara lui dit :
– Mais vous savez où on va ?
– Où ?
– A mon village, bon sang !
– Je t’ai déjà dit de ne plus prononcer de vilains mots devant moi. Si tu recommences une seule fois, je ne t’autorise plus à me suivre. Bon, vers où dis-tu que nous allons ?
– Vers Polvoranca, c’est mon village et je ne voudrais pas retourner chez moi où j’ai des parents qui ont une bonne place et ma sœur est mariée avec le préposé de l’octroi. Ne croyez pas que Polvoranca est un trou, on y trouve des gens riches, il y en a qui en ont jusqu’à six paires… je parle des mules.
– Je comprends bien que tu as honte de retourner dans ton pays natal, répondit le pèlerin. Eh bien voilà ! Si tu étais une fille correcte tu pourrais aller partout sans avoir honte. Bon, on n’ira donc pas par là, nous allons prendre ce chemin-ci, de toutes façons, pour nous, cela revient au même.
Ils marchèrent toute la journée sans autre événement à raconter, à part la désertion du chien qui accompagnait Nazarín depuis Carabanchel. Est-ce parce que l’animal avait lui aussi de la parenté honorable à Polvoranca ou bien parce qu’il n’aimait pas sortir de son territoire, un court rayon d’action autour de Madrid, toujours est-il qu’un soir, il prit congé comme un domestique mécontent, il prit la poudre d’escampette pour aller chercher dans Madrid meilleure fortune. Après avoir passé la nuit à la belle étoile, au pied d’un frêne, les marcheurs aperçurent de nouveau Móstoles. C’est là qu’Ándara voulait conduire Nazarín sans qu’il ne s’en rende compte.
– Tiens donc ! Nous revoilà dans la localité de tes amies ! Ecoute, ma fille, moi, je n’entre pas. Vas-y toi et informe-toi de l’état de la petite et au passage, tu diras de ma part à cette pauvre Beatriz ce que tu sais, qu’elle ne tienne pas compte des appels du vice et que si elle veut partir en pèlerinage et qu’elle veut mener une vie humble, elle n’a pas besoin de moi pour ça… Allez, ma fille, va. Je vais t’attendre à cette vieille noria, entre les deux arbres rachitiques, ça doit être à un quart de lieue du village. Ne tarde pas.
Il s’en alla doucement à la noria, but un peu d’eau et se reposa. A peine deux heures après le départ de la mendiante, Nazarín la vit revenir, mais pas seule, elle était accompagnée d’une autre du même genre et à mesure qu’elles s’approchaient, il reconnut la Beatriz. Quelques enfants du village les suivaient. Avant d’arriver à l’endroit où le mendiant les attendait, les deux filles et les gamins poussèrent des cris de joie.
– Vous ne savez pas ?… La petite va bien ! Vive notre saint Nazarín ! Vivat !… La petite va bien… tout à fait bien. Elle parle, mange, on dirait qu’elle est ressuscitée.
– Mes filles, soyez sérieuses. Ce n’est pas la peine de faire un tel vacarme pour m’annoncer la bonne nouvelle.
– Mais si, on veut faire du vacarme ! criait Ándara en sautant de joie.
– On veut que même les oiseaux du ciel, les poissons des rivières et même les lézards qui courent entre les pierres le sachent, dit la Beatriz toute rayonnante de joie. Ses yeux lançaient des éclairs joyeux.
– C’est un miracle, nom d’une pipe !
– Chut ! Silence !
– Ce n’est peut-être pas un miracle, père Nazarín, mais vous êtes bon et le Seigneur vous accorde tout ce que vous lui demandez.
– Ne me parlez pas de miracles et ne m’appelez pas saint, parce que j’en aurais honte et cela me ferait fuir et vous ne me reverriez plus jamais.
Les gamins n’étaient pas en reste et faisaient autant de bruit que les femmes ; l’air n’en pouvait plus de leurs cris de joie.
– Si vous entrez dans le village, on va vous porter en triomphe. Ils croient que la petite était morte et que vous, rien qu’en lui mettant la main sur le front, vous lui avez rendu la vie.
– Mon Dieu ! Mais quelle sottise ! Je suis donc bien content de ne pas y être allé. Enfin, louons l’infinie miséricorde du Seigneur… Et la Fabiana, elle doit être contente, non ?
– Elle est folle, monsieur, folle de joie. Elle dit que si vous n’étiez pas venu, sa fille serait morte. Moi aussi, je le crois. Et savez-vous ce que font les vieilles du village ? Elles entrent chez nous et nous demandent le droit de les laisser s’asseoir sur le même banc où le saint de Dieu s’est assis.
– Qu’elles sont bêtes ! Mais qu’elles sont sottes ! Quelle naïveté !
Don Nazario remarqua alors que Beatriz était pieds nus, portait une robe noire, un petit châle croisé sur la poitrine, un sac sur le dos et un autre foulard attaché sur la tête.
– Tu pars en voyage, ma fille ? lui demanda-t-il. Et ne vous étonnez pas de l’entendre la tutoyer, car c’est une vieille habitude chez lui lorsqu’il parle aux gens de la campagne.
– Elle vient avec nous, confirma Ándara non sans aplomb. Vous voyez bien, monsieur. Elle n’a que deux voies, ou bien elle s’en va avec la Seve, là-bas, ou elle vient avec nous.
– Bon, eh bien, qu’elle commence sa campagne spirituelle seule. Allez, toutes les deux de votre côté et laissez-moi seul.
– ça jamais, répondit la fille de Móstoles, car il n’est pas bon que vous soyez seul. Il y a plein de mauvaises gens dans ce monde. Si nous allons avec vous, n’ayez aucune crainte, nous saurons vous défendre.
– Non, je n’ai aucun souci, je ne crains rien.
– Mais en quoi est-ce qu’on vous gêne ? En voilà d’un monsieur !… dit la fille de Polvoranca, câline… Et si jamais les démons entraient en nous, qui nous en débarrasserait ? Et qui va nous enseigner toutes ces belles choses, les choses de l’âme, la gloire divine, la miséricorde, la pauvreté ? Elle et moi, toutes seules ! Nous voilà bien ! Ecoutez… Voilà qu’on vous aime, sans malice, en tout bien tout honneur et voilà le remerciement !… Nous sommes méchantes, mais si vous nous abandonnez, qu’allons-nous devenir ?
Beatriz ne disait rien. Elle séchait ses larmes avec son mouchoir. Nazarín resta un instant, songeur, traçant des lignes par terre avec son bâton, puis il leur dit :
– Si vous me promettez de bien vous comporter et de m’obéir en tout, c’est bon, venez.
On renvoya les gamins de Móstoles. Il fallut pour cela se débarrasser des quelques sous de la collecte du jour, puis les trois pénitents se mirent en marche, empruntant un petit sentier sur la droite de la grand-route comme on va à Navalcarnero. L’après-midi fut orageux. Il se leva le soir un fort vent qui leur fouettait le visage car ils marchaient vers l’ouest. Des éclairs épouvantables sillonnaient le ciel, suivis de formidables coups de tonnerre et une pluie violente s’abattit sur eux de telle façon qu’ils étaient dans un drôle d’état. Heureusement, la chance leur offrit les ruines d’une ancienne cabane et là ils s’abritèrent de la furieuse tempête. Ándara rassembla quelques feuilles mortes et du bois. Beatriz, en femme prévoyante, avait des allumettes, elle mit donc le feu et fit une bonne flambée. Ils s’en approchèrent tous les trois pour faire sécher leurs vêtements. Ils résolurent de passer la nuit là, car il était peu probable qu’ils puissent trouver un endroit plus confortable et plus sûr. Nazarín leur fit alors sa première leçon sur la Doctrine que les pauvres filles ignoraient ou avaient oubliée. Il les captiva pendant plus d’une demi-heure ; sa parole était persuasive, sans rhétorique inutile. Il leur parla des principes du monde, du péché originel et de ses conséquences lamentables, et même de la miséricorde infinie de Dieu tout disposé à sortir l’Homme de la prison du mal par la rédemption. Ces notions élémentaires, l’ermite errant les expliquait en langage simple, clarifiant les choses par des exemples ; elles en restaient bouche-bée, surtout Beatriz qui n’en perdait pas un mot et assimilait tout très facilement, gravant toutes ces choses dans son cœur. Ensuite ils prièrent le rosaire et les litanies et répétèrent quelques prières que le bon maître voulait leur faire apprendre par cœur.
Le lendemain, après avoir prié tous les trois à genoux, ils reprirent leur route, ravis. Les femmes allaient devant quêter dans les villages ou les hameaux qu’ils allaient traverser et récoltèrent suffisamment de sous, de légumes, de quignons de pain et autres victuailles. Nazarín pensait que ça allait trop bien pour des pénitences, car depuis qu’il avait quitté Madrid, il tombait sur lui une véritable pluie de bienfaits. Personne ne l’avait mal traité et on ne mettait aucun obstacle, on lui donnait chaque fois qu’il demandait l’aumône. La faim et la soif lui restaient inconnues. Mais le meilleur don était qu’il jouissait d’une liberté bien précieuse, la joie débordait de son cœur et sa santé n’en devenait que plus forte. Pas le moindre mal de dents depuis qu’il parcourait les chemins et en plus aucun souci de chaussures, ni de vêtements, pas d’inquiétude pour savoir si le chapeau était à la mode ou pas ou bien pour savoir s’il avait bonne ou mauvaise mine ! Vu qu’il ne se rasait pas, il ne le faisait plus depuis déjà longtemps, il avait une barbe assez longue, elle était poivre et sel, et finissait en pointe élégante. Avec le soleil et l’air de la campagne, il avait une belle peau chaude et bronzée. Son air clérical avait complètement disparu et le type arabe, libre de tout masque, ressortait, pur et sain.
Le Guadarrama, qui avait bien grossi après l’orage, leur coupa la route ; mais ce ne fut pas difficile de remonter un peu pour trouver un endroit pour le traverser à gué. Ils continuèrent dans la campagne moins solitaire et moins stérile que sur la rive gauche, et de temps en temps on voyait quelques maisons, de petits hameaux, des terres bien labourées, sans qu’il y manque les arbres et les bosquets charmants. Au milieu de l’après-midi, ils aperçurent quelques maisons cossues, toutes blanches, entourées de tonnelles vertes, une tour de brique rouge en ressortait, on aurait dit le clocher d’un monastère. En s’approchant davantage, ils virent sur leur gauche un village minable et pauvre, couleur de terre, puis une autre petite tour, comme celle d’une église paroissiale. Beatriz qui se débrouillait bien en géographie locale leur dit :
– Cette localité c’est Sevilla-la-Nueva, il y a peu d’habitants. Ces grandes maisons blanches dans la verdure et la tour, c’est la propriété ou les domaines qu’on appelle la Coreja. Son propriétaire actuel est un certain Pedro de Belmonte, un homme riche, assez jeune, bon chasseur, bon cavalier mais qui a le plus sale caractère de toute la Nouvelle-Castille. Certains disent que c’est une personne méchante, possédée par les démons, d’autres qu’il s’enivre pour oublier ses chagrins et quand il se trouve en état d’ébriété, il se met à taper sur tout le monde et fait mille exactions… Il est si fort qu’un jour, alors qu’il était à la chasse, un homme croisa son chemin sur son âne et ne voulut pas se ranger, il saisit homme et bête, les souleva à bout de bras et les balança dans le ravin…
Une autre fois, à un garçon qui effarouchait ses lièvres, il donna tant de coups de bâtons qu’on le sortit de la Coreja, à quatre, à moitié mort. A Sevilla-la-Nueva on en a peur et quand on le voit arriver, tout le monde se met à déguerpir en faisant de grands signes de croix, parce qu’une fois, ce n’est pas une blague, à cause de je ne sais quelle histoire d’eaux, don Pedro est entré dans le village à l’heure de la sortie de la messe et a distribué des taloches en veux-tu en voilà, si bien que la moitié s’est retrouvée par terre… Enfin, monsieur, il me semble plus prudent de ne pas nous approcher de là, parce que ce monsieur est souvent à la chasse dans le coin et il peut facilement nous voir et nous interpeller en criant : «Qui va là ?»
– Sais-tu que tu avives ma curiosité ?[3] dit Nazarín et la peinture que tu as faite de ce sauvage me pousse plutôt à continuer qu’à reculer.
6
– Monsieur, dit Ándara, ne cherchons pas midi à quatorze heures, si cette brute nous tombe dessus et nous fiche une raclée, on aura tout gagné.
Là-dessus, ils arrivaient à un chemin étroit, bordé de rangées de peupliers, qui semblait être l’entrée de la propriété et les trois pèlerins n’y avaient pas trop mis les pieds que deux molosses déboulèrent comme des lions en aboyant comme des malades et se mirent à les attaquer avant qu’ils n’aient eu le temps de s’enfuir. Mais quelles gueules ! Quelles bêtes féroces ! Nazarín était mordu à une jambe, Beatriz à une main et la robe d’Ándara était en charpie. Les trois avaient beau se défendre crânement de leur bâton, les chiens féroces leur auraient réglé leur compte si un garde, sorti des buissons, ne les avait arrêtés.
Ándara, les mains sur les hanches, injuriait à qui mieux mieux la maison et ses satanés chiens. Nazarín et Beatriz ne se plaignaient pas. Mais ce maudit garde, au lieu de s’apitoyer sur les dommages causés par ses animaux féroces, s’en prit aux pèlerins de manière grossière :
– Allez-vous-en d’ici, vauriens, fainéants, bande de voleurs ! Heureusement pour vous, le maître ne vous a pas vus, morbleu ! Vous n’auriez pas eu envie de refourrer votre nez à la Coreja.
Les deux femmes apeurées s’éloignèrent entraînant presque de force Nazarín qui, apparemment, n’était pas si effrayé que ça. Dans une épaisse ormaie par où passait un ruisseau, ils s’assirent pour se reposer de leur stupeur, laver les blessures du saint prêtre, le bander avec des chiffons qu’avait apportés Beatriz, très prévoyante. Tout le reste de l’après-midi et jusqu’aux premières heures de la nuit, heures de la prière, on ne parla que du risque qu’ils avaient courus et la fille de Móstoles raconta bien d’autres abus de ce monsieur de Belmonte. Le bruit courait qu’il était veuf et qu’il avait tué sa femme. La famille, de la noblesse madrilène, n’avait plus de contacts avec lui et il était retenu dans cette résidence champêtre comme dans un bagne en compagnie de nombreux domestiques, tous bien braves, les uns veillaient sur lui et l’accompagnaient dans ses parties de chasse, d’autres devaient le surveiller et prévenir sa famille s’il disparaissait. Tous ces détails encouragèrent Nazarín à rencontrer ce sauvage. Ils se mirent d’accord pour passer la nuit dans cet épais bosquet d’ormes. Ils prièrent et dînèrent, et en guise de dessert, Nazarín dit qu’il ne manquerait pour rien au monde cette visite à la Coreja où le cœur lui disait qu’il allait rencontrer là de grandes souffrances ou tout au moins quelques mépris et contrariétés, unique désir de son cœur.
– Et alors, mes filles, tout ne peut pas être fait que de bonheur ! Si on ne rencontrait jamais de quoi souffrir, quelques mésaventures, si on ne souffrait jamais de la faim, de la méchanceté des hommes et de la férocité des bêtes, cette vie serait un délice et les hommes et les femmes seraient bien bêtes de ne pas en profiter. Mais à quoi vous attendiez-vous ? A ce qu’on allait entrer dans un monde de plaisirs et d’abondance ? Tant d’efforts pour me suivre et, dès que se présente la moindre occasion de souffrir, vous voilà prêtes à fuir ! Alors ce n’était pas la peine de venir avec moi ; et vraiment je vous le dis, si vous n’avez pas l’audace des montées difficiles et si vous ne vouliez que les petits chemins plats et fleuris, alors, il faut vous en retourner et me laisser seul.
Elles essayèrent de le dissuader en prenant tous les motifs qui leur venaient à l’esprit, entre autres, quelques-uns qui ne manquaient pas de bon sens, par exemple, que lorsque le malheur viendrait elles sauraient y faire face, mais que ce n’était pas très prudent de le chercher avec témérité. Elles discutaient de tout cela, comme elles pouvaient sans parvenir à le convaincre, ni cette nuit-là, ni le matin suivant.
– Ce monsieur de la Coreja a beau avoir la réputation d’un cœur dur, leur dit-il, il a beau être cruel avec ses subordonnés, implacables avec les petits, moi je veux frapper à sa porte et lui parler. Je verrai par moi-même si l’opinion générale est juste ou non, car là-dessus on se trompe souvent, mesdames. Mais, si, effectivement, c’est un méchant, ce monsieur… Comment tu dis qu’il s’appelle ?
– Don Pedro de Belmonte.
– Eh bien, si vraiment c’est un dragon ce don Pedro, je veux quand même lui demander l’aumône pour l’amour de Dieu et voir si le dragon se calme et me donne quelque chose. Et si non, tant pis pour lui et pour son âme.
Il ne voulut rien entendre et voyant que les deux femmes en étaient vertes de peur et qu’elles claquaient des dents, il leur ordonna de l’attendre là, qu’il irait seul, imperturbable et prêt à tout ce qui pourrait lui arriver, que ce soit la mort, au pire, ou les morsures de ses chiens, au mieux. Quand il se mit en marche, elles lui criaient :
– N’y allez pas, n’y allez pas, cette brute va vous tuer !… Ah ! Nazarín de mon cœur qu’on ne va plus revoir !… Revenez, revenez, voilà déjà les chiens et toute une troupe qui arrivent… il y en a un qui semble bien le maître, il a un fusil… Mon Dieu ! Vierge sainte, au secours !
Don Nazarín s’en alla directement à l’entrée de la propriété et avança bien décidé dans l’allée bordée d’arbres sans trouver personne. Tout près du bâtiment, il vit que deux hommes venaient vers lui et il entendit les aboiements des chiens, mais c’étaient des chiens de chasse et non les molosses de la veille. Il s’avança d’un pas ferme et, une fois à proximité des hommes, il remarqua qu’ils l’attendaient tous les deux. Il les regarda aussi, recommanda son âme à Dieu et continua du même pas tranquille. En arrivant à eux, et avant même d’être en mesure de savoir qui ils étaient, il entendit une voix autoritaire et courroucée :
– Où allez-vous par là, maudit bonhomme ? Ce n’est pas un chemin ici, morbleu, ce chemin ne conduit que chez moi, nulle part ailleurs.
Nazarín s’arrêta bien en face de don Pedro de Belmonte car c’est bien lui qui lui adressait la parole, et d’une voix ferme mais avec humilité sans pour cela manifester de couardise, il lui dit :
– Monsieur, je viens vous demander l’aumône, pour l’amour de Dieu. Je sais bien que ce chemin ne mène que chez vous mais comme je sais qu’en toute maison sur ces terres chrétiennes il y a de bonnes âmes, je suis entré sans permission. Si je vous ai offensé, je vous demande pardon.
Ceci dit, Nazarín put contempler à son aise, la fière allure du vieux monsieur de la Coreja, don Pedro de Belmonte. C’était un homme si grand qu’on pouvait bien dire que c’était un géant, bien bâti, courtois, la soixantaine, on aurait difficilement trouvé plus beau vieillard. Son visage, bruni par le soleil, le nez élargi à la base et bien arqué, des yeux vifs sous d’épais sourcils, la barbe blanche, pointue et frisée, le front large et dégarni, tout trahissait un type noble, fier, plus enclin à commander qu’à obéir. Aux premières paroles qu’il entendit, Nazarín put observer la férocité de son caractère et l’allure autoritaire de ses gestes. Le plus bizarre fut qu’après avoir renvoyé avec fracas l’humble pénitent, qui s’en allait, la casquette à la main, don Pedro se mit à le regarder fixement, comme pris d’une curiosité intense.
– Viens ici, lui dit-il. J’ai l’habitude de ne donner aux fainéants et aux vagabonds qu’une volée de coups de bâton quand ils s’approchent de chez moi. Je te dis de venir ici.
Nazarín se troubla un instant, car même le plus courageux du monde se serait évanoui devant la férocité de ces yeux et la voix terrifiante de cet orgueilleux. Il était vêtu d’un costume léger et élégant, avec cette négligence des personnes habituées aux pratiques raffinées de la haute société, des bottes champêtres, un délicat couvre-chef sombre, incliné sur la gauche. Il portait en bandoulière son fusil de chasse et ses munitions dans une très belle cartouchière.
«Là, pensa Nazarín, ce brave monsieur va prendre son fusil et m’étriper d’un coup de crosse ou me donner un coup sur la tête et me la fendre du canon de son fusil. Que Dieu me vienne en aide.»
Mais, le brave monsieur de Belmonte le regardait toujours, le regardait sans rien dire, son accompagnateur, armé d’un fusil aussi, les regardait tous les deux.
– Pascual, dit le gentilhomme à son domestique, qu’est-ce que tu penses de ce type ?
Comme Pascual ne répondait pas, sans doute, par respect, don Pedro éclata d’un gros rire bruyant et fixa Nazarín en ajoutant :
– Tu es maure… Pascual, n’est-ce pas qu’il est maure ?
– Monsieur, je suis chrétien, répliqua le pèlerin.
– Chrétien de religion… Va-t-en savoir… ! Mais ça n’empêche que tu es de pure race arabe. Ah ! Je connais bien mes gens. Tu es arabe et même d’Orient, du si poétique et sublime Orient. J’ai l’œil… Dès que je t’ai vu… ! Viens avec moi.
Il se mit à avancer vers la maison, emmenant à ses côtés le vagabond et derrière eux le serviteur.
– Monsieur, répondit Nazarín, je suis chrétien.
– ça, nous allons voir… On ne me la fait pas à moi. Pour ta gouverne, sache que j’ai été diplomate et premier consul à Beyrouth puis à Jérusalem. J’ai passé quinze ans en Orient, mes meilleures années. ça c’est un pays !
Nazarín crut plus prudent de ne pas le contredire et se laissa conduire en attendant ce que cela donnerait. Ils entrèrent dans une grande cour et on entendit aboyer les chiens de la veille… Il les reconnaissait au son métallique de leur voix. Puis, ils traversèrent un deuxième porche et pénétrèrent dans une autre cour plus grande que la première où paissaient quelques moutons et deux vaches hollandaises. Il y avait là de l’herbe en abondance. Après cette cour, une autre plus petite avec une noria en son milieu. Pour Nazarín, toute cette série d’enceintes semblaient une forteresse ou une citadelle. Il vit aussi la tour qu’il avait vue de loin. C’était un immense colombier autour duquel volaient des milliers de couples d’oiseaux magnifiques.
Le gentilhomme se débarrassa de son fusil, le remit à un domestique et demanda à ce dernier de se retirer. Il s’assit ensuite sur un banc de pierre.
– Dis-moi : si à présent je te jetais dans ce puits, que ferais-tu ?
– Que voulez-vous que je fasse, monsieur. Je me noierais s’il y a de l’eau ou alors, je m’écraserais.
– Qu’est-ce que tu en penses, toi ? Me crois-tu capable de t’y jeter ?… Quelle opinion as-tu de moi ? Tu as bien dû entendre dire de moi au village que je suis méchant.
– Comme toujours, je vais parler en disant la vérité, monsieur, en effet, je vais vous dire que l’opinion que j’ai de vous n’est pas très bonne. Mais, je pense que la rudesse de votre caractère n’empêche pas d’avoir un cœur noble, un esprit droit et chrétien qui aime et craint Dieu.
Le gentilhomme le regarda à nouveau avec une attention et une curiosité si intenses que Nazarín ne savait qu’en penser, il était un tantinet abasourdi.
7
Soudain, Belmonte commença à fulminer contre les domestiques parce qu’ils avaient soi-disant laissé passer une chèvre qui était venue manger un rosier. Il les traitait de fainéants, de renégats, de bédouins, de zoulous et les menaçait de les écorcher vifs, de leur trancher les oreilles ou de les couper en deux. Nazarín était indigné mais se retenait. «Si c’est comme ça qu’il traite ses serviteurs, qui sont un peu comme de sa famille, pensait-il, que vais-je devenir moi, un pauvre misérable ? C’est déjà incroyable que je sois encore entier !» Le bonhomme revint à côté de lui, après l’orage grondant encore comme un volcan qui continue à lancer gaz et scories après une éruption.
– Ces crapules épuisent ma patience. Ils font exprès de mal faire les choses pour me casser les pieds et m’énerver. Dommage qu’on ne vive plus au temps du féodalisme, j’aurais plaisir à pendre aux arbres tous ceux qui ne filent pas droit.
– Monsieur, dit Nazarín, bien résolu à donner une leçon de christianisme à ce noble monsieur, sans craindre les conséquences funestes de ses colères, vous penserez ce que vous voudrez de moi, et vous direz que je suis un impertinent, mais je m’en voudrais de ne pas dire que votre façon de traiter vos serviteurs n’est pas chrétienne, c’est antisocial, barbare et grossier. Prenez ça comme vous voudrez, je ne suis qu’un pauvre nécessiteux qui ne fait qu’entrer et sortir. Les serviteurs sont des personnes et non des animaux, tout autant fils de Dieu que vous, ils ont leur dignité et leur amour-propre, comme n’importe quel seigneur féodal ou qui prétend l’être, des temps passés et à venir. Et, ceci dit, c’est pour moi un devoir de conscience, accordez-moi la permission de me retirer.
Notre homme se remit à l’examiner attentivement : la tête, les vêtements, les mains, les pieds nus, le crâne si bien fait, le langage poli si peu conforme aux apparences de mendiant qu’il en fut tout surpris et confondu.
– Toi, tu es un Maure authentique ou un faux mendiant, lui dit-il, comment sais-tu tout cela, quand et où as-tu appris à t’exprimer de cette façon ?
Et avant d’écouter la réponse, il se leva et donna au pèlerin l’ordre impérieux de le suivre.
– Viens ici… Je veux t’examiner avant de te répondre.
Il l’emmena dans une salle spacieuse, meublée de fauteuils anciens, en bois de noyer, des tables du même style, des coffres et des étagères, puis, il lui montra un fauteuil et s’assit aussi. Mais, il se remit debout et allait d’un côté à l’autre, montrant des signes d’inquiétude et de nervosité qui auraient déconcerté des hommes au caractère moins souple que celui de notre grand Nazarín.
– J’y suis… Oh ! Quelle idée !… Si c’était… ! Mais, non, ce n’est pas possible. Mais si… Que le diable m’emporte si ce n’est pas ça… Bien sûr que oui… On en a vu bien d’autres… Mais bon sang de bon sang ! Dès le début, je m’en suis douté… Je ne suis pas homme à me laisser gruger… Oh ! L’Orient ! Quelle grandeur… ! Il n’y a que là qu’on trouve une vie spirituelle !…
Il ne faisait que dire ça, en faisant les cent pas, sans un regard au prêtre, ou bien, il s’arrêtait, le dévisageait, étonné, troublé même. Don Nazario ne savait qu’en penser, tantôt il voyait en ce monsieur de la Coreja, le plus grand fou que Dieu ait envoyé sur la terre, tantôt un tyran d’une cruauté raffinée qui préparait à son hôte quelque supplice atroce et jouait avec lui, comme le chat joue avec la souris avant de la dévorer.
«Si je me fais tout petit, pensa-t-il, je vais être sacrifié comme un minable et un idiot. Profitons de la situation, et si ce géant furieux veut faire sur moi quelque atrocité, qu’il entende d’abord les vérités évangéliques.»
– Mon cher monsieur, mon frère, lui dit-il en se levant et en prenant un ton solennel et courtois qu’il utilisait autrefois pour reprendre les malfrats, pardonnez ma petitesse si j’ose me mesurer à votre grandeur. Le Christ me le demande : je dois parler et donc, je parlerai. Je vois Goliath devant moi et sans m’arrêter à son pouvoir, je vais droit sur lui avec ma fronde. C’est le propre de mon ministère d’admonester ceux qui s’égarent, l’arrogance de celui qui m’écoute ne m’intimide pas. Mes pauvres apparences ne signifient pas que je sois ignorant de la foi que je professe ou de la doctrine que je peux enseigner à qui en a besoin. Je n’ai rien et si quelqu’un m’imposait le martyre en échange des vérités chrétiennes, j’irais au martyre avec plaisir. Mais avant, j’ai décidé de vous dire que vous êtes en état de péché mortel, vous offensez Dieu gravement de votre orgueil et si vous ne vous corrigez pas, vos racines, vos honneurs et vos richesses ne vous serviront à rien. Vanité des vanités, ce ne sont que des poids et plus vous voudrez vous en sortir plus vous vous enfoncerez. La colère est un mal très grave qui sert d’appât aux autres péchés et prive l’âme de la sérénité nécessaire pour vaincre le mal des autres domaines. Le colérique est aux mains du diable qui sait bien qu’il a peu d’effort à faire avec ces âmes qui s’enflamment facilement. Modérez vos élans, soyez courtois et humain avec vos inférieurs. J’ignore si vous sentez en vous l’amour de Dieu, mais sans l’amour du prochain, ce grand amour est impossible, car la plante de l’amour plonge ses racines dans notre sol. Les racines sont l’affection que nous avons pour nos semblables et si ces racines sont sèches, comment pouvons-nous espérer récolter des fleurs et des fruits là-haut ? L’attention stupéfaite avec laquelle vous m’écoutez prouve que vous n’êtes pas habitué à entendre des vérités comme celles-là, et encore moins d’un pauvre va-nu-pieds en guenilles. C’est pour cela que la voix du Christ m’a maintes fois soufflé d’entrer, sans craindre rien ni personne et c’est pour cela que je suis entré et que j’ai fait face au dragon. Ouvrez grand la gueule, tendez vos griffes, dévorez-moi si ça vous chante, mais en expirant, je vous redemanderai de vous amender, je vous dirai que le Christ m’envoie ici pour vous appeler à la vérité et vous annoncer votre condamnation si vous ne répondez pas promptement à son appel.
Nazarín fut très surpris de voir que le brave monsieur de la Coreja, non seulement ne se fâchait pas, mais qu’il l’écoutait avec attention et même avec respect, il n’allait pas jusqu’à s’humilier devant le prêtre mais il était abasourdi d’entendre de tels concepts de la part d’une personne si humble.
– Nous reparlerons de cela, dit-il calmement. J’ai une idée… une idée qui me tourmente… parce qu’il faut que tu saches que depuis quelque temps, je perds la mémoire et c’est le pire supplice de ma vie et la raison de mes colères…
Soudain, il se frappa le front et se dit : «J’y suis. Eureka, eurêka !» Il partit presque d’un bond vers une salle attenante et laissa le brave pèlerin seul et de plus en plus perplexe. Comme Belmonte avait laissé la porte ouverte, il put le voir remuer de nombreux papiers sur la grande table de la salle voisine, sorte de bibliothèque ou de bureau,. Il passait en revue rapidement de grands journaux, apparemment étrangers, il feuilletait des revues puis, pour finir, il prit sur une étagère des dossiers qu’il examinait fébrilement. Cela dura près d’une heure. Nazarín vit que des domestiques entraient dans le bureau. Le brave homme leur donnait des ordres, plus aimablement qu’avant, c’est sûr, et enfin, maître et domestiques disparurent par une autre porte qui donnait sur les appartements intérieurs de ce vaste édifice. Resté seul, le brave prêtre examina avec plus de calme la salle où il se trouvait. Il vit sur les murs de vieux tableaux religieux, assez bien faits : Saint Jean reprenant Hérode devant Hérodiade, Salomé en train de danser, Salomé avec la tête de Jean-Baptiste ; sur l’autre côté, des saints de l’Ordre des Frères Prêcheurs et sur le plus grand mur, un beau portrait de Pie IX. Et, mon Dieu, il ne comprenait toujours rien à cette maison ni à son maître, il n’en croyait pas ses yeux. Il commençait même à croire qu’on l’avait abandonné à son triste sort, lorsqu’un domestique entra, l’appela et lui demanda de le suivre.
» Qu’est-ce qu’ils me veulent ? se disait-il, alors qu’il traversait salles et couloirs derrière le laquais. Que Dieu me vienne en aide et si on m’emmène par là pour me mettre dans un cachot ou me jeter dans une citerne ou me couper le cou, que la mort me prenne dans l’état où j’ai toujours désiré être toute ma vie durant.»
Mais, le cachot ou la citerne où on l’emmena n’était qu’une grande salle à manger, joyeuse et très propre. Il vit que la table était mise avec toute la vaisselle et la cristallerie fine en vogue à Madrid. Il y avait deux couverts seulement, face à face. Monsieur de Belmonte était là, vêtu de noir, les cheveux et la barbe très bien soignés, une chemise à jabot et le col lustré. Il signala à Nazarín un des sièges.
– Monsieur, balbutia le pénitent, troublé et confus, ainsi, misérablement vêtu, comment puis-je m’asseoir à cette table si élégante ?
– Assoyez-vous et ne m’obligez pas à le répéter, ajouta-t-il avec plus de rudesse dans les mots que dans la voix.
Comprenant que les minauderies ne cadraient pas avec sa sincère humilité, don Nazario s’assit. Un refus aurait entraîné plus d’orgueil affecté qu’un véritable amour de la pauvreté.
– Je m’assois, monsieur et j’accepte l’honneur démesuré que vous me faites en recevant à votre table, un pauvre vagabond qui a été cruellement mordu hier par les chiens de cette même maison. Une partie de ce que je vous ai dit, tout de suite, sur ordre de mon Seigneur, a perdu de sa valeur à cause de votre acte de charité. Qui agit ainsi n’est pas, ne peut pas être ennemi du Christ.
– Ennemi du Christ ! Mais que dites-vous là, mon ami ? s’écria le géant, bon enfant. Lui et moi sommes si bons amis !
– Bien… Si j’accepte votre noble invitation, mon cher monsieur, je vous supplie d’accéder à ma demande de ne pas changer mes habitudes et de ne prendre que ce dont j’ai besoin pour me nourrir. Non, ne me mettez pas de vin, je n’en bois jamais, pas plus que n’importe quelle liqueur.
– Vous mangez ce que vous voulez. Je n’ai pas l’habitude de forcer mes invités en les poussant au-delà de leur appétit. On vous servira de tout, et vous, vous mangez ou pas, vous jeûnez, vous vous goinfrez ou vous restez sur votre faim, faites comme vous l’entendez… Et en échange de cette concession, mon cher monsieur, moi, à mon tour, je vous demande une permission…
– Permission pour quoi ? Vous n’en avez pas besoin pour me demander tout ce qui vous passera par la tête.
– La permission de vous interroger…
– Sur quoi ?
– Sur les problèmes du jour, d’ordre social et religieux.
– Je ne sais pas si mon peu de savoir me permettra de vous répondre de manière satisfaisante.
– Oh ! Si vous commencez à dissimuler votre science, comme vous dissimulez votre vrai statut, l’affaire est terminée.
– Je ne dissimule rien, je suis tel que vous me voyez. Quant à ma science, bien entendu, elle peut être supérieure à la vie que je mène et aux vêtements que je porte, mais elle ne mérite pas de s’exprimer devant une personne si illustre.
– Nous verrons bien. Moi, je ne sais pas grand chose, mais j’ai un peu appris au cours de mes voyages en Orient et en Occident, dans les comportements humains qui restent la bibliothèque la plus riche et la meilleure chaire du monde, et d’après ce que j’ai pu observer et ce que j’ai pu lire, en particulier à propos des sujets religieux, je thésaurise certaines idées qui sont pour moi la richesse la plus inestimable… Mais, tout d’abord, je meurs d’envie de vous interroger… Que pensez-vous de l’état actuel de la conscience humaine ?
8
– «Ce n’est pas rien comme question ! dit Nazarín en son for intérieur.
– La question est si complexe que je ne sais par où commencer.
– Je veux parler de l’état actuel des croyances religieuses en Europe et en Amérique.
– Je crois, mon cher monsieur, que les progrès du catholicisme sont tels que le siècle prochain verra les églises dissidentes réduites à presque rien. La sagesse, la bonté angélique, le tact exquis de l’incomparable Pontife qui gouverne l’Eglise y tiennent une grande importance.
– Sa Sainteté Léon XIII, dit fermement monsieur de Belmonte, oui, nous boirons à sa santé.
– Non. Excusez-moi. Je ne bois pas, pas même à la santé du pape, car ni le pape, ni le Christ ne peuvent vouloir me voir changer mes habitudes de vie… Je disais donc qu’apparemment l’humanité est fatiguée des spéculations scientifiques et de ses tromperies et on sent un heureux retour au spirituel. Il ne pouvait pas en être autrement. La science ne résout aucun problème de transcendance sur nos origines ou notre destinée et ses applications absurdes sur le plan matériel ne donnent pas non plus les résultats escomptés. Après les progrès de la mécanique, l’Humanité est encore plus malheureuse, le nombre de pauvres et d’affamés est encore plus grand, les déséquilibres dans le domaine du bien-être social encore plus cruels. Tout pousse aux voies, un moment abandonnées, qui conduisent à l’unique source de la vérité: la pensée religieuse, l’idéal catholique qui a prouvé qu’il était immuable et impérissable.
– Tout à fait, affirma le gigantesque haut personnage qui, soit dit en passant, mangeait avec un appétit féroce tandis que son hôte goûtait à peine aux plats riches et variés. Je vois avec joie que nous avons les mêmes idées.
– La situation du monde est telle, continua Nazarín, enhardi, qu’il faut être aveugle pour ne pas voir les signes précurseurs de l’âge d’or de la religion. Il nous vient de là-bas un air frais que nous prenons en pleine figure et qui nous annonce que la fin du désert approche, voilà que vient la terre promise avec ses vertes vallées et ses collines ruisselantes.
– C’est vrai, c’est vrai. Je le pense aussi. Mais vous ne nierez pas que la société est fatiguée de marcher dans le désert et comme son désir tarde à se réaliser, elle peut s’impatienter et faire mille bêtises. Où est le Moïse qui la retiendra par la rigueur et la douceur ?
– Ah ! Le Moïse… ! Je ne sais pas.
– Ce Moïse, devons-nous le chercher dans la philosophie ?
– Non, sûrement pas ; la philosophie n’est, en somme, qu’un jeu de mots et de concepts, derrière lesquels il n’y a que du vide et les philosophes soufflent un air sec et décourageant sur le rude chemin de l’Humanité.
– Trouverons-nous ce Moïse dans la politique ?
– Non. La politique est maintenant dépassée. Elle a rempli sa mission et ce qu’on appelait les problèmes politiques, concernant la liberté, les droits de l’homme, etc. sont désormais résolus mais l’Humanité n’en a pas pour autant trouvé le nouveau Paradis terrestre. Après la conquête de tant de droits, les peuples ont-ils moins faim qu’avant ? De nombreux progrès politiques, mais guère de pain. Beaucoup d’avancées matérielles et chaque fois moins d’emplois et beaucoup de désœuvrés. N’attendons rien de bon de la politique, elle a donné tout ce qu’elle pouvait. Elle nous a tous rendus malades, partisans et adversaires avec ses querelles publiques et privées. Qu’ils rentrent chez eux tous ces hommes politiques, ils sont maintenant inutiles à l’Humanité. Les vains discours, les formules ridicules, tout cet encombrement de nullités, des plus nuls aux plus quelconques, des quelconques aux plus notables, des plus notables aux grands hommes, tout cela, ça suffit.
– Bien, très bien. Vous vous exprimez à merveille. Trouverons-nous ce Moïse dans le secteur des plus forts ? Un dictateur, un militaire, un César… ?
– Je ne saurai vous répondre ni oui ni non. Notre intelligence, la mienne au moins, n’y arrive pas. Je ne peux affirmer qu’une chose : il ne reste plus que quelques lieues à faire dans le désert, mais qui dit lieues dit une distance relativement grande.
– Eh bien, pour moi, le Moïse qui doit nous guider jusqu’au bout ne peut venir que du religieux. Ne croyez-vous pas qu’il va apparaître au moment le plus inattendu ? Ce sera un de ces hommes extraordinaires, un génie de la foi chrétienne, une sorte de François d’Assise, ou même mieux, qui conduira l’Humanité jusqu’aux limites de ses souffrances, juste avant que le désespoir ne le mène au cataclysme.
– Cela me paraît très juste de penser ainsi, dit Nazarín, et ce sauveur extraordinaire ne peut être qu’un Pape, ou bien je me trompe lourdement.
– Vous croyez ?
– Oui, monsieur… C’est un coup de cœur, une idée venue de la philosophie de l’histoire, mais Dieu me préserve de lui donner une quelconque autorité dogmatique.
– Bien entendu !… Je pense pareil, exactement pareil. Cela ne peut être qu’un Pape. Mais quel pape ? Allez donc savoir !
– Notre intelligence pèche par orgueil à vouloir scruter davantage. Le présent nous offre assez de matière à réflexion. Le monde va mal.
– Cela ne peut pas être pire.
– La société humaine souffre. Elle cherche son remède.
– Ce ne pourra être que la foi.
– Et ceux qui ont la foi, ce don du ciel, il leur sera donné de conduire ceux qui en sont privés. Dans ce domaine comme dans bien d’autres, les aveugles doivent se laisser conduire par ceux qui voient. On a besoin d’exemples et non de phraséologie usée. Il ne suffit pas de prêcher la doctrine du Christ, il faut lui donner une existence pratique et imiter sa vie dans la mesure où il est possible à l’humain d’imiter le divin. Pour que la foi parvienne à se répandre, dans l’état actuel de la société, il faut que ses partisans renoncent à ces artifices qui lui viennent de l’Histoire, comme les torrents descendent de la montagne, mais qu’ils défendent et pratiquent la vérité élémentaire. Ne pensez-vous pas ? Pour rendre manifestes les bénéfices de l’humanité, il faut être humble, pour exalter la pauvreté comme la meilleure condition possible, il faut être pauvre et l’être vraiment pas seulement paraître. Voilà ma doctrine… Non, je me suis mal exprimé, c’est la représentation que je me fais de la doctrine de toujours. Le remède au mal-être social et à la lutte de plus en plus amère entre les riches et les pauvres, quel est-il ? C’est la pauvreté. Renoncer à tout bien matériel. Le remède aux injustices qui enlaidissent le monde, au milieu de tous ces désenchantements politiques du progrès, c’est quoi ? Eh bien, c’est de ne pas lutter contre l’injustice, c’est de s’en remettre à la méchanceté humaine comme le Christ s’est rendu sans défense à ses ennemis. De la résignation absolue devant le mal, il ne peut sortir que du bien, tout comme la force vient de la douceur, en fin de comptes, de l’amour de la pauvreté devra bien sortir la consolation de tous et l’égalité devant les biens de la Nature. Voilà mes idées, ma façon de voir le monde et ma confiance absolue aux effets du fondement chrétien, tant dans l’ordre spirituel que matériel. Je ne me contente pas de me sauver, tout seul, je veux que tous soient sauvés et que disparaissent du monde, la haine, la tyrannie, la faim, l’injustice. Qu’il n’y ait plus ni maîtres, ni esclaves, qu’on en termine avec les disputes, les guerres, la politique. Voilà ce que je pense, mais si tout cela peut paraître des billevesées aux yeux du bien-pensant que vous êtes, tant pis, je persiste dans mon erreur, si c’en est une, dans ma vérité, si, comme je le crois, elle demeure dans mon esprit, et dans ma conscience comme la lumière de Dieu.
Don Pedro entendit toute la fin de ce substantiel discours avec beaucoup de recueillement, les yeux mi-clos, les doigts caressant une coupe de vin généreux dont il n’avait bu que la moitié à peine. Il murmurait doucement : «C’est vrai ça ! Tout à fait vrai !… posséder la vérité, quel bonheur !… La pratiquer, encore mieux !…»
Nazarín récita les prières d’actions de grâces et don Pedro continua à ronchonner, les yeux fermés : «La pauvreté… que c’est beau !… mais, moi, je ne peux pas, je ne peux pas… Quel délice ! La faim, le dénuement, l’aumône… Magnifique… mais, non, moi, je ne peux pas.»
Quand ils se levèrent de table, le ton et les allures du géant étaient tout à fait différents du matin. La sauvagerie s’était tue pour faire place à la gaieté de la bonne éducation. C’était un autre homme. Il conservait le sourire aux lèvres et ses yeux brillants l’avaient rajeuni apparemment.
– Bon, mon père, vous voulez sans doute vous reposer. Vous devez avoir l’habitude de faire la sieste…
– Non, monsieur, je ne dors que la nuit. Tout le reste de la journée, je suis debout.
– Eh bien, moi, pas. Je me lève tôt et à cette heure-ci, j’ai besoin d’un petit sommeil. Vous allez vous reposer vous aussi. Venez, venez avec moi.
Bon gré mal gré, on emmena Nazarín non loin de la salle à manger dans une chambre richement meublée.
– Oui, monsieur… oui, lui dit Belmonte sur un ton cordial. Reposez-vous, reposez-vous, vous en avez grand besoin. Cette vie de pauvre errant, cette vie d’anéantissement volontaire, d’ascétisme, d’exercices et de privations, mérite bien quelques ménagements. Il ne faut pas abuser de ses forces, mon bon ami. Oh ! Je vous admire, je vous respecte et je vous tire ma révérence d’autant plus que je manque de courage pour vous imiter ! Abandonner ma position, dissimuler un nom illustre, renoncer au confort, aux richesses, aux… !
– Moi, je n’ai pas dû renoncer à tout cela, car je n’ai jamais rien eu.
– Comment ça ? Allez, monsieur, plus de fables avec moi, mais je ne dirai pas de bêtises pour ne pas vous offenser.
– Que dites-vous ?
– Que sous vos dehors chrétiens, vraie tunique de disciple de Jésus, vous pourrez en tromper d’autres mais pas moi. Je vous connais bien, j’ai l’honneur de bien savoir à qui je parle.
– Et qui suis-je donc, monsieur de Belmonte ? Dites-le-moi, puisque vous le savez.
– Allons, c’est inutile de vous cacher, mon cher monsieur ! Vous…
Monsieur de la Coreja, reprit son souffle et sur le ton de la courtoisie familière, posant sa main sur l’épaule de son hôte, il dit :
– Excusez-moi de vous avoir dévisagé. Je parle au révérendissime évêque arménien qui parcourt l’Europe depuis deux ans, en pèlerin.
– Moi… un évêque arménien !
– Autrement dit… Je sais tout !… autrement dit, patriarche de l’Eglise d’Arménie qui s’est soumise à l’Eglise latine en reconnaissant l’autorité de notre grand pape Léon XIII.
– Monsieur, monsieur, au nom de la très sainte Vierge !
– Votre révérence traverse les nations européennes en pèlerin, pieds nus et sous d’humbles vêtements, vivant de la charité publique, pour accomplir le vœu que vous avez fait au Seigneur, s’il vous accordait l’entrée de vos ouailles dans le grand troupeau du Christ… Mais si, ce n’est pas la peine de nier ni de vous obstiner à vous cacher, attitude que je respecte cependant ! Votre révérence illustrissime a reçu l’autorisation d’accomplir ce vœu de cette façon en renonçant temporairement à toutes ses dignités. Je ne suis pas le premier à le découvrir. On vous a déjà découvert en Hongrie où on susurre même que vous avez fait des miracles ! On vous a découvert aussi à Valence en France, capitale du Dauphiné… Mais, j’ai là les journaux qui parlent de l’insigne patriarche, ils en font le portrait, décrivent les vêtements de manière très exacte… C’est pour cela que dès que je vous ai vu approcher de la maison, j’ai eu des doutes. Puis j’ai cherché les récits des journaux. Le même, le même ! Quel grand honneur que vous me faites !
– Monsieur, mon cher monsieur, je vous supplie de m’écouter…
Mais le géant, tout troublé, ne le laissait pas placer un mot et étouffait sa voix et noyait ses mots dans un flot de paroles.
– Nous nous connaissons, j’ai vécu longtemps en Orient, il est donc inutile mon Révérend de continuer plus avant cette pieuse comédie ! Je vais laisser vos titres de côté si vous le voulez vraiment… Vous êtes arabe de naissance.
– Par la croix de notre Seigneur Jésus-Christ !…
– Arabe légitime. Je connais votre histoire par cœur. Vous êtes né dans un pays magnifique, on dit même que c’était le Paradis terrestre, entre le Tigre et l’Euphrate, territoire qu’on appelle Al-Jezira, on dit aussi Mésopotamie.
– Doux Jésus !
– Mais si, je le sais bien, je sais tout ! Votre nom arabe est Esrou-Esdras.
– Vierge bénie !
– Mais les franciscains du Mont Carmel vous ont baptisé, vous ont éduqué et vous ont appris le beau langage que vous parlez, l’espagnol. Vous êtes ensuite allé en Arménie où se trouve le mont Ararat, que j’ai visité moi-même… C’est là que s’est échouée l’arche de Noé.
– Vierge conçue sans péché !
– Vous avez alors choisi le rite arménien. Vous vous êtes fait remarquer par votre science et votre vertu et vous êtes parvenu au Patriarchat et c’est là que vous avez essayé et réussi la grande affaire de faire revenir l’Eglise orpheline au sein de la grande famille catholique. Là-dessus, je ne vous embête pas plus, révérendissime monsieur. Reposez-vous bien sur ce lit. On ne peut pas toujours être dans la rigueur, l’abstinence et la mortification. Il faut bien de temps en temps savoir faire quelque concession au confort, et surtout, Eminentissime monsieur, vous êtes chez moi et au nom de la sainte loi de l’hospitalité, je vous ordonne de vous coucher et de dormir.
Sans explication aucune et sans attendre de réponse, il sortit de la pièce en riant. Le bon Nazarín resta tout seul, la tête de celui qui est resté longtemps au milieu de la canonnade, à se demander s’il devait dormir ou veiller, s’il rêvait ou si tout ce qu’il avait vu et entendu était vrai.
9
«Mon Dieu ! Mon Dieu ! s’exclamait le bienheureux prêtre. Quelle sorte d’homme est-ce là ? Je n’ai jamais vu un bagou pareil. Mais il ne me laisse même pas lui répondre ou lui expliquer… ! Croit-il vraiment ce qu’il dit ?… Que moi, je suis un patriarche arménien et que je m’appelle Esdras et … Mon Dieu ! Mère très aimante, permettez-moi de m’échapper vite de cette maison, car la tête de cet homme est comme une grande cage pleine de chardonnerets, de merles, de calandres, de pies et de perroquets et ils chantent tous ensemble… Je crains que ce ne soit contagieux. Bénie soit la sainte Miséricorde !… Dieu fait de bien bizarres créatures, quelle variété d’êtres ! Quand on croit avoir tout vu, on s’aperçoit qu’il reste plein de merveilles et de bizarreries à voir… Il voudrait que je me couche dans ce si beau lit, au couvre-lit damasquiné… ! Au nom du Père… ! Et dire que je pensais recevoir ici vexations, mépris et même peut-être le martyre… voilà que je me trouve face à un géant malicieux qui me fait asseoir à sa table, m’appelle monseigneur et m’introduit dans cette jolie chambre pour faire la sieste ! Mais cet homme est bon ou méchant… ?
Le pauvre prêtre sémitique se perdit dans des réflexions sans fin, l’affaire que sa petite tête se proposa de l’élucider était embrouillée et difficile. Avant même d’avoir pu définir l’être moral de don Pedro de Belmonte, voilà que celui-ci réapparut après sa sieste. Dès qu’il le vit, Nazarín se présenta à lui, résolument et, sans lui laisser le champ libre, il le prit par le revers de son vêtement et lui dit sur un ton extrêmement vif :
– Venez par ici, mon cher monsieur car comme vous ne me laissiez pas le temps de souffler, je n’ai pas pu vous dire que je ne suis ni arabe, ni évêque, ni patriarche, je ne m’appelle pas Esdras et je ne suis pas originaire de Mésopotamie mais de Miguelturra et je m’appelle Nazario Zaharin. Sachez qu’il n’y a rien en moi qui soit de la comédie, à moins que vous ne considériez ainsi, vous, le vœu de pauvreté que j’ai voulu faire, sans renoncer…
– Monseigneur, monseigneur, je comprends que vous teniez absolument à cacher…
– Sans renoncer, dis-je, aux honneurs et aux émoluments que je n’ai jamais eus et je n’en veux pas…
– Mais je ne vais pas révéler votre secret, bon sang ! Je trouve normal que vous teniez à ce rôle et que…
– Et que rien. Car tout ce que vous avez dit est une bêtise, c’est du rêve, du délire. J’ai commencé cette vie de pénitence poussé par un élan du cœur que j’ai en moi depuis tout petit. Je suis prêtre et même si je n’ai demandé à personne de laisser l’habit et de me mettre à mendier, je pense être toujours dans la pure orthodoxie et je respecte et vénère tout ce que commande l’Eglise. Si j’ai préféré la liberté au cloître, c’est que je vois dans cette libre pénitence davantage de difficultés, d’humiliation et parce que je trouve plus patent le renoncement à tous les biens du monde. Je me fiche de l’opinion des autres, je défie la faim et le dénuement, j’aspire aux outrages et au martyre. Et là-dessus, je prends congé de monsieur de la Coreja, en lui disant que je suis ravi de sa gentillesse et que je le porterai toujours dans mes prières.
– Le plus reconnaissant, c’est moi, non seulement pour l’honneur que votre Révérence m’a faite…
– Allez ! ça recommence !
– … et l’honneur immense que j’ai de vous avoir eu sous mon toit. Mais votre offre de prier pour moi et de me recommander à Dieu, j’en ai grand besoin, croyez-moi.
– Je le crois… Mais, de grâce, s’il vous plaît, ne m’appelez pas Révérence.
– Bon : je vous traiterai en toute simplicité, en récompense de votre humilité, répondit le gentilhomme qui se serait fait égorger vif plutôt que de renoncer à ce qu’il avait soutenu et affirmé. Vous avez raison de rester incognito, cela évite les indiscrétions…
– Mais, monsieur… ! Enfin, donnez-moi la permission de me retirer. Je demande à Dieu de vous corriger de votre entêtement. C’est d’ailleurs une sorte d’orgueil. La colère est aussi le fruit de l’orgueil tout comme le mensonge est le fruit de l’entêtement. Vous voyez tout ce que l’orgueil apporte de mal. Mes dernières paroles en sortant de cette noble maison sont pour vous encourager à vous défaire de tous ces péchés, pensez à la vie éternelle. Il est inutile de frapper à cette porte, l’âme chargée de toutes ces jouissances et tous ces appétits matériels. La vie que vous menez, mon cher monsieur, vous conduira peut-être à une vieillesse robuste mais pas au salut éternel.
– Je sais bien, je sais bien, disait le brave don Pedro, souriant de manière mélancolique pendant qu’il accompagnait Nazarín jusqu’au premier patio. Mais, que voulez-vous, mon excellent ami, tout le monde n’a pas votre énergie… Ah ! Arrivé à un certain âge, on a la peau trop dure pour être soumis à des abstinences et à des changements de caractère. Croyez-moi, quand notre pauvre corps est à deux doigts de la mort, c’est de la cruauté de lui refuser ce à quoi il est habitué. Je suis faible, je le reconnais, je pense parfois que je devrais bien lui donner un tour de vis à ce pauvre corps. Mais ensuite, ça me fait pitié et je me dis : «Mon pauvre corps, pour les jours qui te restent…» C’est là aussi une marque de charité, n’est-ce pas ? Bon, c’est que le gredin aime bien la bonne table, les bons vins. Et que faire sinon les lui donner… ? Il veut la dispute, va pour la dispute… Tout cela est bien innocent. La vieillesse a besoin de ses jouets comme les enfants. Ah ! Lorsqu’il avait quelques ans de moins, il s’adonnait à bien d’autres choses… Les belles filles, par exemple… De cela, c’est vrai, je l’en ai privé complètement… Non, non, il ne manquerait plus que ça ! Interdiction totale. Il n’a qu’à supporter… Je ne le lui laisse que les broutilles du péché, manger, boire, fumer et se fâcher avec les employés… Enfin, monsieur, je ne veux pas vous retenir davantage. Priez Dieu pour moi. C’est une chance pour nous, les pauvres mécréants d’avoir auprès de nous des êtres parfaits comme vous, prêts à intercéder pour tous et à obtenir par leurs excellentes vertus, leur salut personnel et celui des autres.
– Non, non, ça ne marche pas.
– Si, si, ça marche tant qu’on fait ce qu’on peut. Je sais ce que je dis… Vos pénitences, père très saint, vous mèneront à la perfection que vous cherchez et Dieu vous donnera la force de continuer une si sainte et si méritoire action… Au revoir, au revoir.
– Au revoir, mon cher monsieur. Ne vous dérangez pas. Et tant que j’y pense, j’ai laissé mon sac près de la noria.
– Bon, bon, on vous l’apporte, répondit Belmonte. J’ai envoyé quelqu’un y mettre quelques victuailles, il n’y en a jamais trop, croyez-moi. Et même si vous ne mangez que de la verdure et du pain dur, cela ne vous fera pas de mal d’emporter quelque chose de solide en cas de maladie…
Il voulut lui baiser la main, mais don Nazario, à grand peine, l’en empêcha et sur le terre-plein devant la maison, ils se saluèrent en se montrant de grandes marques d’affection mutuelle. Comme don Pedro vit que les chiens erraient tout seuls dans la nature, il donna l’ordre de les attacher tout en retenant Nazarín un instant.
– J’ai appris, lui dit-il, qu’hier, et cela m’a beaucoup contrarié, qu’à cause de la négligence de cette canaille, les chiens vous avaient mordu, vous et les deux saintes femmes qui vous accompagnent.
– Ces femmes ne sont pas saintes, loin de là.
– Dissimuler, toujours dissimuler…. Comme si la Presse européenne n’en parlait pas !… L’une est Première dame, chanoinesse de Thüringen ; l’autre, une soudanaise déchaussée…
– Ah ! Que de bêtises !…
– Les journaux le disent !… Enfin, je respecte votre saint incognito… Adieu. C’est bon, les animaux sont attachés.
– Adieu… Et que le Seigneur vous illumine, dit Nazarín qui ne voulait pas discuter davantage et voulait filer le plus vite possible.
Le sac, débordant de paquets de nourriture, pesait pas mal, et à cause de cela et de sa marche rapide, il arriva tout haletant à l’ormaie où Ándara et Beatriz étaient restées à l’attendre. Les deux femmes, impatientes et inquiètes de tant de retard, se mirent à courir dès qu’elles l’aperçurent. Elles étaient folles de joie de le retrouver, car elles avaient bien cru ne jamais le revoir ou qu’il reviendrait de la Coreja, le crâne brisé. Elles furent tout étonnées et bien contentes de le revoir sain et sauf. Dès les premiers mots du saint homme, elles comprirent qu’il aurait plein de choses à raconter, mais le poids et le volume de son sac éveilla plutôt leur curiosité. Sous l’ormaie, Nazarín vit une vieille inconnue, la mère Polonia, compatriote de Beatriz et habitant près de Sevilla la Nueva. Elle passait par là, de retour de ses champs où elle avait semé des navets et s’était mise à discuter avec elle.
– Ah ! Mon Dieu ! Quel homme bizarre que ce don Pedro ! dit le petit père en s’étendant par terre. Ándara lui avait pris son sac pour en examiner le contenu. Je n’ai jamais vu cela. Il a un côté méchant, soumis à tous les vices et un bon côté, très brave, courtois et chevaleresque. Il ne manque pas de culture, de finesse n’en parlons pas, c’est un mauvais caractère aussi et il n’y a pas plus têtu pour persister dans ses erreurs.
– Ce vieux grigou géant et beau garçon, dit Polonia qui était en train de tricoter une chaussette, est fou à lier. On raconte qu’il est resté longtemps chez les Maures et les Juifs, et qu’à son retour, il s’est mis à faire des études sur la religion, la thiologie… ça l’a complètement abruti.
– C’est bien ce que je disais. Monsieur don Pedro ne raisonne pas comme il faut. Quel dommage ! Dieu lui accorde le jugement qui lui manque !
– Il est fâché avec toute la famille des Belmonte, ses neveux et ses cousins. Ils ne peuvent plus le supporter, c’est pour cela qu’il ne sort plus d’ici. C’est un païen et un mécréant en ce qui concerne les vices de la table, et il ne peut pas voir une jupe sans qu’elle lui tape dans l’œil. Quant à dire qu’il a mauvais fonds, non. On raconte que lorsqu’on lui parle des histoires de religion catholique ou bien d’histoire païenne ou d’idolâtrie, si l’occasion se présente, c’est à ce moment-là qu’il perd tout jugement. C’est à cause de cette légende et parce qu’il a brassé un tas de documents sur les saintes Ecritures qu’il est devenu fou.
– Pauvre homme !… Vous n’allez pas me croire, les filles, mais il m’a assis à sa table, une table magnifique, avec une vaisselle de cardinal. Et des plats ! Des mets exquis !… Puis, il s’est mis dans la tête de me faire faire la sieste dans un lit couvert d’un dessus damasquiné… Enfin, moi qui…
– Et nous qui pensions qu’il aurait bien pu vous briser les os !
– Ensuite, je vous dis… Il s’est mis dans la tête que je suis évêque, plus que cela, patriarche, que je suis né à Al-jézira… autrement dit en Mésopotamie, et que je m’appelle Esdras… Il est même allé jusqu’à dire que vous étiez des chanoinesses… et ce n’était pas la peine de le contrarier et de lui dire la vérité. Cela ne servait à rien.
– Bon, on voit bien qu’il aime la bonne chère, ce brave homme, dit Ándara, joyeusement, tout en sortant les paquets de viande. De la langue de bœuf… de la langue encore… du jambon… Mon Dieu ! Que de bonnes choses ! Et ça, qu’est-ce que c’est ? Une tourte grosse comme la roue d’une charrette. Qu’est-ce que ça sent bon !… Il y a aussi des croustades, une, deux, trois… du chorizo, des saucisses…
– Garde tout cela, lui dit Nazarín.
– Bien sûr que je vais le garder, nous y goûterons quand il sera l’heure.
– Non, ma fille, on n’y goûtera pas.
– Ah non !
– Non, tout ça c’est pour les pauvres.
– Mais, y a-t-il plus pauvres que nous, monsieur ?
– Nous, nous ne sommes pas pauvres, nous sommes riches, puisque nous avons le flot immense et les inépuisables provisions de la fraternité chrétienne.
– Très bien dit, fit remarquer Beatriz tout en aidant Ándara à tout remettre dans le sac.
– Si nous avons tout ce qu’il nous faut maintenant, s’il ne nous manque rien, parce que nous sommes rassasiés, dit don Nazario, nous devons donner à ceux qui en ont davantage besoin.
– A Sevilla la Nueva, ce n’est pas la pauvreté qui manque, dit la mère Polonia. Vous avez là où répartir toutes ces bonnes choses. Vous ne trouverez pas plus pauvre ni plus misérable.
– C’est vrai ? Eh bien, nous y porterons ces restes de la table de notre riche Harpagon, puisque nous y avons eu droit. Montrez-nous, madame Polonia, indiquez-nous les maisons les plus dans le besoin.
– Mais, c’est vrai que vous allez entrer dans Sevilla ? Les filles m’ont dit qu’elles ne voulaient pas y aller.
– Pourquoi ?
– Parce qu’il y a la variole.
– Très bien !… Je veux dire… non pas que c’est très bien, mais nous allons avoir l’occasion de trouver la misère humaine, nous battre et la vaincre.
– Ce n’est pas une épidémie. Il n’y a eu que deux ou trois cas ces derniers jours. Là où il y a une mortalité horrible, c’est à Villamantilla, deux lieues plus loin.
– Une épidémie horrible… et de variole ?
– C’est effrayant, oui, monsieur. Il n’y a personne pour s’occuper des malades et les bien-portants fuient épouvantés.
– Ándara, Beatriz… dit Nazarín en se mettant debout. En route. N’attendons pas une minute de plus.
– Nous allons à Villamantilla ?
– Le Seigneur nous y appelle. On a besoin de nous là-bas. Et alors ? Vous avez peur ? Celle qui a peur ou qui est dégoûtée, qu’elle reste.
– Allons-y. Qui a parlé d’avoir peur ?
Sans perdre un instant, ils reprirent leur marche et en chemin, Nazarín leur racontait, avec un luxe de détails, le singulier épisode de sa visite à don Pedro de Belmonte, seigneur de la Coreja.
[1] Allusion à Luc 9/58.
[2] Allusion à Mt. 8/8 l’enfant du centurion.
[3] Allusion comme souvent dans les romans de Galdós et tout particulièrement dans Nazarin, à don Quichotte. Dans le chapitre suivant, le brave prêtre s’en va à la propriété où il pressent des tourments et des difficultés chez ce Belmonte, qui est un géant !




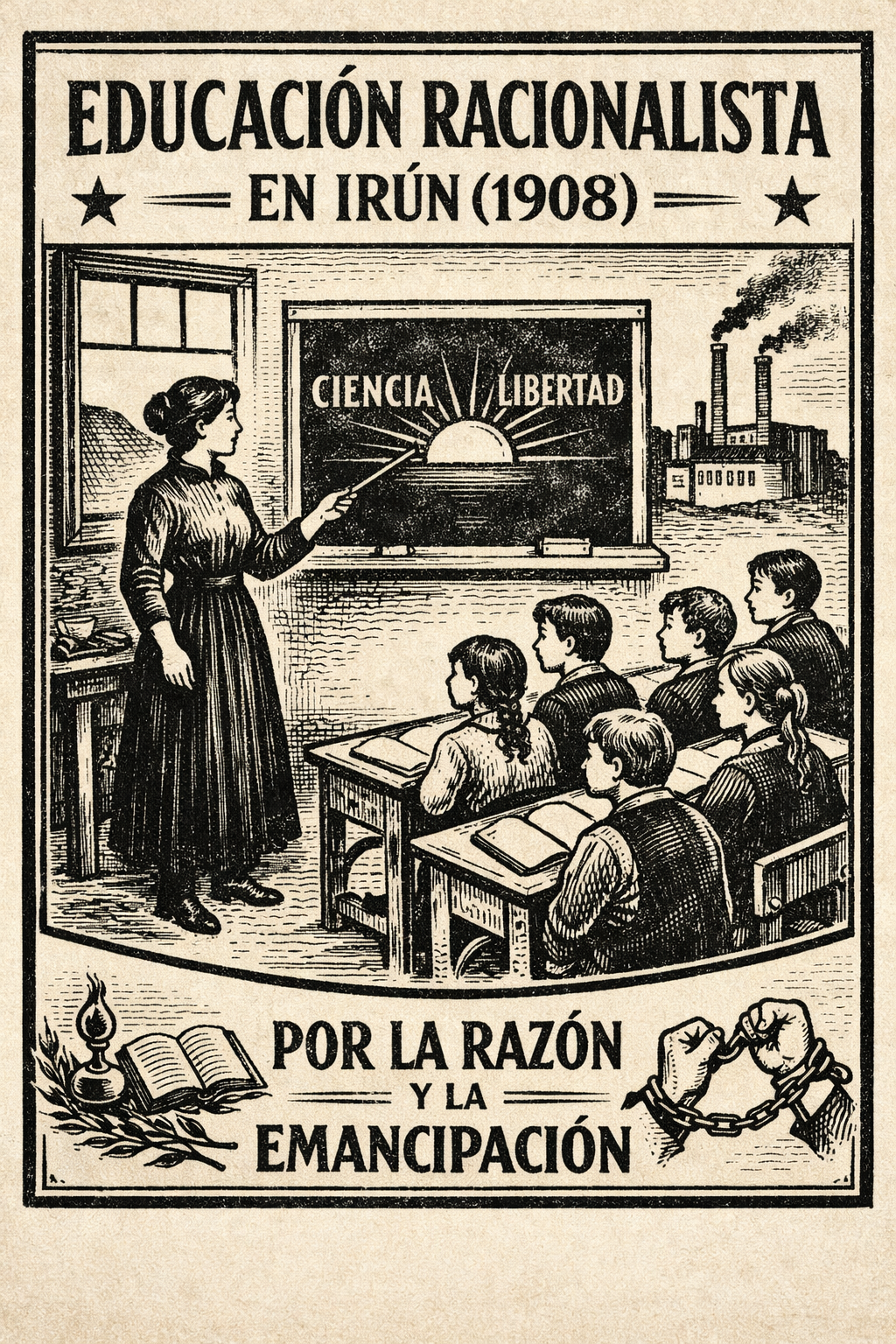











Started with phdrean1 today, and so far I am not dissapointed and have had some small fun. Not making any promises but it shows potential for good gaming experiences, or something. Go check it, here phdrean1.
Just tried 444wim, and it’s pretty cool! The interface is smooth, and I love the selection. Definitely worth checking out. You can find it here: 444wim
PKRVIPgames sounds kinda exclusive, doesn’t it? I’m curious what kinda games they have. Anyone tried it out? Let me know! pkrvipgames
Popbra RTP, eh? So, we’re talkin’ slots, are we? Gotta see if those RTPs are juicy enough to spin! Don’t wanna waste my money on tight machines. popbra rtp
Very interesting details you have noted, thankyou for putting up. «She had an unequalled gift… of squeezing big mistakes into small opportunities.» by Henry James.
**mitolyn reviews**
Mitolyn is a carefully developed, plant-based formula created to help support metabolic efficiency and encourage healthy, lasting weight management.
Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.