No hay productos en el carrito.

Scène IV
Nell et Dolly. Don Rodrigo de Arista-Potestad, comte d’Albrit, marquis des Baztanes, seigneur de Jerusa et de Polan, Grand d’Espagne, etc.
C’est un beau vieillard noble, longue barbe blanche et allure corpulente, légèrement voûté. Il est habillé d’un costume de voyage très usé mais propre. Il a de grosses chaussures et s’appuie sur un solide bâton noueux. On voit à son allure qu’il s’agit d’une personne sur le déclin et ruinée mais distinguée.
Nell – (L’observant, craintive.) C’est un pauvre vieillard… Pourquoi est-ce qu’il nous regarde ainsi ? Est-ce qu’il va nous faire du mal ?
Dolly – On dirait le Saint Nicolas des contes anglais. Mais il n’a pas de sac sur le dos.
Nell – Tu sais que j’ai peur, Dolly ?
Dolly – Moi aussi. C’est peut-être un mendiant.
Nell – Si au moins on avait quelques sous, on les lui donnerait… Oh, il ne bouge pas !…
Dolly – Voilà qu’il nous fixe des yeux…
Nell – (Toute pâle.) On dirait qu’il parle tout seul… Oh, que j’ai peur !
Dolly – (Tremblante.) Et dire qu’il n’y a pas âme qui vive. Si on appelle, personne ne nous entendra.
Nell – Je pense qu’il ne nous fera rien.
Dolly – Le mieux est de lui parler.
Nell – Vas-y toi, parle… Dis-lui : Monsieur le mendiant…
Dolly – Ce n’est pas un mendiant. On dirait plutôt une personne honnête mais mal habillée. (Le chien se lance en aboyant furieusement sur le comte.)
Nell – Capitán, viens ici…

Dolly – Ah ! Nell, je connais cette tête !…
Nell – Moi aussi, je l’ai vue quelque part. Ah ! Ah ! (Elles se rapprochent l’une de l’autre comme pour mieux se protéger.) Il avance, maintenant… Il nous fait signe…
Dolly – On dirait qu’il pleure. Le pauvre monsieur !…
Le comte – (D’une voix grave, tout en avançant.) Jolies petites filles, n’ayez pas peur. C’est vous Leonor et Dorotea ?
Nell – Oui, monsieur, on s’appelle comme ça.
Le comte – (En arrivant près d’elles.) Eh bien, embrassez-moi. Je suis votre grand-père. Vous ne me reconnaissez pas ? Ah ! Il y a tant d’années que vous m’avez vu la dernière fois. Vous étiez toutes petites et si mignonnes… Vous voir comme ça si gracieuses et si éveillées me rendrait fou… (Il les embrasse et dépose un baiser sur leur front.)
Dolly – Cher grand-père !
Nell – Je me disais : mais, je le connais.
Dolly – On t’a reconnu à ton portrait.
Le comte – Et moi, je vous ai reconnues à la voix. Je ne sais pas ce qu’a le timbre de votre voix mais ça me remue le cœur. J’ai l’impression que les deux sons ne font qu’un, c’est bizarre, non ? Laissez-moi vous regarder comme il faut : vous avez les mêmes frimousses, c’est comme le son de vos voix… Non, non, je ne vous vois pas bien, mes pauvres filles. Je suis presqu’aveugle. Allez, en route pour Jerusa. (Capitán ouvre la marche.)
Nell – Quelle bonne surprise, cher grand-père ! Eh bien, écoute, tu nous as fait peur.
Le comte – Je vous ai fait peur, moi qui vous adore ?
Dolly – Senén nous a dit hier soir que tu venais, mais nous ne t’attendions pas si vite.
Nell – Comment ? Tu n’es pas venu, en voiture ?
Le comte – Je supporte très mal les secousses de cet engin… et venir au milieu de ces gens grossiers et stupides… Non, non… J’ai préféré venir à pied, sans autre compagnie que ce bâton qu’un berger de mon temps m’a offert à Polan. Vous vous rendez compte comme il doit être vieux, le bonhomme ! Je n’étais qu’un gamin et lui était déjà un solide jeune homme, fort comme un roc. Nous allions dans ces bois pour la tonte…
Nell – Mais, tu viens de Polan ?
Le comte – J’y ai passé la nuit, dans la cabane de Martín Paz… Ensuite, je suis venu tout doucement le long de la falaise, ça m’a rappelé les anciens temps. Ah ! Tous les chemins et sentiers de ce pays me connaissent ; toutes les broussailles, les rochers et les arbres me connaissent… Même les oiseaux, on dirait que ce sont les mêmes que j’ai connus dans mon enfance. Cette magnifique Nature a été ma nourrice. Vous ne pourrez pas comprendre, vous, petites filles innocentes, vous débutez dans la vie, vous ne pourrez pas comprendre comme c’est à la fois agréable et triste de parcourir tous ces lieux et comme je souffre et comme je suis heureux en même temps de faire revivre à mon passage les choses et les personnes ! J’ai l’impression que tout ce qui m’entoure me voit et me reconnaît… De la mer immense à l’insecte invisible, tout ce qui vit ici, reste en émoi… je ne sais pas comment dire… s’arrête et me regarde… pour voir passer le malheureux comte d’Albrit. (Les deux petites poussent un soupir.)
Dolly – Appuie-toi sur mon bras, grand-père.
Nell – Et sur le mien.
Le comte – Sur les deux… Une de chaque côté. Comme ça… Vous allez me porter comme le feraient des anges.
Scène V
Nell, Dolly, le comte et Senén, qui a vu la scène de la rencontre entre le grand-père et ses petites filles de loin, caché derrière un arbre.
Senén – Il est bien abîmé, le vieux lion d’Albrit ! Quelle dégringolade !… Bon, aujourd’hui il ne serait pas bien de me brouiller avec lui. On ne sait jamais vers où souffle la chance. (Voyant le groupe avancer il se présente, chapeau en main.) Monsieur le Comte, bienvenue à vous, mille fois bienvenue sur cette terre de vos aïeux. Quelle belle allure, votre Excellence, entre ces deux anges !
Le comte – (En s’arrêtant.) Qui me parle ?
Nell – C’est Senén, papa.
Dolly – Tu ne t’en souviens pas ?
Senén – Senén Corchado, monsieur, celui qui a été… je n’ai pas honte de le dire, domestique chez monsieur le comte de Laín.
Le comte – Ah ! Laquais ! (Pris d’une soudaine colère, cherchant son bâton.) Tu viens ici pour que je te donne du bâton ?
Senén – (Il s’écarte.) Monsieur !…
Nell – Grand-père, qu’est-ce qui t’arrive ?
Dolly – Il est de la maison, c’est notre ami.
Le comte – (Se reprenant.) Excusez-moi, mes filles chéries… j’ai dû confondre… Et toi, Sénèque ou Cenon ou… peu importe comment tu t’appelles, pardonne-moi aussi… j’ai dû te prendre pour un autre. J’ai pensé que tu étais l’infâme qui s’est permis de me dire… Viens ici, serrons-nous la main. J’ai le caractère un peu chaud…
Senén – (En lui tendant la main.) Votre Excellence, vous êtes toujours le même.
Le comte – Et puis, il y a cette fichue perte de la vue qui ne me permet pas de distinguer les brigands des personnes honnêtes. La cécité me rend irascible… Alors, comment ça va ? Je me souviens bien, on m’a parlé de toi ; je sais que tu es devenu un homme.
Senén – (Faussement timide.) Même si j’étais très bien dans la maison de monsieur le comte de Laín, j’en suis venu à abandonner le monde des domestiques pour travailler dans l’industrie ou le négoce…
Le comte – Très bien vu. Voilà comment on devient un homme. Et maintenant, tu es quoi ? Cordonnier ?
Senén – Non, monsieur.
Nell – Papa, c’est un fonctionnaire.
Dolly – Fonctionnaire du Trésor avec une solde de je ne sais combien de mille…
Le comte – Bon, comme tu voulais gagner de l’argent à tout prix… L’argent, Senén, se laisse gagner par tous ceux qui, patiemment et attentivement, vont derrière ceux qui le perdent ; rappelle-toi cela.
Senén – (Se regorgeant.) Madame la comtesse m’a obtenu un petit poste…
Nell – Maman l’a protégé et le protège parce que c’est un bon garçon…
Le comte – La comtesse a beaucoup de pouvoir. Personne ne lui refuse rien. Tu sais bien, toi, chenapan, à quelle porte frapper.
Dolly – Comme tu le vois, là, papa, c’est l’épargne ambulante, mais il prend grand soin de ses vêtements comme une femme.
Le comte – Sénèque, je veux dire Senén, tout baigne pour toi. Et maintenant, tu es là avec autorisation ?
Senén – Je suis venu de Durante pour avoir l’honneur de saluer monsieur le Comte d’Albrit et madame la comtesse de Laín qui doit arriver aujourd’hui aussi.
Nell – Maman vient ! (Elles abandonnent toutes les deux les bras de leur grand-père et sautent de joie.)
Dolly – Mon Dieu ! Quelle joie !
Nell – Eh bien, nous ne savions rien. Tu le savais toi, grand-père ?
Le comte – (Tout pensif.) Oui.
Dolly – (En reprenant le bras d’Albrit.) Allons-y, vite.
Nell – (Inquiète.) Il faut qu’on se refasse une beauté.
Senén – Les demoiselles doivent aller à l’hôtel de monsieur le maire attendre leur maman.
Nell – Mais maman va chez le maire ?
Dolly – Pourquoi ne vient-elle pas à La Pardina avec nous et avec grand-père ? (Senén hausse les épaules.)
Le comte – La Pardina ne doit pas être assez confortable pour ta mère… Enfin, je ne veux pas vous retenir… Allez, mes filles.
Nell – Ah ! J’allais oublier… Mon ami Senén, voudrais-tu nous faire une faveur ?
Senén – Tout ce que ces demoiselles voudront. Quoi donc ?
Nell – Monter à cet arbre récupérer l’Histoire.
Le comte – Récupérer l’Histoire !…
Dolly – Ce coquin de livre s’est mis à voler.
Nell – En jouant, on l’a lancé en l’air.
Le comte – (Joyeux.) Je comprends, oui… Vous étiez à d’étudier en regardant le ciel… Senén, intrépide Senén, monte vite, mon gars… Allez, quand tu étais jeune homme, tu grimpais bien des fois pour attraper des nids.
Senén – (Cachant son mécontentement, enlève sa veste.) J’y vais.
Nell – Attention, ne va pas déchirer ton costume.
Senén – Il est tout neuf… vous voyez bien.
Dolly – Et quelle épingle à cravate !… Mon Dieu, ne tombe pas.
Le comte – N’aie pas peur, c’est quelqu’un qui sait monter et s’accroche bien. S’il tombe c’est qu’il doit y avoir quelque avantage.
Senén – Pour le moment, monsieur le Comte, j’ai avantage à m’accrocher aux grosses branches… Tiens ! Allez, que je t’attrape, maudite Histoire.
Dolly – Descends vite. (Senén descend aux branches les plus basses et saute.)
Nell – (En saisissant le livre.) Dieu te le rendra. Bon, allons-y.
Dolly – Grand-père, tu ne veux pas rentrer par le village ?
Le comte – Non, non. Allons-y par le raccourci qui nous conduit directement à La Pardina sans passer par les rues de Jerusa. Je ne veux pas voir les gens et encore moins les gens de Jerusa.
Senén – (En remettant sa veste.) Dommage qu’on n’ait pas su avant que monsieur le Comte arrivait ! Le village lui aurait préparé une réception.
Le comte – (Avec mépris.) A moi ?… Jerusa, à moi ? Brrr… !
Senén – On aurait sorti la fanfare, l’orphéon… Rien n’aurait manqué ni le petit arc de fleurs ni le lunch à la mairie.
Le comte – Je vois que tu es terriblement à la mode. Je connais ces hommages. En d’autres temps, quand je les méritais et que j’étais disposé à les recevoir, cela me flattait, oui. Maintenant, cela me ferait l’effet d’une cruelle moquerie. Avant de me voir vieux et pauvre tel que je le suis, j’ai eu l’occasion d’apprécier l’ingratitude roturière de mes compatriotes, les habitants du domaine de Jerusa. (Il s’arrête pour souffler.) Cela fait vingt ans, la dernière fois que je me suis trouvé ici, les métayers avaient réussi, Dieu sait comment, à s’approprier mes terres ; ces petits messieurs, descendants de mes cuisinières ou engendrés par mes garçons d’écurie, me reçurent avec froideur et mépris et cela m’a alors rempli de tristesse et d’amertume. Ils m’ont dit que la ville s’était civilisée. C’était une civilisation improvisée et postiche, comme cette redingote que le péquenaud achète dans un bazar de vêtement tout fait.
Nell – Petit papa, le village n’oublie pas les bénéfices qu’il a reçus de toi.
Dolly – Il n’oublie pas, non. La rue principale de Jerusa s’appelle «rue de Potestad».
Nell – La fontaine aux cinq jets, près de l’église, s’appelle la fontaine du «Brave Comte».
Le comte – Oui, oui. Mon grand-père paternel. L’Histoire, le passé laisse toujours derrière soi une pancarte, une description… Tout s’efface, hélas ! Même ce qui est écrit dans la pierre. Quand la saleté et la mousse l’envahit et que des centaines d’araignées et de lézards y ont élevé leurs petits, le progrès arrive et on fait frapper cette pierre pour y écrire autre chose… ou bien on l’utilise pour les égouts. Je ne me plains pas, non. Le monde est comme ça. Nous roulons tous vers l’infini.
Senén – (Avec emphase.) Jerusa, quoi qu’on dise, ne peut oublier qu’elle doit son existence aux Albrit du Moyen-Âge.
Le comte – (Méditatif.) C’est à mes ancêtres et à moi que Jerusa doit ce qu’elle a de valeur. La mairie, qui était autrefois le palais des comtes de Laín, a été donnée par don Martín de Potestad, capitaine des galères de Naples. La chaussée de Verola et le pont sur le fleuve Caudo fut l’œuvre de ma mère. Mon grand-père maternel a fait l’hôpital et la maternité, et moi, j’y ai apporté les riches eaux de Santaorra ; j’ai fait construire le mur de soutènement qui protège le village des crues du Caudo ; j’ai fondé et pourvu en dons la Confrérie des pécheurs, avec cela, en plus, je leur ai fait un bassin pour abriter les bateaux ; j’ai reboisé les collines de la commune… sans compter d’autres améliorations dont je ne me souviens plus. Et comment m’ont payé mes paysans en retour de tant de bienfaits? Eh bien, lorsqu’ils ont vu que mes affaires n’allaient pas bien, ils m’imposaient horriblement sur les propriétés pour m’obliger à les leur vendre… Ils y sont parvenus… tout est maintenant entre leurs mains de rapaces.
Nell – Mon cher grand-père, ne pense plus à ces tristes choses.
Dolly – Tu n’es pas content de nous voir et de nous avoir à tes côtés ?
Le comte – (Il s’arrête, les enlace et leur fait un tas de bisous.) Oh si, si, mes anges innocents ! Je suis heureux avec vous et je me fiche des autres.
Senén – (Avec une malice déplacée rendue antipathique par la pédanterie de l’expression.) Il ne serait pas juste d’imputer à Jerusa le péché d’ingratitude quand nous avons aujourd’hui une preuve éloquente, monsieur le Comte, sachant à l’avance que madame la comtesse de Laín arrivait, nous lui avons préparé une réception chaleureuse. Cela revient à celui qui a contribué au grand développement des intérêts matériels et moraux de cette ville. Le maire sera à la gare…
Le comte – Et il y aura des feux d’artifice. C’est tout à fait le genre.
Nell – (Impatiente.) Des feux d’artifice et de la musique… ! On y va, on y va, vite !
Dolly – Grand-père chéri, si tu veux, on va tout droit à La Pardina.
Le comte – On est déjà rendu à la colline qu’on appelle «Le Balcon» ?
Senén – Oui, monsieur ; de là, on voit toute la ville, et si votre Excellence veut bien jeter un coup d’œil à la population, en deux minutes, nous sommes à la place.
Le comte – Non, non. Merci. On descend à La Pardina par cette rue. (En s’arrêtant et en regardant la localité, qui à cet endroit est totalement entourée d’arbres et de vertes collines.) Oui, oui… Je te connais Jerusa ; je vois un tas de toits rouges et de grandes fenêtres blanches… ; là-bas, les taches vertes, pleines de jeunesse. C’est bien toi, Jerusa, je te sens sous mes pieds, je te renifle en te foulant… Ton ingratitude me remplit les narines. Tu t’es bien moquée de celui qui a été ton seigneur, tu lui as donné un surnom moqueur… Eh bien, maintenant, «le pauvre lion d’Albrit«, qui ne te demande rien, qui n’a pas besoin de toi en rien, te présente son mépris, de tout son cœur, ne voulant recevoir de toi, ni même un petit lopin de terre pour enterrer ses pauvres os. (Se retournant vers les petites.) Si je meurs ici, il faudra m’emmener à Polan pour m’enterrer ou alors, qu’on me jette à la mer.
Dolly – Mon petit papa, ce n’est pas le jour des choses tristes.
Nell – Nous sommes tellement contentes !
Le comte – (En effaçant une larme.) Oui, oui… Allons-y, pour que vous arriviez à temps aux festivités en l’honneur de votre mère.
Senén – Par cette ruelle, on arrive tout de suite à La Pardina.
Le comte – Je connais bien le chemin… A cet endroit, en tournant à gauche, on ne voit plus la mer. (En s’arrêtant pour contempler l’océan.) Oh, quelle beauté ! C’est l’amie de mon enfance.
Nell – C’est splendide, quel bleu ! Aujourd’hui, elle a mis ses habits de gala pour te recevoir.
Le comte – Savez-vous pourquoi j’ai tant de plaisir à la regarder ? Parce que je la vois… C’est la seule chose que je distingue bien, à cause de son étendue. Depuis que je perds la vue, mes petites, mes pauvres yeux n’apprécient que les grandes choses… Plus c’est grand, mieux je vois. Je voudrais que dans le monde tout ait des proportions colossales, immenses… Ce qui est petit, croyez-moi, m’attriste, me fâche… (Ils pénètrent dans la ruelle.)
Scène VI
Une salle du rez-de-chaussée de La Pardina. Sur les murs, le plafond et les meubles, une impression d’ancien et de respectable, en bon état.
Gregoria et Venancio.
Gregoria – (Apparaissant à une fenêtre.) Capitán est déjà là… Oh ! Les voilà !… (Effrayée.) Doux Jésus, que vois-je !
Venancio – Quoi ?
Gregoria – Le comte est avec elles, monsieur le comte !
Venancio – Il est sans doute venu à pied par le raccourci du bois. C’est un grand marcheur.
Gregoria – Mais qu’il a vieilli ! Regarde, regarde-le.
Venancio – Et il est bien mal fagoté ! Ça fait peine à voir… Lui qui a toujours été l’élégance même… !
Gregoria – Tu ne vas pas l’accueillir ?
Venancio – (Il s’empresse.) J’y vais de ce pas… Prépare-lui du café, je suis sûr que c’est ce qu’il va demander en entrant…
Gregoria – Oui, oui.
Venancio – (De la porte.) Envoie un mot à monsieur le curé car il nous a dit de le prévenir dès que le comte arriverait.
Gregoria – (Abasourdie, ne sachant pas par quoi commencer.) Le café… le mot à monsieur le curé… Et le repas ? Bon, j’y vais. Mais, les voilà déjà… Grand Dieu du ciel !…
Scène VII
Gregoria, le curé, les deux petites, Senén et Venancio.
Gregoria – (Elle baise la main du comte.) Bienvenu mon cher Monsieur…
Venancio – Vous êtes icichez vous, vous avez ma bénédiction.
Le comte – (D’une bonté seigneuriale.) Merci, merci, mes chers amis Venancio et Gregoria. Je suis heureux de vous voir contents et en bonne santé… ; je peux dire en vous voyant… (Les regardant fixement.) Non, je ne vois que les grandes choses.
Venancio – Monsieur veut-il s’asseoir ici ? (En le conduisant à un fauteuil de cuir, près de la table de noyer.)
Le comte – Où tu voudras.
Nell – Et nous, maintenant, grand-père, nous allons nous habiller à toute vitesse.
Le comte – C’est cela, c’est cela ; ne vous attardez pas.
Dolly – Nous allons vite revenir, cher grand-père… Maman va venir avec nous, je suppose.
Le comte – Oui, oui… (Il les embrasse.) A tout à l’heure…
Gregoria – (Les faisant se presser.) Vite, vite… Vous allez arriver en retard. (Gregoria s’en va avec les filles.)
Senén – Moi aussi, avec la permission de monsieur le Comte, je vais me retirer.
Le comte – Oui, oui, va tirer tes fusées…
Senén – Si monsieur a besoin de moi…
Le comte – Non… merci beaucoup… Je suis content de te voir partir… Non, ça n’a rien d’offensant pour toi, Sénèque… ou Senén. Qu’est-ce que j’ai dit ?
Senén – Votre seigneurie peut dire ce qu’elle voudra, rien ne m’offensera.
Le comte – Eh bien, j’aime autant que tu t’en ailles, parce que… mon garçon, tu utilises un parfum qui empeste. Les arômes trop forts me donnent la nausée… Excuse-moi… (En lui tendant la main et caressant la main de Senén.) Pardonne-moi si je te congédie avec impertinence.
Senén – (Déconcerté.) Monsieur… quelques goutes d’héliotrope…
Le comte – Je n’ai rien dit… Adieu.
Senén – (A part, en se retirant.) Il est de mauvais poil le «pauvre lion d’Albrit«.
Scène VIII
Le comte et Venancio.
Longue pause. Le comte incline la tête sur sa poitrine et cache ses yeux de la main. Venancio reste debout, à bonne distance, et le regarde.
Le comte – (Relevant la tête et portant la main à sa poitrine qu’il sent oppressée.) Ah ! Venancio ! L’émotion que j’ai ressentie en entrant ici m’empêche de respirer… (Venancio souffle mais se tait.) J’ai cru que je n’allais pas te revoir, ma pauvre maison, maison bénie de mes aïeux, de ma mère… Je ne m’attendais pas à me voir touché au cœur par cette vague de vie que sont les souvenirs, coup de chaleur et de santé, qui revigore tout d’un coup l’être caduque, mais ensuite… ça tue, oui, ça tue. La mémoire m’embrouille, les sentiments m’étouffent… (Il se repasse la main sur les yeux.) Je n’aurais pas dû venir, non, non.
Venancio – Monsieur, les souvenirs de La Pardina seront toujours agréables à votre Excellence.
Le comte – (En montrant la droite.) C’est dans cette chambre que je suis né, moi… C’est là qu’est née ma mère aussi, et c’est dans celle du haut qu’elle est morte… Je ne sais pas si ma mauvaise vue me trompe, mais j’ai l’impression que rien n’a changé, les meubles sont toujours les mêmes… Quel bonheur !
Venancio – On n’a pas changé grand-chose. On maintient tout en l’état à force de soin et de nettoyage.
Le comte – (Profondément triste.) Ici, j’ai passé mon enfance, à côté de ma mère qui est devenue veuve très peu de jours après ma naissance… Héritier des comtés d’Albrit et de Laín, que de fois, jeune, dans la plénitude de la vie, plein d’illusions forgées par la grandeur de ma descendance ; que de fois, seul, avec mon épouse ou mes amis, je suis venu à La Pardina passer des moments heureux ! A cette époque-là tu n’étais qu’un enfant. Tes parents et bien d’autres parents de gens ingrats en poste un peu partout, étaient alors à mon service. Vous voyiez en moi le seigneur, le roi de La Pardina, et jusqu’à un certain point le maître de tout Jerusa… Le temps a passé ; mon fils Rafael a grandi. A la mort de sa mère, on lui a attribué, d’après les lois de Laín, ce comté et cette maison… Je suis revenu, moi, à La Pardina : je n’étais plus le seigneur mais le père du seigneur, et toi, tu avais bien grandi, et les autres serviteurs de cette vieille maison, vous me regardiez avec respect, avec affection, avec vénération. Le comte d’Albrit, tout puissant encore, vous payait pour vos services de cette noble largesse qui était habituelle chez lui.
Venancio – Votre Excellence a toujours été le premier Grand d’Espagne.
Le comte – (Digne, mélancolique, il se lève.) Eh bien, aujourd’hui, le Grand d’Espagne, le généreux et puissant vient te demander l’hospitalité. Ce sont des vicissitudes et des bouleversements dont je ne voudrais pas me souvenir, cette révolution chronique qui fait et défait les Domaines et les familles et qui bouleverse et brasse tout, t’a donné à toi la propriété de La Pardina. J’y viens moi, maintenant, te demander le gîte, non pas comme seigneur, mais comme un déshérité sans foyer, abandonné par tous. Si tu me le donnes, tu sais bien que tu dois le faire par pure charité, non comme rémunération ou comme récompense. Je suis pauvre ; j’ai tout perdu.
Venancio – Monsieur le Comte est toujours ici chez lui, et nous, aujourd’hui comme hier, nous sommes vos domestiques.
Le comte – (Il s’assoie.) Merci… Je te le dis bien calmement et sans manières ; car dans la réalité, il n’y a guère de place aux jeux de la rhétorique. Je suis tombé par degré au plus bas de la pauvreté ; mais j’ai beau tomber, je n’irai jamais jusqu’au déshonneur. Hormis la décadence matérielle, je suis et je serai jusqu’à mon dernier jour ce que j’ai été.
Venancio – Moi, également, aujourd’hui comme hier, je serai l’humble serviteur de monsieur don Rodrigo.
Le comte – Je te remercie, crois-moi, je te remercie de tout cœur… Mais… tout bien considéré, tu y es obligé, et tu agis là en bon chrétien. Tout ce que tu es et tout ce que tu as, tu me le dois.
Venancio – Sans doute.
Le comte – Tu ne fais rien de particulier en me protégeant, en voyant en moi ton seigneur, et en respectant non seulement mon nom et mon histoire, mais aussi mon ancienneté, mes infirmités… Les malheurs, mon garçon, m’ont rendu quelque peu impertinent. Mon caractère altier s’aiguise de plus en plus en perdant la vue… Je ne peux plus étouffer mes élans d’absolutisme, mes désirs de personne habituée à commander.
Venancio – C’est bien, monsieur.
Le comte – Et à être obéi.
Venancio – J’ai aussi l’habitude de l’obéissance… Et avant tout, monsieur, dans quelle pièce votre Excellence veut-elle dormir ?
Le comte – En haut, dans la chambre qui fut celle de ma mère.
Venancio – (Contrarié.) Celle du grand couloir ? Elle est pleine d’affaires diverses.
Le comte – Eh bien, tu sors les affaires et tu me mets moi.
Venancio – Monsieur, c’est tout un déménagement…
Le comte – (En se fâchant légèrement.) ça commence ?
Venancio – On l’a transformée en séchoir ; c’est là que sèchent les haricots…
Le comte – (Un peu plus fâché.) Mets les haricots ailleurs. Est-ce que je suis si peu de choses pour ne pas mériter… une petite gêne pour messieurs les légumes ?
Venancio – (Sans s’y résigner tout à fait.) Bon, monsieur… C’est que…
Le comte – Tu grognes encore ? Tu aurais dû gentiment accepter dès que je te l’ai demandé. Faudra-t-il que je te le commande ?… Faut-il que tu me mettes à bout ? (Tapant sur les accoudoirs.) Ah ! Quelle triste affaire de demander l’hospitalité chez mes inférieurs ! Venancio, je veux me soumettre au Destin, je veux m’oublier moi-même, mais je ne peux pas, je ne peux pas. L’autorité est chez moi une seconde nature. De grâce, supporte-moi ou jette-moi de chez moi, je veux dire, de chez toi.
Venancio – ça non… (En voyant le curé qui arrive.) Tiens, voilà votre ami don Carmelo.
Scène IX
Le comte, Venancio et le curé, un bon gros, grand gaillard, de belle taille, très ventripotent sans pour autant manquer d’agilité et de souplesse. Son visage est rougeaud, sa bouche souriante, son nez comme une gousse de pois chiche et ses petits yeux malins. Il porte des lunettes légèrement bleutées qui glissent sur la pointe du nez. Il vient sans apprêts, c’est-à-dire sans son grand manteau, il faut dire qu’il fait beau temps. Il est soigné et le tissu de sa soutane propre et luisante lui enveloppe la courbure de l’abdomen sans un pli, tous les petits boutons sont bien tirés depuis le cou jusqu’au ventre. Il a un bonnet noir, en pointe, avec des franges tombantes et son inévitable parapluie qui sert aussi bien contre le soleil que contre la pluie. Il entre dans la maison puis dans la pièce, rapidement, avec force bruit et s’avance vers le comte, les bras grands ouverts.
Le curé – Mon très cher ami et maître, don Rodrigo de mon cœur !…
Le comte – (En l’embrassant.) «Pasteur Curiambro»[1], viens dans mes bras !… Mais, dis donc, que tu as grossi !… Je n’arrive plus à te prendre dans mes bras, tu te rends compte ? Je n’y arrive plus… J’ai du mal à te taper dans le dos avec les paumes de mes mains.
Le curé – Quelle surprise bien agréable, quelle joie !
Le comte – (En lui touchant le ventre.) Mais, mon garçon, est-ce à toi tout ça ? C’est ton ventre, ça ? Tu n’aurais pas apporté devant toi l’ambon de l’église ?
Le curé – (En riant.) C’est que par ici, monsieur don Rodrigo, cela ne sert à rien de faire pénitence.
Le comte – Pénitence, toi ? Allons bon, ce serait bizarre !… Enfin, tant que tu rendras tes fidèles heureux…
Venancio – (Flatteur.) Nous avons un curé de paroisse qui vaut plus qu’il ne pèse.
Le comte – Et la santé ? Parfait ? Ton visage. (Il l’observe.). Ecoute, je te vois, je te vois bien. Tu es tellement grand ! Ah !… Tu permets que je te tutoie, malgré le temps passé.
Le curé – (Extrêmement modeste.) Monsieur le Comte, pour l’amour de Dieu…
Le comte – (Très affectueux.) Bien, Carmelo ; bien, Pasteur Curiambro ! Assieds-toi là à mes côtés. Comme ça passe, hein ! Qu’elles passent vite ces bigres d’années ! Toi, si je ne me trompe pas, tu dois avoir dans les cinquante…
Le curé – J’avais dans les cinquante, il y a deux ans…
Venancio – Comme moi. Nous sommes du même temps.
Le comte – ça ne pouvait pas être autrement. Tu avais vingt-six ans quand…
Le curé – Quand mon père est mort. J’ai dû à la générosité de monsieur le Comte de terminer mes études de Théologie et de Droit.
Le comte – (Avec délicatesse, spontanément.) Eh bien, figure-toi que je ne me rappelais pas de cela.
Le curé – Ah ! Moi, si !
Le comte – Tu te souviens de ces pique-niques d’enfer au Bois d’Aguillón ? Dès cette époque j’avais prédit que tu serais la première fourchette d’Espagne.[2]
Le curé – (En riant.) J’avais un coup de fourchette terrible, oui.
Le comte – Et tu as toujours l’habitude salutaire de manger abondamment et d’avoir un estomac à toute épreuve ?
Le curé – Je ne suis plus que l’ombre de ce que j’ai été, mais j’ai encore…
Venancio – Il fait encore… si le cas se présente honneur au buffet.
Le comte – Tu te souviens que tu avais parié avec Valentín, le secrétaire de Verola, à qui mangerait le plus ?
Le curé – (En riant à gorge déployée.) Et j’ai toujours gagné, toujours.
Le comte – Un jour de vigile… Venancio, tu ne vas pas le croire, mais c’est pourtant vrai… je l’ai vu s’enfiler une langouste tout entière, grande comme ça, après un plat de riz au poisson et aux fruits de mer… et avant une douzaine et demie de tranches de pain perdu.
Le curé – Ce temps-là est passé.
Venancio – Mais, jusqu’à tout récemment… Je me souviens du jour de la fête champêtre à Novoa… ; son dessert avait consisté en une boule de fromage tout entière.
Le comte – Qu’est-ce que ça me faisait plaisir de le voir manger comme ça !
Le curé – A propos de cela, il y a une phrase de Saint François de Sales qui me rassure, elle dit : «Ce qui entre par la bouche ne fait pas de mal à l’âme.»[3]
Le comte – Et il avait raison.
Scène X
Les mêmes et Gregoria, habillée pour sortir.
Gregoria – (Elle apporte le service à café.) Même si monsieur ne l’a pas demandé, comme je sais que vous aimez beaucoup le café… (Elle le met sur la table.)
Le comte – Oh ! Mon Dieu ! C’est bien !… Tu prévois tout, ma fille, ça mérite des louanges. Carmelo, je te sers…
Gregoria – Les filles finissent de se préparer. Nous partons tout de suite.
Le comte – Qu’elles ne traînent pas, il doit être l’heure. (En servant du sucre au curé.) Tu l’aimes bien sucré, si je me souviens bien.
Le curé – Vous avez une de ces mémoires !
Le comte – Sauf pour les services qu’on me rend, je perds la mémoire comme la vue.
Gregoria – Monsieur veut-il autre chose ?
Le comte – Non… Merci. (Gregoria s’en va.)
Le curé – (En savourant son café.) Et alors ?… Monsieur le Comte, que pensez-vous de vos petites filles ? Vous ne les aviez pas vues depuis votre retour d’Amérique ?
Le comte – Non.
Le curé – Ce sont des anges… Et qu’elles sont jolies, qu’elles sont amusantes ! Elles vous vont droit au cœur… On ne peut pas les voir, parler avec elles et ne pas les aimer, c’est impossible. (Le comte, songeur, ne dit rien. Pendant la pause, don Carmelo l’observe.) Dieu a fait d’elles deux petites filles charmantes, la joie et l’orgueil de leur mère… et de vous.
Le comte – (Comme s’il revenait à lui.) Tu disais ?… Ah ! Oui, ce sont des petites charmantes.
Le curé – (Voulant lui soutirer les raisons de sa présence à Jerusa.) Je comprends bien l’impatience que vous avez de les revoir. En plus du désir sacré de connaître vos petites filles et de les embrasser, nous avons l’honneur de vous avoir ici à Jerusa…
Le comte – Moi, je suis venu à Jerusa, surtout pour… (A Venancio, de manière autoritaire mais sans arrogance.) Eh ! Toi…
Venancio – Oui, monsieur…
Le comte – Veux-tu bien nous laisser seuls ? (Venancio s’en va.)
Scène XI
Le comte et le curé.
Le curé – Senén m’a déjà dit que la comtesse et vous, vous vous étiez donné rendez-vous ici… (Sa curiosité sournoise veut s’emparer de la pensée du comte et deviner ses intentions.) Ici, vous pouvez élucider les questions d’intérêts en toute tranquillité… (Pause. Le comte ne dit rien.) Ou les questions de quelque caractère que ce soit.
Le comte – Pour en revenir aux petites, je vais te dire, mon cher Carmelo, qu’elles ont fait sur mon âme une très profonde impression.
Le curé – Impression de joie ?
Le comte – Oui… Ces joies se transforment vite en une extrême tristesse, épuisé que je suis par de cruels malheurs, poursuivi par des pensées rebelles, fruit d’une analyse fiévreuse que font sur moi l’expérience du mal, l’excessive opiniâtreté de mon caractère, les années et même ma cécité… J’imagine que tu ne dois pas me comprendre, mon brave Carmelo, et si tu veux bien, je ne vais pas t’en dire plus pour le moment.
Le curé – Franchement, je reste sur ma faim.
Le comte – (Avec humour.) Sur ta faim, toi ?… Je ne te crois pas.
Le curé – Ces tristesses, sans doute nerveuses, ont-elles quelque chose à voir avec l’avenir des demoiselles ?
Le comte – (Refusant d’entrer dans le sujet.) Je n’en sais rien. Laisse-moi te dire autre chose. Ma première impression à les voir et à les entendre a été… bien sûr, excellente, une grande joie et un grand orgueil, comme tu as dit. J’ai cru remarquer une parfaite ressemblance, égalité plutôt, dans le timbre de leurs voix. Comme je ne vois pas bien, leurs visages m’ont semblé comme deux reproductions exactes d’un même type. Est-ce que par hasard, leurs caractères et leurs âmes sont les mêmes aussi ?
Le curé – (Il reste perplexe un petit moment.) Oh, non, monsieur Rodrigo ! Elles n’ont pas la même voix, ni la même tête, ni le même caractère.
Le comte – (Il marque un grand intérêt.) Eh bien puisqu’elles sont différentes, il y en a forcément une qui est meilleure que l’autre. Dis-moi, toi qui les as contactées et qui les as bien vues, laquelle des deux est la plus intelligente ? Laquelle des deux a le cœur le plus pur, le plus droit, le plus généreux ?
Le curé – La réponse est difficile, par ma foi. Elles sont toutes les deux bien braves, dociles, intelligentes. Elles ont le cœur généreux et très noble… un peu espiègles, ça oui, mais elles observent la loi de la pudeur, tout en étant fermes sur les principes élémentaires et elles craignent Dieu.
Le comte – Tout cela c’est ce qu’elles ont en commun : j’ai bien compris. Mais qu’ont-elles de différent ?
Le curé – Eh bien, elles diffèrent… Vous le verrez… Dolly prend les initiatives dans l’espièglerie ; Nell semble plus poussée aux choses sérieuses, plus prévoyante… Dolly a une vive imagination, une volonté plus impétueuse ; Nell, une nature réfléchie, plus stable, plus constante que l’autre dans ses goûts ; Dolly, quand elle divague, montre des attitudes étonnantes pour la vie pratique ; Nell, quand elle joue ses tours, nous étonne par l’éclat d’une intelligence incroyable… Mais, que voulez-vous que je vous dise, monsieur Rodrigo, dès que vous serez en contact permanent et familier avec elles vous les reconnaîtrez et saurez les différencier mieux que quiconque, n’est-ce pas ?
Le comte – (Se laissant aller à la sincérité.) C’est de cela qu’il s’agit ; voilà ce que je suis venu faire.
Le curé – Vous êtes venu… ?
Le comte – Je suis venu pour les observer, essayer de faire une analyse approfondie de leur caractère… Les raisons de cela, il vaut mieux que tu ne les saches pas tout de suite… (Il change de ton.) Ecoute, Carmelo, pourquoi ne restes-tu pas à manger avec moi, aujourd’hui ? Gregoria ne va pas te maltraiter…
Le curé – Je la connais… Je sais ce qu’elle vaut. Mais quitte à témoigner à Gregoria les honneurs qui lui sont dus une autre fois, aujourd’hui, aujourd’hui même, monsieur le Comte d’Albrit va venir chez moi faire pénitence avec votre serviteur, monsieur le curé.
Le comte – J’accepte, oui, monsieur, j’accepte… A quelle heure ?
Le curé – A une heure et demie précise.
Scène XII
Le comte, le curé et le médecin, jeune, petit, d’allure sympathique et au regard intelligent. Il porte une redingote et un chapeau haut de forme, c’est une pièce de vêtement qui traduit une marque de respect, lorsqu’elle est utilisée uniquement de temps en temps en des occasions très solennelles.
Le curé – Oh, mon petit médecin, viens !… (En le présentant.) Salvador Angulo, notre médecin attitré.
Le comte – (En lui serrant la main.) Très cher monsieur.
Le médecin – Je viens offrir mes respects au seigneur de Jerusa et de Polan…
Le comte – (Se souvenant.) Angulo, Angulo… Attendez…
Le curé – C’est le fils de Bonifacio Angulo, celui qu’on appelait ici du vilain nom de «Cachorro», garde forestier de Laín.
Le comte – Ah ! Oui !… «Cachorro», un homme simple et un peu rude… fidèle serviteur… Je me souviens parfaitement. (Il lui retend la main que le médecin embrasse.)
Le curé – Et, monsieur Rodrigo, vous vous souvenez sûrement que c’est vous qui avez payé les études de ce garçon à Valladolid.
Le médecin – C’est pourquoi je dois à monsieur le Comte le peu que je suis et le peu que je vaux.
Le comte – Je ne me souvenais pas de cela… Je jure que je ne m’en souvenais pas.
Le curé – Eh bien, il faut que vous sachiez, je ne dis pas cela parce qu’il est là… mais que c’est une notoriété en affaire médicale.
Le médecin – De grâce, don Carmelo.
Le comte – (Très affectueux.) Bien, mon garçon, embrasse-moi. (Il l’embrasse.) Me permets-tu de te tutoyer ? Je ne peux pas m’empêcher cette marque de familiarité depuis que je suis arrivé à Jerusa. (Le médecin acquiesce silencieusement par des marques de respect.)
Le curé – Allez, te voilà bien joli, petite graine de Jerusa.
Le médecin – On m’a nommé pour faire partie de la commission qui doit recevoir madame la comtesse de Laín… Excusez-moi, monsieur le Comte, si après vous avoir salué comme il se doit, je doive me retirer.
Le curé – Allons, allons, rien ne presse encore.
Le comte – Si, si ; vas-y, va !
Le curé – Au fait, Salvador, dès la fin de la cérémonie, une fois que le peuple aura laissé éclater son enthousiasme avec un peu de poudre et quatre beuglements, et que les airs auront entendu les dernières billevesées que doit prononcer don José Monedero, tu viens vite chez moi et tu auras l’honneur de manger avec monsieur le comte et avec moi.
Le médecin – Bien, bien. Quel grand honneur !
Le comte – (Avec joie.) Quelle heureuse occasion de vous consulter en toute tranquillité.
Le médecin – Un petit souci ?
Le comte – Non pas. Tu connais mes petites filles ; elles ont bien dû avoir recours à ton assistance pour un malaise quelconque…
Le médecin – Nell et Dolly jouissent d’une parfaite santé campagnarde et plébéienne. Je les ai eues en consultation pour des indispositions sans importance.
Le comte – Mais, toi, en observateur avisé, tu dois bien en savoir assez sur leur caractère, les tendances principales chez l’une ou l’autre, les prédispositions pathologiques qui ressortent… parce qu’il doit y avoir sûrement de grandes différences dans la constitution anatomique et physiologique des deux petites. Je ne sais pas si je m’explique bien.[4]
Le médecin – Parfaitement bien. Mais jusqu’à aujourd’hui, je n’ai pas eu l’occasion de déterminer chez elles de grandes différences.
Le curé – Enfin, vous aurez l’occasion de parler de tout cela en long et en large. (On entend une fusée.)
Le comte – (Il se trouble.) Elle est déjà là.
Le médecin – (Pressé.) Voilà qu’elle arrive…
Le comte – Va, mon garçon, va.
Le médecin – Avec votre permission… Inutile de vous dire… En toute humilité, sans condition, à votre service… (On entend d’autres fusées.)
Le comte – (Au curé.) Et toi, tu n’y vas pas, Carmelo ?
Le curé – Inévitablement, il faut bien que je pointe mon nez là-bas. Il ne faut pas que la comtesse dise que je manque de courtoisie…
Le comte –Dans ce genre de cérémonies il ne faut pas que la population regrette une aussi haute figure.
Le curé – C’est cela, c’est cela, j’y vais. Attention, monsieur le Comte. A une heure et demie précise.
Le comte – Je n’y manquerai pas. Il ne me reste pas grand-chose mais j’ai toujours un religieux respect de la ponctualité. (On entend de la musique au loin.)
Le médecin – A tout à l’heure.
Le comte – Amusez-vous bien… (Le curé et le médecin s’en vont. Il médite tout seul.) Ces deux-là vont-ils m’aider dans mes recherches ?… Sauront-ils se pénétrer de l’esprit de loyauté, du sentiment de justice qui me fait agir ?… (Avec découragement.) J’en doute… Ils vivent dans un monde de convenances, d’égoïsme et d’hypocrisie et parle-t-on de la loi suprême de l’honneur, ils font des têtes d’étonnés stupides comme si on faisait allusion à des contes de sorcières. S’ils ne m’aident pas, je me débrouillerai tout seul. Le vieil Albrit se suffit à lui-même. (La musique se rapproche ainsi que le brouhaha de la foule.) Ah ! La voilà qui arrive, la voilà qui entre à Jerusa, Lucrecia Richmond !… Te voilà donc ici, vermine enluminée, statue vivante, malhonnête ! Comme je l’attendais cette occasion !… Toi et moi, seul à seul, face à face ! (Il se montre à une fenêtre.) Je ne sais pas ce qui est le pire : toi qui te promènes impunément sur les lieux de ton dévergondage ou une population servile et sans grade qui te festoie et t’adule. (On entend les cloches.) Elles sonnent pour toi… et puis elles appelleront à la prière. (Furieux, il crie de la fenêtre vers l’extérieur.) Peuple imbécile, celle qui t’arrive est un monstre de légèreté, une falsificatrice infâme ! Ne l’acclame pas, ne la reçois pas avec chaleur. Lapide-la, crache-lui dessus…
[1] Allusion à Don Quichotte de la Manche, traduction d’Aline Schulman, éditions du Seuil, 1997, collections Points, Livre II, chap. 73, p. 581. Don Quichotte donne un nom au curé et l’appelle ainsi Curiambro ou Curaillon.
[2] En français dans le texte.
[3] St François de Sales, Introduction à la vie dévote, 1619, III, chap. XXVII.
[4] Allusion probable aux théories sur le positivisme d’Auguste Comte, développées de 1830 à 1845.




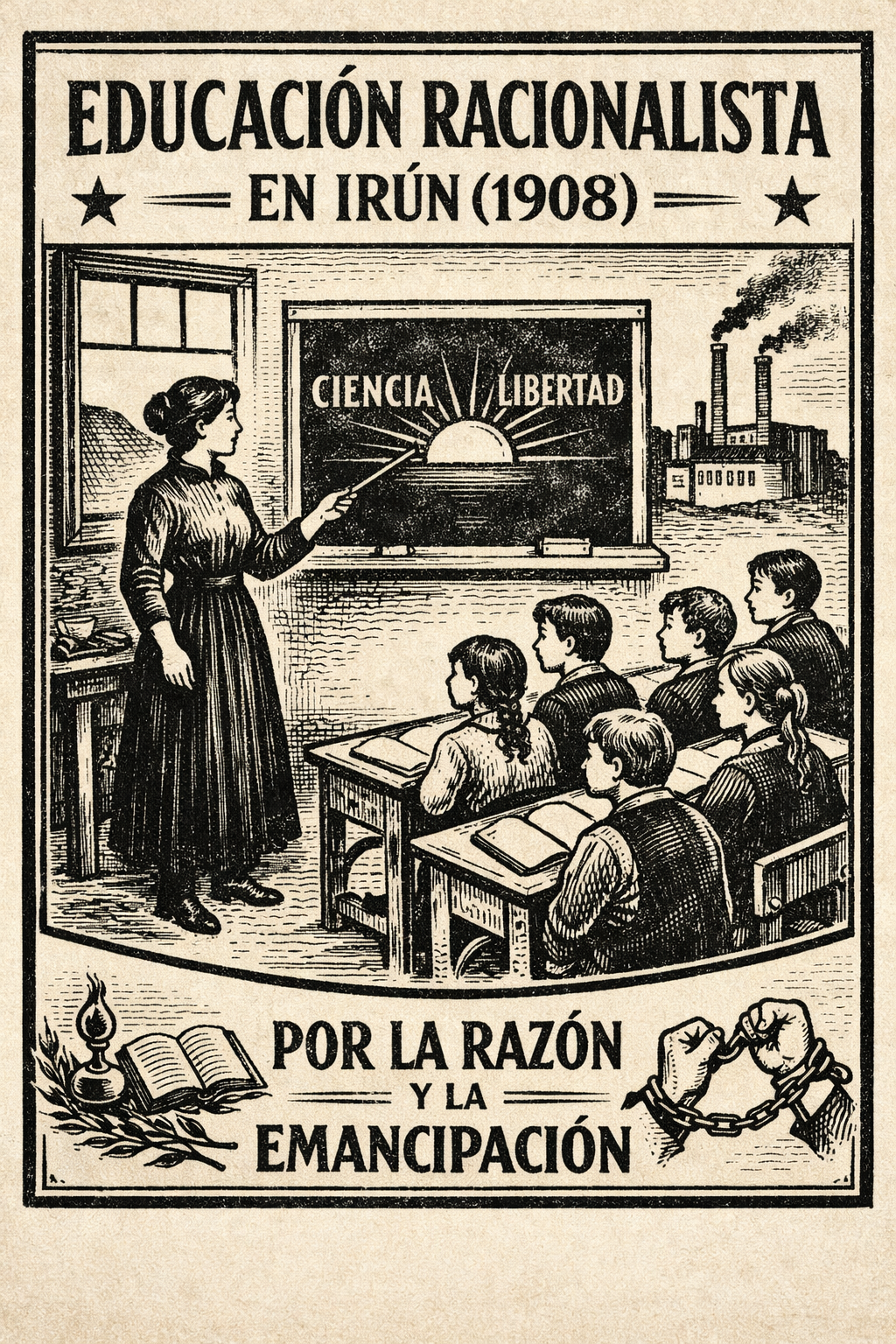











**mitolyn official**
Mitolyn is a carefully developed, plant-based formula created to help support metabolic efficiency and encourage healthy, lasting weight management.
I intended to send you one little remark just to thank you very much yet again relating to the pleasing views you have shown on this website. It is so pretty generous with you to give easily just what a few people might have offered as an e-book to help with making some profit for themselves, even more so considering that you might well have tried it if you ever considered necessary. Those advice also acted to become fantastic way to be aware that other individuals have a similar keenness just as mine to grasp significantly more with respect to this issue. I’m certain there are thousands of more pleasant periods ahead for individuals that read carefully your blog post.
Wonderful blog! Do you have any suggestions for aspiring writers? I’m hoping to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally overwhelmed .. Any suggestions? Many thanks!
I think other website proprietors should take this web site as an model, very clean and excellent user friendly layout.