No hay productos en el carrito.

Traduction de Daniel Gautier
– III –
Extraordinairement triste de toute cette réponse, je retournai à Madrid et je passai toute la semaine à méditer, comme abasourdi, désirant et craignant que n’arrive le dimanche suivant parce que mon esprit était poussé d’un côté par la curiosité et de l’autre par la crainte. Mes soubresauts étaient tels que je ne fermai pas l’œil de la nuit du samedi et, de bon matin, je partis à l’auberge de la rue de la Aduana chercher une place dans n’importe quelle galère en partance pour le Site Royal. Le peu d’argent liquide que j’avais me mit en danger de ne pouvoir y aller, ce qui me désespérait et m’affligeait de manière extraordinaire.
Mais les prières et les subtiles raisons jointes aux quelques sous que j’avais, me permirent d’amadouer le cœur dur d’un charretier qui consentit enfin à m’emmener. Les trois mules mirent, je ne sais pas, un siècle peut-être, pour arriver à la fin du voyage. Je craignais que l’oncle et la tante d’Inès ne me devancent mais non. Quand j’arrivai, don Celestino était à la grand-messe ; j’entrai dans l’église comme les dimanches précédents ; mais le temple me parut triste et funèbre. En sortant, je passai l’eau bénite à Inès, nous attendîmes le brave curé à la porte de la sacristie et nous allâmes tous les trois à la maison. Chose singulière ! Il n’y eut pas un mot en chemin. Tous les trois, nous soupirions. Pendant le repas, j’essayai d’encourager les autres, feignant la bonne humeur ; mais je n’y parvins pas. Vu le retard de la visite annoncée, je croyais que les Requejo ne viendraient pas ; mais ma joie fut dissipée alors qu’on finissait le repas. Nous entendîmes soudain des bruits de voix dans la cour de la maison. Nous nous levâmes et, moi, je sortis dans le couloir et j’entendis une voix creuse et rugueuse qui disait : «C’est bien ici que vit le latiniste et musicien don Celestino Santos del Malvar, curé de la paroisse ?»
Ils entrèrent dans la salle où nous étions, et dès qu’il vit sa nièce, don Mauro se dirigea vers elle, les bras grands ouverts et, l’étreignant, dit d’une voix douce :
- Inès de mon cœur, innocente fille de la pauvre Juana ! Enfin, enfin, je te vois. Béni soit Dieu qui me donne cette consolation. Que tu es jolie ! Viens, laisse-moi t’embrasser encore.
Doña Restituta fit la même chose mais en exagérant à l’extrême les grimaces larmoyantes de son visage ainsi que l’ouverture des bras ; puis, après avoir tous les deux soulagé leur cœur amoureux, ils saluèrent don Celestino qui ne put que verser quelques larmes en voyant une telle explosion de sensibilité. Pour ma part, j’aurais volontiers répondu aux embrassades qui emprisonnaient Inès par des paires de claques à ces crétins dont je considère maintenant qu’il est bien temps de faire le portrait.

Don Mauro Requejo était un homme gauche. Je crois que je n’ai pas besoin d’en dire plus. Vous n’avez pas bien entendu ? Bon, je vais donc vous expliquer. Est-ce la nature ou l’habitude qui a décidé qu’une moitié du corps humain se distingue par son habileté et l’autre moitié par sa maladresse ? Une de nos mains est inapte à l’écriture et dans les travaux de mécanique, elle ne sert qu’à aider sa compagne experte, la droite. Celle-ci fait tout ce qui est important : au piano, c’est elle qui joue la mélodie, au violon, elle tient l’archet qui en est l’expression ; dans l’escrime, elle manie l’épée ; dans le monde nautique, elle est le gouvernail ; dans la peinture, le pinceau ; c’est elle qui donne les gifles dans les disputes ; celle qui fait le signe de la croix dans la prière, et celle qui frappe la poitrine dans la pénitence. Le pied droit a les mêmes dispositions ; s’il y a quelque chose à faire d’important et d’extraordinaire dans la danse, inévitablement c’est le pied droit qui le fera ; c’est lui le point d’appui dans la fuite, lui qui frappe le sol avec colère dans le désespoir, c’est lui qui fait peur au chien audacieux, qui écrase le sale reptile, sert de bélier pour attaquer un ennemi méprisable qui ne mérite pas d’être blessé par devant. Cette supériorité mécanique, musculaire et nerveuse des extrémités droites s’étend à tout l’organisme. Lorsque nous sommes perplexes, sans savoir quelle direction prendre, si le corps s’abandonne à son instinct, il penchera à droite, et les yeux chercheront la droite comme un orient inconnu. En même temps, du côté gauche, tout est maladroit ; tout est subordination, tout est inaptitude ; tout ce qui est fait par là est tordu, et son infériorité est si notoire que même en taille le côté gauche ne peut équivaloir à l’autre côté. La moitié de tout homme est généralement plus petite que l’autre : pour raison d’équilibre sans doute, il a été décidé que le cœur occuperait le côté gauche.
Nous avons fait cette ennuyeuse digression pour bien comprendre ce que l’on dit de don Mauro Requejo. Les deux côtés de cet homme étaient deux côtés gauches ; c’est-à-dire que tout était maladroit, inapte, hésitant, inhabile, lourd, brusque, embarrassé. Je ne sais pas si je m’explique bien. On dirait qu’il est gêné même par ses propres mains : à le voir regarder ici et là, on croirait qu’il cherche un coin où jeter ces membres inutiles, couverts de gants trop grands qui ôtaient toute sensibilité à des doigts opprimés, au point que le propriétaire ne les prenait pas pour siens.
Il s’était assis sur le bord de sa chaise et ses jambes, petites et rigides, n’étaient pas les membres qui reposent avec assurance : il les étendait de chaque côté comme les deux béquilles qu’un boiteux approchent de lui. Elles ne lui servaient à rien sauf pour traîner ici et là ses pieds lourds. En ôtant son chapeau pour le déposer par terre, en s’épongeant la sueur avec un grand mouchoir à carreaux rouges et bleus, il ressemblait à un portefaix qui se décharge d’un lourd fardeau. Le beau linge qui l’habillait n’était pas un ornement pour le corps car il ne l’habillait pas mais était posé sur lui. Quant à ses gants qui lui engourdissaient les mains, ils les transformaient en pieds. A chaque instant, il touchait les breloques de sa montre et les dentelles de son jabot pour s’assurer qu’elles n’étaient pas tombées ; mais comme sous la peau de chamois, tout tact disparaît, il devait utiliser la vue et cela le rendait semblable à un singe qui se réveille un beau matin habillé de pied en cap.
Don Mauro Requejo et sa sœur doña Restituta, oncle et tante d’Inès, étaient arrivés.
Son agitation était extraordinaire, comme celle d’un corps mortifié par un nombre infini de piqûres et chaque pli de son costume devait causer des plaies à ses chairs délicates. Parfois, cette moufle inerte de daim jaune, pleine de doigts raides et insensibles, partait en direction de l’aisselle ou de la ceinture avec la rapidité d’une main angoissée qui va se gratter ; mais il se retenait et montait caresser le menton fraîchement rasé. Il remuait le cou aussi avec fréquence, comme si une bête bizarre s’était accrochée à son occiput pour jouer dans le cou entre les cheveux et le col. C’était le gilet imbibé de sébum qui se fourrait irrévérencieusement entre la peau et la chemise ou bien lui grattait l’oreille. La main de daim jaune s’élevait aussi dans cette direction ; mais elle s’arrêtait aussi pour se mettre à frotter le genou.
La tête de don Mauro Requejo était ronde comme un verre de montre ; le nez n’était pas à sa place car il s’inclinait d’un hémisphère pour aller chercher la joue gauche qui, par l’effet et la grâce d’une excroissance, était plus lumineuse que celle de sa compagne. Les yeux verdâtres et bien placés sous les cils noirs et un peu en amande comme les Chinois, avaient l’éclat de la ruse tandis que sa bouche, insignifiante, si elle n’avait pas été enlaidie par deux ou trois dents vermoulues qui se montraient de temps en temps entre les lèvres, avait tous les plis et les grimaces que le rustre roublard étudiait pour tromper ses semblables. Le rire de don Mauro Requejo était soudain et sonore ; habituellement chez les gens, ce phénomène physiologique commence et finit de manière graduée, parce qu’il accompagne des états particuliers de l’esprit, lequel ne fonctionne pas, que je sache, avec la précision d’une machine. Tout au contraire, notre personnage avait sans doute dans son organisme un ressort pour le rire, qui pouvait passer au sérieux aussi brutalement que si un doigt mystérieux s’enlevait de la touche «joie» pour appuyer sur la touche «grave». Je crois que lui, en son for intérieur, pensait comme ça : «c’est le moment de rire, rions.» Et il riait.
– IV –
Impossible de dire si doña Restituta était plus jeune ou plus âgée que son frère : les deux semblaient avoir passé assez largement les quarante ans, mais s’ils se ressemblaient en âge, par la tête et le geste non, car Restituta était femme à ne pas déranger, elle savait rester tranquille. Il y avait en elle, sinon de la finesse dans les manières, cette aisance facile, propre à quelqu’un qui a longtemps parlé aux gens. Pour les comparer aux deux branches humaines d’un même tronc, on dirait : «Mauro a toute sa vie porté des fardeaux et Restituta a mesuré et vendu ; l’un est une vermine de magasin, l’autre la petite bête intrigante de la boutique.»
Grande et maigre, avec ce teint neutre et uniforme ressemblant à une doublure, de grandes et vilaines mains qui, à force de passer sur les tissus, avaient pris une certaine flexibilité ; le cheveu rare, si lustré et collé sur le crâne qu’on aurait cru de la peinture plus qu’une chevelure ; son nez rouge et quelque peu granuleux, même s’il n’était pas ami des vins d’Arganda ; la bouche plissée aux coins tombants, le menton légèrement velu, un regard entre chien et loup, comme des yeux qui regardent sans regarder. Restituta Requejo était une personne dont l’aspect n’invitait, à première vue, à être ni pour ni contre. A l’écouter parler, à la fréquenter, on trouvait en elle je ne sais quoi de fuyant, quelque chose qui échappait à l’observation, on se rendait compte qu’il fallait la fréquenter longtemps pour pouvoir avoir prise sur elle avec des doigts agiles sur la peau humide de son caractère qui, pour se cacher, possédait la rapidité du saurien et la flexibilité de l’ophidien. Mais laissons ces considérations pour plus tard, et maintenant, contentez-vous d’entendre parler l’oncle et la tante d’Inès.
- Celui-ci était si pressé de venir, dit Restituta, en désignant son frère, que la précipitation ne nous a pas permis d’apporter quelques petites choses comme on aurait voulu.
Don Celestino les remercia de son aimable sourire.
- J’étais si impatient de venir voir ces terres, dit don Mauro, que… et en même temps j’avais le cœur qui battait la chamade à la pensée de revoir ma chère nièce, orpheline et abandonnée… parce que les terres, ce n’est pas rien, monsieur don Celestino, ça m’a coûté quelque chose comme trois cent quarante-huit réaux, treize maravédis, sans compter les diligences et la paperasserie. Oui, monsieur, tout est payé à présent, tout, rubis sur l’ongle.
- Tout est payé, indiqua doña Restituta en nous regardant tous les trois, l’un après l’autre. Celui-ci n’aime pas devoir quelque chose.
- N’en parlons pas ! Je préfère me faire pendre que de devoir un maravédis, s’écria don Mauro, portant la moufle à la gorge serrée par la cravate.
- A la maison, il n’y a jamais eu d’entourloupes, ajouta la sœur.
- C’est pour cela que vous avez si bien réussi, dit don Celestino.
- La chance… ça oui, nous avons eu de la chance, dit Requejo. Ensuite, celle-ci est si travailleuse, si économe, si fourmi…
- Mais tout est dû à ton honnêteté, ajouta Restituta. Oui, croyez-le bien, à son honnêteté. Celui-ci a une telle renommée chez les commerçants qu’ils lui accorderaient les trésors du Roi.
- Enfin… on a fait quelque chose, grâce à Dieu et à notre travail. Si cela ne dépendait que de celle-ci, on achèterait plus de terres. Celle-ci n’aime que les propriétés.
- Et avec raison ! si celui-ci tenait compte de ce que je dis, ajouta la sœur, en regardant successivement les assistants, toutes nos économies seraient employées aux terres de labour.
- Comme je suis si… bon, remarqua Requejo.
- En toute modestie, monsieur don Celestino, dit Restituta, il est bon de montrer qu’on a ce qu’on a.
- Et elle me fait acheter des vêtements, des chapeaux, des bijoux, fit remarquer don Mauro. Je ne connais même pas tout le charivari qui est entré à la maison. Voilà, comme on peut… Vous voyez, ajouta-t-il en montrant à don Celestino une chaîne qu’il portait au cou ; voyez aussi cette épingle. Combien croyez-vous que ça m’a coûté ? La bagatelle de mille réaux… Pschitt ! moi, je ne voulais pas ; mais celle-ci s’est entêtée, et comme on peut…
- Ce sont de belles choses.
- Eh bien, je t’ai dit de garder aussi la bague d’émeraude, tu dois t’en souvenir, ils la donnaient pour presque rien. Quel dommage que le duc d’Altamira l’ait prise !
Ils nous regardaient en disant cela et nous, nous répondions par des signes d’acquiescement, mais sans rien dire, parce que ni Inès ni moi n’avions idée de répondre.
- Mais, se peut-il que ma nièce reste là si silencieuse ? dit Requejo en riant soudainement pour redevenir sérieux l’instant d’après.
Inès rougit mais ne dit rien parce qu’en effet, elle n’avait rien à dire.
- Ah ! on ne peut le nier, qu’est-ce qu’elle ressemble à sa mère, la pauvre Juana, ma chère cousine ! s’écria Requejo en portant la moufle à sa bouche pour cacher un bâillement. Elle est morte bien vite, la pauvre petite !
- Puisqu’elle est passée à une vie meilleure, cette sainte femme exemplaire, dit Restituta, ne prononçons pas son nom, cela renouvelle la douleur en nos cœurs et en celui de la pauvre jeune fille, mais, elle est encore petite et les enfants se consolent plus facilement.
Inès ne dit rien non plus ; mais la couleur rouge de son visage se changea en une pâleur intense. Le prêtre crut raisonnable de changer de conversation et dit :
- Et, avez-vous vu ces terres du lac d’Ontígola ?
- Pas encore, répondit Requejo, mais on m’a dit qu’elles sont magnifiques. Pschitt !… pour moi, ce n’est pas grand-chose. C’est celle-ci qui s’est entêtée à ce qu’on les prenne et à la fin, je me suis décidé. Là-bas, au pays, on en a de bien meilleures ; on les a achetées peu à peu.
- Dans votre pays, c’est-à-dire vers le Bierzo, si je ne m’abuse.
- Bien au-delà du Bierzo, à Santiagomillas, c’est une propriété de Maragatería. C’est de là que nous sommes tous, et c’est encore la maison mère des Requejo.
- Une famille de la noblesse, d’après ce que je crois, affirma le prêtre.
- C’est… elle n’est pas sans avoir son motu proprio, répondit don Mauro, et d’après ce que nous disait un scribe savant de mon village, nos ancêtres avaient une grande chênaie d’où est venu le nom de Requejo.
- C’est ce qu’il faut, les noms les plus illustres se rapportent toujours à quelque herbe ou légume. Et c’est comme dans la Rome antique, les Léntulos, les Fabios et les Pisones s’appelaient comme ça parce qu’un de leurs aïeux cultivait des lentilles, des fèves et des petits pois. Quant à moi, je crois que ce nom de Malvar vient d’un grand-père qui ne cultivait que des mauves.
- Eh bien, dit don Mauro en se remettant à rire, je crois que dire que la noblesse vient des guerres et des hauts faits de quelques chevaliers est pur mensonge. Qu’on ne me raconte pas d’histoire : je ne crois pas qu’il y ait jamais eu de ces faits héroïques. Il n’y a que les rois qui ont fait l’un duc parce qu’il avait un jardin de choux, et l’autre marquis parce qu’il savait choisir les melons. De toute façon, notre famille ne vient d’aucun chardon aux ânes.
- Et peu importe d’où l’on vient, dit doña Restituta, l’important c’est l’important. Chez nous, monsieur don Celestino, il ne manque rien grâce à Dieu et bien que nous ne vivions pas dans le luxe et que nous ne roulions pas en carrosse, nous ne nous mettons pas en vue, mais il y a toujours du beurre dans les épinards… ça oui : celui-ci et moi, nous ne pouvons pas nous passer d’un certain confort.
- Pour ce qui me concerne, interrompit Requejo, je me nourris de peu de chose. Si j’ai un morceau de pain, un morceau de lard et de l’eau de la source de Berro, tout va bien ; mais celle-ci s’entête à bien faire les choses. Tous les jours, elle apporte une livre et demie de viande de bœuf, du jambon vieilli en cave en abondance et du meilleur aiglefin tous les vendredis, comme dîner une perdrix par personne et le dimanche trois chapons. A Noël et pour la saint Mauro, le 15 janvier, ou pour la saint Restituto, le 10 juin, il y a des dindes plein la maison comme si c’était le pays de Cocagne. Le majordome des ducs de Medina de Rioseco, qui a l’habitude de venir nous demander de leur prêter de l’argent, en est stupéfait de voir tant d’abondance et il dit qu’il n’a jamais vu un tel déploiement de nourriture comme chez nous.
- C’est cela, dit Restituta, cela ne nous fait rien de dépenser en nourriture ou en bon vêtement, ni en bons morceaux de charbon pour le feu. Nous vivons au calme et heureux. Notre unique peine a consisté jusque-là à ne pas avoir une personne aimée à qui tout laisser ce que nous possédons quand Dieu voudra nous appeler près de lui ; car les parents qui nous restent à Santiagomillas ne sont que des voyous qui nous en font voir de toutes les couleurs.
En entendant cela, don Mauro mit en mouvement le ressort du rire et regarda Inès en disant :
- Mais ici, Dieu nous procure notre chère nièce, cette rose printanière, cette demoiselle angélique. Ah ! on ne peut le nier, c’est sa mère tout crachée.
- Mon Dieu, Mauro ! s’écria Restituta, ne rappelle pas à notre mémoire cette sainte femme parce que je suis encore impressionnée par sa mort, quand je pense à elle, il me vient des larmes aux yeux.
- Dieu soit béni, que sa volonté soit faite, dit Requejo en appuyant sur le ressort du sérieux. Je veux dire que tout ce que j’ai et que je pourrais avoir sera pour cette colombe, car elle le mérite bien avec sa tête de princesse.
- Oui, oui, dit Restituta en clignant de l’œil, elle aura des prétendants grâce à Dieu. Je connais bien des marquis et des comtes qui vont soupirer en douce sous nos balcons dès qu’ils sauront que nous avons chez nous un trésor.
- Des gueux, ma fille, des gueux sans le sou, ajouta Requejo. Quand la petite devra se marier, nous lui chercherons alors un jeune dans une des plus grandes familles d’Espagne, qui soit digne de prendre un tel trésor.
- Cela, c’est tout vu. Des maisons riches, il y en a, où tout n’est pas que dans les apparences, et je connais des fils aînés qui, dès qu’ils la verront et connaîtront la richesse dont elle doit hériter de son oncle et de sa tante, en seront fous amoureux et lui demanderont sa main. Ma foi, notre maison n’est pas un taudis, et quand on mettra dans le salon les rideaux de serge vert avec les branches jaunes et ces oiseaux couleur pensée qu’on croirait vivants, ce sera joli d’y recevoir tous les messieurs du Conseil Royal. Car, la petite ne sera pas peu fière dans sa grande maison !
Don Celestino, voyant que sa nièce ne répondait rien à de si pathétiques démonstrations d’affection, crut bon de parler ainsi :
- Elle vous remercie beaucoup, de tout son cœur, pour tous ces bienfaits qu’elle va recevoir.
- J’en suis ravi, monsieur don Celestino, dit Requejo. Il ne me manquait qu’une chose et je l’ai. Inès sera mon héritière, Inès va se marier avec une personne de mérite, qui aura de bonnes pièces d’or ; elle sera heureuse et nous aussi.
- Ne parlons pas trop de ça, parce que j’en pleure, dit doña Restituta. Quel plaisir d’avoir quelqu’un pour nous accompagner dans la solitude et pour partager le confort que Dieu et notre travail nous ont donné ! Ah ! ma petite Inès, tu es si jolie ! Cela me rappelle ma jeunesse quand j’allais jouer dans le jardin du couvent des Mères Recoletas de Sahagún où j’ai été élevée. Il me semble que si on me séparait de toi, je n’aurais plus la force de vivre.

Une fois dit cela, elle prit Inès dans ses bras et je crois bien que la doublure de son visage, je veux dire la peau, se teignait d’un léger rose clair.
- Inès doit être bien impatiente de partir avec nous, dit Requejo, nous l’emmènerons cet après-midi même.
- Comment ça ! cet après-midi ! Moi ! s’écria-t-elle vivement.
- Ma fille, dit Restituta, il ne convient pas de cacher l’affection que tu as pour nous. Nous sommes de ta proche famille et vraiment, je peux te le dire, tu ne dois pas nous remercier pour ce que nous faisons pour toi, c’est pour nous un devoir.
- Elle a peut-être quelques réticences à aller avec vous comme ça… si vite, dit don Celestino, timidement, mais je ne doute pas qu’elle comprendra vite les avantages de sa nouvelle situation et qu’elle décidera…
- De ne pas venir ! s’écria Requejo avec étonnement. Alors comme ça, notre nièce ne nous aime pas… Mon Dieu ! Quel grand malheur !
- Si… elle vous aime, ajouta le prêtre en essayant de concilier la répugnance qu’il voyait sur le visage d’Inès et le désir des Requejo.
- Mon frère, tu ne sais pas ce que tu dis, affirma Restituta. Notre nièce est un modèle de modestie, de naïveté et de simplicité. Tu veux qu’elle se mette à faire un tas de simagrées en plein milieu du salon et qu’elle saute de joie parce que nous l’emmenons. Ce ne serait pas très bien. Au contraire, poursuivit la sœur de don Mauro, elle reste silencieuse, c’est une fille réservée et bien élevée… Cela se voit bien, une fille d’une sainte femme… cache toujours son émotion et reste immobile, remerciant Dieu par la pensée pour la fortune qu’il lui réserve.
- Alors, monsieur don Celestino, dit Requejo, nous allons voir nos terres d’Ontígola qui est là, vers Titulcia, et cet après-midi, à notre retour, Inès sera prête pour venir avec nous à Madrid.
- Je n’y vois pas d’inconvénients, si elle est d’accord, dit le prêtre en regardant sa nièce.
Mais celle-ci n’eut pas le temps de donner son opinion sur ce voyage, car les Requejo se levèrent et partirent en disant qu’une voiture à deux mules les attendait à l’auberge du Rincón. Ils embrassèrent chacun son tour leur nièce deux ou trois fois, firent de ridicules gestes de courtoisie à don Celestino, sans même daigner me regarder, ce qui m’honora beaucoup, puis sortirent, laissant le prêtre tout content, Inès songeuse et moi furieux.
– V –
Immédiatement, on essaya de résoudre en conseil de famille ce qui devait se faire ; mais, moi, désirant rencontrer le brave prêtre pour lui dire ce qu’Inès ne devait pas entendre, je priai celle-ci de nous laisser seuls et nous parlâmes ainsi :
- Seriez-vous capable, Monsieur don Celestino d’accepter qu’Inès aille vivre chez cet imbécile de don Mauro et cette vieille chouette qu’est sa sœur ?
- Mon garçon, me répondit-il, Requejo est très riche, Requejo peut donner à la petite Inès le confort que je n’ai pas, Requejo peut en faire son héritière quand il cassera sa pipe.
- Et vous y croyez ? A plus de soixante ans, ça paraît incroyable. Eh bien, je vous dis et je répète que ce maudit don Mauro n’est rien d’autre qu’un hypocrite farceur. Moi, à votre place, je les enverrais promener.
- Je suis pauvre, moi, mon garçon ; eux sont riches, Inès s’en ira avec eux. Si jamais ils ne la traitent pas bien, je la reprendrai.
- Ce n’est pas qu’ils vont mal la traiter, dis-je, ému. Ce que je crains, c’est autre chose et ça, je ne peux y consentir.
- Voyons, jeune homme.
- Vous savez comme moi ce qu’il y a là-dessous ; vous savez qu’Inès n’est pas la fille de doña Juana ; vous savez qu’Inès est née du ventre d’une grande dame de la Cour, dont le nom nous est inconnu, vous savez tout cela, et comment, le sachant, ne comprenez-vous pas les intentions des Requejo ?
- Quelles intentions ?
- Les Requejo ont toujours eu du mépris pour doña Juana ; les Requejo ne lui ont jamais rien donné ; les Requejo ne l’ont même pas visitée quand elle était malade, et maintenant, mon cher monsieur don Celestino, voilà que les Requejo pleurent en se souvenant de la défunte, les Requejo bavent d’admiration devant leur nièce, cela ne peut être que parce que les Requejo ont découvert qui sont les parents d’Inès, les Requejo ont compris que la jeune fille est un trésor, et, quel malheur ! il ne fait aucun doute que le vieux Requejo, ce pauvre type, a derrière la tête le projet de se marier avec Inès, l’y obligeant dès qu’il l’aura enfermée à la maison.
- Calme-toi, jeune homme, et écoute-moi. Il se peut très bien que l’intention des Requejo soit ce que tu dis, et il se peut que ce soit ce qu’ils ont exprimé. Comme je suis toujours enclin à voir le côté positif, je ne doute pas de la sincérité de don Mauro, jusqu’à ce que les faits me prouvent le contraire. Que sais-tu, toi, si, du jour au lendemain, Inès devient une demoiselle, avec carrosse et page, couverte de diamants comme un noisetier est couvert de noisettes, et vivant dans une de ces grandes demeures de Madrid, plus grandes qu’un couvent ?
- Bah ! Bah ! Cela c’est comme lorsque je voulais être prince, généralissime et secrétaire de bureau. A dix-sept ans, on peut dire des choses comme ça, mais pas à soixante.
- A vivre avec moi, Inès est condamnée à l’éternelle étroitesse. Ne vaut-il pas mieux que la famille de sa mère l’emmène, ce sont des gens charitables apparemment, non ? En tout cas, Gabriel, si la jeune fille n’était pas consentante là-bas, nous aurons le temps de la reprendre, parce que moi, en tant qu’oncle charnel, j’en ai la tutelle.
- Et pourquoi la laissez-vous partir ?
- Parce que les Requejo sont riches… Est-ce que tu vas enfin le comprendre ?… Parce qu’Inès chez ces gens-là peut être comme une princesse et se marier enfin avec un riche commerçant de la rue Postas ou de Platerías.
- Stop là, monsieur, m’écriai-je en colère, qu’est-ce que c’est que cette histoire de marier Inès ? Inès, si Dieu me vient en aide, ne se mariera qu’avec moi. Oui, allez lui parler de commerçants et de vos seigneuries !
- C’est vrai, je ne m’en souvenais plus, mon petit, dit le curé, quelque peu moqueur. Se marier à dix-sept ans ! Le mariage est-il un jeu ? En plus, fais-moi le plaisir de me dire combien tu gagnes, toi, à l’imprimerie où tu travailles.
- Autour de trois réaux par jour.
- Ce qui veut dire, quatre-vingt-treize réaux les mois à trente et un jours. C’est déjà quelque chose, mais ça ne suffit pas, mon petit. Tu vois bien, quand Inès sera dans son salon à rideaux verts avec des branches jaunes et qu’elle s’assiéra à ces tables où il y aura sept dindes pour Noël, et tous les soirs, des perdrix à volonté… tu vois bien, je ne sais pas comment tu pourras t’approcher d’elle, un prétendant à quatre-vingt-treize réaux par mois, les mois de trente et un jours.
- Cela, c’est elle qui en décidera, répondis-je avec la plus grande anxiété ; si elle m’aime comme ça, nous verrons si tous les Requejo du monde peuvent l’en empêcher. Bref, monsieur don Celestino, vous êtes décidé à laisser partir Inès avec don Mauro, cet après-midi ?
- C’est décidé, mon garçon, pour moi, c’est un cas de conscience.
- Et qui vous dit qu’avec quatre-vingt-treize réaux par mois, on ne peut pas entretenir une famille ? Moi, j’ai envie de me marier, oui, monsieur.
- Se marier à dix-sept ans ! L’un et l’autre, vous devez attendre d’avoir trente-cinq ans accomplis. La vie passe vite : ne t’en fais pas. Alors, vous pourrez vous marier. Vous êtes faits l’un pour l’autre. Se marier, sympathiser, chacun trouve sa chacune. Nous verrons si d’ici là tu t’en sors mieux dans ton métier.
- Et si j’arrive à trouver un autre poste ?
- C’est comme lorsque tu t’es mis en tête d’avoir un duché ou une principauté.
- Non, un poste que peut avoir n’importe quel va-nu-pieds, dans la comptabilité ici ou là.
- Mais tu crois qu’un emploi est si facile à obtenir ?
- Pourquoi pas ? répondis-je avec orgueil. A quoi servent les postes sinon à les donner à tous les Espagnols qui en ont besoin ?
- Mon garçon, les antichambres sont pleines de candidats. Rappelle-toi que, tout compatriote et ami du Prince de la Paix que je suis, j’ai fait des demandes pendant quatorze ans.
- Mais enfin… aujourd’hui, vous voyez son Altesse et vous le fréquentez ; de sorte que si vous lui demandiez une petite place pour moi, je ne crois pas qu’il vous la refuserait.
- Ah ! s’écria don Celestino avec satisfaction. Le jour où j’ai visité son Altesse fut le jour le plus flatteur de ma vie, car j’ai entendu de ses augustes lèvres les mots les plus aimables. Si tu avais vu l’accueil qu’il m’a réservé, quelle amabilité, quelle douceur, quelle simplicité pour un prince dans ses gestes et ses paroles ! Quand je suis entré, j’étais tout troublé et confus, et ma langue restait collée à mon palais. Son Altesse m’a ordonné de m’asseoir et m’a demandé si j’étais de Villanueva de la Serena. Tu vois, quelle bonté ! Je lui ai répondu que j’étais né à Los Santos de Maimona, ville qui est sur la grand-route qui va de Badajoz à Fuente de Cantos. Ensuite, il m’a parlé des récoltes de l’année, je lui ai dit que, d’après mes renseignements, le seigle et l’avoine ce n’était pas bon, mais que les glands donnaient bien. Tu comprends bien par là l’intérêt qu’il porte à l’agriculture. Ensuite, il m’a demandé si j’étais content de ma paroisse, ce à quoi j’ai répondu par l’affirmative, ajoutant que j’étais édifié par la piété de mes fidèles ; en disant cela, je n’ai pu retenir mes larmes. On voit bien que le Prince s’intéresse à tout ce qui concerne la religion. Je lui ai dit ensuite que je passais mes moments libres à faire de la poésie latine et je lui ai fait remarquer que j’avais composé un poème en hexamètres, exprès pour lui. Quand il a su cela, il m’a dit «bon», ce qui démontre de manière éclatante son immense passion pour les lettres humaines ; enfin, au bout de dix minutes de réunion, il m’a prié affectueusement de me retirer, parce qu’il avait des affaires très urgentes à régler. Cela prouve que c’est un travailleur et que les meilleures heures de la journée, il les passe de façon précise à l’administration. Je t’assure que j’en suis sorti très ému.
- Et vous ne retournez pas ?
- Eh bien, sûrement que je vais y retourner ! J’ai supplié son Altesse de fixer un jour pour que je lui remette mon poème latin et demain, j’aurai l’honneur de remettre de nouveau les pieds dans le palais de mon illustre compatriote.
- Eh bien, j’irai avec vous, monsieur don Celestino, dis-je très déterminé. Nous irons ensemble et vous lui demanderez un poste pour moi.
- Tu es fou ! s’écria le prêtre très étonné. Je ne me sens pas capable d’une telle irrévérence.
- Eh bien, je le lui demanderai, moi, dis-je de plus en plus résolu à entrer dans l’administration.
- Modère tes élans, jeune homme sans expérience. Comment veux-tu que je me présente comme ça au Prince de la Paix ? Qu’est-ce que je peux dire de toi, quels sont tes mérites ? Connais-tu un traître mot des vers latins ? As-tu salué ne serait-ce que le Divitias alius fulvo sibi congerat auro, le Passer, delitiæ meæ puellæ ou le Cynthia prima suis me cepis ocellis ? Tu es fou, tu crois que les postes sont faits pour les morveux qui viennent tout d’un coup les demander ?
- Vous lui dites que je suis de votre famille et moi, je me charge du reste.
- De ma famille ? Ce serait un mensonge, et moi, je ne mens pas.
Nous nous disputâmes ainsi un bon moment et, enfin, à force de le supplier et de le raisonner, je parvins à convaincre le père Celestino de m’emmener en présence du sérénissime monsieur Godoy. L’opiniâtreté de mon projet venait de l’état désespéré dans lequel me mirent la visite des Requejo et leur intention de s’occuper de la pauvre Inès. La vive antipathie que j’avais pour tous les deux, aussitôt posé le regard sur eux, engendra dans mon esprit de terribles pressentiments. Je me représentais la pauvre orpheline, comme malheureuse esclave de ces deux voyous, condamnée à périr de tristesse si Dieu ne m’envoyait pas les moyens de la sortir de là. Comment pouvais-je y parvenir ? Je n’étais qu’un pauvre va-nu-pieds. Pensant à tout cela, il me vint à l’esprit une idée salvatrice, celle qui depuis déjà longtemps, commençait à être la boussole de la moitié, de la plupart des Espagnols, c’est-à-dire de tous ceux qui n’étaient pas les aînés de leur famille et qui ne se sentaient pas attirés par le couvent ; l’idée d’acquérir une place dans l’administration. Ah ! Même si les places n’étaient pas nombreuses, les candidats ne manquaient pas.
L’Espagne avait dépensé dans la guerre contre l’Angleterre, l’épouvantable somme de sept millions de réaux. Celui qui avait dépensé tout cela dans une telle extravagance ne pourrait pas m’en donner cinq mille pour me permettre de me marier ? Bien entendu, le fait de vouloir me marier à dix-sept ans était une extravagance pire que celle de dépenser sept millions de réaux dans une guerre. Cette idée prit racine dans mon cerveau très rapidement. Une demi-heure après mon entrevue avec don Celestino, je m’imaginais déjà être devant la table couverte d’un tissu vert, remplissant les fonctions que l’Etat me donnerait pour sa prospérité et son salut. C’était osé de demander moi-même au puissant ministre ce que je voulais ; mais la gravité de la situation et le désir fou d’obtenir une situation qui me permettrait de disputer la possession d’Inès à ce terrible couple des Requejo diminuaient les obstacles devant mes yeux, me donnant du courage pour les entreprises les plus difficiles.
L’orpheline ne me cacha pas, dans une conversation, la répugnance que lui inspiraient son oncle et sa tante : j’aurais peut-être pu empêcher le séquestre ; mais don Celestino répéta que c’était pour lui un cas de conscience, et devant cela, Inès n’osa pas formuler ses plaintes, tellement on était grandement soumis à l’autorité des adultes, à l’époque. Les scrupules du brave prêtre ne m’empêchèrent cependant pas de lui dire pis que pendre des deux Requejo, critiquant leur tête, leur façon de s’habiller, et commentant à ma manière cette histoire de sept dindes et chapons, et les perdrix par personne à l’heure du repas. Je me moquai aussi avec un incroyable entêtement des titres que se donnaient le frère et la sœur, comme le lecteur l’aura remarqué, à s’appeler tout simplement par celui-ci et celle-là. Don Celestino me dit en m’écoutant de prendre plus d’égards vis-à-vis de deux personnes respectables qui avaient su se forger une fortune considérable par leur travail et leur honnêteté, pendant qu’Inès préparait ses affaires contre son gré.
La maison du prêtre ne tarda pas à se voir honorée de recevoir à nouveau les personnes des Requejo, qui arrivèrent vers quatre heures, faisant mille éloges des terres acquises près d’Ontígola ; et leur joie de voir Inès disposée à les suivre fut extraordinaire.
- Ne te presse pas, petit trésor, disait don Mauro, on a tout notre temps.
- Son impatience à entreprendre ce voyage, ajouta doña Restituta, plissant de manière indéfinissable la doublure cutanée de son visage, est si vive que la pauvrette voudrait avoir des ailes pour partir le plus tôt possible.
- ça non, dit don Celestino un peu vexé ; son oncle ne l’a pas si mal traitée qu’elle soit si impatiente de l’abandonner.
Inès se jeta dans les bras du prêtre et tous deux versèrent d’abondantes larmes. Pour ma part, j’avais intérêt à ce que les Requejo ne sachent pas l’amour ancien et cordial qui m’unissait à Inès, je dissimulai donc mon angoisse et l’attendant dehors quand elle sortit pour chercher un objet oublié, je lui dis :
- Ma chérie, ne dis pas un mot, ne me regarde pas, ne me salue pas. Moi, je reste ici, mais ne te tracasse pas ; nous n’allons pas tarder à nous revoir là-bas.
L’heure du départ arriva enfin ; la voiture s’approcha à la porte de la maison. Inès y entra tout en pleurs et les Requejo prirent place de chaque côté, car, même là, ils avaient peur qu’elle leur échappe. Jamais je n’ai vu une femme aussi rapace que doña Restituta à ce moment-là. La voiture partit et peu de temps après, nos yeux la perdirent parmi les arbres. Don Celestino qui avait fait un effort pour faire croire à son grand calme, ne put résister et faisant la grimace comme les enfants, sortit son grand mouchoir et le porta à ses yeux.
- Ah ! Gabriel, ils l’emmènent.
Mon émotion aussi était intense et je ne pus lui répondre.
– VI –
Le lendemain, don Celestino m’emmena au palais du Prince de la Paix. C’était le 15 mars, si ma mémoire est bonne.
Je n’avais pas de quoi me changer pour une si solennelle occasion mais les vêtements que je portais à Aranjuez étaient ce que j’avais de mieux ; la chemise propre que me prêta le prêtre, m’aida à me trouver, selon lui, à même de me présenter devant Napoléon Bonaparte lui-même. En chemin et pour passer le temps avant de voir arriver l’heure des audiences, don Celestino sortait de la poche intérieure de sa soutane le poème latin pour le lire à voix haute.
- Peut-être que monsieur le Prince, disait-il, va me demander de lire quelque extrait, il convient de le faire avec intonation classique et sur un rythme assuré, surtout s’il y a un ambassadeur ou un général étranger.
Ensuite, rangeant son manuscrit, il ajouta avec une certaine hésitation :
- Sais-tu que le sacristain de la paroisse, ce maudit Santurrias… tu le connais bien… m’a tout tourneboulé ce matin ? Il dit que monsieur le Prince de la Paix ne va pas rester plus de deux jours à la tête de la nation et qu’on va lui couper le cou. Tout ça ne mérite que le mépris, Gabrielillo ; mais c’est rageant d’entendre traiter ainsi une personne si respectable. Car, qu’est-ce que tu crois ? J’ai découvert que ce voyou de Santurrias est jacobin et se retrouve avec les cochers de l’infant don Antonio Pascual, lesquels sont des gens très tapageurs.
- Et que dit ce révérend sacristain ?
- Mille bêtises, figure-toi. Comme si on pouvait faire avaler de telles balivernes à des gens instruits et qui connaissent leurs classiques latins sur le bout des doigts ! Il dit que monsieur le Prince de la Paix, craignant que Napoléon vienne détrôner nos chers souverains, a pris le parti de les faire fuir vers l’Andalousie afin de les voir s’embarquer et mettre les voiles vers les Amériques.
- Eh bien, hier soir, dis-je, quand je suis allé à l’auberge pour dire aux muletiers de ne pas m’attendre, j’ai entendu dire la même chose exactement par ceux qui étaient là, et sûrement qu’ils parlaient de votre ami et compatriote avec plus de mépris que l’on parle à un cabaretier du Rastro.
- Ils ne savent pas ce qui les attend, mon garçon, me dit le prêtre. Mais, ou je me trompe beaucoup ou les partisans du Prince des Asturies sont en train de mettre la zizanie partout. C’est qu’à Aranjuez, il y a beaucoup de gens bizarres et… Mon Dieu !… Santurrias m’a bien dit ce matin que son plus grand plaisir serait de sonner les cloches à toute volée si le peuple se mutinait pour demander quelque chose ; mais je lui ai dit, et en disant cela don Celestino s’arrêta et agitait le doigt avec la plus grande énergie, que s’il sonnait les cloches de l’église sans ma permission, j’en ferais part à monsieur le doyen pour qu’il résolve le cas.
Cette conversation terminée, ce fut l’heure, pour nous, d’arriver au palais de son Altesse Royale. Nous passâmes entre les gardes qui veillaient à la porte parce qu’il faut savoir que le généralissime avait sa garde à pied et à cheval comme le Roi, et encore mieux équipée, d’après l’observation des curieux. Personne ne mit obstacle à notre passage dans le hall ni dans les escaliers ; mais en arrivant à un grand vestibule dont le sol résonnait des talonnades de bottes d’un autre groupe de gardes, l’un d’eux nous arrêta pour demander à don Celestino, de manière assez impertinente, où nous allions.
- Son Altesse, dit le clerc très troublé, a eu l’honneur de m’indiquer… je veux dire… J’ai eu l’honneur que lui me donne rendez-vous aujourd’hui à cette heure-ci.
- Son Altesse est au Palais-Royal. Nous ignorons quand il reviendra, dit le garde en faisant demi-tour.
Don Celestino me consulta des yeux et allait me consulter aussi de ses lèvres autorisées quand on entendit du bruit dans le hall.
- Le voilà ! Son Altesse est arrivée, dirent les gardes, prenant précipitamment leurs armes et leur chapeau pour rendre les honneurs.
Mais le Prince monta dans ses appartements particuliers par l’escalier dérobé qu’il y avait dans le palais, exprès.
- Peut-être que son Altesse ne recevra pas aujourd’hui, dit à don Celestino le garde qui nous avait arrêtés peu avant. Cependant vous pouvez attendre si ça vous plaît et lui décidera s’il donne audience ou non.
Ceci dit, il nous fit passer à une salle attenante et très grande où nous vîmes beaucoup de gens qui, dès le matin, étaient venus pour solliciter la faveur d’une entrevue avec son Altesse. Entre autres, il y avait des dames très distinguées, des militaires, des messieurs à l’ancienne, vêtus de l’historique casaque et couverts de la monumentale perruque, mais aussi des gens très humbles.
Les prétendants réunis là se regardaient avec méfiance et de méchante humeur parce que tous ceux qui font antichambre sont gênés de se voir accompagnés, considérant sans doute que, si le temps et la bienveillance du ministre sont partagés entre tous, il ne leur restera pas grand-chose. Un huissier s’approcha de nous et demanda à don Celestino qui nous étions, ce à quoi le brave ecclésiastique répondit :
- Nous sommes prêtres de la paroisse de… je veux dire que je suis le curé et ce jeune homme est… ce jeune homme gagne quatre-vingt-treize réaux par mois de trente et un jours ; et nous venons pour… mais je n’ai rien à demander à monsieur le Prince parce que ce petit voyou (en me montrant) n’est pas capable de garder sa langue quand il le faut.
Quand l’huissier s’éloigna, je dis à mon accompagnateur de faire attention à ne pas se tromper si souvent ; de ne pas annoncer à l’avance notre situation de quémandeur et qu’il n’était pas obligé de crier sur les toits ce que je gagnais, ce à quoi il répondit que lui, tout nouveau dans les antichambres et les palais, se troublait à la première occasion et disait un tas de bêtises. Un des messieurs qui attendaient s’approcha de nous et, reconnaissant le prêtre, ils se saluèrent de façon très courtoise. L’inconnu disait :
- Monsieur don Celestino, quel bon vent ?
- Je viens rendre visite à son Altesse. Vous savez bien que nous sommes compatriotes et amis. Mon père et son grand-père ont fait un voyage ensemble de Trujillo à la Vera de Plasencia et un oncle maternel avait à Miajadas une prairie où les Godoy allaient chasser parfois. Nous sommes amis et je lui suis très reconnaissant parce que je dois à la munificence de son Altesse le bénéfice dont je jouis, ce bénéfice m’a été accordé dès que son Altesse a eu connaissance de mes besoins ; et donc, entre ma première requête et le jour où j’ai pris possession de mes biens, il ne s’est passé que quatorze ans.
- On voit bien que le Prince a voulu vous rendre un service, dit notre interlocuteur. Ce n’est pas si rapide pour tout le monde. Cela fait vingt-deux ans que moi, j’essaie d’obtenir qu’on me rende mon ancienne place dans la collecte des contributions et c’est justement l’heure, monsieur don Celestino. Malgré tout, je ne me décourage pas, et encore moins maintenant parce que je suis à peu près sûr que la semaine prochaine…
- Tout le monde n’a pas la même chance que moi, dit l’optimiste don Celestino. Il est vrai qu’en tant que compatriote et ami de son Altesse, je suis en situation plus favorable. De mon village à Badajoz, berceau de don Manuel Godoy, il n’y a que treize lieues et demie par la route, et j’ai très souvent vu la maison où ce phare de l’empire espagnol est né. Et donc, dès qu’il a eu connaissance de mes besoins…
- Mais dites-moi, demanda en baissant le ton l’homme de la semaine prochaine, nous allons avoir un voyage des Souverains pour l’Andalousie ou pas ?
- Mais, croyez-vous de telles balivernes ? dit don Celestino. Ce bruit, c’est Santurrias, le sacristain de mon église qui l’a fait courir. Je lui ai déjà dit que s’il faisait sonner les cloches sans ma permission…
- Tout le monde en est persuadé. Vous savez bien qu’il est venu une troupe nombreuse de Madrid et on trouve en chemin plein de gens aux manières louches.
- Mais quel but peut bien avoir ce voyage ?
- Mon ami, Napoléon a déjà en Espagne la bagatelle de cent mille hommes. Il a nommé Murat comme général en chef et on dit de lui qu’il est déjà parti d’Aranda pour Somosierra. Et, à propos, y a-t-il quelqu’un qui sache ce que viennent faire ces gens-là ? Viennent-ils mettre dehors toute la Famille Royale ? Viennent-ils simplement en passant pour rejoindre le Portugal ?
- Qui redoute une telle chose ? dit don Celestino. Admettons qu’ils viennent mal intentionnés. Que sont cent mille hommes ? Deux ou trois de nos régiments en viendront facilement à bout et sans trop se fatiguer. Son Altesse n’a qu’à chausser ses éperons… Cette histoire de voyage est une pure invention de gens inactifs et ennemis de son Altesse, ils l’insultent parce qu’il ne leur a pas trouvé de poste. Comme si les postes pouvaient s’accorder à tous ceux qui en font la demande.
La conversation prit fin parce que l’huissier s’approcha de nous et nous fit signe de le suivre. Son Altesse nous demandait de passer. Quand les autres prétendants virent qu’on accordait une préférence à ceux qui étaient arrivés les derniers, un murmure de mécontentement se fit entendre dans la salle. Nous traversâmes, fiers de cette faveur et, pendant que don Celestino saluait ici ou là avec sa bonhomie coutumière, moi, j’adressai aux plus proches un regard de mépris qui équivalait à la conviction de ma future entrée dans l’administration des deux mondes.
Nous passâmes de cette salle à une autre puis à une autre, toutes richement meublées. Quelles belles tapisseries, quels jolis tableaux, quelles belles statues de marbre et de bronze, quels vases élégants, quels candélabres magnifiques, quels meubles raffinés, quels rideaux splendides, quels tapis moelleux ! Je ne pus m’arrêter à regarder tant de jolis objets parce que l’huissier nous conduisait à toute vitesse ; je me sentais pris d’une timidité telle que ma hardiesse du début se dissipa et je commençai à comprendre que je manquerais d’idées et de salive pour exprimer mes désirs devant le Prince. Nous arrivâmes enfin dans le bureau de Godoy et, en entrant, je le vis debout, penché près d’une table, vérifiant quelques documents. Nous attendîmes un bon moment qu’il daigne nous regarder et enfin, il nous regarda.
Godoy n’était pas un bel homme, comme on le croit généralement ; par contre oui, il était extrêmement sympathique. La première chose que remarquait l’observateur était son nez, un peu grand et retroussé, ce qui lui donnait une expression de franchise et de communicabilité. Il devait avoir autour de quarante ans ; sa tête droite, bien faite et gracieuse, ses gestes mesurés et la prestance de son corps, plutôt petit, faisaient qu’il était agréable à voir. Il avait sans aucun doute la silhouette d’un homme noble et généreux ; son cœur penchait peut-être aussi vers ce qui est grand ; mais sur son visage se révélaient l’évanouissement, la maladresse, les erreurs et les fausses idées des hommes et des choses de son temps.
Il nous regarda, comme j’ai dit et, immédiatement, don Celestino, qui tremblait comme un gamin de dix ans, fit une profonde révérence et moi une autre. Le chapeau de mon accompagnateur tomba, il le récupéra, fit quelques pas et, d’une voix bégayante, dit :
- Puisque votre Altesse a l’honneur de… non… je veux dire… puisque j’ai l’honneur d’être reçu par votre Altesse sérénissime… je disais que je me félicite de savoir que la santé de votre Altesse est bonne, pour que nous puissions continuer à faire le bien de la nation pendant encore mille ans…
Le Prince semblait très soucieux et ne répondit pas à la salutation sauf par une légère inclinaison de la tête. Il sembla se souvenir et dit :
- C’est vous, monsieur le chantre de la cathédrale d’Astorga, qui venez pour…
- Permettez-moi, votre Altesse, interrompit don Celestino, de me faire reconnaître, je suis le curé de la paroisse militaire d’Aranjuez.
- Ah ! s’écria le Prince, je me souviens… l’autre jour… je vous ai donné la charge de curé sur les recommandations de madame la comtesse de X (Amaranthe). C’est vous qui êtes originaire de Villanueva de la Serena ?
- Non, monsieur, je suis de Los Santos de Maimona. Votre Altesse ne se souvient pas de cette ville ? Sur le chemin de Fuente de Cantos. C’est là qu’on récolte des pastèques qui pèsent je ne sais combien d’arobes, il y a aussi un tas de melons… Eh bien, comme je disais à votre Altesse, je venais aujourd’hui avec deux intentions : celle d’avoir l’honneur de me présenter à votre Altesse pour que ce garçon lise un poème latin qu’il a composé… non, je veux dire…
Don Celestino s’étrangla, tandis que le Prince, étonné de ma précocité dans les études classiques, me regardait d’un œil bienveillant.
- Non, dit le prêtre en retrouvant l’usage de sa langue. Le poème, c’est moi qui l’ai composé et, sur les désirs de votre Altesse, je vais commencer la lecture.
Le Prince avança la main dans ce mouvement instinctif de quelqu’un qui veut écarter un objet invisible. Mais don Celestino ne comprit pas que son protecteur repoussait d’un mouvement physique la menaçante lecture du poème et, ferme dans son intention, dégaina le manuscrit homicide. Dans le même moment, Godoy, qui s’occupait peu de nous et semblait absorbé par des choses plus graves, se retourna brusquement vers la table et commença à feuilleter à nouveau ses documents. Don Celestino me regarda et je regardai don Celestino.
Il se passa ainsi une minute et à la fin, le Prince s’adressa à nous et dit en montrant quelques chaises :
- Asseyez-vous.
Ensuite, il poursuivit ses recherches dans ses papiers. Assis sur nos sièges, le prêtre et moi, nous nous mîmes à parler à voix basse.
- Si tu veux exposer ton idée, me dit l’oncle d’Inès, tu dois attendre que j’aie lu mon poème, ce qui, pause comprise, ne va pas durer plus d’une heure et demie. L’admirable effet que va produire l’audition des vers classiques qu’il aime tant va le prédisposer en ta faveur et je ne doute pas qu’il va t’accorder tout ce que tu lui demanderas.
Après un autre moment d’attente, un officier entra pour donner une dépêche au Prince. Celui-ci l’ouvrit aussitôt et, après l’avoir lue avec beaucoup d’anxiété, le remit sur la table et s’adressa à don Celestino.
- Excusez, dit-il, ma distraction. Aujourd’hui est un jour de grands soucis inattendus. Je pensais ne recevoir personne en audience, et si je vous ai demandé d’entrer, c’est que je savais que vous ne veniez pas me demander un poste.
Don Celestino s’inclina en signe d’assentiment, et je me dis à moi-même : «Nous voilà bien !» Ensuite, son Altesse s’adressa à moi et me dit :
- Quant au poème latin que ce jeune homme a composé, je note qu’il s’agit d’une œuvre remarquable. Continuez, appliquez-vous à de bonnes études et vous serez un homme précieux. Je ne peux pas avoir le plaisir de connaître le poème aujourd’hui ; mais on m’avait déjà parlé de vous et on m’avait fait beaucoup d’éloges, j’ai donc pensé vous intégrer dans les bureaux de l’Interprétation des langues, où votre précocité pourrait être de grand profit. Auriez-vous l’amabilité de me donner votre nom…
Don Celestino allait répondre pour rectifier l’erreur ; mais son trouble l’en empêcha. Avant que mon compagnon ait pu retrouver ses mots, je me levai et, écrivant mon nom sur un papier que je trouvai sur la table, je le présentai respectueusement au Prince, qui termina ainsi :
- Je vous prierai d’avoir la bonté de vous retirer, car mes soucis ne me permettent pas de prolonger cette audience.
Nous fîmes de nouvelles révérences, don Celestino balbutia les formules pompeuses propres à la situation et nous sortîmes du bureau du Prince. En passant dans la salle où attendaient avec impatience les autres prétendants, l’huissier lança cette terrible nouvelle : «Il n’y a pas d’audience !»
De retour dans la rue, le brave prêtre, retrouvant la sérénité de son esprit et l’agilité de sa langue, me dit non sans colère :
- Pourquoi n’as-tu pas dit que le poème était de moi et non de toi ?
Je ne pus me retenir et j’éclatai de rire en voyant son amour propre piqué au vif et en considérant le résultat étrange de notre visite au Prince de la Paix.





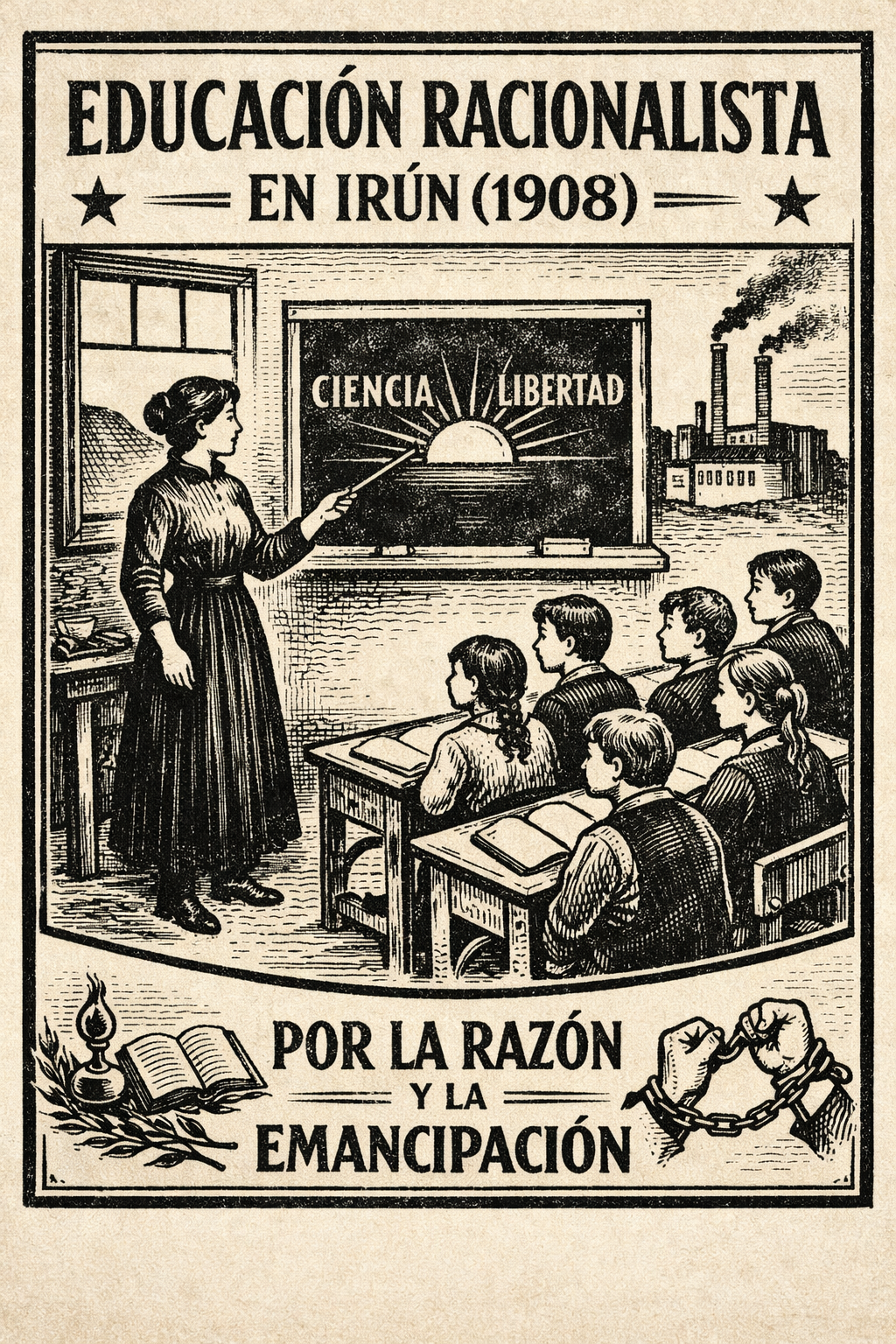










Been trying out PHS777 recently. The graphics are sharp and they’re always adding new games, so it keeps things interesting. Give it a spin! phs777
Yo, 123win64’s the real deal! Been playing here for ages and the wins keep coming. Fair play and good vibes only. Check it out: 123win64
I believe this is one of the so much significant info for me. And i am glad reading your article. But want to observation on few basic issues, The website style is ideal, the articles is in point of fact excellent : D. Just right job, cheers
Easy to log in to Jili77. No problems so far. Now, let’s get this bread! If you’re looking to log in, try this: jili77login
Tried out the Betdasorteapp and it’s pretty slick. Smooth interface, easy to use, and all the essentials right there. If you like to be on the go with a flutter, give it a go. Take a peak here betdasorteapp
you’re really a good webmaster. The website loading speed is amazing. It seems that you’re doing any unique trick. Also, The contents are masterpiece. you have done a wonderful job on this topic!
Thanks a bunch for sharing this with all of us you really know what you are talking about! Bookmarked. Please also visit my site =). We could have a link exchange arrangement between us!
This web site is really a walk-through for all of the info you wanted about this and didn’t know who to ask. Glimpse here, and you’ll definitely discover it.