No hay productos en el carrito.

Traduction de Daniel Gautier
Première partie
1
C’est à un journaliste, nouvelle génération, vous savez, ces journalistes qu’on désigne sous le nom exotique de reporter, de ces gens qui courent après l’information, comme le lévrier court après le lièvre, qui poursuivent l’incendie, les disputes, le suicide, le crime tragique ou comique, l’effondrement d’un immeuble et tous ces événements qui affectent l’ordre public et la Justice en temps normal ou la santé en temps d’épidémie, c’est à un journaliste donc que je dois la découverte de la pension de la mère Chanfaina (Estefania, selon les registres paroissiaux). Elle est située dans une rue dont l’exigüité et la pauvreté contrastent de manière plus qu’ironique avec son brillantissime nom grandiloquent de rue des Amazones. Ceux qui ne sont pas encore habitués à l’éternelle gouaille de Madrid, la ville du sarcasme et des mensonges roublards, ne prêteront pas attention à la terrible fatuité que suppose une enseigne si sonore dans une rue si immonde. Ils ne se demanderont pas non plus quelles furent les amazones qui la baptisèrent ainsi, ni d’où elles vinrent, ni ce qu’elles pouvaient bien avoir perdu dans les champs d’arbousiers de l’Ours[1]. Voilà un grand vide que mon érudition s’empresse de combler pour mettre en lumière mon orgueil de chroniqueur futé. Dans ces lieux, en des temps bien reculés, il y avait un théâtre de la Ville, d’où sortirent à cheval, parées dans le style des héroïnes mythologiques, des mascarades de bonnes femmes qui avaient participé aux festivités organisées à Madrid pour l’entrée de la reine doña Isabel de Valois. Et au dire du candide chroniqueur contemporain, de qui je tiens ces précieux renseignements :»Ces femmes-là firent montre d’un courage extrême sur les places et dans les rues de la Ville, tant leurs jeux, leurs tours d’équilibrisme et leurs voltiges étaient risqués, quand les guerriers faisaient semblant de les prendre par les cheveux et les arrachaient de leurs arçons pour les précipiter au sol.» Ce dut être un divertissement mémorable car depuis lors on appela ce théâtre Les Amazones, et voilà le glorieux passé de la rue, rendue illustre de nos jours par la généreuse institution de bienfaisance de la mère Chanfaina.
J’ai, pour ma part, le sentiment que les amazones dont parle le chroniqueur de Philippe II, mon cher monsieur, étaient des nanas dévergondées du XVIème siècle, mais je ne sais pas comment le peuple les appelait à cette époque-là. Par contre, ce que je peux assurer c’est que cette Chanfaina doit bien descendre de l’une d’elles, en ligne hybride c’est à dire par succession directe de ces viragos sans père connu. C’était la terrible Estefania, la fille de Gibraltar, Chanfaina ou comme vous voudrez l’appeler. Parce que je peux vous dire en toute vérité que la plume m’en tombe des mains quand je veux lui appliquer le paisible nom de femme, et qu’il suffira de faire connaître à mes lecteurs sa dégaine, ses allures, sa grosse voix, son langage et ses façons de faire pour qu’ils reconnaissent en elle la plus formidable mégère qui ait jamais été vue par les vieux Madrilènes et que ne verront jamais leurs descendants.
Cependant, vous pouvez croire que je rends grâce à Dieu et à mon ami le reporter, de m’avoir mis face à cette bête fauve, car je dois à sa sauvagerie l’origine de la présente histoire et la découverte du singulier personnage qui lui donne son nom. Que personne ne prenne au pied de la lettre cette histoire de pension dont je vous ai parlé au début, car entre les différentes modalités de logement que la mère Chanfaina offrait dans ce quartier et celles du centre de Madrid, que nous avons tous connues en tant qu’étudiants, et même après, il n’y a de commun que le nom. Le porche de ce bâtiment était comme celui d’une auberge, large, avec tout le crépi craquelé en mille dessins fantastiques. Il laissait voir ici et là l’ossature même du mur dénudé et couvert d’une couche de crasse d’un côté comme de l’autre, marque des continuels frottements des personnes plus que des chevaux. Un kiosque de boissons, – bouteilles et carafes, récipient de verre poussiéreux, plein de morceaux de sucre assiégé par les mouches, le tout sur une table chancelante et sale, – ramenait l’entrée à des dimensions raisonnables. La cour, mal empierrée et très mal balayée, comme le porche d’ailleurs, avec de grands trous et de temps en temps des touffes d’herbe rachitique, des flaques, des coins boueux ou couverts de morceaux de cruches et de ‘botijos’[2], était d’une irrégularité plus que pittoresque, fantastique. Le pan de mur sud avait dû appartenir aux anciennes constructions du fameux théâtre : le reste, d’époques différentes, aurait pu passer pour une facétie architecturale : des fenêtres qui cherchaient à descendre, des portes qui s’étiraient pour monter, des balustrades transformées en cloisons, des murs dégoulinants d’humidité, des canalisations oxydées et tordues, des tuiles sur les rebords, des plaques de zinc clouées sur des madriers pourris pour boucher un trou, des angles aplatis, des décorations de chaux récente en croix ou en crochets, des faîtages hérissés de tessons ou de fonds de bouteille pour effrayer les voleurs. D’un côté des piliers droits mais vermoulus soutenaient une galerie qui penche comme un bateau échoué, de l’autre, des portes à panneaux percées de chatières si grandes que des tigres auraient pu s’y faufiler, s’il y en avait eu, des grilles de couleur cannelle, des morceaux de briques violacées comme des caillots de sang, et enfin les divagations de la lumière et de l’ombre sur tous ces angles tranchants et ces sinistres anfractuosités.
C’est un mardi de Carnaval, je m’en souviens très bien, que le brave reporter eut la plaisante idée de me faire échouer en ces lieux. Dans le troquet du porche, j’ai vu une borgne en guenilles qui servait et la première chose que nous avons pris en pleine figure en pénétrant dans la cour fut une bruyante horde de gitans qui avaient élu domicile à cet endroit ce jour-là : les hommes, à croupetons, fabriquaient des harnais, les femmes s’épouillaient et arrangeaient leurs tignasses, les gamins, à moitié nus, les yeux noirs et les cheveux frisés, jouaient avec des bouts de verre et des débris. Ils tournèrent vers nous leurs visages expressifs de terre cuite, et nous les entendîmes nous proposer de nous prédire l’avenir dans leur langage mielleux. Deux ânes et un vieux gitan aux favoris soyeux et feutrés comme le poil de ces animaux résignés, complétaient le tableau, auquel il ne fallait pas oublier d’ajouter, pour être précis, le bruit et les chansons, les rengaines d’une gitane et les coups de ciseaux du vieux qui était en train de tondre la croupe d’un baudet.

Apparurent alors, dans un renfoncement, je ne saurais dire s’il s’agissait d’une porte, d’une pièce ou de l’entrée d’une grotte, deux vendeurs de miel, décharnés, les jambes boudinées dans du drap gris et des bas noirs, des sandales à lanières, le gilet ajusté, le foulard sur la tête, les types mêmes de la race castillane, vieilles peaux tannées recouvertes d’amadou. Une mauvaise plaisanterie aux gitans et les voilà partis avec leurs balances et leurs pots vendre à Madrid leur miel savoureux. Nous vîmes ensuite deux aveugles qui suivaient le mur à tâtons. L’un d’eux, un bon gros bien dodu, portait un bonnet de peau gris, une cape à franges et une guitare accrochée sur son dos ; l’autre possédait un violon qui n’avait plus que deux cordes, une écharpe et une casquette de militaire sans galons. Une gamine vint les rejoindre, pieds nus, serrant dans ses bras un tambourin et ils sortirent par le porche sans oublier de boire l’indispensable petit verre.
Là, ils entamèrent une vive discussion avec d’autres qui venaient d’arriver pour goûter eux aussi l’eau de vie. C’étaient deux filles déguisées : l’une tout habillée de serpillières affreuses, si on peut appeler ça s’habiller laisser pendre des serpillières sur ses épaules. Le visage couvert de suie, sans masque, elle avait une canne à pêche et un mouchoir noué aux quatre coins, plein de figues qui ressemblaient plutôt à des excréments. La deuxième avait son masque à la main, c’était une horrible figure représentant le président du Conseil, son corps disparaissait sous un dessus-de-lit rapiécé, fait de chiffons de différentes couleurs. Elles burent et se laissèrent aller à des grossièretés, puis elles se mirent à courir dans la cour, à grimper par un escalier fait de briques usées et de bois pourri. Là-haut, on entendit un grand tapage de rires et un grand bruit de castagnettes, puis elles descendirent jusqu’à une douzaine de femmes masquées ; deux d’entre elles, vu leurs formes gonflées et leur petite stature, laissaient deviner que c’étaient des femmes habillées en homme. D’autres, vêtues d’habits de théâtre affreux, enfin une autre sans masque, mais le visage peinturluré de rouille. Au même moment, deux hommes sortirent. Ils portaient dans les bras une vieille paralytique qui avait, accrochée à sa poitrine, une pancarte indiquant son âge, plus de cent ans, c’était une bonne manière d’implorer la charité publique. Ils la portèrent jusqu’au coin de la rue d’Arganzuela. Le visage de la vieille était celui d’une châtaigne grillée, en plus gros et on l’aurait bien prise effectivement pour une momie si ses yeux clairs n’avaient révélé dans ce sac de peau et d’os, oublié par la mort, un reste de vie.
Nous vîmes ensuite qu’on sortait le cadavre d’un enfant de deux ans environ, dans un cercueil doublé de percale rose et orné de quelques fleurs artificielles. On le sortit sans la mise en scène habituelle des pleurs ou des adieux maternels, comme si personne au monde n’était chagriné de le voir partir. L’homme qui le portait s’envoya lui aussi son petit verre à la porte et, seules, les gitanes eurent un mot de compassion pour cet être passé si vite dans notre monde. Des enfants déguisés aussi d’un simple pardessus de percaline ou d’un chapeau de carton orné de bandes de papier, des fillettes couvertes d’un châle court, une fleur dans les cheveux à la mode du jour, traversaient la cour s’arrêtant pour écouter les moqueries des gitans ou s’en prendre aux baudets sur lesquels elles seraient bien montées si les propriétaires le leur avaient permis.
Avant d’entrer, le reporter me fit de précieuses remarques qui sans satisfaire ma curiosité ne faisaient que l’accroître. Madame Chanfaina logeait il y a longtemps, des gens de meilleure condition : des étudiants vétérinaires, des marchands ambulants aussi balourds que bons payeurs. Mais, comme l’activité de ce quartier se déplaçait vers la place de la Cebada, la qualité de ses locataires baissait de manière évidente. Aux uns, elle ne retenait que le prix de la chambre, ils devaient se débrouiller pour manger. Aux autres elle accordait logement et nourriture. Dans la cuisine d’en haut, chacun se débrouillait avec ses ustensiles, sauf les gitans qui cuisaient leur fricot dans la cour, sur des trépieds de pierre et de briques. Nous montâmes enfin, pour voir tous les recoins de cette étrange demeure, repaire d’une bonne partie de notre lamentable Humanité, et dans un petit réduit, au sol de dalles brisées qui imitait le mouvement des vagues d’une mer tempétueuse, nous vîmes Estefania en savates. Elle lavait ses grosses mains qu’elle séchait ensuite sur son tablier de toile. Son ventre était volumineux, ses bras herculéens, sa poitrine tombante rivalisait en étendue avec son ventre qui n’avait point de corset pour le retenir. Son cou était énorme, charnu et à fanons comme les taureaux, son visage rouge et des restes bien marqués d’une beauté grossière, gonflée, baroque, criarde, comme celle d’une nymphe sur des plafonds peints, destinée à être vue de loin et qu’on voit de près.
2
Les cheveux étaient gris bien peignés avec d’incalculables crans, ondes et boucles. Le reste de la personne révélait la négligence, le manque absolu de coquetterie et de soin. Elle nous salua par un rire franc, et aux questions de mon ami, elle répondit qu’elle en avait assez de tout ce va-et-vient et qu’un beau jour elle abandonnerait tout pour entrer chez les Petites Sœurs ou bien chez n’importe quelles âmes charitables qui voudraient bien l’accepter. Son affaire était un pur esclavage car il n’y a rien de pire que de se battre pour des pauvres gens, surtout si on a un naturel compatissant comme elle. Parce qu’elle, d’après ce qu’elle nous disait, n’avait jamais eu le culot de demander ce qu’on lui devait et presque toute cette racaille était chez elle en terrain conquis. Les uns la payaient, les autres non et certains s’en allaient emportant qui une assiette, qui une cuiller, qui un vêtement. Ce qu’elle faisait, elle criait, ça oui, elle criait beaucoup, elle en effrayait les gens, mais le faire ne correspondait guère au dire et si elle débinait contre quelqu’un, par exemple, il n’y avait pas de gorge plus sonore que la sienne, ni de mots plus terribles, mais ensuite, elle se laissait enlever le pain de la bouche et le plus sot la faisait marcher et la retenait avec un brin de laine. Elle nous fit enfin l’esquisse de son tempérament et le dernier argument qu’elle nous présenta c’est qu’après vingt et quelques années dans ce nid à rats, logeant des gens de tout poil, elle n’avait même pas de quoi conserver deux pesetas pour pouvoir respirer en paix en cas de maladie.
Elle nous racontait tout cela, lorsqu’entrèrent avec force bruit quatre femmes à masques, comprenez par là, non pas qu’elles portaient un masque de carton ou de chiffon comme l’élément de carnaval, mais la couche de peinture que s’étaient mise ces friponnes, poudre de riz, couches de rouge sur les joues, les lèvres comme ensanglantées, et bien d’autres produits de maquillage, faux grains de beauté, cils et même le dessous des yeux noircis par petites touches pour rendre le regard plus poétique. Il émanait de leurs mains et de leurs vêtements l’odeur d’un parfum bon marché qui annonçait à nos narines «qui va là ?» et pour cette raison et à leur langage, nous comprenions que nous étions dans le milieu le plus abject et le plus miteux de l’espèce humaine. Au début, on aurait pu croire qu’il s’agissait de masques et des couleurs d’une forme extravagante de déguisement carnavalesque. Ce fut d’abord ma première impression, mais je n’ai pas tardé à comprendre que la peinture était pour elles, une affaire ordinaire ou bien que c’était toujours pour elles carême-prenant. Je ne sais pas quel diable d’embrouille elles apportaient, car comme les quatre et Chanfa parlaient en même temps, s’égosillant et faisant des gestes ridicules et furieux, nous ne pûmes rien comprendre. Mais il s’agissait d’une histoire d’épingles et d’un homme. Que s’était-il passé au sujet des épingles ? Qui était l’homme ?
Fatigués de ce charivari, nous sommes sortis dans une galerie qui donnait sur la cour et là, j’ai vu une caisse de terre avec de la mauvaise herbe, des œillets et autres végétaux à demi desséchés, et sur la balustrade des paillassons et des peaux de mouton à sécher. Nous nous sommes promenés là, craignant de voir l’armature délabrée qui nous supportait céder sous notre poids lorsqu’une petite fenêtre, qui donnait sur le couloir, s’ouvrit et apparut une silhouette qui à première vue nous sembla celle d’une femme. C’était un homme. Sa voix, plus que sa tête, nous l’apprit. Sans savoir que nous le regardions de loin, il se mit à appeler mame Chanfaina, qui ne s’occupait absolument pas de lui dans un premier temps. Cela donna à mon compagnon et à moi tout le temps de l’examiner à notre aise.
Il était d’âge moyen, disons, plutôt jeune mais prématurément vieilli, le visage sec voire décharné, le nez aquilin, les yeux noirs, le teint bronzé, la barbe rasée, le type sémite parfait hors du monde mauresque : le pur Arabe sans barbe. Il était habillé de noir. Sur le coup, j’ai cru qu’il s’agissait d’un balandras[3] mais j’ai vu ensuite que c’était une soutane.
– Mais c’est un prêtre, cet homme ? demandai-je à mon ami.
La réponse affirmative m’obligea à une observation plus attentive. Pour sûr la visite à cette maison que j’appellerai maison des Amazones devenait d’une grande utilité pour une étude ethnographique, par la diversité des espèces humaines qui s’y trouvaient : les gitans, les vendeurs de miel, les viragos qui ne pouvaient venir que d’une branche simiesque ignorée, et pour finir, cet Arabe à houppelande noire, c’était vraiment la plus grande confusion des genres encore jamais vue. Et le comble : l’Arabe disait la messe.
En quelques mots, mon compagnon m’expliqua que le prêtre sémite vivait dans la partie de la maison qui donnait sur la rue, c’était une partie bien meilleure que tout le reste sans être très bonne, avec sous le porche un escalier indépendant et sans autre communication avec la propriété de madame Estefania que cette petite fenêtre par où nous le vîmes apparaître et une porte impraticable parce que clouée. Le prêtre ne faisait donc pas partie de la famille hébergée par la formidable amazone. Celle-ci finit par se rendre compte que son voisin l’appelait, elle accourut et nous fûmes les témoins d’un dialogue que mon excellente mémoire me permet de retranscrire sans en perdre une seule syllabe.
– Mame Chanfaina, savez-vous ce qui m’arrive ?
– Ah ! Grand Dieu du ciel, délivrez-nous du mal ! Qu’est-ce que vous allez encore me raconter comme histoire ?
– Eh bien, j’ai été volé. Il n’y a aucun doute, c’est bien un vol. Je m’en suis douté ce matin, parce que j’ai entendu la Siona retourner mes malles. Elle est sortie faire des courses et à dix heures, en voyant qu’elle ne revenait pas, j’ai eu encore plus de soupçons, je me suis dit que j’avais pratiquement confirmation de mes doutes. Maintenant, il est onze heures, je viens de comprendre que le vol est une réalité parce que j’ai passé en revue mes malles et je n’ai plus de linge de corps, tout a disparu et le reste aussi sauf mes habits ecclésiastiques. Et de l’argent qui était dans le tiroir de la commode, dans cette bourse en cuir, voyez, il ne me reste pas la moindre pièce. Mais le pire… et ça c’est le plus fort, mame Chanfa… le pire c’est que le peu que j’avais dans le garde-manger a disparu et de la cuisine se sont envolés aussi le charbon et le bois menu. De sorte que, ma chère dame, j’ai beau faire, je ne trouve rien pour me nourrir, plus de provisions, pas même un morceau de pain sec, pas une assiette, ni même une écuelle. Elle n’a laissé que les pinces et le soufflet, une écumoire, la petite casserole et deux ou trois marmites abîmées. C’est un déménagement en bonne et due forme, mame Chanfa et me revoilà à jeun, dans le plus grand dénuement, sans savoir que faire… Alors, voyez ! : si vous avez un petit quelque chose pour que je tienne debout, ça suffit. Le reste, je m’en fiche, vous le savez bien.
– Maudit soit le lait que vous avez sucé, père Nazarín, et maudit soit la drôle de minute où on a dit :»Un homme est né !» Parce qu’un homme comme vous, plus malchanceux, plus naïf que vous je ne crois pas qu’on puisse trouver facilement…
– Mais, écoutez, que voulez-vous ?… Je…
– Je, je !… C’est de votre faute, vous vous volez tout seul, vous vous faites du tort à vous, espèce d’abruti, sainte nitouche, bon sang !
La liste des expressions grivoises qui suivit, nous l’avons supprimée par respect pour les lecteurs. La bête fauve gesticulait et vociférait à la fenêtre, le corps à moitié entré dans la pièce pendant que le prêtre arabe faisait les cent pas tout tranquillement, comme s’il entendait des compliments et de douces paroles, un peu triste, oui, mais sans être affecté plus que ça par ses malheurs ni par la volée d’injures que la voisine utilisait pour le consoler.
– Ce n’est pas l’envie qui me manque de frapper un homme, qui plus est un prêtre. J’entrerais bien, je soulèverais vos jupes noires et je vous ficherais une tournée… Sacré gamin, plus innocent que ceux qui tètent encore leur mère… Et maintenant il veut que je lui donne la becquée. En voilà trois, en voilà quatre… Vous n’êtes qu’un oiseau. Allez dans la nature et mangez ce que vous voudrez ou perchez-vous sur la branche d’un arbre à piailler jusqu’à ce que ça vous tombe dans le bec… Et si vous êtes fou, à supposer, qu’on vous conduise à l’asile.
– Madame Chanfa, dit le prêtre, d’un calme incroyable, tout en s’approchant de la fenêtre, il ne me faut pas grand chose pour me nourrir : s’il n’y a rien d’autre, un morceau de pain et c’est bon. Je vous demande à vous, parce que vous êtes ma voisine. Mais si vous ne voulez pas me donner, j’irai ailleurs, là où on me donnera ; les âmes charitables ne manquent pas, figurez-vous.
– Allez donc à l’auberge du Diable ou à la cuisine du Nonce archi-apostolique, où on cuisine pour tous ces fainéants, par exemple, des prêtres bons à rien comme vous… Autre chose, père Nazarín : Etes-vous sûr que ce soit la Siona qui vous a volé ? Parce que vous êtes la confiance et la sottise mêmes, et tout le monde entre chez vous comme dans un moulin… Même les filles de tout genre… les unes pour vous raconter leurs péchés, à supposer, les autres pour vous emprunter ou vous rendre, et pour vous demander l’aumône et vous rendre fou. Vous ne regardez pas qui vient vous voir, vous faites bonne figure à tout le monde et vous leur balancer les Béatitudes. Qu’est-ce qui arrive ? Que celui-ci vous trompe, l’autre se moque de vous, et à eux tous ils vous laissent sans rien.
– C’est la Siona. Ce n’est personne d’autre. Allez, tant mieux pour elle, grand bien lui fasse, je ne vais pas lui faire un procès.
Moi, j’étais tout étonné de voir et d’entendre tout cela, et mon ami, même si ce n’était pas la première fois qu’il assistait à une scène de ce genre, en était tout éberlué. Je lui demandai les antécédents de cet incroyable Nazarín si bizarre et qui avait pour moi de plus en plus le type musulman, et il me dit alors :
– C’est un Arabe de la Manche, originaire de Miguelturra exactement, il s’appelle don Nazario Zaharin ou Zajarin. Je ne sais de lui que le nom et le pays, mais si vous voulez on peut l’interroger pour connaître son histoire et sa personnalité, je suis sûr que ça doit être assez singulier comme sont singuliers son genre et ce que nous avons entendu de sa propre bouche. Dans le quartier beaucoup le prennent pour un saint, d’autres pour un simplet. Qu’est-il au juste ? Je crois bien qu’en discutant avec lui on devrait en savoir un peu plus.
3
On n’avait encore rien vu. Les quatre harpies amies de Estefania, dont l’une était la nièce, avaient entendu qu’on accusait la Siona et arrivèrent comme des lionnes ou des panthères à la fenêtre et avaient bien l’intention de défendre l’inculpée. Mais elles le firent de façon si brutale et si infâme que nous dûmes intervenir pour mettre un frein à leurs dires immondes. Il n’y avait pas d’insolences qu’elles ne vomissaient sur notre prêtre arabe de la Mancha, ni de mots grossiers qu’elles ne décochaient sans crier gare…
– Regardez-moi cet imbécile, ce salaud et ce déguenillé, malappris, cette burette des âmes ! Accuser la Siona, la dame la plus respectable de toute la chrétienté ! Oui, monsieur, la plus respectable et bien plus que ces curetons qui ne font qu’embobiner les gens honnêtes avec leurs mensonges tout inventés !… Qu’est-ce qu’il est celui-là, et qu’est-ce que ça veut dire ses habits noirs, de chauve-souris, il ne fait que vivre de chine et ne sait même pas gagner son argent ? Pourquoi est-ce que ce simplet ne s’arrange pas pour avoir des baptêmes et des funérailles comme les autres curetons qu’on trouve à Madrid, le poil tout luisant ? … Il y a des messes à la pelle pour tout le monde, et pour lui, rien : la misère, du chocolat à trois sous, du foie et un peu de bettes que même les chèvres ne voudraient pas… Et après dire qu’on le vole !… Et pourquoi on ne lui volerait pas les os de son squelette, et sa tonsure et sa pomme d’Adam et ses coudes, et je ne sais quoi… Il n’a même pas de linge, pas de draps, il n’a pour toute fringue qu’une branche de romarin à la tête de son lit pour chasser les démons !… Ceux-là ont bien dû le voler, lui piquer ses Evangiles et son Saint-Chrême et ses saintes huiles de la messe et ses ora pro nobis… le voler ! Mais voler quoi ? Deux images de la Sainte Vierge et le Seigneur crucifié sur son socle plein de cafards… Ah ! Ah !… Allez donc, monsieur Domino vobisco, attaqué par les voleurs !… Même s’il était le Saint Nonce apostolique ou la Procession de la Fête-Dieu avec tous ses Reposoirs et le Saint-Sépulcre des onze mille vierges ! Allez et qu’il aille se faire foutre !… Allez ! Qu’il aille se faire voir ailleurs !… Allez et que… !
– ça suffit ! leur dit mon ami, utilisant les poings plus que les mots pour les éloigner, car c’était dégoûtant de voir une personne si respectable, tout au moins apparemment, se faire injurier par une canaille pareille.
Il ne fut pas facile de les mettre dehors. Tout en descendant les escaliers, elles continuaient à cracher leur venin et leur parfum, et une fois dans la cour, elles s’en prirent aux gitans et même aux mulets. Le terrain une fois dégagé, nous ne pensions plus qu’à faire connaissance avec Nazarín et nous lui demandâmes la permission de nous introduire dans sa demeure, tout en montant par l’étroite échelle qui y conduisait à partir du porche. Tout ce qu’on pourrait dire de l’état de misère et d’abandon de cette demeure n’est rien. Dans la petite pièce, nous ne vîmes qu’un très vieux sofa de paille, deux malles, une table où il y avait un bréviaire et deux autres livres puis une commode. Près de cette pièce, il y avait une autre salle qu’on appellera chambre parce qu’on y voyait le lit sur un plancher, une paillasse, un mince oreiller et pas la moindre trace de draps ni de couvre-lit. Trois illustrations à thème religieux, un Crucifix sur une petite table complétaient le mobilier, deux paires de chaussures usagées bien alignées, ainsi que quelques objets sans importance.
Le père Nazarín nous reçut avec une froide amabilité, sans mépris non plus ni extrême délicatesse, comme si notre visite le laissait complètement indifférent ou s’il croyait qu’il ne nous devait que le respect de la plus élémentaire politesse. Mon ami et moi nous occupâmes le sofa, et lui s’assit sur la banquette en face de nous. Nous le regardions pleins de curiosité mais lui nous regardait comme s’il nous avait déjà vus des centaines de fois. Naturellement, nous parlâmes de l’affaire du vol, le seul sujet à quoi nous accrocher et comme nous lui disions que le plus urgent était de porter plainte à l’agent de police, il nous répondit le plus tranquillement du monde :
– Non, messieurs, je ne suis pas habitué à porter plainte…
– Mais quoi ?… On vous a volé tant de fois que ça ? C’est devenu pour vous une routine ?
– Oui, monsieur, souvent, tout le temps…
– Et vous dites ça comme ça ?
– Ne voyez-vous pas que je n’ai rien ? Je ne sais pas ce que c’est que les clés. En plus, le peu que j’ai, c’est-à-dire que j’avais, ne vaut pas le petit effort de donner un tour de clé.
– Cependant, monsieur le curé, la propriété c’est la propriété et, d’après les dires de don Hermogènes[4], ce qui paraît normalement peu pour un autre, peut être pour vous une fortune. Vous voyez bien, aujourd’hui, on ne vous a laissé ni votre modeste repas ni votre chemise.
– Ni un savon pour me laver les mains… Du calme, de la patience. La chemise, le repas et le savon vont bien revenir. En plus, mes chers messieurs, j’ai mes idées, je les soutiens de façon aussi sérieuse que ma foi en Jésus-Christ, notre Père. La propriété ! Pour moi ce n’est qu’un vain mot, inventé par des égoïstes. Rien n’est à personne. Tout appartient au premier qui en a besoin.
– La belle société que nous aurions si vos idées devaient se répandre ! Et comment savoir qui serait le plus nécessiteux ? Il nous faudrait nous disputer, couteau en main, ce droit à la primauté de la nécessité.
Le prêtre sourit avec bonté et même avec un petit air dédaigneux et me répondit avec ces mots ou des mots semblables :
– Vous voyez cela avec les idées d’aujourd’hui et bien sûr ça paraît absurde, mais il faut prendre de la hauteur, mon cher monsieur, voir d’en haut. D’en bas, entourés de tant de choses artificielles, nous ne voyons rien. Enfin, je n’ai envie de convaincre personne, je ne continue donc pas et je vous prie de m’excuser…
A ce moment précis, nous vîmes que mame Chanfa obscurcissait la pièce en bouchant de son imposante corpulence toute la fenêtre par où elle tendit une assiette avec une demi-douzaine de sardines, un gros morceau de baguette de pain et une fourchette d’étain. Le prêtre la lui prit des mains et après nous en avoir proposé se mit à manger avec appétit. Le pauvre ! Il ne n’avait rien avalé de toute la sainte journée. Soit par respect pour nous soit parce que la pitié avait pris le pas sur ses pratiques grossières, toujours est-il que la Chanfaina n’ajouta aucun commentaire désobligeant à son geste charitable. Nous laissâmes le temps au jeune prêtre de faire taire sa faim avant de l’interroger à nouveau discrètement. A force de questions nous apprîmes son âge, entre trente et quarante ans ; ses origines, bien humbles ; sa famille, des bergers, ses études… je me risquai à explorer un terrain plus délicat.
– Si j’étais sûr, père Nazarín, que vous ne me prendriez pas pour un impertinent, je me permettrais bien deux ou trois petites questions.
– Tout ce que vous voudrez.
– Vous pouvez me répondre ou pas, comme ça vous arrange et si je me mêle de ce qui ne me regarde pas, vous m’envoyez sur les roses, un point c’est tout.
– Allez-y.
– Je m’adresse à un prêtre catholique ?
– Oui, monsieur.
– Vous n’êtes pas hérétique, vous pas du tout hérétique ? Il n’y a pas chez vous des idées ou des habitudes qui vous mettraient un peu en dehors de la doctrine immuable de l’Eglise ?
– Non, monsieur, me répondit-il avec simplicité et sincérité sans même se montrer surpris de ma question. Je n’ai jamais dévié de l’enseignement de l’Eglise. Je professe la foi de Jésus-Christ dans toute sa pureté et il n’y a rien en moi qu’on puisse me reprocher.
– Avez-vous essuyé parfois des mises au point de la part de vos supérieurs, de ceux qui sont chargés de définir la doctrine et d’appliquer les règles sacrées ?
– Jamais. Je ne vois même pas en quoi je mériterais ces correctifs ou ces rappels à l’ordre.
– Une autre question, vous prêchez ?
– Non, monsieur. Je suis très rarement monté en chaire. Je parle à voix basse et en toute discrétion avec ceux qui veulent bien m’écouter, et je leur dis ce que je pense.
– Et vos compagnons n’ont jamais trouvé chez vous quelque trace d’hérésie ?
– Non, monsieur. Je parle peu avec eux, parce qu’ils ne me parlent pas beaucoup et ceux qui le font me connaissent suffisamment pour savoir qu’il n’y a en moi aucun caractère hérétique.
– Vous avez des autorisations ?
– Oui, monsieur, et, que je sache, on n’a jamais pensé à me les retirer.
– Vous dites la messe ?
– Chaque fois qu’on m’en donne. Je n’ai pas l’habitude d’aller en quête de messes dans les paroisses où je ne connais personne. Je dis la messe à San Cayetano quand il y en a pour moi et parfois à l’Oratoire des Oliviers. Mais ce n’est pas tous les jours, loin s’en faut.
– Vous ne vivez que de cela ?
– Oui, monsieur.
– Votre vie, ne vous fâchez pas, ne me paraît pas bien reluisante.
– ça va. Je suis résigné et je n’en tire aucune amertume. Je n’ai absolument pas l’ambition du confort. Le jour où j’ai de quoi manger, je mange, les jours où je n’ai pas, je ne mange pas.
Il dit cela avec beaucoup de candeur, sans affectation aucune et nous en fûmes émus, mon ami et moi… Pensez donc ! Mais nous n’avions encore pas tout entendu.
4
Nous ne nous lassions pas de l’interroger, et lui nous répondait à tout sans paraître contrarié par notre insistance. On ne remarquait pas non plus la suffisance de quelqu’un qui se voit interrogé ou interviewé comme on dit maintenant. Estefania lui apporta, après les sardines, une côtelette, apparemment de veau et d’ aspect douteux, mais il n’en voulut pas malgré l’insistance de l’amazone qui s’emporta à nouveau et se mit à lui balancer un tas de bêtises. Malgré cela et malgré ce que nous pouvions lui dire gentiment pour le pousser à manger, il ne se laissa pas convaincre. Il refusa aussi le vin que la mégère lui présentait. Un peu d’eau et une brioche à quatre sous mirent fin à son déjeuner et il rendit grâces à Dieu pour la nourriture de ce jour.
– Et demain ?
– Eh bien ! demain, il y aura ce qu’il y aura, sinon, nous attendrons un autre jour car il n’y jamais deux jours de suite vraiment mauvais.
Le reporter s’obstina à l’inviter à prendre un café, mais lui tout en nous avouant qu’il aimait cela, ne voulut pas accepter. Nous dûmes insister tous les deux de manière très amicale pour qu’il finisse par accepter. On passa commande au café le plus proche et c’est la borgne qui vendait des liqueurs sous le porche qui nous l’apporta. On le prit comme on put, sur la petite table et on continua à parler de choses et d’autres. On l’entendit parler de différentes idées qui nous poussèrent à penser qu’il n’était pas sans instruction.
– Excusez-moi, lui dis-je, si je fais une observation qui m’arrive tout à coup. On voit bien que vous êtes une personne cultivée. Cela me surprend beaucoup de ne voir aucun livre chez vous. Cela ne vous plaît pas ou bien ce sont les difficultés qui ont fait que vous avez dû vous en débarrasser.
– J’en ai eu, oui, monsieur, je les ai tous offerts et je n’ai plus que ces trois livres que vous voyez là. Je peux vous dire qu’en vérité, à part mes livres de prière, aucun livre ne m’intéresse vraiment, bon ou mauvais, le cœur et l’intelligence n’en tirent guère profit. En ce qui concerne la foi, j’ai tellement rabâché cela dans ma tête que ni les commentaires, ni la paraphrase qu’on fait sur la doctrine n’ajoutent grand chose. Le reste, à quoi cela sert-il ? Quand on a pu ajouter au savoir inné quelques idées, apprises du savoir des hommes et après avoir observé la société et la Nature, il n’y a pas à attendre des livres de meilleur enseignement ni d’idées nouvelles sans rendre confuses et emberlificotées celles qu’on a déjà. Je ne veux ni livres ni revues. Tout ce que je sais, je le sais bien et je reste inébranlable dans mes convictions parce que les sentiments prennent racines dans la conscience, leurs fleurs dans la raison et leurs fruits dans la pratique. Je vous semble pédant ? Eh bien ! je n’en dis pas plus. J’ajoute seulement que les livres sont pour moi la même chose que les pavés du chemin ou la poussière des routes. Quand j’entre dans des librairies et que je vois tant de papier imprimé, plié et cousu, et que je vois dans les rues cette pluie de journaux, jour après jour, cela me fait de la peine pour ces pauvres petits qui se brûlent les yeux à écrire des choses inutiles, et encore plus de peine pour l’Humanité trompée qui quotidiennement s’impose de les lire. On écrit et on imprime tant que l’Humanité, étouffée sous le poids de ce monstre qu’est l’Imprimerie, va se voir obligée de supprimer tout le passé. Une des choses qu’il faut abolir c’est la gloire profane, les lauriers qu’accordent les écrits littéraires, parce qu’arrivera un jour où l’on aura tellement emmagasiné dans les bibliothèques qu’on n’aura plus la possibilité matérielle de les conserver et de les protéger. On verra alors, si on le voit, l’intérêt que l’Humanité porte à tant de poèmes et tant de romans mensongers, tant d’histoire qui nous rapporte des faits dont l’intérêt diminue avec le temps et qui finira par se perdre complètement. La mémoire humaine est déjà un petit grenier pour tant de fatras historique. Messieurs, il n’est pas loin le temps où le présent absorbera toute la vie et où les hommes ne conserveront rien du passé à part les idées éternelles connues par révélation. Tout le reste ne sera que scories, détritus qui occuperont trop d’espace dans les intelligences et dans les bâtiments. En ces temps-là, ajouta-t-il sur un ton que je n’hésite pas à qualifier de prophétique, le César ou n’importe quelle autorité, ordonnera un décret disant :»Tout le contenu des bibliothèques publiques et privées est déclaré vain, inutile et sans autre valeur que le contenant. Les chimistes ont fini par dire que la substance du papier finit avec le temps par donner le meilleur des engrais pour la terre, nous décidons donc d’empiler les livres anciens et modernes sur de grandes aires à l’entrée des localités afin que les habitants des régions agricoles viennent prendre de la précieuse matière la part qui leur revient selon la quantité de terre qu’ils ont à travailler.» Aucun doute, ce sera comme ça et la matière cellulosique formera un gigantesque gisement, comme le guano dans les îles Chinchas ; on l’exploitera en la mélangeant à d’autres substances qui activeront la fermentation et elle sera transportée par train et bateau à vapeur de notre Europe aux pays nouveaux, où il n’y a jamais eu ni littérature, ni imprimerie, ni rien de tout cela.
Nous nous amusâmes beaucoup de cette idée. Mon ami, d’après les regards complices qu’il me faisait en l’entendant, dut se faire une opinion bien peu favorable sur l’état mental de l’ecclésiastique. Moi, je le prenais plutôt pour un de ces humoristes qui se veulent originaux. Notre conversation devenait interminable et nous abordions tous les sujets. Notre brave Nazarín passait pour bouddhiste puis très rapidement pour un imitateur de Diogène[5].
– C’est très bien tout cela, lui dis-je, mais, père, vous pourriez vivre mieux que vous ne le faites. Ceci n’est pas une maison, vous n’avez pas de meubles et apparemment vous n’avez rien d’autre que les vêtements que vous portez. Pourquoi ne prétendez-vous pas, dans votre état religieux, à une position qui vous permette de vivre dans un confort relativement modeste ? Mon ami que voici a beaucoup d’entregents dans les deux Chambres législatives et dans tous les ministères, alors, il ne lui serait pas difficile par ses relations de vous obtenir un poste de chanoine.
Le prêtre sourit non sans une certaine ironie et nous dit qu’il n’avait pas besoin qu’on le fasse chanoine et que la vie de chœur un peu mollassonne ne cadrait pas avec son naturel indépendant. Nous lui proposâmes aussi de lui procurer une place de coadjuteur dans les paroisses de Madrid ou de curé de village. Il répondit à tout cela que si on lui donnait une telle place, il la prendrait par obéissance et par soumission inconditionnelle à ses supérieurs.
– Mais, ne vous tracassez pas, ils ne me la donneront pas, ajoutait-il avec une assurance exempte d’amertume. Avec ou sans placement, vous me verriez toujours tel que je suis actuellement, parce que la pauvreté est pour moi une condition absolue et si vous me le permettez, je vais vous dire que le fait de ne rien posséder» est mon aspiration suprême. Ainsi d’autres rêvent d’être heureux par l’accumulation des richesses, mon bonheur à moi consiste à rêver de pauvreté, je m’y complais et quand je suis mal en point, je rêve d’un état pire encore. C’est une ambition qui n’est jamais rassasiée, car plus on a, plus on veut avoir, autrement dit, moins on a, moins on veut avoir. Je présume que vous ne devez pas bien me comprendre ou que vous devez me regarder avec un sentiment de compassion. Dans le premier cas, je ne vais pas essayer de vous convaincre, dans le deuxième, je vous remercie de votre pitié et je rends grâces à Dieu si mon manque de biens a servi à vous inspirer ce sentiment chrétien.
– Mais que pensez-vous, demandions-nous avec une certaine pédanterie, décidés à en terminer avec notre interview, des problèmes du jour, de l’état actuel de la société ?
– Moi, je n’en sais rien, répondit-il en haussant les épaules. Je ne sais qu’une chose : Plus on avance dans ce que vous appelez la culture, et qu’on tend vers le progrès, plus le monde mécanique augmente, plus on accumule de richesses et plus le nombre de pauvres augmente et la pauvreté est la plus noire, la plus triste et la plus amère. Voilà ce que je voudrais éviter, moi : que les pauvres, c’est-à-dire les miens soient touchés par cette maudite misanthropie. Croyez bien que parmi tout ce qu’on a perdu, le pire c’est la perte de la patience. On en trouve encore, perdue ici ou là mais le jour où on l’aura perdue complètement, adieu le monde. Qu’on redécouvre un nouveau filon de cette grande vertu, la première et la plus belle des vertus que nous a enseignée Jésus-Christ et vous verrez comme tout trouvera une solution.
– Apparemment, vous êtes un apôtre de la patience.
– Moi, je ne suis pas apôtre, mon cher monsieur, je n’ai point de telles prétentions.
– Vous enseignez par l’exemple.
– Je fais ce que la conscience m’inspire, et si, par mes actions, il en résulte un exemple pour l’un ou l’autre, tant mieux.
– Votre credo dans le domaine du social c’est la passivité.
– Vous l’avez dit.
– Parce que lorsqu’on vous vole, vous ne protestez pas.
– Voilà, monsieur. Je me laisse voler sans protester.
– Parce que vous ne prétendez pas améliorer votre situation et vous ne demandez pas à vos supérieurs de vous donner les moyens de vivre dans votre état religieux.
– Voilà, je ne prétends à rien, je ne demande rien.
– Vous mangez quand vous avez de quoi et sinon, vous ne mangez pas.
– Tout juste… je ne mange pas.
– Et si on vous expulse de votre maison.
– Je m’en vais.
– Et si vous ne trouvez personne pour vous en donner une autre ?
– Je dors à la belle étoile. Ce ne sera pas la première fois.
– Et s’il n’y a personne pour vous donner à manger ?
– La nature, la nature…
– Mais, d’après ce que j’ai vu, ces femmes de rien vous injurient et vous, vous supportez en silence.
– Oui, monsieur. Je supporte en silence. Je ne sais pas ce que c’est que de se mettre en colère. Je n’ai pas d’ennemis.
– Et si on vous outrageait en vrai, si on vous giflait… ?
– Je souffrirais avec patience.
– Et si on vous accusait de faux délits… ?
– Je ne me défendrais pas. Si ma conscience est tranquille, les accusations ne me tracasseraient pas.
– Mais, vous ne savez pas qu’il y a des lois et des Tribunaux pour vous défendre contre les méchants ?
– Je doute qu’il y ait de telles choses ; je doute qu’on protège les faibles contre les forts, mais même si cela existait, ce que vous dites, mon tribunal à moi c’est celui de Dieu et pour gagner mes litiges, je n’ai pas besoin de papier avec cachet, ni d’avocats ni de demander des lettres de recommandation.
– Dans cette passivité, poussée à l’extrême, je vois un certain courage héroïque.
– Je n’en sais rien… Pour moi ce n’est pas du mérite.
– Parce que vous défiez les outrages, la faim, la misère, les persécutions, les calomnies et tous les maux qui nous entourent, d’où qu’ils viennent, de la société ou de la Nature.
– Moi, je ne défie rien, je supporte.
– Vous ne pensez donc pas au lendemain ?
– Jamais.
– Vous ne vous désolez pas de ne pas avoir demain de lit pour dormir, un morceau de pain à porter à votre bouche ?
– Non, monsieur, je ne m’en fais pas pour cela.
– Vous comptez sur des âmes charitables comme cette madame Chanfaina, qui semble un démon et qui ne l’est pas ?
– Non, monsieur elle ne l’est pas.
– Et ne croyez-vous pas que la dignité d’un prêtre est incompatible avec l’humiliation de recevoir l’aumône ?
– Non, monsieur. L’aumône n’enlaidit pas celui qui la reçoit ni ne blesse en rien sa dignité.
– De sorte que vous ne vous sentez pas blessé dans votre amour-propre quand on vous porte secours ?
– Non, monsieur.
– Et on peut imaginer que ce qu’on vous donne pourrait aller en d’autres mains plus nécessiteuses, au moins en apparence.
– Parfois.
– Et vous recevez des secours, pour vous exclusivement, quand vous en avez besoin ?
– Il n’y a pas de doute.
– Et vous n’en rougissez pas ?
– Jamais. Pourquoi voulez-vous que j’en rougisse ?
– De sorte que si nous, là, maintenant… c’est un exemple… impressionnés par votre situation, nous vous remettions… une partie de ce que nous avons en poche… ?
– Je le prendrais.
Il répondit avec une telle candeur et un tel naturel qu’on ne pouvait pas le soupçonner de penser ou de s’exprimer ainsi par cynisme ou pour jouer le personnage humble, masque d’un orgueil démesuré. Il était l’heure d’en finir avec notre interrogatoire qui prenait l’allure de l’indiscrétion dérangeante et nous prîmes congé de don Nazario en nous félicitant par des phrases sincères d’avoir fait sa connaissance. Il nous remercia de notre visite et de nos affectueuses déclarations et nous accompagna jusqu’à la porte. Mon ami et moi avions laissé sur la table quelques pièces de monnaie d’argent sans bien calculer, incapables de savoir quels étaient les besoins de cet ambitieux de la pauvreté : en gros, nous ne devions guère lui laisser plus de deux douros, en tous cas, moins de trois.
5
– Cet homme est une canaille, me dit le reporter, un cynique aux grands talents, qui a trouvé la pierre philosophale de la paresse ; un voyou à l’imagination débordante qui cultive le parasitisme avec art.
– Ne nous précipitons pas, mon ami, à nous faire trop vite un jugement que la réalité démentirait. Si vous n’y voyez pas d’inconvénient, nous reviendrons et nous observerons tranquillement ce qu’il fait. Pour ma part, je n’ose pas encore me faire une opinion catégorique sur l’individu que nous venons de voir. Il me paraît tout aussi arabe qu’au début même si ses extraits de baptême nous prouvent qu’il est comme vous dites, maure de la Manche.
– Eh bien ! si ce n’est pas un cynique, je soutiens qu’il est dérangé de la tête. Tant de passivité dépasse les limites de l’idéal chrétien surtout en ces temps-ci où chacun est héritier de ce que sont ses œuvres.
– Lui aussi est héritier des siennes.
– Que voulez-vous : ma définition de la personnalité de cet homme c’est que c’est l’absence de tout caractère et la négation de toute personnalité humaine.
– Eh bien, en attendant d’autres données et plus d’éclairage pour le connaître et le juger, je soupçonne ou je devine chez ce bienheureux Nazarín une forte personnalité.
– Tout dépend de ce qu’on entend par forte personnalité. Un fainéant, un bon vivant, un profiteur peut arriver par l’exercice de certaines qualités à la hauteur du génie ; il peut affiner, cultiver une aptitude, aux dépens des autres, et donc… que sais-je… devenir une merveille d’inventivité et de sagacité que nous ne pouvons pas soupçonner. Cet homme est un fanatique, un parasite vicieux même si on dit qu’il n’a pas d’autres défauts, tout se concentre sur la culture et l’entretien de cette aptitude-là. Qu’il y ait là une nouveauté ? Je n’en doute pas mais on ne me fera pas croire que ce sont de purs sentiments spirituels qui le poussent. Qu’est-il d’après vous ? Un mystique, un père du désert, un amateur d’infusion et d’eau claire, un bouddhiste, un exalté de l’extase, du nihilisme, du nirvana ou comment appelez-vous ça ? Eh bien s’il l’est, je n’en démords pas. La société, en sa qualité de tutrice et d’infirmière, doit considérer ce type d’homme comme des corrupteurs de l’Humanité, selon les lois politico-économiques et l’enfermer dans un asile bienfaiteur. Je me demande : cet homme avec son altruisme débridé, quel bien fait-il à ses semblables ? Je réponds : Non. Je comprends les institutions religieuses qui aident l’Assistance par leurs œuvres. La miséricorde, vertu privée, est la meilleure collaboratrice de l’Assistance, vertu publique. Ces individus miséricordieux, solitaires, médiévaux, ont-ils par hasard contribué à forger notre Etat ? Non. Ce qu’ils cultivent c’est leur propre vigne, et l’aumône, élément respectable utilisé avec méthode et réparti suivant certains critères, ils la transforment en accumulation indécente. La loi sociale ou chrétienne si l’on veut, veut que tout le monde ait du travail, chacun dans son secteur. Les bagnards, les enfants, les vieux à l’asile travaillent. Mais ce prêtre musulman de la Mancha a résolu le problème de vivre sans aucune sorte de travail, pas même celui de dire la messe, guère fatigant pourtant. Il ne fait rien, il se tourne les pouces, il ressuscite l’âge d’or, c’est le cas de le dire, l’Age d’Or. Et je crains qu’il ne fasse des disciples, parce que sa doctrine est du genre à se couler partout et à coup sûr il va en séduire plus d’un, il y a tant de fainéants par les temps qui courent. Bref, que peut-on attendre d’un type qui propose que les livres, le sacrosaint livre et les journaux, les journaux sacrés, tout le produit de la civilisation écrite, ce levier, cette source miraculeuse… tout le savoir ancien et moderne, les poèmes grecs, les Védas, les mille et mille histoires, que tout cela ne serve qu’à former des tas d’engrais pour la terre ? Homère, Cervantès, Voltaire, Victor Hugo, convertis en guano philosophique pour faire pousser les choux et les cornichons ! Je me demande comment il n’a pas prophétisé que les Universités se transforment en étables, les Académies, les Clubs et les Conservatoires en troquets ou en abris pour les ânesses !
Ni mon ami avec ses appréciations franchement amusantes ne pouvait me convaincre, ni moi le convaincre du contraire. Au moins, le jugement sur Nazarín devait être remis à plus tard. Il fallait chercher d’autres sources d’information et nous entrâmes dans la cuisine où campait la Chanfaina face à une batterie de marmites et de poêles, cuisant par ici, attisant le feu par là, suant à grosses gouttes, les bouclettes blanches tachées de suie, les mains inlassables, la main droite au travail pendant que la gauche enlevait la petite fuite qui lui tombait du nez. Elle comprit tout de suite ce qu’on voulait lui dire, car c’était une femme d’une subtilité peu commune. Elle devança nos questions et nous dit :
– C’est un saint, croyez-moi, messieurs, un saint. Mais comme les saints, je les trouve un peu fatigants… je ne peux même pas les voir… moi, je lui en donnerais des tournées au père Nazarín s’il n’était pas ce curé-là, excusez-moi… A quoi ça sert un saint ? A rien du tout. Parce qu’autrefois il paraît qu’ils faisaient des miracles, et avec ça il y avait de quoi manger, ils convertissaient les pierres en poissons ou bien ils ressuscitaient les cadavres des défunts et chassaient les diables du corps. Mais maintenant, par les temps qui courent, tant de sagesse avec cette histoire de téléfore ou téléfone et de chemins de fer et tant de choses bizarres qui vont et viennent dans le monde, à quoi ça sert un saint sinon à amuser les enfants dans la rue ?… Ce malheureux que vous avez vu a le cœur d’une colombe, la conscience propre et immaculée de la neige, une bouche d’ange qui ne dit jamais une expression de travers, il est innocent comme l’agneau qui vient de naître, tout ça pour dire qu’on l’enterrera avec les palmes… ça c’est certain… Vous aurez beau fouiller vous ne trouverez pas chez lui le moindre péché, grand ou petit, sauf celui de donner tout ce qu’il a… Moi, je le considère comme un enfant et je le dispute comme ça me chante. Mais, lui, se fâcher ? Jamais. Si vous lui donnez un coup de bâton, à supposer, il vous remercie… C’est comme ça… Si vous le traitez de sale Juif, il sourit comme si on lui jetait des fleurs… Et d’après ce que je sais, à San Cayetano, il ne leur revient pas, c’est pour ça qu’il est comme ça un peu mis de côté et ils ne lui donnent des messes à dire que lorsqu’ils en ont trop… de sorte que ce qu’il peut bien gagner avec son sacerdoce ça fait pitié. Moi, comme j’ai mon tempérament, je lui dis : «Petit père Nazarín, faites un autre métier, ne serait-ce que de porter et de conduire les morts aux funêbres…» Mais, lui, il rit… Je lui dis aussi qu’il pourrait être maître d’école, il est fait pour ça, vu qu’il est patient et qu’il ne mange pas… mais lui, il rit… Parce que, ça oui… un homme aussi facile à contenter vous pouvez chercher, vous n’en trouverez pas même en cherchant avec une bougie. Il va vous manger tout pareillement un morceau de pain frais qu’une marmitée d’abats. Si vous lui donnez de l’agneau, il le mange, un trognon de bettes ne lui fait pas peur. Ah ! Si au lieu d’être un saint, c’était un homme, la femme qui l’aurait pourrait bien pu rendre grâces à Dieu…
Nous dûmes écourter la litanie de la mère Chanfa, car c’était parti comme les histoires qui n’en finissent pas. Alors nous descendîmes tailler une bavette avec le vieux gitan qui, devinant ce que nous voulions lui demander, s’empressa de nous apporter la lumière de son opinion autorisée.
– Messieurs, nous dit-il, le chapeau à la main, Dieu vous garde. Et si c’est pas de la curiosité, peut-on savoir si vous lui avez donné du fric à ce veinard de don Najarillo ? Parce qu’il vaudrait mieux nous le donner à nous, ainsi, ça ne nous obligerait pas à monter le lui demander ou bien ça éviterait que ça tombe dans de mauvaises mains… Il y en a beaucoup, vous savez qui lui soutirent la charité et lui piquent même son air de saint avant qu’il ne le donne à qui le mérite… Ah ! Ça oui, pour être bon, c’est un brave, lui, ceci dit sans vouloir vous offenser. Moi, je le prends pour le premier des Séraphins couronnés, Grand Dieu, je vous le dis par la très sainte crête du coq de la Passion !… Je me confesserais à lui plutôt qu’à sa Majesté le Pape de Dieu… Parce que nous voyons bien que c’est une bave d’ange qui lui coule de la bouche, on voit bien que dans ses yeux danse la magnifique étoile pastorale de la Vierge bénie qui est au Ciel… Alors, messieurs, je ne suis que votre serviteur et celui de toute la famille…
Nous ne voulions plus d’autres informations, et pour l’instant nous n’en avions plus besoin. Sous le porche, il nous fallut nous ouvrir un chemin au milieu d’un attroupement de masques immondes qui prenaient d’assaut le kiosque à eau-de-vie. Nous marchions en sortant dans la boue, sur des guenilles tombées de ces corps misérables, des pelures d’orange et des éléments de déguisement, puis nous revînmes petit à petit vers le haut-Madrid, notre Madrid à nous, qui nous semblait celui de gens d’une toute autre importance, malgré l’obligation de ce Carnaval vulgaire et moderne et des irritants figurants de quémandeurs que nous pouvions rencontrer. Il est inutile de raconter le reste de la journée que nous passâmes à commenter la particularité et l’incompréhensible personnage envers qui nous démontrions indirectement l’importance que chacun lui accordait dans son esprit. Le temps passa et le reporter comme moi, sollicités par d’autres sujets nous oubliâmes petit à petit le prêtre arabe même si de temps en temps il revenait dans nos conversations. De l’indifférence méprisante avec laquelle mon ami en parlait, j’en déduis qu’il n’avait pas laissé beaucoup de trace, pour ne pas dire aucune, dans son esprit. Pour ma part, c’était l’inverse et il y avait des jours où je ne pensais qu’à Nazarín, à l’oublier et à y revenir sans cesse, élément par élément comme un enfant qui démonte un jouet mécanique pour s’amuser à le remonter à nouveau. Ai-je fini par construire un Nazarín tout différent, avec les éléments de ma propre imagination ou bien suis-je arrivé à prendre possession intellectuellement du vrai personnage réel ? Je ne peux pas répondre de manière catégorique. Ce que je raconte dans les lignes qui suivent, est-ce l’histoire véridique ou est-ce une de ces inventions dont la double vertu de l’art de celui qui écrit et la crédulité du lecteur, transforment en impression de réalité ? J’entends en plus ce genre de questions : «Qui diable a écrit ce qui suit ? Est-ce vous ou le reporter ? La mère Chanfaina ou le vieux gitan ?… Je ne peux rien répondre, parce que je serais bien ennuyé moi-même si je devais dire de manière définitive qui a écrit ce que j’ai écrit. Je ne réponds pas du processus mais je réponds de l’exactitude des faits. Le narrateur se cache. La narration, nourrie du sentiment des choses et de vérité historique, claire, précise, sincère est manifeste.
[1] L’ours et l’arbousier (el Oso y el madroño) sont l’emblème de la ville de Madrid. L’ours, symbole de force, nous rappelle que Madrid ne fut qu’une modeste cité entourée d’importantes forêts où les ours étaient nombreux, jusqu’à la fin du XVIème siècle.
[2] sorte de cruche.
[3] Espèce de manteau dont on se servait anciennement.
[4] Hermogène, disciple de Socrate.
[5] Diogène, philosophe grec. Il vivait dehors, dans le dénuement, vêtu d’un simple manteau, muni d’un bâton, d’une besace et d’une écuelle. Dénonçant l’artifice des conventions sociales, il préconisait en effet une vie simple, plus proche de la nature, et se contentait d’une grande amphore pour dormir.




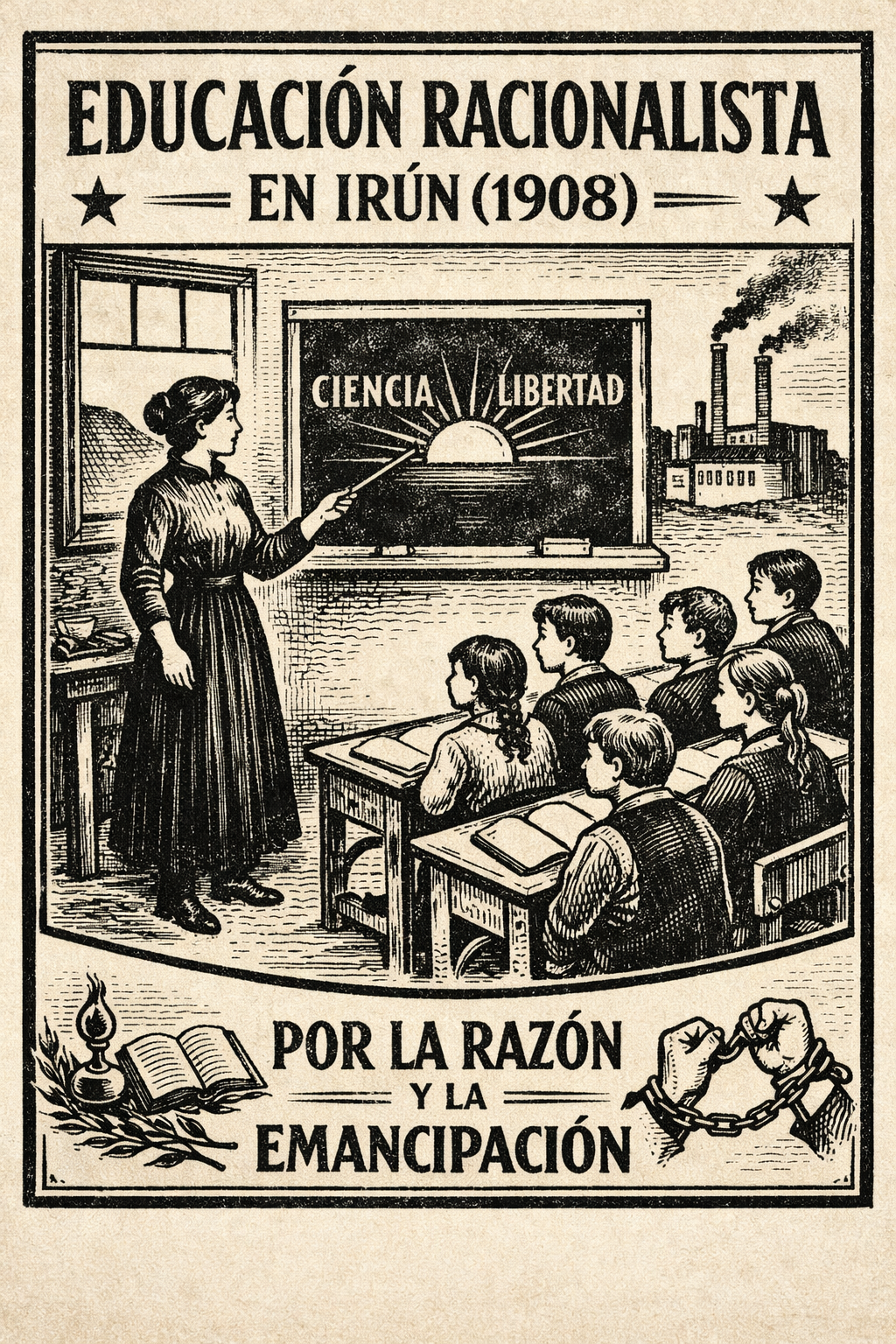











Yo, check out f1685vip! I saw some stuff on there that piqued my interest. If you’re into this kinda thing, don’t sleep on it. Here’s the link: f1685vip
vz88bet… I’m curious. Anyone have any inside scoop or stories about their experience with vz88bet?
Just browsed around admtechbong88… Looks clean! Site design is good, and I hope they got what I’m lookin’ for. Let’s see what happens!
An fascinating dialogue is worth comment. I think that you must write extra on this subject, it might not be a taboo subject however typically people are not sufficient to talk on such topics. To the next. Cheers
Cwinsgame is alright, has a solid selection of games. Not my favorite site, but it’s reliable and works on different devices. Check it out yourself! Right here: cwinsgame
WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait .. …
Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.