No hay productos en el carrito.

Una de las obras espirutualistas de Benito Pérez Galdós
Traduit par Claire Nicolle Robin
6
Et comme si les paroles de Consuelo étaient une évocation, se présenta sur le pas de la porte, sans qu’on en ait entendu les pas auparavant, un prêtre grand et âgé qui, en souriant et avec une petite voix molle, disait :
– Don Manuel, oui, don Manuel est ici, disposé à convaincre la déraison elle-même… Oh !, ma chère madame doña Catalina… Foi de Manuel Flórez, je ne m’attendais pas à une aussi agréable rencontre, et je pensais, avant de déjeuner, faire un petit tour au deuxième étage.
– Aujourd’hui est un jour solennel –dit le Marquis avec son habituelle courtoisie- : aujourd’hui nous avons à déjeûner monsieur don Manuel, et ma sœur, qui sait tout ce que mérite un ami de cette qualité, rompt son isolement, descend à la salle à manger et nous accompagne à table.
– Je n’en mérite pas autant … Oh !
Doña Catalina voulut protester sans offenser le vénérable prêtre ; mais sa voix fut étouffée par quelques remarques affectueuses, et peu après, tous les quatre passèrent à la salle à manger. En y allant, le sympathique Flórez disait à la comtesse de Halma :
– Il n’est pas mauvais, ma chère et sainte amie, d’être moins sévère de temps en temps.
En disant que l’éducation du Marquis et de son épouse était tout en raffinement, je veux dire qu’au cours du déjeuner, on ne parla que de choses agréables, sur lesquelles tout le monde pouvait dire son mot sans aucune violence. Catalina se montra mélancolique et aimable ; don Manuel, enjoué ; le Marquis, réservé, et Consuelo, aimable et pleine d’attentions pour tout le monde. Il ne se passa rien, donc, qui mérite une attention particulière. Ils parlèrent un peu de politique, thème que Feramor traitait toujours d’un point de vue très élevé, en évitant les personnalités, dirent quatre mots de littérature et des académies et aussi sur les procès du curé Nazarín, qui, ces jours-là, monopolisait l’attention publique et agitait tous les journalistes et reporters. Comme les avis sur cette étrange personnalité étaient partagés, les uns le considéraient comme un saint ; les autres, comme un fou, dans le cerveau duquel se trouvaient réunis avec une densité extraordinaire, tous les corpuscules malsains, qui flottent, pour ainsi dire, dans l’atmosphère intellectuelle de notre temps. Comme on lui avait demandé son avis sur un cas aussi singulier, don Manuel dit qu’il n’avait pas encore assez d’éléments pour avoir une idée sur cette question, et qu’il réservait son jugement, son avis, pour quand il aurait étudié, après de nombreuses visites et de nombreux échanges, le fou, ou le saint ou ce qu’on voudra. Madame de Halma ne dit pas un mot, et de manifesta pas même de l’intérêt pour cette affaire, qui, parce que tous les journaux en parlaient, avait dû lui sembler d’un intérêt futile et passager.
Après le déjeuner, don Manuel et doña Catalina montèrent dans les appartements de cette dernière, et passèrent un long moment à bavarder avec les gamins et l’institutrice, qui était anglaise, d’âge mûr, avec le visage d’un oiseau empaillé, personne de qualité, qui connaissait son métier et le faisait consciencieusement, en transmettant aux enfants ses manières très affinées et ses clichés de connaissance élémentaire à l’usage des familles très aisées. Les enfants de monsieur et madame la Marquise étaient au nombre de quatre et tous, on les appelait avec des diminutifs familiers, à la manière anglaise. Alexandre, l’aîné (Sandy), se distinguait par sa correction de petit gentleman, et était une copie fidèle de son papa, par sa mesure, son économie et sa précocité dans tout ce qui concernait la vie pratique. Venait ensuite Catalinita (Kitty) filleule de sa tante du même nom, petite fille très mignonne, très sensible et un peu espiègle. Paquito (Frank) était un peu primaire, mais en lui on remarquait une intelligence solide pour la mécanique et … les travaux publics. En effet, son jeu préféré était d’imiter le chemin de fer, lui faisant le rôle de la locomotive. Ensuite venait Teresita, trois ans, que l’on appelait Thressie, grassouillette, gloutonne, et sans aucune sensibilité pour le moment. Elle adorait barboter dans l’eau, laver des chiffons et autres occupations du quotidien. C’était celle qui donnait le plus à faire à la miss, qu’ils appelaient Dolly, ce qui est la même chose que Dorothée.
Ils sortirent tous se promener bien habillés, sous la houlette de l’Anglaise, et la comtesse et don Manuel, maintenant seuls, s’enfermèrent, je veux dire qu’ils restèrent en tête à tête longtemps, presque tout l’après-midi, à parler de choses sérieuses qui touchaient la religion et la charité. Il n’est pas possible de continuer cette véridique histoire sans consigner que don Manuel Flórez état un prêtre fort sympathique : ses qualités personnelles lui donnaient autant de prestige et de considération dans les hautes classes que de popularité dans les classes inférieures. Il évoluait continuellement parmi différentes sortes de personnes, côtoyant des aristocrates, ou fréquentant l’humble pauvreté, et en haut et en bas il savait employer le langage le plus approprié pour se faire comprendre. Chez lui, il fallait admirer, plus que les vertus profondes, celles qui étaient superficielles, car s’il ne manquait ni d’austérité ni de droiture dans ses principes religieux, ce qui chez lui brillait le plus, était la propreté et le soin de sa personne, sa douceur, sa bienveillance et son langage affectueux, persuasif et avec parfois une rhétorique de bon goût. La médisance avait pu tenter à l’occasion de le salir, en l’éclaboussant de la fange des trottoirs ; mais il était toujours ressorti propre et pur de ces attaques, grâce à a sa ferme volonté de les mépriser et de ne leur accorder aucune valeur.
Il n’avait jamais eu d’ambition ecclésiastique. Il aurait pu être évêque, simplement en se laissant aimer de toutes les nombreuses personnes très influentes en politique qui le fréquentaient intimement. Mais il avait toujours cru que, plutôt qu’en dirigeant un diocèse, il accomplirait sa mission sacerdotale en utilisant au service de Dieu la qualité que Celui-ci lui avait donnée à un degré supérieur : le don de plaire. Qualité prodigieuse, inouïe, dont les effets se révélaient dans une foule de cas ! Il n’y avait pas que la parole, tantôt drôle, tantôt éloquente, familière ou grave, selon les cas ; c’était le visage, les yeux, les mimiques, l’âme souple et ductile qui pénétrait dans l’âme de l’ami, du pénitent, du frère en Dieu, et même dans celui de l’ennemi invétéré. On aurait pu croire que cette qualité lui aurait été utile pour briller en chaire. Et bien, non monsieur. Dans ses jeunes années, il s’était essayé à l’éloquence sacrée avec un succès mitigé. Médiocre prédicateur, il dut bientôt reconnaître qu’il n’arriverait à rien par cette voie. La conversation était l’organe de son apostolat, et la sociabilité était l’espace où il devait gagner ses grandes batailles.
Flórez vivait avec indépendance grâce à la rente de deux belles propriétés dont il avait hérité de ses parents, à Piedrahita. Il n’avait, donc, pas à se soucier de son sacré beefsteak ni à tourner le regard, comme d’autres malheureux, vers le palais épiscopal, les paroisses ou le Ministère des Cultes. Dieu lui avait donné en viager son pain quotidien, le mettant ainsi en mesure d’exercer son ministère avec l’efficacité que donne… une parfaite alimentation. Cette indépendance lui était aussi très utile pour conserver son orthodoxie accommodante, sa parfaite conformité avec l’esprit et la lettre de tout ce qu’enseigne et pratique la Sainte Eglise. Il s’habillait avec soin et même avec une certaine élégance dans les limites de la sévérité de l’habit ecclésiastique, sans qu’il y eût la moindre affectation, parce que chez lui, la propreté et une mise soignée étaient aussi naturelles que la correction de la langue et les bonnes actions. Il était élégant pour la même raison qui fait que les oiseaux chantent et que les poissons nagent. Chaque être a son épiderme particulier, produit à la fois de l’alimentation intérieure et du milieu atmosphérique. Le vêtement est comme une deuxième peau, dans la composition et la patine de laquelle influe autant ce qui vient de l’intérieur que ce qui vient de l’extérieur.
Ce dont parlèrent don Manuel et doña Catalina cet après-midi-là devait être très important, parce que leur tête-à-tête dura longtemps. Le bon prêtre prit congé à la fin, en disant en prenant son chapeau :
– Donc on est d’accord…, n’est-ce pas ?
– Je ne dirai rien et ne ferai rien.
– D’accord, ma chère et sainte amie. Si on vous dit quelque chose, faites celle qui ne comprend pas. Si vous avez une petite contrariété, rendez m’en responsable. Vous n’avez qu’à dire : « Des idées de don Manuel. »
– Très bien. Si j’obtiens ce que je désire, c’est à vous que je devrai tout, et c’est à vous qu’en reviendra l’honneur.
– Non, pas ça ; l’honneur vous en revient ; on est d’accord, l’honneur vous en revient. Je ne suis que l’exécuteur ou l’auxiliaire d’une grande, d’une très grande idée. Au revoir, au revoir.
7
Il descendit tout doucement l’escalier, les yeux sur les marches, tandis que virevoltait dans sa tête la grande, la très grande idée, et sur le portail, il tomba sur le marquis et la marquise qui revenaient de leur promenade en voiture.
– Encore dans nos murs, don Manuel ?
– Voulez-vous rester pour manger ?
– Mille fois merci. Vous savez bien que je ne mange pas à ces heures-ci. Mon petit chocolat et au lit comme un ange bienheureux. Consuelo, bonsoir
– Et quand aurons-nous le plaisir de vous revoir ici ? –lui demanda le marquis.
– Ce plaisir, vous l’aurez demain.
– Tout le déplaisir sera pour vous.
– Peut-être…. Mais, enfin, demain nous parlerons. Au revoir, au revoir.
Il demanda sa cape, et s’en alla, laissant son cher ami un peu soucieux avec cette annonce d’une réunion, qui devait être, son cœur le lui disait, quelque extravagance de madame sa sœur la comtesse. Il se prépara donc, en prévoyant d’avance tous les types d’arguments avec lesquels don Manuel pourrait l’attaquer, et l’attendit tranquillement. Il devait être dix heures quand le prêtre entra dans la maison, et tous deux dans le bureau, assis des deux côtés de la table, ils parlèrent longtemps. Le marquis, quand on le laissait parler, était un aigle pour les développements; mais Flórez savait être laconique et contondant, s’il le fallait. La familiarité autoritaire, de supérieur à inférieur, avec laquelle il le traitait, parce qu’il avait été son maître avant le départ de Feramor pour l’Angleterre, rendaient plus aisées les formulations concises pour don Manuel.
– Oui, oui, c’est ce que j’imaginais –dit le marquis, après avoir écouté la brève exposition que lui avait faite donc Manuel de sa visite-. Depuis que vous m’avez indiqué hier soir…. Vous descendiez de sa chambre, où vous avez tenu un conclave avec elle tout l’après-midi… J’ai tout de suite compris. Madame ma sœur désire que je lui remette sa dot.
– Exactement.
– Et pour cela il fallait autant de mystère et de réunions aussi longues entre vous et elle ? Pourquoi ne me le dit-elle pas ? Est-ce que, d’aventure, je me refuse à lui remettre ce qui lui appartient ? N’ai-je pas, bienheureusement, des comptes fort clairs, et la conscience, très tranquille, et toutes les affaires tellement en règle, que je pourrais répondre à toutes les objections que l’on me ferait ? Regardez, regardez…
Et en disant cela, il sortit un dossier sur l’entête duquel on lisait : « Rapport sur les sommes données à madame ma soeur Catalina… »
– Oui, oui –dit le prêtre, en continuant de mémoire la lecture de l’entête-. « Sommes données à Madrid lors de son mariage…, et ensuite à Sofia, Constantinople, Corfou… ». Donne-moi ça.
Il prit les papiers, et sans daigner y jeter un regard, avec un calme ferme et résolu il commença à les déchirer, sans pouvoir tout détruire d’un coup parce qu’il était trop gros.
– Que faites-vous, don Manuel –s’exclama le marquis, en précipitant son corps au-dessus de la table, mais sans oser arracher des mains de l’autre les papiers qu’il déchirait tranquillement, en jetant les morceaux dans une petite corbeille qui se trouvait là.
– Tu le vois bien… Je fais ce que toi, tu ferais, si tu étais comme Dieu et moi voulons, que tu sois, ce que tu feras certainement si tu y penses un peu… Laisse-moi, laisse-moi détruire toute cette pourriture.
– Mais…
– Il n’y a pas de mais qui tienne. Tu vas finir par approuver et m’aider à déchirer ceux qui restent ! Mon fils, j’ai de toi une meilleure opinion qu’il n’y paraît, et bien que tu t’obstines à cacher ton bon cœur avec ces apparences d’égoïsme que t’impose la société, tu n’y arriveras pas. Tu es juste en train de comprendre que tu dois intégralement remettre son héritage à ta sœur et que cette soustraction infâme que tu avais préparée n’est pas digne d’un chrétien… , comme tu dois l’être…, comme tu l’es, je le dis et le répète, comme tu l’es.
– Don Manuel !
– Don Manuel t’aime beaucoup, et quand il te voit défiguré par l’égoïsme, qui contamine tout, il te refait à son goût… Je veux que tu sois conforme au type de chrétien que j’avais voulu faire de toi quand ils t’ont emmené chez les Anglais métallisés. Ne fais pas cette figure contrite et n’ouvre pas de grands yeux., Paco, mon ami et cher élève. Les avances que tu as faites à ta sœur sont une misère…, une misère pour toi qui est riche ; et si tu retiens ces sommes quand tu lui donneras son héritage, tu rabaisses ta dignité et tu te mets au niveau des gens de peu. Montre que tu es noble, et non seulement par le nom, mais par les actes, et oublie les aumônes que tu as faites à ta pauvre sœur, car si ne pas faire l’aumône est chose fort laide, réclamer ce que l’on a donné, est encore plus laid, plébéien, bas.
– Permettez-moi, mon cher Flórez –dit le marquis en pâlissant , sans la moindre envie de céder, mais aussi sans courage pour s’opposer au geste de son ami et maître- ; permettez que je vous dise que ce n’est pas comme ça que l’on traite des questions d’intérêt. Discutons….
– Ça, c’est ce que tu veux, discuter, parce que tu y es toujours à ton avantage. Eh bien moi, je déteste les discussions ; je suis très peu parlementaire. Et pourquoi devrions-nous discuter ? Tes fameux comptes ont maintenant disparu en mille petits morceaux. C’est moi qui porte la responsabilité de ce crime de lèse majesté … économique. Mais j’ai la conscience tranquille, et là où tu me vois, en déchirant tes morceaux de papiers, j’ai ressenti en moi une joie très vive. Mais tu es bon, toi-même tu ne sais pas à quel point tu es bon ! Bon. Je vais jouer au parlementaire. Discussion : je pose les termes du débat. Je serai bref, très bref. Ecoute-moi. Toi, tu étais riche ; ta sœur, pauvre. Toi, tu avais fait un bon mariage, sous tous les aspects ; ta sœur en a fait un détestable. Toi, tu étais heureux ; elle, malheureuse. Que pouvais-tu faire d’autre que la secourir dans sa misère, quand tu ne pouvais pas encore lui remettre son héritage, puisque le testament n’avait pas été fait ? Tu l’as secourue, tu as été un bon frère, un honnête homme ; et maintenant, quand elle te demande l’héritage de votre père, tu t’avances vaillamment et tu lui dis : « Ma chère sœur : prends ce qui t’appartiens, et oublie les désagréments que je t’ai causés, comme j’oublie les aides que je t’ai données. » C’est ce que fait un noble, c’est ce que fait un homme, c’est ce que fait l’aîné d’une maison illustre qui se trouve aujourd’hui en possession de grandes richesses.
– Vous ne me laissez pas parler…. Mais, don Manuel de mon cœur !…
– Je suis toujours dans mon temps de parole, comme vous dites là-bas. Monsieur parlera ensuite, car j’ai encore beaucoup à dire… Je continue. Parce que je me figure que j’ai devant moi ton père, ou mieux encore, l’homme que tu as devant toi, ce n’est pas moi, mais ce si bon, bien que désordonné, Pepe Artal, mon noble ami. Pourquoi je me suis décidé à déchirer tout ce tas de papier ? Parce que j’avais la certitude que lui, l’aurait déchiré Ce n’était pas moi, c’était lui qui le déchirait. Je fais revivre devant toi l’image, plus que la mémoire, de ton père, pour que tu l’imites dans ce cas, bien que je me garderais bien, dans d’autres, de te le présenter comme modèle. Ah, Paco, ton père était un débauché… je veux dire, un vrai débauché, non ; c’était une mauvaise tête, le désordre, l’imprévision. Une tête de linotte, un cœur d’or. Quel cœur, celui de Pepe Artal ! C’était un noble espagnol, prêt à toutes les sottises imaginables ; mais généreux aussi, vraiment noble et magnifique. Le pauvre n’avait pas la moindre idée des économistes anglais. Il avait entendu parler, à grand renfort d’éloges, des politiciens de là-bas : lord Palmerston, Pitt, que sais-je ; mais lui, ne les connaissait pas plus que moi je ne connais les prêtres de Confucius. Il croyait que tout ce qui est bon devait porter la marque Londres, et il s’était mis dans la tête que tu devais entrer dans le monde social et politique avec cette étiquette. Tu es allé là-bas, tu en es revenu un vrai Anglais. Tu es quelqu’un de grande valeur, je ne le nie pas. Tu seras capable de mettre en ordre le Ministère des Finances espagnol… et je te la souhaite bien bonne…, comme tu as mis en ordre la tienne. Tu as de grandes qualités, quelques unes fort rares ici, et dont nous avons grand besoin ; mais il t’en manque d’autres, peut-être les plus élémentaires… Mais moi, qui t’aime tellement, tellement, je te prends comme on prend une poupée ou n’importe quelle marionnette faite de matières molles, et je te tords , et je te retourne, jusqu’à ce que redresser en toi ce qui me semble tordu et te faire à mon goût… Voilà, le discours est terminé. On est d’accord : tu remettras à ta sœur sans tenir compte des sommes avec lesquelles tu as répondu à ses besoins lors de son extrême pauvreté… Ça va ? Eh bien : maintenant, moi, qui suis un grand menteur quand l’occasion se présente, je vais monter voir Catalina et je vais lui dire un très gros mensong, mais très gros…
– Quoi !
– Que toi, de ta propre initiative, comme si cela venait de toi-même, tu me comprends ? tu as eu ce trait généreux. Moi, je ne t’ai rien dit, les papiers, c’est toi qui les as déchirés ; mieux encore, que tu les avais déjà déchiré ; enfin, je me comprends.
– Et vous allez dire ça à ma soeur ?
– Exactement cela, comme tu l’entends.
– Eh bien, elle ne va pas le croire –dit Feramor, souriant pour la première fois après les émotions qu’il venait de supporter.
– Tant pis pour elle et pour toi… Mais si, qu’elle va le croire. Il suffit que ce soit moi qui le lui dise.
– Avec beaucoup d’actes de véracité comme celuici…
– Mais, à la limite ce n’est même pas un mensonge ce que je pense lui raconter. C’est toi qui, à la fin, regrettes de n’avoir pas eu cette spontanéité, parce que ton cœur s’est incliné à pratiquer la générosité courtoise et noble ! Et en acceptant maintenant tout joyeux ce qu’avant tu n’avais pas fait, c’est la même chose que si tu l’avais fait, et tu arrives à croire que c’est toi qui as déchiré les comptes, et… Allons, confesse-moi que tu t’es bien pénétré de ton rôle de noble et de bon frère, et que tu es content de l’avoir démontré avec une action éclatante. Confesse-le, dis oui, et avec cette déclaration je suis plus tranquille, et je n’aurai pas de remords pour le mensonge que je vais administrer à la comtesse…
– Hum !…
8
– Ecoutez, mon cher don Manuel –dit le Marquis en s’asseyant , après avoir fait deux trois tours dans la pièce-. Sans effort aucun, sur une simple indication de votre part ou de la sienne, vous auriez vu echez moi ce que vous appelez un geste si j’étais certain que, en remettant sa dot à ma sœur, elle employerait utilement ce petit capital… Laissez-moi continuer, c’est maintenant mon tour de parler. Car il ne manquerait plus que vous lui disiez tout ! Je continue à user de mon temps de parole. Guérissez ma sœur de ses lubies de fondatrice…
– Mais viens ici, nigaud : la foi serait-elle par hasard une maladie ?
– C’est moi qui parle maintenant : on n’interrompt pas l’orateur. Enlevez de la tête de madame ma sœur ces idées et ces projets pour la réalisation desquels Dieu ne lui a pas donné la jugeotte nécessaire, et non seulement je lui remettrai avec plaisir ce qui lui appartient, sans diminution aucune, mais j’y ajouterai un petit quelque chose, du moment qu’elle s’humanise, cessant d’aspirer à la canonisation, et qu’elle revienne dans le monde, considérant son intérêt personnel et celui de sa famille. Bien volontiers, je donnerai tout l’éclat possible à la position qu’elle pourrait se créer, soit en se mariant avec le veuf Muñoz Moreno-Isla, soit avec…
– Paco, par le Ciel, ne divague pas !… Oui, je t’interromps, je ne te laisse pas parler, je n’accepte pas que tu dises des bêtises de cette façon. Mais, idiot, son grand esprit l’appelle à des choses bien différentes de ce que tu appelles position !… Vous parlez d’une position ! Elle, elle veut la plus haute de toutes, celle qui restera toujours inaccessible à tous ces Casa-Muñoz et autres trafiquants ennoblis qui se vautrent dans la vulgarité, au milieu de balayures d’or et d’argent. C’est tout à fait Catalina de vendre la joie de son âme, qui consiste à être toujours en Dieu et avec Dieu, pour l’argent de ces publicains ! Ta sœur s’amuserait bien avec ces gens-là, car en échange de quelques actions en banque, elle aurait à supporter à ses côtés, nuit et jour, monsieur de Casa Muñoz et l’entendre dire axide, charcutarie et autres barbarismes. Et en plus, avoir pour belle-sœur la Josefita Muñoz, la reine des encres, comme l’appelle je ne sais qui, et l’entendre et la supporter et être à côté d’elle, horreur !, parce que c’est chose connue et reconnue qu’elle a mauvaise haleine ! …. Je ne m’en suis pas approché…, ouh lala !… On me l’a dit. Et puis celle-ci aussi : leur mère avait sa boutique rue de la Sal. Dieu de miséricorde, les aunes de serge que la brave femme a mesuré pour les soutanes ! Et aujourd’hui, ses enfants sont marquis, et en signe de finesse, ils portent la main à la bouche quand ils éructent, et vont à Paris comme des valises pour introduire en Espagne la mode… des œufs sur le plat ! E c’est la position que tu veux pour ta sœur !
-On ne peut rien contre vous, mon cher Manolo, quand vous tournez tout en ridicule –répliqua le marquis sur un ton enjoué-. Moquez-vous autant que vous voudrez ; mais je répète et je soutiens qu’il n’y a pas d’autres moyens pour créer des classes dirigeantes dans cette société désaxée que de croiser l’aristocratie du parchemin avec celle du papier raisin, maîtresse de l’argent qui avait appartenu à l’Eglise et aux majorats. Je vous assure que…
– Ne m’assure rien du tout. Ta sœur ne veut pas être d’une classe dirigeante dans le sens social. Elle peut l’être, dans un autre, beaucoup plus élevé. Ses malheurs lui ont fait haïr toute cette misère dorée du monde. Aucun amour terrestre ne peut remplacer dans son âme l’affection qu’elle a eue pour son époux. Telle que tu la vois, avec son air de rien du tout, c’est une héroïne chrétienne. Elle a été bonne épouse, martyre de ses devoirs, le souvenir du pauvre défunt est sa consolation, et la flamme très vive de la foi qui brûle dans son âme, se traduit par l’ambition de consacrer sa vie au bien de ses semblables, de soulager dans la mesure du possible les maux immenses qui nous entourent, et que vous, les riches, les gens pratiques, les parlementaires, vous voyez avec indifférence, quand vous ne les bafouez pas, en voulant appliquer pour les soulager, les fameuses lois économiques, qui finissent par être les recettes de l’italien contre les puces.
Mais je ne m’oppose pas à ce que ma sœur sois pieuse …. J’acccepte qu’elle ne se marie pas, qu’elle se consacre à la prière dans la solitudfe d’un cloître. Je suis croyant, vous le savez très bien …
– Hum !… Croyant ! Tous les hommes pratiques, politiques et parlementaires, le sont par convenance, par bienséance et décorum. Ils vont dans les processions avec des cierges, et quand ils s’agenouillent devant le Saint Sacrement et voient s’élever l’Hostie, ils sont en train de penser que les taux de change eux aussi montent et descendent.
Don Manuel avait dit cela avec nervosité, impatience, en se levant et en allant et venant dans la pièce. Soudain Sandy entra pour demander à son père les timbres qu’il avait reçus ces jours derniers, et le bon prêtre, après lui avoir caressé la tête, lui dit :
– Monte vite au second, mon cœur, et dis à ta tante Catalina qu’elle descende sur le champ, parce que ton papa et moi nous avons à lui parler.
Le gamin monta en un souffle, et dans le temps qui s’écoula jusqu’à ce que la comtesse se présente, le marquis dut paraphraser ses dernières affirmations pour éviter que Flórez ne les interprète mal. C’était un homme pratique et, en s’humiliant devant les faits accomplis, il voulait s’en tirer à son avantage devant tout le monde.
– J’ai voulu dire, monsieur don Manuel, que ma sœur ne m’a pas démontré jusqu’à présent, des aptitudes pour une chose aussi grande, pour une entreprise qui non seulement requiert de la piété, mais aussi de l’intelligence, une connaissance du monde et des affaires. Cela je l’ai soutenu et je le soutiens. Mais, peut-être le fait qu’elle n’ait pas montré des aptitudes signifie-t-il qu’elle ne puisse les acquérir, quand on s’y attendra le moins ? La foi fait des miracles, qui peut en douter ? La foi peut faire beaucoup de choses.
– D’après toi, c’est la sainte économie qui fait des miracles.
– Aussi. Et l’intelligence, et la méthode, et…
L’entrée de sa sœur lui coupa la parole. Avant de la saluer, don Manuel lui tendit de loin ses bras pour la saluer, en lui disant avec autant de sérieux que de joie :
Venez ici, madame la comtesse de Halma, et remerciez votre frère, ce noble fils de son père, cette gloire des Artal et des Xavierre… Monsieur le marquis, à peine lui avais-je indiqué vos projets, qu’il a ouvert, comme on dit, son cœur et toute son âme, inondée de foi chrétienne et d’enthousiasme catholique… Et voilà…, vous pouvez disposer de votre dot, sans diminution aucune, parce qu’il n’y a pas de comptes, qu’il n’y en a jamais eu, et qu’il ne peut y en avoir entre un frère et une sœur qui s’aiment autant… car si ce n’est pas suffisant, lui est disposé…
– Doucement, don Manuel… Moi…
– Oui, oui ; il veut dire qu’il ne nous abandonnera pas au cas où … Enfin, il s’est montré à la hauteur de ce qu’il est, un noble espagnol, un chevalier, de la foi du Christ. Je m’y attendais, car je connais la famille, et j’ai pleuré de joie en voyant comme ses idées avaient répondu aux miennes, comme son noble coeur s’était inondé de joie devant les sublimes projets de sa sœur bénie. Vive les Artal et les Xavierre, dont le blason n’a pas d’égal parmi la noblesse, dont l’histoire est pleine d’actes magnanimes, d’héroïques vertus ! Vive la famille qui compte dans son arbre généalogique plus de saints que de princes, des princes par centaines, et félicitons-nous tous, moi le premier, d’avoir l’honneur d’être un ami de personnes aussi illustres !
– Bien, très bien –dit doña Catalina entre deux sourires, montrant par la froideur avec laquelle elle avait prononçé ces mots qu’elle n’acceptait pas comme un article de foi les paroles du prêtre.
– Je ne m’oppose jamais –dit Feramor, avalant sa salive pour étouffer la révolte qui grondait en lui-, je ne m’oppose jamais à rien qui soit raisonnable. Quand le spirituel se présente dans des conditions pratiques, je suis le premier…, c’est connu… Mes idées générales, mes idées politiques sont en accord avec tout ce qui serait développement et protection des intérêts religieux. La foi est une force, la plus grande des forces, et grâce à elle les autres forces, tantôt sociales, tantôt économiques, pourront réaliser des merveilles. Toute entreprise de progrès moral me trouve à ses côtés parce que je ne vois pas d’autre chemin pour perfectionner l’humanité que la fermeté des croyances, la miséricorde, le pardon des offenses, la protection accordée par le fort au faible, l’aumône, la paix des consciences.
– Quelles belles idées –dit don Manuel feignant l’enthousiasme-. Bénies soient les richesses que tu possèdes, parce que grâce à elles, tu feras du bien à tes semblables déshérités. Si tous les riches étaient comme toi, il n’y aurait pas de misère, pas vrai ?, et le problème social ne serait pas aussi effrayant.
En arrivant à ce point, le marquis avait besoin de se faire violence pour ne pas prendre une chaise et ne pas la laisser tomber sur la tête de ce curé malin et narquois. Mais sa correction sociale, telle une conscience plus puissante que la vraie conscience, l’emporta sur sa colère, et pas une minute ne disparut de ses lèvres le sourire de la bonne éducation, qui paraissait sculpté… Ah ! la bonne éducation ! C’était la seconde nature, la visible, celle qui affrontait la société, tandis que l’autre, son support, sortait rarement du cloître où les règles humaines bien étudiées la maintenaient recluse. Faire abstraction de cette seconde nature dans tous les actes publiques et même domestiques, était aussi impossible que de sortir tout nu dans la rue en plein jour. Les raffinement de l’éducation si, dans certains cas, ils corrigent les aspérités natives de l’être, dans d’autres, ils produisent très souvent des hommes artificiels qui, par les conséquences de leurs actes, se confondent souvent avec les vrais.
Epuisant les inépuisables ressources de sa bonne éducation, de cette force d’une certaine manière créatrice et formatrice qui crée des hommes ou, du moins, des statues vivantes, le marquis défendit le rôle que lui avait imposé l’ecclésiastique ami de la maison, et il mit un point final à la conférence, en disant élégamment à sa sœur :
– Dispose de… ce que tu voudras. Je suis à tes ordres. Et, comme te l’a fort bien dit don Manuel, entre nous, entre frère et sœur, il ne aurait être question de comptes ni d’accomptes…Non, ne me remercie pas. Il est dans mon devoir d’oublier une dette insignifiante. La fortune m’a favorisé plus que toi ; que dis-je, la fortune ? Dieu, qui est celui qui donne et qui ôte les richesses. S’il me les a données à moi, c’est pour que tu puises te consacrer…, te consacrer…
Il ne termina pas sa pensée, parce que la bonne éducation employée à des doses si fortes, avait dû s’épuiser… Pour dissimuler la soudaine extinction de cette force, le marquis n’eut d’autre solution que de faire semblant de tousser un peu.
Et don Manuel, sortant une petite boite en carton, lui dit non sans malice :
– Servez-vous, monsieur le parlementaire, une pastille de celle que j’utilise.




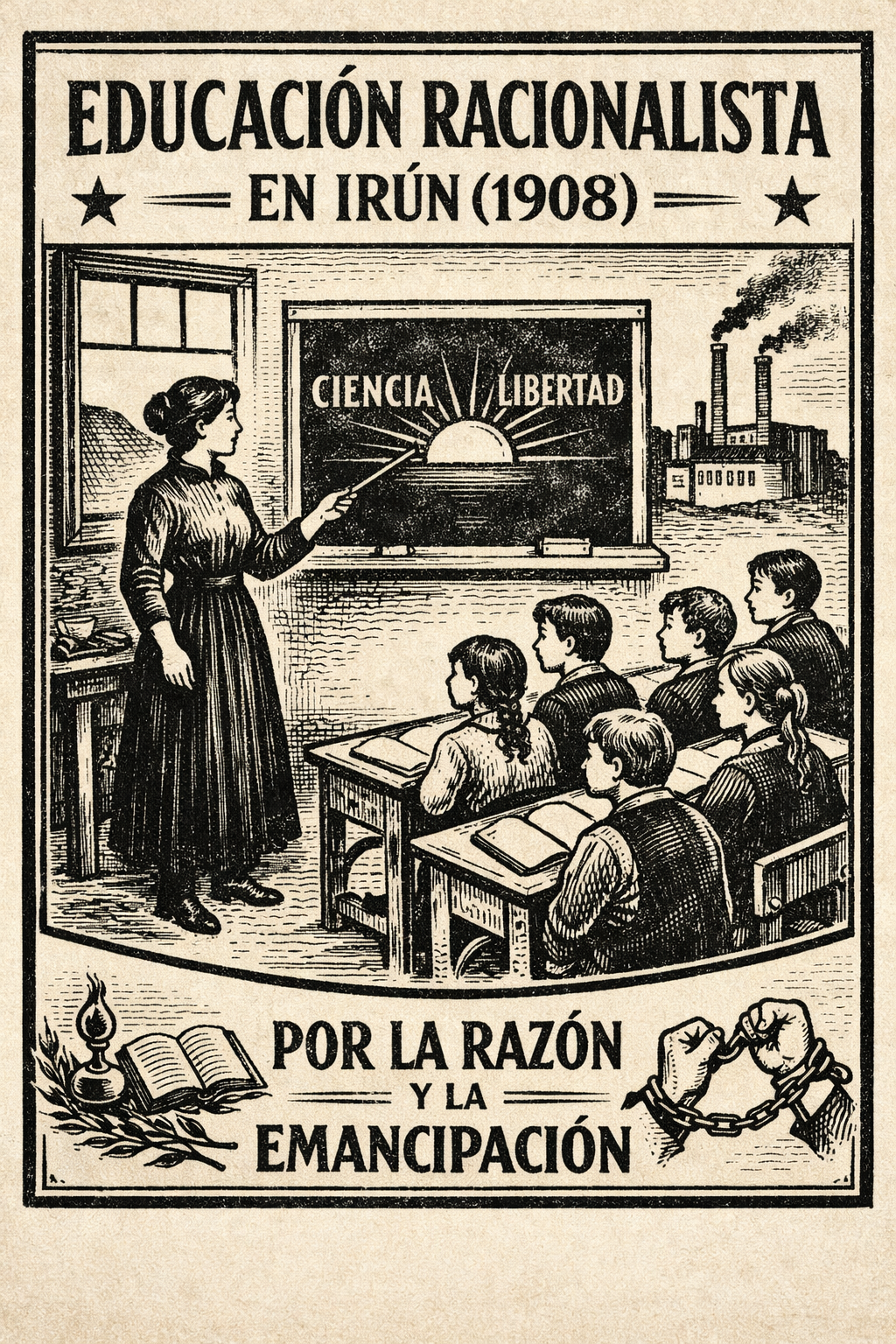











Very interesting subject , thanks for posting.
Simply want to say your article is as amazing. The clarity to your publish is simply nice and that i could assume you’re a professional on this subject. Fine together with your permission allow me to snatch your feed to keep up to date with imminent post. Thanks one million and please keep up the rewarding work.
You are my intake, I possess few blogs and infrequently run out from to brand.
I like this blog very much, Its a rattling nice situation to read and find information. «I’d better get off the phone now, I’ve already told you more than I heard myself.» by Loretta Lockhorn.
Very great visual appeal on this website , I’d value it 10 10.