No hay productos en el carrito.

Deuxième partie
1
Voyons maintenant les artifices qui, dans la conduite du marquis de Feramor, déterminaient sa seconde nature, son être social et correct, parce que l’élan acquis l’avait amené à des distances considérables de sa véritable nature intérieure, pétrifiée dans l’égoïsme. Ce soir-là et les suivants, en bavardant dans ses soirées avec les graves personnes des deux sexes qui y venaient, il signala, en se vantant discrètement, son dessein d’aider les entreprises religieuses de sa sœur la comtesse . C’est vrai que tout cela, c’était pour la galerie. Il faut dire que ce qui le poussait à exprimer de telles idées et d’autres similaires, c’était l’atmosphère qui régnait dans ses soirées, qui n’était qu’une prolongation de l’ambiance générale. Parce que, à cette époque qui n’est pas lointaine, était tombée sur la société un de ces courants qui temporairement l’agitent et la remuent, courant qui alors était religieux comme à d’autres époques elle avait été impie. Le phénomène se reproduit avec une périodicité assurée. Des vents contraires arrivent sur la conscience publique : parfois comme une mode d’exaltations démocratiques ; parfois la mode de l’idéal contraire. En littérature aussi, ces bourrasques furibondes vont et viennent, et elles feraient de grands dégâts si elles ne passaient pas rapidement. Parfois souffle un réalisme cyclonique qui détrempe tout ; parfois un vent classique de l’intérieur qui dessèche tout.
La religion n’échappe pas à cette élasticité atmosphérique qui, d’une certaine manière, est salutaire quoiqu’on en dise. Arrivent de hautes pressions d’indifférentisme ; les suivent d’autres de piété. Dans les jours auxquels je me réfère, la rafale religieuse arrivait avec force, et elle tourbillonnait d’une façon furibonde dans les salons de Feramor. On parlait de préférence de Rome et du Saint Père ; chacun avait des mots amusants pour ridiculiser les incrédules, ou pour vanter les beautés du symbolisme chrétien et des arts auxiliaires du culte ; d’autres signalaient la décadence, les symptômes de ruine morale dans les pays protestants. Ces derniers soutenaient la fréquence des conversions au catholicisme, et les premiers rappelaient avec force louanges les vies des saints et des fondateurs, les trouvant plus belles que celles des héros de Plutarque. On projetait des voyages en groupes pour admirer des cathédrales et fureter dans des monastères détruits, et les amateurs d’esthétique trouvaient plus de talent chez les écrivains orthodoxes que chez les impies ou les indifférents. Certains qui n’avaient jamais été des dévots, laissaient voir, sous leur savoir mondain, une pointe d’oreille piétiste, et ceux qui l’étaient se grandissaient et menaçaient de dévorer le monde. C’est de l’extérieur, par le véhicule de la Presse, qui a toujours été extraordinairement sensible à ces changements atmosphériques, que venait la rafale, avec chaque jour plus de force, parce que les journaux taxés de libres penseurs et qui l’étaient réellement, au moment de la Semaine Sainte, avaient leurs colonnes bourrées d’une bigoterie qui aurait fait pâlir de colère les progressistes d’il y a trente ans . Les dames, naturellement, ne faisaient qu’alimenter la rafale avec le vent de leurs éventails et avec le souffle de leur phraséologie passionnée, jusqu’à parvenir à la gonfler comme une trombe. Elles ignoraient que lorsque ces vents se seraient apaisés, en viendraient d’autres avec de nouvelles idées et des passions nouvelles.
Donc : dans une atmosphère lourde de revendications religieuses, le marquis de Feramor versait ses idées artificielles, que l’on appelle ainsi pour les différencier des idées vraies, toute cachées à l’intérieur, loin de l’histrionisme sec de la bonne éducation. Il s’efforçait de se montrer content d’aider sa sœur doña Catalina dans les extraordinaires entreprises chrétiennes auxquelles elles allaient bientôt s’attaquer. Oh ! en tant que représentant des classes dirigeantes, il était obligé de contribuer à tout ce qui favoriserait les grands intérêts spirituels de la société ! On ne pouvait se contenter que de développer les travaux publics, et de défendre comme un article de loi les chambres de commerce. Il fallait regarder vers l’au-delà, montrer aux classes prolétariennes le chemin oublié du ciel, et préparer le retour des grands idéaux. De cette façon, il alimentait sa vanité, en préconisant en public ce qu’il détestait en son for intérieur, et il avait l’intention de tirer parti de ce qui était en train de se tramer contre sa volonté, au deuxième étage, entre l’entêtée comtesse de Halma et le complaisant don Manuel Flórez.
Ceux qui venaient à ses réunions se voyaient obligés à faire des éloges encore plus grands que ceux qu’on lui faisait constamment à propos de son sens anglais et de son mépris des exagérations. A l’exception du comte de Monte-Cármenes, équilibriste incorrigible, qui gardait toujours un juste milieu très commode, équidistant du mysticisme et de l’impiété, les amis de Feramor le voyait avec plaisir dans cette voie. Naturellement, les hommes à la capacité intellectuelle et pécuniaire comme lui se trouvaient obligés de donner de la force au Pouvoir public, en revigorant le ressort religieux. Le marquis de Cicero ne pouvait contenir son enthousiasme ; Jacinto Villalonga qui, après avoir obtenu un poste de sénateur à vie, s’était constitué en chef des grands principes, déplorait ne pas être riche pour aider la comtesse de Halma, dans ses entreprises spirituelles, qui étaient la même chose qu’une grande bataille livrée aux révolutions ; les Trujillos, les Albert et Arnáiz , de noblesse récente, pensaient que la noblesse devait se mettre à la tête du mouvement de régénération ; le comte de Casa-Bohío, Tellería de naissance, marié à une riche cubaine, confirmait son accord et son approbation enthousiaste au nom de l’Europe et de l’Amérique. Le général Mola ne faisait que répéter et confirmer ses idées de toujours. Severiano Rodríguez regimbait un peu, mais sans se lancer résolument dans l’opposition parce que la courtoisie le lui interdisait.
Mais celui qui fit avec la plus grande véhémence et la gesticulation la plus emphatique l’apologie des intérêts spirituels fut un certain José Antonio de Urrea cousin du marquis, parasite de la maison par périodes, homme inconstant, léger et à la réputation douteuse. Plus jeune que Feramor, il lui ressemblait un peu sur le plan physique, peu sur le plan moral, parce que c’était la tête la plus écervelée de la famille et la plus grande calamité qui pesait sur elle. Le marquis lui vouait une antipathie qui parfois était une haine mortelle, et avait fait l’impossible pour l’envoyer à Cuba, aux Philippines, au bout du monde, et pour se libérer de ses furieuses attaques quand il réclamait des secours pécuniaires. Les flatteries dudit parent le faisait sortir de ses gonds parce que, derrière, arrivait toujours le coup inexorable.
En réalité, José Antonio de Urrea était plus malheureux que mauvais. Orphelin à un âge tendre et sans fortune, il n’y eut personne pour l’envoyer étudier en Angleterre ou autre part. La famille riche voulut lui faire faire des études ; il en commença successivement de plusieurs types : l’Infanterie, les Eaux et Forêts, l’Administration militaire, les Télégraphes, et n’arriva pas même à la moitié d’aucune. A vingt deux ans, il fut nécessaire de lui obtenir une place. Feramor comptait par centaines les voyages au Ministère pour demander un renouvellement ou une mutation. Le fait est qu’on le renvoyait de tous les bureaux parce que, ou il n’y allait pas, ou il arrivait en retard, et ne faisait que fumer, dessiner des caricatures ou s’amuser avec les collègues. Lâché par sa famille, il s’adonnait à des affaires inconnues mystérieuses. On le voyait quelque temps bien habillé, dépensant de l’argent en voitures et théâtre, sans que personne ne sût d’où procédaient ces bénédictions. Après une longue période d’éclipse, mon José Antonio réapparaissait dans un état à faire pitié, malade, brisé, mort de faim ; mais avec l’idée de monter une grande affaire, qu’il étudiait et qui certainement serait son salut. Feramor et sa femme, la duchesse de Monterones et son mari en avaient pitié et, après lui avoir fait promettre de se corriger, se laissaient détrousser. Le bandit avait mille ruses amusantes pour conquérir les cœurs, en particulier ceux des dames ; avec l’aide qu’il recueillait, il remettait ses habits en état ou en commandait des neufs, et vous l’aviez à nouveau tiré à quatre épingles, de jour comme de nuit, avec son couvert dans toutes les maisons, et en train d’égayer les soirées avec la désinvolture de son esprit.
Son inconstance n’était pas moindre que son toupet ; parfois il disparaissait de chez les Feramor et Monterones, et jouait au parasite chez d’autres gens, où, sans doute, on payait ses bons mots d’un repas, qui n’étaient pas toujours du meilleur goût. Il n’en reste pas moins qu’à la table et lors des soirées de la famille, il payait leur fréquentation avec une adulation asphyxiante, et chez les autres, il se vengeait de l’humiliation reçue en disant du mal de sa famille, en ridiculisant l’anglicanisme de son cousin, les vanités de la Marquise et d’Ignacia Monterones. Après, venait en général une longue immersion dans des obscurités inconnues, pour resurgir en suite, repentant, implorant miséricorde. Aussitôt que son cousin le voyait l’encensoir à la main, il se mettait à trembler, parce que les flatteries annonçaient toujours une sensationnelle estocade, qu’il portait comme personne. Et ainsi, quand il le vit s’enthousiasmer autant pour des idéaux religieux, le marquis se dit : « Il est armé de pied en cape. Préparons-nous. »
En effet, profitant d’une occasion propice, José Antonio l’assaillit à un angle du billard, et là, avec perfidie, préméditation et acharnement, il laissa tomber sur sa tête le fil coupant de son épée et le marquis resta si étourdi de ce terrible coup, qu’il ne put lui répondre. Le terrible tapeur se montra très excité avec l’espoir d’une affaire qui marchait à tous les coups, et il ne lui manquait qu’une somme d’argent, une misère que son cousin, son cher cousin, son opulent cousin et Mécène lui donnerait le jour suivant… ; si c’était le matin, ce serait encore mieux.
2
– Mais, tu es fou ? Que je te donne mille pesetas ! –lui dit la victime, en lui mettant la main sur la poitrine et en l’écartant de lui comme un poids qui lui tomberait dessus-. Quelle histoire ! Toi, des affaires ?… Et c’est quoi, on peut savoir ?
– Une affaire d’édition, mais sûre, Paco. Tellement sûre, que, grâce à elle, je gagnerai en peu de temps des mille et des cents.
– Vas-y, cause. Toujours la même histoire. Et avec mille pesetas tu vas créerune maison d’édition ?
– Tu ne m’as écouté ? J’en ai plus ; mais il me manque ce petit quelque chose.
– Ce qui te manque, c’est de la dignité –répondit le marquis qui, devant cette calamité de la famille, en perdait sa bonne éducation-. Laisse-moi tranquille, ou je te jette hors de chez moi.
– Bon, il n’y a pas de quoi te fâcher. Tu me refuses l’aide que moi, pauvre industriel, je viens te demander. Et ensuite, vous me dites : « Travaille, travaille, sois un homme, deviens raisonnable. » Eh bien, monsieur, je deviens raisonnable, je suis assommé à force de travailler ; mais, hélas ! cette friponne de loi économique s’interpose… Le capital, où est-il ? Je le cherche, j’en trouve une partie ; je vais voir mon opulent cousin pour qu’il me le complète, et mon opulent cousin me jette à la porte, me condamne à la misère, m’attache les mains…. Bien, Paco, bien… Je t’aimerai toujours, et je te respecterai toujours.
– C’est vraiment le moment de mettre de l’argent dans des entreprises d’édition…. précisément quand nous avons convenu de le consacrer aux choses spirituelles.
– Tu es de taille à suffire à tout. Tu te trouves dans l’obligation de développer les œuvres de Dieu et celles de César.
– Ah oui , avec ce que je dois sortir ces jours-ci. Sais-tu que je dois donner à ma sœur… ?
– Je le sais : tu lui donnes ce qui lui appartient.
– Mais…
– Entendu : ta sœur est folle.
– Parle avec plus de respect.
– Folle à lier. Une folie sublime, si tu veux. Moi, si j’étais toi, je ne lui donnerais pas un sou. Ce qui est sublime cesse de l’être dès que tu y mets de l’argent. Donne-moi à moi ce que je te demande, car moi je suis sage et au ras du sol, avec mon petit travail méthodique et mes habitudes d’hommes prévoyant et ordonné.
En effet, il faut le dire, parce que c’est la vérité, le pauvre Urrea depuis six mois menait une vie totalement distincte de celle qui lui avait donné une si triste réputation. Il était parvenu à donner une forme pratique à son habileté pour la photographie, et s’associant à un industriel très actif, il avait fait une excursion dans les provinces andalouses et en avait ramené une collection de clichés de monuments qui lui avaient rapporté quelque argent. Cela l’avait encouragé. Il avait fondé un journal, en étudiant la zincographie et l’héliogravure ; mais la pauvreté de la partie littéraire avait fait échouer la publication. Avec de nouveaux éléments il essayait de créer un autre hebdomadaire illustré, espérant en tirer des gains considérables, et il réunissait de l’argent pour le matériel indispensable et pour les premiers frais. L’imprimeur lui demandait, outre le papier, une somme en caution pour répondre de la composition et du tirage des deux premiers numéros. En parlant
de ces sujets, en entrant à fond dans l’explication technique de l’affaire, pour voir s’il faisait fléchir son cousin, il affûta encore plus son arme, arrivant à fixer a deux mille pesetas la somme dont il avait besoin.
– Deux mille !
– Oui, et tu vas me les donner. Tu es meilleur que ce que tu crois.
– Non, je ne me considère pas comme perfectible. Et c’est parce que je ne le suis pas, que je ne te donne pas les deux mille pesetas : cela serait comme les jeter par la fenêtre… Ecoute, j’ai une idée : demande-les à ma sœur, qui maintenant a de l’argent, ou l’aura bientôt, et selon don Manuel, elle le consacre à secourir la misère humaine. Toi évidemment, avec ta toute nouvelle entreprise d’édition, tu fais partie de cette Humanité misérable, que Catalina pense sauver.
– Eh bien, tu vois, ce n’est pas une mauvaise idée… Ah ! Ta sœur est une sainte, une héroïne chrétienne. Je l’admire, chaque fois que je la vois, j’ai envie de m’agenouiller devant elle et de prier… Parole d’honneur… Eh bien oui : une fameuse idée !
– Fais-lui comprendre que protéger les industries naissantes et les hommes entreprenant et sérieux comme toi fait partie des œuvres de miséricorde, et que la charité commence par la famille…, tu me comprends ? Qui sait, mon ami, qui sait si… !
– Ne le prends pas à la légère, car il n’est pas impossible…. On essayera, mon ami, on essayera. Catalina est réellement un ange et ses malheurs lui donnent une extraordinaire pénétration pour comprendre ceux des autres. Si on regarde bien l’affaire, sa campagne de charité doit commencer par moi, qui la vénère, qui l’idolâtre ; par moi, le plus malheureux de la famille, plus qu’elle certainement, plus, plus. Et je crois, en mon âme et conscience, que je peux bien lui demander trois mille pesetas.
– Oui…, monte ton prix, mon garçon, monte ton prix.
– Mais, hélas ! –s’exclama Urrea, soudainement découragé, et en portant sa main à sa tête-, je ne me souvenais pas de… Hélas, c’est impossible, mon cher Paco, c’est impossible. Que nous sommes idiots toi et moi ! Evidemment, si ma cousine se laissait conduire par son cœur magnanime, il n’y aurait pas de problème. Mais comme celui qui dirige sa volonté, c’est cette anguille de don Manuel… Imagine un peu.
– Je ne te permets pas de parler ainsi de notre très digne ami.
– Pardonne-moi…. Je ne l’offense pas. Pauvre de moi ! Quand je dis que la majorité des maux qui affligent l’Humanité sont d’origine ecclésiastique !… Car si je pouvais trouver ma cousine libre, je veux dire, dans le libre exercice de sa miséricorde, crois-moi bien que mes quatre mille pesetas personne ne me les enlèverait. Ma parole.
– Je vois que si on ne te les donne pas rapidement, tu vas finir par demander un million.
– J’ai une idée…. Peut-être pourrait-on… Il faut voir. Je peux compter sur toi ?
– Sur moi ? Pour quoi faire ?
– Pour m’appuyer au cas où cette très révérende moule instruise, comme il semble naturel, contre ma demande.
– Moi…. Comment ?
– En disant à madame la comtesse de Halma que je ne suis plus ce que j’étais, que je me suis corrigé, que je travaille, qu’avec ma petite industrie je donne à manger à de nombreuses familles indigentes ; enfin, que je défends point par point les grands idéaux chrétiens, et que ce serait une œuvre de charité fort méritoire que de m’aider avec cinq mille pesetas.
– Tais-toi, voyons, tais-toi !. Je ne puis t’appuyer. Ils vont croire que je suis devenu fou. De toutes manières, montre-moi que ta volonté de te corriger est véritable, et que tes plans de travail sont quelque chose de sérieux et de décisif.
Le marquis avait dit cela en passant dans le salon d’à côté, comme si avec la fuite il eût voulu se libérer d’une mouche aussi importune ; mais le parent pauvre le suivait, cousu à ses basques, en déployant la volonté obstinée de ces caractères qui ne faiblissent pas tant q’ils n’ont pas obtenu ce qu’ils veulent. Quelques minutes plus tard, Feramor s’assit sur un divan pour parler de politique avec Manolo Infante. Le parasite fut obligé de s’y joindre avec une affabilité mielleuse ; la conversation roula insensiblement sur le terrain journalistique, et aussitôt Urrea intervint avec cette allusion
– Quand j’arriverai à publier mes Causeries du samedi, vous verrez. Un truc nouveau, l’actualité présentée ave art et chic, un prix phénoménal, je veux dire, très bon marché ; la partie littéraire, de première classe ; l’héliographie, la même chose sur toile ; enfin, une affaire pour enrichir n’importe qui. Le premier numéro, qui est déjà prêt, je le consacre au célèbre apôtre de notre temps, le grand Nazarín, sur qui je donne des nouvelles extraordinaires, la biographie complète, des photos de lui et de ses disciples…
– Mais ce Nazarín, c’est qui ? –demanda le marquis à Manolo Infante-. La presse nous rend déjà fous avec le fameux trio nazariste, et le procès, et les interviews… Toi, tu l’as vu ?
– Je n’ai pas besoin de le voir –répliqua Infante- pour penser, comme ton cousin, que c’est le coquin le plus malin que Dieu a mis sur la terre.
– Doucement –dit Urrea avec l’aplomb qu’il utilisait généralement pour se dédire -. Je ne suis pas du tout de cet avis.
– Il y a un moment tu nous racontais à Severiano et à moi que tu l’avais vu, et que tu avais parlé avec lui et ses compagnes, et que tu le considérais… ce sont tes mots…, comme un imposteur des plus banals.
– J’ai dit ça ?… Bon, je vais vous révéler tous les dessous de ma diplomatie. Pour vous désorienter, toi et Severiano, je vous ai rapporté le point de vue habituel et banal, réservant pour mon public la nouveauté de la surprise. Je présente Nazarín comme il apparaît après que j’ai sondé son caractère en lui rendant visite à l’hôpital jour après jour.
– Et tu penses que c’est un saint. Mais ça ce n’est pas nouveau, parce qu’il y a des gens qui ont déjà soutenu la même chose.
– Mais ils ne présentent pas les éléments de preuves que moi, je vais présenter. C’est un homme extraordinaire, un novateur, qui prêche avec les actes, non avec les mots ; qui fait un apostolat avec le cœur, non avec la raison, et qui laissera, ne vous moquez pas de ce que j’affirme, une trace profonde dans notre siècle.
– Mais tu nous as dit il n’y a pas une demie heure que ce n’est pas même un fou, mais un aventurier qui fait mine d’être dément pour vivre aux crochets du pays !
– Il y a une demi heure, je n’avais pas intérêt de te dire ma véritable opinion. Dans la diplomatie et dans l’industrie la tromperie est permise. Avant, je n’avais pas intérêt à propager la vérité : maintenant j’y ai intérêt.
– Celui-ci, je le comprends mieux que personne –dit Feramor en riant-. Il a ses plans, il poursuit son affaire et, soudain, un changement atmosphérique le fait changer de direction pour arriver plus vite là où il veut aller. Mon cousin est très malin, et maintenant il veut se mettre bien avec ceux qui consacrent leur argent aux idéaux éternels, aux campagnes de la charité évangélique. C’est cela, oui ou non ? Et à propos, Manolo, connais-tu quelqu’un qui voudrait prendre part à une entreprise d’édition, à tendances religieuses, nota bene, à tendances religieuses, en faisant un petit sacrifice de six mille pesetas ?
– Doucement… – dit vivement José Antonio-. La participation aux bénéfices ne peut se faire qu’en apportant sept mille pesetas à l’affaire.
Feramor et Infante se mirent à rire, et l’autre, sans se troubler et sans abandonner le champ de son formidable sport, continua de cette manière.
– Riez, riez… On verra bien qui rira le dernier. Et revenant à mon héros , je vais vous montrer quelques épreuves des différentes photographies que j’ai pu faire de lui à l’hôpital… J’en ai aussi de ses compagnes. Vous allez voir.
Mettant la main dans sa poche, il montra quelques épreuves photographiques, qu’il avait faites, lesquelles furent examinées avec une intense curiosité par les différentes personnes qui aussitôt avaient constitué un groupe.
– Donc, c’est lui le fameux Nazarín ?… Voyons, voyons…
– Dites-moi si un visage aussi intelligent appartient au genre humain.
– On dirait un maure.
– Ce à quoi il ressemble, c’est à une figure biblique.
– Et cette femme… ?
– Regardez, regardez cette tête, et dites-moi si l’imposture peut arriver un jour à cette beauté idéale.
– Joli profil. Mais là, il y a des retouches.
– Plus qu’à la Beatriz du Dante, elle ressemble à un Dante jeune.
– Dites que c’est une pythonisse, avec l’inspiration peinte dans ses yeux.
– Ou une Sainte Claire.
– Non, pas ça ; ce n’est pa une figure médiévale, elle est biblique.
– De l’Ancien Testament. Ne confondez pas …
– Et celle-ci ? Qu’est-ce que c’est que cette guenon ?
– Elle, c’est Ándara…, la monstrueuse, parce que sur son visage, il y a un clin d’œil de l’Enfer et un autre du Ciel…
– Ándara !… Jésus, quelle physionomie démoniaque !
– Tout est étrange, sublimement énigmatique et mystérieux dans cette famille, ou disons tribu… Mais regardez, regardez bien le visage de Nazarín. Est-ce Job, est-ce Mahomet, est-ce Saint François, est-ce Abélard, est-ce Pierre l’Ermite, est-ce Isaïe, est-ce Sem lui-même, le fils de Noé ? Immense énigme !
Notre brave Urrea débitait ces chaleureuses hyperboles comme un voyageur de commerce qui montre les échantillons des articles qu’il offre au marché. Et, pendant ce temps-là, les photos allaient de main en main. Les dames, essentiellement, se les arrachaient, et y mettaient toute leur attention, avec une intense curiosité, insatiable, fébrile.
3
– Mais mon cher Urrea -dit le marquis de Cicero avec une sincérité infantile-, il faut publier cela.
– On le publiera.
– Et le texte, ça vaut le coup ?
– Ah !…
– Mais le coût est si considérable –dit Feramor-, que l’entreprise qui a pris à sa charge la propagande nazariste sollicite une subvention de huit mille pesetas.
– Oh !… Tu n’as pas exagéré, mon cher cousin –manifesta Urrea-. Et je t’assure aussi, parole d’honneur, que pour bien mener la chose, à la hauteur du sujet, neuf mille ne seraient pas mal venues.
– Voyons, il vaut mieux que tu arrives de suite à un chiffre rond, deux milles douros[1].
– Pour mille choses superflues, des Mécenes que je connais ont donné cela et beaucoup plus. Sur ma foi. Ce que l’on veut maintenant est circonscrit dans les limites d’une modestie presque invraisemblable : dix milles pesetas. Comment demander moins ?
– Cela ne me semble pas beaucoup. Que le Gouvernement vous les donne.
– Ou bien, il faut les demander aux Confréries Sacramentelles –dit Manolo Infante-, qui ont l’adjudication pour conduire à la vie immortelle.
– Mieux vaut alors demander aux entreprises funéraires, parce que le nazarisme fait de la propagande pour la mort.
– Eh bien, moi, si j’étais vous, Urrea –manifesta une dame qui savait se moquer avec douceur-, je demanderai la subvention au syndicat de constructeurs de statues et de chars pour la Semaine Sainte.
Notre ingénieux aventurier ne se laissait pas démonter par la moquerie amusée ave laquelle les amis de la maison accueillaient ses projets ; au contraire, il se trouvait excité, sentait dans son esprit d’audacieuses initiatives et une extraordinaire fécondité de solutions pour travailler dans cette affaire. L’idée suggérée par Feramor était très bonne. Ah !, si lui avait pu, lui, manœuvrer en terrain libre, c’est-à-dire, dans le cœur plein de bonté de sa cousine ! Mais l’intrusion de ce pot de colle de Manuel Flórez, tamis par lequel passait toutes les pensées et les actes de Catalina de Halma, le déconcertait et le faisait douter douloureusement du succès. Pour discuter à son aise sur un problème aussi difficile, il avait besoin d’être seul, de stimuler son esprit à un point incroyable, de se préparer, enfin, avec tout l’appareil de ruses et de subtilités qui, dans sa longue expérience de ces joutes, lui avaient donné tant de victoires. Méprisant les moqueries dont il était l’objet chez Feramor, il en sortit à la hâte, sans prendre congé de personne; contrairement à ses habitudes, il alla chez lui, et dans sa petite chambre à coucher, il s’enferma pour méditer un plan d’attaque, essayant de prévoir, les positions de l’ennemi pour bien choisir le terrain sur lequel il devait attaquer. En se mettant au lit, les pieds froids et la tête ch aude, il se dit : « Il ne faut pas se laisser abattre : la timidité serait mon échec. En concrétisant mon honnête demande à deux milles douros, ils pourraient croire que c’est pour m’amuser. Pour qu’on voit que c’est une affaire sérieuse, un sujet où entrent en ligne de compte les grands intérêts de l’esprit humain, il faut que je pousse jusqu’à trois mille. »
Il s’endormit à l’aube, et si au début il avait rêvé que don Manuel Flórez, en entendant sa demande, tirait sur lui à bout portant avec un canon Hontoria, ses rêves furent ensuite optimistes et agréables, parce qu’ il vit que le dit Flórez l’embrassait tendrement, tandis que Catalina, sortait de son secrétaire un coffret gothique et de celle-ci de nombreuses liasses de billets de Banque, dont elle donnait une partie à Nazarín et une autre à lui ; et comme Nazarín était tout abnégation et mépris pour les biens de ce monde, il lui faisait cadeau de sa part, sans même la regarder. Le geste pudique de l’apôtre mendiant resta dans l’esprit d’Urrea même après qu’il fût passé de ce rêve à un autre, bien différent. Il rêva qu’avec une partie de cet argent, il achetait une mine de fer, qui en peu de temps lui donnait des rendements fabuleux ; avec les gains de la mine, il achetait deux pâtés de maison et beaucoup d’emprunts d’Etat, et, en négociant avec habileté, il parvenait à mettre la main sur tout le réseau de chemins de fer d’Espagne…, pourquoi ne pas le dire…, et de France et d’Angleterre. Et pendant ce temps-là, Nazarín, qui écartait de lui le paquet de billets avec une répugnance apostolique.
Au point du jour, pendant que des choses aussi inouïes se passaient dans le cerveau d’un homme endormi, don Manuel Flórez, qui vivait dans la même rue, exactement en face de ce rêveur d’Urrea, sortait de son domicile. Il alla d’un pas alerte dire sa messe ; il passa ensuite quelques heures dans une église et dans une autre, et vers dix heures, il se présenta chez les Feramor. Entrant sans se faire annoncer dans le bureau du Marquis, qui travaillait avec son administrateur et fondé de pouvoir, il lui dit :
– Mon cher Paco, nous voudrions en terminer rapidement avec cela ; si c’était possible, aujourd’hui.
– Comment cela ne serait-il pas possible ? Aujourd’hui même, mon cher don Manolo. Notre rédemptrice est très pressée d’entrer en fonction.
– La misère humaine, mon fils, c’est elle qui est pressée, et la faim humaine, la soif et le dénuement.
– Qu’à cela ne tienne.
L’administrateur intervint, affirmant que le notaire, pour préparer tous les documents, était déjà prévenu, et que s’il terminait ce jour-là, le lendemain la remise de la dot de madame la comtesse, une partie en biens immobiliers ou en valeurs, une partie en argent comptant, serait chose faite.
– Parfaitement –dit le brave prêtre, en se caressant une main avec l’autre-. Et puisque tu es aujourd’hui en veine d’amabilité…
– Mais, vous ne vous asseyez pas, don Manuel ?
– Non, je m’en vais tout de suite. Je dis que puisque je te trouve en veine de concessions, j’ose te présenter une petite envie de ta sœur ; une chose insignifiante ; tu vas voir….
– Finissez-en vite, car je commence a ressentir des frissons.
– Pourquoi, mon cher fils ?
– Parce qu’il se pourrait bien que pour sauver la pauvre Humanité, sa dot ne lui suffise pas, et que, au nom du Dieu Un en Trois, elle demande aussi la mienne…, et il pourrait arriver que vous vous obstiniez pour que je la lui donne.
– Allons, ne plaisante pas. Ce qu’elle te demande c’est que tu lui donnes la propriété de Zaportela, en Aragon. Dans cette grosse bâtisse délabrée, elle a passé une partie de son enfance avec sa tante Rudesinta. Elle y a des souvenirs… ; enfin, tu n’as pas besoin de ce nichoir à lézards, et elle a envie de la restaurer, et …
– C’est que la maison de Zaportela et deux propriétés adjacentes, je les ai données en usufruit aux Urrea, les oncles de ce débauché de José Antonio, quémandeurs insatiables comme lui, qui pratiquent la mendicité par la terreur. Si je les chasse de là-bas, ils sont capables de me brûler toutes les maisons que j’ai en Aragon.
– Bon, eh bien, au lieu de Zaportela, tu lui donnera le château de Pedralba, dans cette province, commune de San Agustín, tu sais bien…, une vieille masure, avec une tour et je ne sais quelles ruines d’un monastère cistercien… Ainsi donc, il n’y a pas à hésiter, mon fils, et sois-moi reconnaissant d’ouvrir de larges horizons à ta générosité. Tu es un ange et le type parfait du bon chrétien.
– Ça va, ça va. Vous n’avez pas besoin d’employer la flatterie pour me dévaliser. On va arranger cela. Dites à votre disciple de ne pas pleurer pour le château. Pedralba sera à elle.
– C’est toi qui le lui diras, parce que je ne monterai que cet après-midi –dit Flórez en regardant sa montre-. Je suis très pressé. A onze heures, il faut que je voie monsieur le vicaire ; et à midi, on m’attend au Ministère de la Justice pour aller à la Nonciature… Bien, monsieur, bien.
– Quoi de plus ?
– Rien de plus. Cela te semble peu ?
– J’ai cru que vous alliez me demander la voiture pour tous ces voyages.
– Je ne pensais pas te la demander, mais je la prends si tu me la donnes. Madrid est couvert de boue.
Peu de temps après sortait, tout content et guilleret, le brave don Manolo, et à la porte d’entrée, pan !, voilà José Antonio de Urrea qui entrait. Le jeune homme resta bouche bée, et il n’arrivait pas même à saluer le respectable aumônier de la maison.
– Pepillo, quelle joie de te voir !… Viens ici, mon fils, embrasse-moi ! –lui dit le prêtre avec effusion-. Mais, qu’est-ce que tu as ? Tu es devenu tout pâle. Es-tu malade ?… Tu trembles.
– Non monsieur… L’émotion… J’étais justement en train de penser à vous –répliqua Urrea en lui baisant la main-. Ne croyez-vous pas que voir, après tant d’années, ce vénérable ami de la maison, cet ange tutélaire de toute la famille, est quelque chose qui impressionne ?
– Tais-toi, tais-toi, flatteur.
– Donnez-moi votre main pour que la baise à nouveau.
– Ça suffit, ça suffit. Je sais, je sais que tu t’es bien amendé. Je sais que tu travailles, et que tu t’es rangé. Il était temps, mon fils.
– Qui est-ce qui vous l’a dit ? –demanda Urrea un peu inquiet, craignant l’ironie de son cousin Feramor.
– On me l’a dit. Qu’est-ce que cela peut te faire. Tes cousines, les Hinestrosa, me l’ont dit, voilà !
– Je suis un autre homme. Et comme cela fait du bien d’être quelqu’un de bien ! Quelle beauté celle d’une conscience tranquille, d’une honnête pauvreté et d’une conduite normale, ordonnée et parfaitement correcte ! quel repos que la pureté des intentions, la domination des désirs, l’adaptation de nos joies à la mesure de la réalité ! Quelle grande consolation que de vivre en harmonie avec tout le monde, et de se sentir aimé, respecté !…
– Oui, mon fils, oui.
– C’est vrai que je vis un peu sur une corde raide, car je ne peux me passer de certaines habitudes de confort et, n’ayant pas de fortune, le pain quotidien, mon très cher don Manuel, représente pour moi des efforts herculéens.
– Dieu bénira ton travail. Continue sur ce chemin. Persiste dans tes idées ; aie de la constance, du courage, et de la confiance en toi-même.
– Ainsi ferai-je. N’ayez crainte.
– Tu vas voir Consuelo ?
– Non, je vais rendre visite à Halma.
C’est avec cette brièveté familière, Halma, que le parasite nommait généralement sa cousine.
– C’est bien, c’est bien. Accompagner les malheureux, adoucir leur tristesse avec des mots de consolation ! La pauvre t’en sera très reconnaissante. Rends-moi le service de lui dire que je ne puis aller la voir avant cet après-midi… Ah oui ! Et que tout, elle sait de quoi il s’agit, sera résolu demain. Va, va mon fils. Et que le Seigneur te maintienne dans ces bonnes dispositions. Au revoir.
Il lui baisa à nouveau, la main, et après l’avoir accompagné jusqu’à la voiture, le grand Urrea monta, plus que joyeux, ivre d’enthousiasme et de bonheur, parce que les choses se présentaient à lui mieux que ce qu’il aurait pu imaginé dans son optimisme le plus débridé. Premier coup du sort ; trouver don Manuel Flórez avec cette humeur d’une incroyable bienveillance, et au courant de ses nouvelles habitudes de travail. Deuxième coup du sort ; savoir que le dit personnage n’irait pas avant l’après midi voir la faible forteresse, menacée d’un terrible siège. Il est vrai que l’ennemi pouvait se présenter au dernier moment avec un renfort puissant, des idées et une autorité toute fraîches ; mais il pouvait aussi se produire qu’ il arrive tard, et que, la promesse ayant été arrachée par l’assiégeant, l’illustre dame n’ait d’autre solution que de tenir sa promesse. L’homme se redressa moralement et physiquement en montant les escaliers droit à la chambre du deuxième. Il se sentait impétueux, audacieux, invincible, et, surtout, grand, énorme. Il croyait toucher de la tête le haut de l’escalier, et que les portes n’étaient pas assez vastes pour qu’il puisse entrer. Sans aucun doute, la Divine Providence se mettait-elle de son côté. Comme il avait bien fait ce matin de prier Le Père Éternel, la Vierge et Saint Antoine, en implorant leur aide efficace ! Que diable ! N’était-il pas lui aussi un pauvre, n’était-il pas un homme triste, un miséreux ? Eh bien, que faisait-il d’autre que demander une aumône, et donner l’occasion aux bonnes âmes d’exercer la plus belle des vertus, la charité ?
« Foin de timidité, foin des mesquineries qui pourraient compromettre le succès –se dit-il en passant la porte, superbe et arrogant, comme un champion qui désire grandir les dangers pour que la gloire de les vaincre soit plus grande-. En avant les hommes courageux. Je lui demande…, peuh…, vingt mille pesetas. »
4
Chaque fois que don Manuel entrait, après une longue absence d’une demi journée ou d’un jour entier, dans la chambre de sa noble amie la comtesse de Halma, il la trouvait plongée dans une mélancolie profonde et ténébreuse, telle une nageuse au fond d’une citerne. Avec, ouvert sur sa jupe, le livre de la Cité de Dieu de Saint Augustin, ou quelque autre œuvre mystique ; la joue appuyée sur la main droite, le coude du même côté soutenu par la main gauche, et celle-ci, sur le genou droit, un peu surélevé parce qu’elle posait le pied sur un tabouret, elle ressemblait à un Dante pensif, en train d’agiter dans son esprit les cercles noirs de l’Enfer ou les cercles lumineux du Paradis. En la voyant plongée dans de telles tristesses, silencieuse et sombre, don Manuel essayait d’égayer son esprit de sa conversation agréable, et parfois il y parvenait, parfois pas. Mais cet après-midi, quelle ne dut pas être la surprise du sympathique Flórez en trouvant son amie dans un état d’agitation joyeuse ? Il n’en croyait pas ses yeux en la voyant debout, allant d’un côté à l’autre de la chambre comme si elle rangeait et mettait en ordre les livres et les objets de dévotion qu’elle avait sur différentes étagères. Et le plus étrange était que sur son visage resplendissaient l’entrain, la vie. Ses yeux, toujours éteints, brillaient d’une lueur de fièvre ; ses joues, toujours pâles, avaient une teinte rosée, comme si elle revenait d’une promenade dans la campagne, ivre de soleil et d’air.
– Qu’avez-vous, ma noble et sainte amie ? –lui demanda le prêtre-. Que vous arrive-t-il ?
– Rien, il ne m’arrive rien. Je suis contente. Est ce que cela veut dire qu’il arrive quelque chose ?
– Oui… Je suis heureux de vous voir aussi contente. Il ne faut pas laisser l’esprit tomber dans la tristesse. La vertu est par sa nature joyeuse, et la conscience pure se réjouit en elle-même.
– Asseyez-vous, si vous voulez, et laissez-moi rester debout. Je ressens un inexplicable besoin de marcher, de bouger. Soudain, la tranquillité a commencé à m’être désagréable.
– Je vous ai recommandé de faire de l’exercice d’une manière modérée. La vertu ne requiert pas précisément la prostration sédentaire, qui peut même finir par être un vice et s’appeler paresse.
– Et maintenant vous allez me demander le motif ou la raison de ce contentement que vous observez en moi.
– En effet , madame, je vous le demande.
– Et moi je vous réponds que je ne le sais pas ; que je ne peux expliquer ce qui se passe cet après-midi dans mon cœur. Nous verrons si j’arrive à m’en rendre compte. Et maintenant, c’est moi qui vais poser les questions. Dites-moi : qui est Nazarín ?
Le brave Flórez resta un moment sans savoir quoi dire, et regarda le visage de la comtesse comme celui qui veut déchiffrer une devinette obscure.
– Eh bien, Nazarín… -murmura-t-il.
– Quel homme est-ce ? Le connaissez-vous ?
– Oui, madame.
– De maintenant, ou le connaissez-vous depuis longtemps ?
– C’est un prêtre de la Manche, d’âge moyen. Il y a deux ou trois ans, je ne me souviens pas bien de la date, j’ai eu l’occasion de lui parler dan la sacristie de San Cayetano. Il m’avait paru être un homme de grande valeur, aux moeurs très pures, humble, d’une intelligence peu commune, sobre en paroles… Après, je l’ai parfois rencontré dans la rue ; nous avons parlé. Le pauvre semblait avoir des ennuis ; il trahissait une profonde pauvreté, sans s’en plaindre. J’ai cru que c’était sa timidité et son extrême délicatesse qui le maintenaient dans un tel état, et je lui ai conseillé de se secouer, en essayant d’acquérir un peu l’art de parler aux gens. Par la suite, je l’ai vu impliqué dans un procès honteux, et son nom traîné sur la voie publique. Franchement je n’ai pas du tout aimé voir un prêtre en arriver à une telle situation, que ce soit par faiblesse de caractère, ou que ce soit par une véritable perversité. J’ai su qu’il était à l’hôpital, se remettant d’un très fort accès de typhus, et que croyez-vous ?… Je suis allé le voir. Je suis comme ça ; j’aime apprendre les choses par moi-même. Je l’ai vu, nous avons longtemps parlé, et…
– Pensez-vous comme presque tout le monde, que c’est un pauvre fou ?
– C’est l’opinion générale.
– Mais la vôtre, c’est la vôtre que je veux connaître.
– La mienne n’a aucune importance. Des experts médicaux l’ont examiné, des professeurs de maladies mentales et nerveuses.
– Mais vous êtes assez intelligent pour ne pas avoir besoin du jugement d’autrui pour faire le vôtre. Dites-moi ce que vous pensez, en votre âme et conscience, de cet homme. Est-ce une crapule?
– Je ne crois pas.
– Vraiment non ?
– Je soutiens avec une entière conviction que ce n’est pas un scélérat.
– Donc, c’est un fou.
– Je n’irais pas jusque là.
– Donc, c’est un homme aux vues élevées, un homme qui…
– Je ne dis pas cela non plus.
– Donc, vous n’êtes pas arrivé à vous faire une opinion concrète.
– Non, madame, je n’ai pas pu. Et, croyez-moi, ce Nazarín a été pour moi une source de grands embarras.
– Comment se fait-il que vous ne m’ayez pas parlé de cela, don Manuel ?
– Parce que je n’avais pas pensé qu’une telle affaire mériterait d’attirer l’attention de madame la comtesse.
– Savez-vous que circule un livre qui parle de Nazarín, dans lequel on raconte comment il est parti pour ses pérégrinations, comment il a rencontré des prosélytes, comment il a réalisé des actes de véritable héroïsme et de charité sublime ?
– J’ai lu ce livre, dont l’auteur m’a fait cadeau, avec une dédicace fort éloquente. Mais je n’ai pas confiance dans ce qu’on y raconte, parce que c’est plus une œuvre d’imagination que d’histoire. Les écrivains d’aujourd’hui, cherchent plutôt à plaire avec la fantaisie qu’à instruire avec la vérité.
– Puis-je lire ce livre ?
– Certainement. Mais sans oublier que c’est un roman.
– Alors, je préfère autre chose.
– Quoi ?
– Voir Nazarín lui-même. Le sujet vivant éclairera davantage qu’une histoire quelconque, en supposant même qu’elle ne serait pas une oeuvre d’imagination et écrite simplement pour amuser les oisifs.
– Voir Nazarín ? Où ?
– N’importe où. A l’hôpital…, ici.
– Cela me paraît plus grave. Malgré tout, je ne dis pas non.
– Dites oui et on en finira plus vite. Maintenant, point à la ligne : parlons d’autre chose.
– Eh bien, parlons d’autre chose –répéta Flórez, un peu, préoccupé par la saute d’humeur soudaine de la tristesse au contentement dans l’esprit de l’illustre dame-. Vous savez déjà que demain se fera la remise de la dot. C’est déjà un problème de résolu.
– Grâce au Ciel. Je suis profondément reconnaissante à mon frère –dit Catalina, s’asseyant un peu fatiguée, comme si ses nerfs excités commençaient à s’apaiser-. S’il faut que je vous dise la vérité, je vois avec une parfaite indifférence l’arrivée de cet argent entre mes pauvres mains.
– La personne qui regarde le Ciel –dit le curé en fermant à moitié ses petits yeux pour mieux voir le visage de son amie- s’habitue mieux que les autres à mépriser les biens terrestres.
– Et quant à l’emploi que nous devons donner à ce petit capital, nous en parlerons tranquillement.
– Si je me souviens bien, nous en avons déjà assez parlé. Nous avons convenu que vous fonderiez, en pleine campagne et loin de l’agitation, une institution de charité, avec ses propres rentes…
– Et qu’avant on garderait une certaine somme pour la distribuer à ceux qui ont besoin.
– Oui ; mais cela est difficile, parce que nous n’aurions pas même de quoi commencer. La charité doit se faire avec méthode, en s’appuyant sur les critères de l’Eglise, et en favorisant les plans de celle-ci. Cela ne sert à rien de donner des aumônes à tort et à travers. Il faut savoir à qui on donne et comment on le donne.
– Savez-vous, mon cher don Manuel, que cela, je ne le comprends pas bien ?
– Je vous l’ai expliqué hier même en long et en large.
– Eh bien, je l’ai oublié. Mais inutile de le répéter. Je le comprendrai quand j’aurai l’esprit plus serein.
Soudain, le bon prêtre se donna une tape sur le front, comme s’il voulait tuer un moustique qui le piquait et dit :
– Ah, ça y est, j’y suis !
– Quoi ?
– Rien, mais pendant que nous parlions, je me creusais la cervelle en cherchant qui avait bien pu venir vous rendre visite aujourd’hui. Et maintenant, cela m’est revenu en tête.
– Mon cousin Pepe Antonio de Urrea.
– Je l’ai rencontré à la porte d’entrée : lui il entrait, moi je sortais. On m’a dit que c’est un homme nouveau.
– On dirait… Le pauvre ! Il m’a émue en me racontant ses difficultés à gagner sa vie avec un dur labeur.
– Et certainement, il vous a demandé de l’argent pour ses projets.
– Oui…
– Et il vous a parlé de Nazarín.
– Exactement.
– Mais je n’arrive pas à trouver la relation entre Nazarín et les conflits pécuniaires du descendant des Urrea.
– Je lui ai promis d’étudier sa demande et de trouver une solution en accord avec vous.
– Il a dû vous demander au moins deux à trois mille réaux[2].
– Un peu plus : cinq mille douros.
– Ave Maria Puríssima !… Saint Antoine !
– Croyez bien que j’ai ri, et dès qu’il m’a parlé de cela, j’ai commencé à me sentir joyeuse. Voir quelqu’un qui a des ennuis pour une chose si peu importante que l’argent, me remplit de joie. C’est comme si je repoussais tout ce dont j’ai souffert à cause de ce maudit argent dans ces jours terribles quand j’en avais tellement besoin. Et maintenant que je ne puis l’employer à rien pour mon propre usage, puisque j’ai perdu le bien de ma vie, maintenant que gisent sous terre les restes de celui qui était mon unique amour et que je pense que son âme est au ciel, les plaintes de ceux qui demandent de l’argent avec un besoin pressant me remplissent de joie, et en voyant que je l’ai, je suis encore plus satisfaite. Je ressens, croyez-moi, comme un secret désir de vengeance… ; oui, je veux me venger de mon destin, qui m’a assujettie à tant de privations, et qui m’a fait passer par tant de chagrins… Et quand un malheureux s’approche de moi en me demandant cela même que je n’avais pu avoir quand j’en avais besoin, et que maintenant je possède que je n’en ai plus besoin…
– Vous vous vengez… en le lui refusant.
– Non, monsieur, en le lui donnant… C’est une vengeance dans laquelle je confonds mon destin et l’argent lui-même, matière vile et méprisable, dont le partage ne doit obéir à aucune règle d’ordre ni d’administration. Les lois économiques de mon frère me semblent l’une des plus infâmes inventions du genre humain.
– De sorte que vous, madame, vous croyez que, pour mépriser l’argent et le punir de sa bassesse, il faut le donner au premier plaisantin qui le demande, sans que nous sachions à quoi il va l’employer ?
– Je crois que l’emploi final de l’argent est toujours le même, qui que ce soit à qui on le donne. Où qu’il tombe, il va satisfaire des besoins. Le couple, le gaspilleur, le débauché même, le font passer dans d’autres mains qui en profitent dans ce qu’il y a à profiter. Lancez une poignée de billets dans la rue, ou remettez-les au premier vaurien qui passera, au premier voleur qui le demandera, et cet argent, de même que toutes les eaux vont vers les fleuves, et les fleuves vers la mer, ira accomplir sa mission dans la mer immense de la miséricorde humaine. De près ou de loin, ici ou là, avec cet argent que vous avez jeté dans la rue, quelqu’un va s’habiller, quelqu’un apaisera sa faim et sa soif. Le résultat final de n’importe quel don en argent est toujours le même.
– Madame, -dit don Manuel un peu abasourdi-, ne tombons pas dans les paradoxes…, ni dans les sophismes. Si vous me permettez que je vous contredise, que je vous fasse une démonstration claire de votre erreur sur cette matière…
L’homme ne parvenait pas à bien s’exprimer. Il était très contrarié, il avait chaud et il s’éventait avec son chapeau.
5
– Vous aurez beau dire –continua la comtesse-, je crois que l’aumône consiste essentiellement à donner ce que l’on a à celui qui ne l’a pas, quel qu’il soit, et quel que soit l’emploi qu’il en fera. Imaginez les applications les plus abominables que l’on puisse donner à l’argent : le jeu, la boisson, le libertinage. Il arrivera toujours que, à force de circuler, et après avoir satisfait des besoins illégitimes, il va toujours satisfaire les légitimes. Donner aux pauvres, rien qu’aux pauvres ! Outre le fait qu’on ne sait jamais qui sont les vrais pauvres, tout ce que l’on donne finit toujours par aller vers eux par un chemin ou un autre. Ce qui importe c’est l’effusion de l’âme, la piété,le fait de nous défaire d’une somme d’argent que nous avons et que les autres nous demandent.
– Et vous, vous sentez cette effusion de l’âme en donnant à votre cousin l’aide qu’il sollicite ?
– Oui, monsieur ; je la ressens, parce que je vois derrière sa demande un monde de misères écrasantes, d’horribles martyrs, dans lesquels gémissent de la même façon l’âme et le corps. Je vois le manque de nourriture, la petitesse du logement, la persécution des créanciers, la vie d’angoisses, pleine d’humiliations et de hontes cachées ; la terrible disparité entre les moyens d’existence et le nom retentissant qu’il porte dans la société. Je crois que, chez mon cousin, le désir de s’amender est réel ; mais supposons qu’il ne le soit pas, que c’est un vaurien, un débauché plein de vices, parmi lesquels se détache celui de quémander à droite et à gauche. Et que ferez-vous pour le sortir de l’enfer de cette vie ? Des sermons ? On n’obtiendra rien tant qu’on ne le mettra pas en condition de changer de conduite, et vous aurez beau vous creuser la cervelle, vous ne trouverez pas une autre manière de rédemption que de lui donner ce qu’il n’a pas, parce que sa mauvaise vie n’est que le résultat fatal, inévitable, de la pauvreté.
– D’après cela, madame –dit le prêtre avec une certaine sévérité-, vous pensez donner à José Antonio les cinq mille douros qu’il vous demande ?
– Oui, monsieur ; j’ai décidé de les lui donner, et c’est ce que je lui ai promis. Ma parole est d’or. Mais…
– Mais quoi ?
– Oh ! Il manque encore le plus important. Pour que vous voyiez que je ne manie ni le paradoxe ni le sophisme, je les donne et ne les lui donne pas.
– Vous les lui prêtez ?
– Non plus. Je les lui donne sous une forme que vous approuverez certainement. Je lui prête la somme d’argent, et celle-ci restera dans mes coffres, à la disposition de ses administrateurs.
– Qui sont …
– Vous et moi. Nous, nous allons nous charger de lui arranger une maison convenable, de lui assurer sa subsistance pendant le temps que l’on fixera, et, en plus, nous allons payer ses dettes, nous allons rompre ces chaînes infâmes qui le condamnent durant sa vie à un enfer horrible, nous allons le libérer de la honte d’avoir à taper des amis, de l’humiliation de manquer de tout. Nous complèterons notre œuvre en lui donnant les moyens de travailler à ce projet qu’il a en vue, spéculation qu’il convient d’étudier tranquillement pour voir, si en effet, elle est propre à faciliter la formation d’un homme honnête. Allons, que me dites- vous de cette façon de pratiquer la charité ? Croyez-vous qu’il y ait d’autre manière de ramener sur le bon chemin un homme plein de défauts, désaxé, endurci dans mille habitudes pernicieuses ?
– Je réponds, madame, que, en principe, j’applaudis à votre pensée. Je respecte la pratique…, je ne sais…. Dites-moi : José Antonio accepte-t-il l’aide dans la formes et les conditions que vous venez de m’indiquer ?
– Le pauvre s’est mis à pleurer. J’ai bien vu que ses larmes jaillissaient du cœur : « Tu es la Providence en personne –me disait-il-, et tu réalises le rêve de ma vie ; tu me sauves, tu me rachètes, tu fais de moi un autre homme, et grâce à toi, Halma, je peux vraiment dire que je renais. » Et en disant cela, il me baisait les mains.
– Et moi aussi, je vous baise les mains maintenant –dit don Manuel, le faisant avec un véritable attendrissement-. Vous êtes une sainte… à votre manière ; je veux dire que chaque jour vous inventez une nouvelle forme de sainteté. Je dois vous dire, en toute conscience, que dans ce genre de choses, l’originalité est en général un petit peu dangereuse ; mais jusqu’à présent, tout va bien, et que le Seigneur continue de vous inspirer ces heureuses initiatives.
– Je suis heureuse que vous approuviez mon plan –dit Catalina, excitée par les éloges-, et que vous ayez pitié de mon malheureux cousin, qui, je le vois clairement, a la tête plus gâtée que le cœur. C’est vrai que c’est le manque de sérieux en personne et qu’il est interminable quand il se met à débiter des mensonges, que, pour trouver le pain de tous les jours, il commet des bassesses. Pour cela même, parce que c’est un malade de l’âme, la médecine de charité tutélaire et éducative lui est tout à fait recommandée. Ne suis-je pas dans le vrai ?
– Oui, madame -répliquait Flórez en fermant à demi les paupières et en opinant du chef.
– La charité doit s’exercer sur toutes sortes de malades et sur toutes les classes de misérables, et ce petit Urrea est un pauvre sans le sou…, avec un blason, un malheureux dont les tourments déchirent le cœur. Il me le disait, me faisant rire et pleurer en même temps : « Ma chère cousine, le dernier des mendiants est un millionnaire comparé à moi. Il ramasse des bouts de pain et des épluchures de pommes de terre ; mais il le mange en paix, et son esprit vit avec la sérénité et la joie de l’oiseau qui, au lever du soleil, chante en saluant le jour… Même les aveugles qui marchent dans la rue en jouant de la flûte ou du violon, sont moins malheureux que moi. J’envie les vendeurs de journaux, et les portefaix et les puisatiers de la Villa[3]. Tous mangent leur ratatouille sans manger en même temps leur déshonneur, qui est amer comme le fiel. » Pauvre petit de mon coeur. Je ne peux le considérer, monsieur don Manuel, que comme un enfant roublard qu’il convient d’éduquer. Nous lui ferons tout le bien possible sans lésiner sur le martinet. Parce que ça oui, beaucoup de charité, mais beaucoup de rigueur.
– Voilà, c’est ça ; et si nous parvenons à le corriger, nous aurons fait une grande œuvre méritoire –dit en soupirant le prêtre, qui, s’il avait ressenti au début une certaine rancœur devant la belle initiative de sa disciple, n’avait pas tardé à s’approprier ses idées à elle, dans l’intention de leur donner de la vigueur et de récupérer de cette façon son magistère.
– Et personne ne m’enlèvera de la tête –continua Halma- que le cœur de Pepe est bon, et qu’il y a en lui, quoique cela ne se voie pas tellement c’est caché, matière abondante pour obtenir la vraie vertu. Enfant c’était un ange. Nous sommes du même âge, et nous avons vécu ensemblequelques temps à Zaportela ; sa mère, ma tante Rudesinta, m’aimait follement, et comme j’étais un peu chétive et souffreteuse, elle m’emmenait avec elle à la campagne pour que je me refasse. Pepe Antonio et moi passions de longues périodes comme de vrais sauvages, en courant dans les prairies et les champs, déclarant la guerre aux pauvres grillons et en mangeant, non seulement les fruits mûrs, mais verts. Eh bien, regardez : j’étais beaucoup plus espiègle que Pepe Antonio, je faisais souvent des taquineries, innocentes, ça oui, mais des taquineries, et lui pas, lui paraissait être un petit saint en herbe ; et ce n’est pas qu’il fût hypocrite, non ; il était la bonté même, la pureté, l’abnégation. Un jour, devant moi, il a enlevé sa chemise pour la donner un enfant pauvre. Il donnait tout, il n’était pas glouton, ni avare, ni envieux, comme tous les gamins. Mes fautes, il les prenait sur lui, et se laissait punir pour qu’on ne me punisse pas. Ensuite, il a pris un chemin différent du mien, ce qui fait que nous sommes restés très longtemps sans nous voir. Quand nous nous sommes à nouveau rencontrés, il était déjà un homme, et menait à Madrid une vie vertigineuse et désordonnée. Le fait d’être orphelin, la misère honteuse avaient corrompus cette belle âme, qui paraissait avoir été créée pour le bien.
– Quelle tête que la mienne, madame la comtesse ! –dit don Manuel, qui d’un geste maudissait sa mauvaise mémoire-. Parce que, n’avais-je pas oublié de vous donner la bonne nouvelle ?… Ces souvenirs infantiles de Zaportela me font me rappeler que monsieur le marquis a convenu avec moi de vous donner non pas cette propriété, mais une autre, bien mieux : le château de Pedralba, dans notyre province même. Je lui en ai tant dit, que… !
– Oh ! quel bonheur !… Mais, est-ce vrai ? Rien moins que Pedralba ? Vous avez raison, mon frère est la bonté même, et je ne sais comment le remercier de tant de bienfaits. Enfant, j’ai aussi vécu à Pedralba : vous ne pouvez vous figurer la tendresse que j’ai pour les vieilles pierres rongées du château, qui n’en a que le nom.
– Et le fait de posséder ces propriétés facilite sans doute vos projets de fondation…. N’est-ce pas cela, madame ; la comtesse ?
Doña Catalina ne répondit pas, et sa méditation silencieuse remplit à nouveau de crainte l’esprit du brave prêtre. La demande qui précède avait été formulée par Flórez dans le but d’explorer la pensée de sa noble amie, laquelle chaque jour se concentrait davantage, en jetant soudain une clarté resplendissante, qui en même temps qu’elle éblouissait le bon maître, le plongeait dans une grande confusion. Après un long silence, la comtesse reprit le dialogue , en disant :
– C’est donc décidé.
– Que…, oui…, que Pedralba peut servir de base…
– Je ne pensais pas à Pedralba. Ce que je dis c’est que vous ne vous opposez pas a ce que je voie celui que l’on appelle Nazarín.
– Ah !… oui… en effet… Eh bien oui, il n’y a pas d’inconvénient.
– Vous n’osez pas affirmer s’il est fou ou saint ?
– Pour le moins, jusqu’à présent…
– Eh bien, je veux le savoir, il me faut le savoir avec certitude.
– J’espère arriver à cette certitude simplement en le fréquentant, en analysant ses idées et en soumettant à un examen détaillé de ses actions.
– Et même si pour me convaincre votre avis me suffit, serait-il malvenu, serait-il impertinent que moi-même je le voie et lui parle, sinon pour une autre raison, pour satisfaire du moins une curiosité qui me travaille ?
– Je ne crois pas inconvenant que vous appréciez par vous-même son état cérébral –répondit le prêtre, mesurant bien les mots. Mais auparavant, il faut que moi je l’examine, que nous parlions tranquillement. Ensuite, nous déciderons dans quel endroit et à quelle occasion vous pouvez satisfaire votre curiosité.
– Parfaitement… Mais faites vite, don Manuel
– Demain même je lui rendrai visite à l’hôpital. Allons. Il est très tard, et vous allez manger, et moi je vais chez moi. Il fait nuit. Au revoir, mon amie, et reposez-vous. Donnez du repos non seulement au corps, mais aussi à la pensée, qui travaille beaucoup pour imaginer de grandes choses. Au revoir… A demain.
6
Don Manuel se retira bien emmitouflé dans sa longue cape, parce que le froid redoublait, et pensif, et un peu mécontent de lui-même, chemin faisant il se disait : « Cette doña Catalina est un véritable démon…. Quelle énormité ! Je veux dire, c’est un ange, un être extraordinaire. Cela ne fait plus aucun doute. Elle est beaucoup plus intelligente que moi, elle en sait plus que moi, et elle découvre des choses que personne ne voit et qui, si au début semblent être des absurdités, une fois examinées, possèdent toute la beauté et toute la grandeur de Dieu. Chaque jour elle trouve une chose nouvelle. Et quelles idées, mon Dieu ! Que va-t-elle me réserver pour demain ?
Il disait cela, en ressentant un tout petit peu l’humiliation du maître qui se voit transformé en élève. Mais comme il était quelqu’un de bien, et ne laissait jamais entrer dans son cœur la basse envie, et en outre, comme il estimait cordialement la comtesse, au lieu de se fâcher bêtement à cause de l’usure graduelle de son autorité, il s’appropriait les idées de sa disciple, et en les faisant siennes, il les présentait à nouveau sous une forme méthodique et systématique ; grâce à cela, il pensait apparaître à ses yeux à elle, et même à ses propres yeux, comme le véritable inspirateur, alors qu’en réalité, il était l’inspiré. Homme souple, créé pour les adaptations sociales et pour appliquer et défendre la sainte doctrine selon le milieu et les occasions dans lesquelles il avait à agir, assez sagace pour reconnaître le bien, d’où qu’il vienne, et assez pratique pour savoir en profiter, il agissait comme agissent toujours les caractères faits et construits comme lui, ne se mettant pas en face d’une force qu’ils pensent être utile, mais se laissant porter par cette force, avec assez d’habileté et de malice dans le comportement, pour qu’on ait l’impression qu’ils la dirigent et la conduisent.
Le bon prêtre entra chez lui, en pensant à la régénération d’Urrea, et puisque madame comptait sur son aide pour y parvenir, il projetait de prendre les devants dans le déroulement de cette idée, de la faire sienne, en lui ajoutant des détails qui certainement la rendrait plus efficace. Mais ce qui le déconcertait était de ne pas savoir quelles nouvelles inventions la comtesse sortirait de sa caboche inspirée, parce qu’il n’était pas impossible qu’elle ait des idées auxquelles personne ne s’attendait. Ses initiatives à lui ne réussissaient presque jamais ; les siennes arrivaient avec une telle force qu’aussitôt elles conquéraient le maître, et il n’y avait rien d’autre à faire que de les suivre, en les arrangeant avec quelques touches ça et là, après avoir conservé les prééminences extérieures du pouvoir directeur. En résumé, si au début Halma ressemblait à une reine constitutionnelle à la manière moderne, qui régnait et ne gouvernait pas, peu à peu elle prenait sa volée et visait la souveraineté absolue. Mais elle était si bonne, si raisonnable et si pieuse, qu’elle s’arrangeait adroitement pour laisser à son ministre les satisfactions et même la croyance qu’il avait l’initiative gouvernementale.
– « Bien, monsieur, bien –disait don Manuel, en s’asseyant devant son dîner, aussi frugal que bien assaisonné-. Et cette idée de rencontrer ce malheureux Nazarín, c’est en vue de quoi ? Quel motif a-t-elle, quelles idées la font-elle bouger, quels projets caresse-t-elle, et veuille Dieu que ce soit quelque chose de facile à comprendre, et encore plus facile à manier. »
A cette heure même où le très respectable Flórez dînait, pas ce jour-là mais deux ou trois jours après, Joé Antonio Urrea mangeait avec son cousin Feramor chez le duc et la duchesse de Monterones. Il est aisé de comprendre de quoi ils pouvaient bien parler, en se retrouvant tous seuls dans le salon, peu avant le repas.
– Je ne le crois pas, même si tu me le jures –lui disait le marquis, sans pouvoir contenir son rire-. Tu rêves, Pepe, ou tu veux te moquer de moi. Et tu me dis que tu t’es lancé à fixer ta demande à la fabuleuse somme de … ?
– Cinq mille douros. Et je crois même que j’ai été un peu court. Je suis entré dans la cellule mystique décidé à poser l’affaire sur la base de quatre mille…. C’est clair, les blagues ou on les fait bien ou on ne les fait pas… Et au cours de la conférence, voyant les bonnes dispositions de Halma, je me suis lancé à demander cinq mille. Succès complet. Ah ! je puis dire maintenant que ta sœur est une sainte ; mais exactement comme je le dis, une sainte !… Tout le contraire de toi, qui es le Souverain Pontife de l’égoïsme. Quelle bonté, quelle douceur, quelle pénétration, quelle intelligence subtile pour comprendre la situation dans laquelle je vis. Je soutiens qu’elle est plus intelligente que toi, et qu’elle beaucoup plus pratique, sublimement pratique. La noble indulgence avec laquelle elle me détaillait point par point mes misères, mes actes malséants, m’est allée droit au cœur, Paco, parce qu’en même temps qu’elle me grondait doucement pour ma conduite, elle l’excusait, l’attribuant plus qu’à un égarement moral, à l’inexorable despotisme du besoin, de l’habitude… Oh ! quelle femme, quelle belle et grande âme ! Crois bien qu’elle m’a fait pleurer. Parole d’honneur. Je suis arrivé à me figurer que j’étais un petit garçon, que l’on me grondait parce que j’avais fait la bêtise de casser un jouet très cher, tout en me promettant de m’en acheter un autre. Enfin, le ciel s’est ouvert devant moi, après avoir inutilement frappé à sa porte pendant si longtemps. Je suis sauvé, Paco ; ta sœur me sauve…. Je crois en la Providence, en Dieu… Je suis heureux, je vais être un autre homme, grâce à elle, à cet ange plus intelligent que que tous les Artales et Fermore de ce siècle et des siècles passés, amen.
– Eh bien, je te félicite –dit le marquis goguenard-. Tu vois comme j’ai eu raison en te l’indiquant… ? J’avais l’intuition que ma sœur dépenserait son argent dans la régénération des vauriens de la famille. Œuvre louable, sur ma foi.
-Si tu te moques, c’est tant pis pour toi.
– Je ne me moque pas. Maintenant, ce qui m’importe c’est que ton honnêteté soit à la hauteur de la vertu de Catalina, sous peine de voir que cette sainteté ne sera pas seulement inutile, mais qu’elle méritera l’asile de fous plutôt que les autels.
– Ne crains rien. En premier lieu, ils ne me donnent pas l’argent à moi, ce qui en vérité m’est indifférent. C’est mieux, c’est mieux comme cela. Ils ne me le donnent pas ; ils le consacrent à la grande et belle œuvre de soulager les malheurs du premier malheureux du monde, et de secourir la misère la plus angoissante et la plus déchirante qu’éclairent le soleil et la lune.
Après le repas, notre homme, excité par une alimentation abondante et de nombreux verres, recommença à parler avec son cousin tout en fumant, et il s’attendrit en racontant les bontés de Halma. Il couvrait d’éloges aussi don Manuel Flórez, en l’appelant père des pauvres , apôtre des gentils, lumière de la charité, et, à la fin, de fil en aiguille, au milieu des enthousiasmes de l’homme égaré, qui désire se rédimer, se manifesta le cynisme du songe-creux aventurier .
– J’ai, en outre, un autre petit projet. Voyons ce que, tu en penses. Ta cœur adorait son mari, cette pauvre moule allemande qui était venu ici pour qu’on lui donne à manger. Le souvenir de Carlos Federico est son unique passion en ce monde, et son esprit se nourrit de l’idée du défunt, telle une plante qui vit de ce qu’extraient ses racines. En parlant avec moi, elle s’est laissé aller à dire que son plus grand plaisir serait de faire ramener en Espagne le corps, qui doit être intact, de son cher époux, pour qu’elle puisse s’ensevelir avec lui, quand Dieu la rappellera à lui… Eh bien : j’ai eu l’idée de lui proposer le transfert du défunt… Allons, je lui fais un contrat pour le transport des précieuses cendres pour cinq mille douros, et je paie tous les frais, l’embarquement, le transport par chemin de fer, les douanes, de ma poche…, parce que les momies paient aussi des droits. Qu’est-ce que tu en penses ?
– Que c’est un contrat comme n’importe quel autre. Rédige ta feuille de conditions, étudie le sujet…
– On peut gagner quelques mille douros…, parole d’honneur. Je vais à Corfou, je fais l’inhumation, et je m’engage à le ramener dignement, avec une équipe de franciscains qui chanteront des répons pendant toute la traversée. Et je me charge d’assurer le cercueil, de l’emballer convenablement et de le remettre à l’endroit d’Espagne qu’elle me désignera. Je vais recevoir rubis sur l’ongle deux mille douros avant de partir pour Corfou, et trois mille lors de la remise de la sainte relique.
– Ma pauvre sœur ! –s’exclama le marquis, voyant soudain les extravagances de son cousin sous leur jour sérieux et dangereux-. Voilà ce qui lui arrive en voulant tout faire par elle-même, oubliant son incompétence. Elle va voir, elle va voir…. José Antonio, je te préviens quez si tu continues à inspirer à ma pauvre sœur je ne sais si des idioties ou des folies, il me faudra intervenir comme chef de famille.
Sans attendre sa réponse, il le laissa en train de mâchonner son cigare. Je te méprise –murmura Urrea en le voyant partir-, gros égoïste, éternel anglais de l’Humanité déshéritée, usurier… Shylock déguisé en aristocrate… »
La nouvelle de la régénération du vaurien grâce à l’argent et à la piété de Catalina n’avait pas tardé à circuler dans la réunion des Monterones, et les commentaires impitoyables qui s’étaient faits à ce propos non seulement étaient blessants non seulement pour la noble dame, mais aussi pour son respectable directeur spirituel.
– Parce que, moi, je m’explique tout –disait la duchesse- : je m’explique les faiblesses de ma pauvre sœur, qui avait perdu la tête depuis avant son mariage ; je m’explique les audaces de Pepe Antonio ; ce que je ne comprends pas, c’est que don Manuel permette de telles absurdités.
Consuelo Feramor, qui ne s’entendait pas bien avec sa belle-sœur, et blâmait sans pitié sa retraite, la qualifiant de bigoterie et d’orgueil, finit par dire à son mari :
– C’est de ta faute…, et aussi un peu celle de notre angélique don Manuel. Car si c’était vrai ce qu’on m’a dit aujourd’hui chez les Cerdañola ! Non, ce n’est pas possible…Je le raconte comme une plaisanterie. Eh bien, que Catalina a supplié Flórez de lui amener Nazarín…. Ça, ça serait trop, n’est-ce pas ? Mais que sais-je… ; je le crois, et je suis portée à le croire. À quel degré de sottise, d’extravagance, un esprit agité qui s’emballe ne peut-il arriver ?
– Laissons-la disposer de son argent comme elle en a enie –dit madame de San Salomó, moins intransigente que ses amies, sans doute parce qu’elle ne faisait pas partie de la famille-, et louons Catalina de Halma, si elle nous donne ce qu’on va lui demander. Et il ne faut différer le moment de lui taper des sous, mesdames. Il pourrait arriver que nous arrivions en retard et que nous trouvions le filon épuisé. Réunissons-nous demain, et allons toutes les trois la voir, brandissant les terribles alfanges d’or… et crac dans la poche!
Consuelo Feramor, Ignacia Monterones et la marquise de San Salomó étaient comme les présidentes, vice-présidentes ou secrétaires d’une de ces juntes de bienfaisance aristocratiques qui réunissent des fonds, soit au moyen d’aumônes, soit grâce à l’attrait de représentations théâtrales, tombolas, kermesses, pour secourir les pauvres de tel ou tel quartier, édifier des chapelles ou soigner un nombre incommensurable de victimes que les éléments déchaînés ou nos malheurs publics accumulent continuellement sur la malheureuse Espagne. Inutile de dire que toutes trois tombèrent sur la solitaire et triste veuve avec la fureur de piété qu’elles déployaient en général dans ces cas semblables. Catalina les reçut avec une courtoise prévenance et des démonstrations polies d’amitié ; mais avec la même urbanité sereine qu’elle avait employée dans ses salutations, elle leur refusa l’aide qu’elles demandaient. Catégoriquement et tout net : chacun devait s’arranger tout seul pour pratiquer la charité.
Elles s’en allèrent déconcertées, confuses, furieuses, et au paroxysme de sa colère, Consuelo dit à son mari :
– Si elle n’était pas qui elle est, et nous, qui nous sommes, je croirais volontiers que la résidence naturelle de ta soeur est un saint asile de fous.
7
Feramor les calmait, en leur faisant voir quelle impertinence révélait leur colère, car chacun est libre de faire le bien, s’il le fait, de la manière qui lui convient le mieux. Avec son esprit clair, sa facilité d’élocution, mi sérieuse, mi plaisantante, il parvint à mettre les choses au point, démontrant que si Catalina, à cause de son individualisme exagéré et la sauvage indépendance dont elle donnait chaque jour des preuves, pouvait mériter une censure, elle ne méritait par d’être rejetée, et encore moins d’être condamnée à un enfermement perpétuel dans un asile de fous. Mais si Feramor parvenait à calmer les esprits, en créant une situation de relative tolérance, très dans le goût et le style anglais, il n’en allait pas de même de don Manuel Flórez, qui, lorsque les trois dames tombèrent sur lui furibondes, lui demandant des explications sur l’incroyable conduite de la comtesse, ne savait que répondre ni comment s’en sortir : telles étaient sa confusion et son embarras. Dans les jours qui avaient suivi, elles le rendaient fou avec leurs questions, leurs commentaires et leurs questions blessantes.
– Mais, dites- moi, don Manuel : l’idée de la régénération de José Antonio, elle est venue de vous ?
– D’elle… ; pas de moi… Celle qui ne comprendra pas que c’est une idée très belle, qu’elle ne compte plus sur moi pour quoi que ce soit.
– Très belle, et surtout, très pratique.
– Nous verrons bien. Les huées qu’entendra don Manuel, si la régénération échoue, on va les entrendre jusqu’à Pékin.
– Et dites-moi encore autre chose : c’est aussi une idée à vous d’amener ici Nazarín ?
– Oui, madame ; c’est une idée à moi –dit vaillamment le bon prêtre en avalant sa salive, décidé à toujours corroborer les idées de doña Catalina, pour ne pas perdre son autorité-. Si vous ne comprenez pas la délicatesse, l’élégance, la noble finalité qu’elle renferme, tant pis pour vous.
– Eh bien, écoutez, nous ne comprenons pas, et moi je le déclare, même si vous nous considérez comme… des ignorantes. Nous sommes très primitives, mon très cher don Manuel.
– Mais, est-ce vrai qu’ils vont amener chez nous ce pauvre fou…, ou criminel…, allez donc savoir ? –dit Consuelo scandalisée.
– Oh !, moi je vote pour qu’il vienne -manifesta madame de San Salomó et la duchesse en fit autant-. Je meurs d’envie de voir le mendiant et apôtre Nazarín.
– Oui, qu’ils l’amènent. Et qu’ils nous préviennent à temps pour inviter toutes nos amies.
– Et nous verrons aussi Beatriz, la mystique de Móstoles, dont disait un journal que c’était une sorte d’Héloïse sans Abélard.
– Abélard, c’est Nazarín… Et que vienne aussi Ándara. Nous voulons voir toute la tribu . Oui, don Manuel qu’ils viennent tous.
– Comme il ne s’agit pas de satisfaire une curiosité malsaine, vous ne les verrez pas.
– Eh bien, nous nous opposons à ce qu’ils entrent dans la maison.
– Non, non. Ce que nous ferons, c’est reconnaître et proclamer l’élégance de la pensée de Catalina, si on les amène et si on nous permet de les voir et de parler avec eux. … Mais qu’on soit clair: il faut qu’Ándara vienne aussi. Ce type de polissonnerie insolente et cette témérité héroïque m’intéressent prodigieusement.
– Nous parlerons avec eux, ils nous expliqueront leur doctrine.
– Nous leur ferons un goûter.
– Bon ! Ça suffit -dit Flórez, en se fâchant-. Ils ne viendront pas. On n’a pas l’intention d’amener ici les femmes nazaristes. Lui, le malheureux prêtre mélancolique et vagabond, ne viendra pas non plus, simplement parce qu’il ne veut pas venir.
– Ah ! Tout tombe à l’eau !
– Alors, c’est Catalina qui ira les voir à l’hôpital. Cela me paraît très inconvenant.
– Cela me semble une sottise extraordinaire.
– Moins d’opinions et plus de jugeote, mesdames. Ce que moi je déciderai dans des affaires pour lesquelles je ne manque pas de compétence, au moins à cause de mon âge, sinon de mon savoir, ne doit pas être discuté et encore moins ridiculisé par mes chères amies, l’une desquelles (il le disait pour madame de Monterones) a reçu de mes mains l’eau du baptême. Donc, pour aujourd’hui, je n’en dis pas plus.
Avec cette observation, dans laquelle les trois dames remarquèrent un fort accent de sévérité et d’amertume, chose fort rare chez don Manuel, qui était tout sucre dan ses relations sociales, spécialement avec les dames, elles se retinrent, donnant à leurs critiques un ton purement amical. Quelques jours passèrent, durant lesquels Flórez n’eut pas l’occasion de sortir les disciplines ; mais quand il s’agit de mettre en place le plan de régénération du pauvre Urrea, les médisances redoublèrent. Dieu du Ciel ! Quand circula la rumeur qu’on installait une maison pour José Antonio, que doña Catalina s’occupait de ses vêtements, et que don Manuel parcourait tout Madrid en furetant pour trouver les usuriers qui dépeçaient le cousin de Feramor, il s’éleva un tumulte si imposant, que notre brave Flórez dut s’arrêter. Il admettait tout sauf que son autorité soit tournée en ridicule. Que l’on fasse des commentaires plus ou moins avisés sur ses actions, cela ne lui importait guère ; mais que ses actions soit défigurées avec méchanceté, cela ne pouvait rester impuni. Il se présenta, et qu’est-ce qu’il fit ? Il convoqua les trois dames, qui menaient l’émeute, et leur fit un sermon sur un ton très sérieux, les laissant, sinon convaincues, du moins silencieuses et avec fort peu d’envie de se mêler de la vie d’autrui. Le brave aumônier se retira chez lui, fatigué de ces luttes auxquelles l’engageait la géniale initiative de la Comtesse, brisant la facile placidité de son ministère religieux, et en entrant dans son lit, après ses prières, en mêlant la prière et la méditation profane, il se disait : » Comme ce serait mieux si cette bonne dame suivait les chemins déjà tracés et dégagés, au lieu de s’obstiner à en ouvrir de nouveaux, défrichant un chemin broussailleux. Comme cela serait mieux pour tout le monde qu’elle respecte l’ordre établi, et qu’elle se jette dans les bras de ceux qui ont parfaitement organisés les services de la charité, les comités de dames, les archiconfréries, les confréries, mes collectes pour les écoles, mes… ! Comme ce serait mieux d’embrasser l’ordre établi, Seigneur, que … ! ».
En dépit de tout, don Manuel dormait comme un bienheureux. Il n’en allait pas de même pour José Antonio, qui dans la maison juste en face (rue de Olivar) passait des nuits blanches à cause de l’exaltation de son bonheur, car l’onde de bonheur, quand elle arrive avec force, ressemble à l’onde du malheur, en ce qu’elle fait perdre le sommeil et même l’appétit. C’était une si grande nouveauté pour lui que de voir définitivement résolu le problème de se nourrir, de ne pas vivre matin et soir, en se demandant sur quelle branche se poser pour manger, que l’étonnement même de son bonheur le maintenait comme sur des charbons ardents, craignant pour son destin. Il lui semblait si invraisemblable d’être le maître de maison, c’est-à-dire, d’être en paix avec le propriétaire, de voir un début d’ordre dans les choses nécessaires pour vivre ; d’avoir dans sa salle à manger, une vaisselle modeste, mais de la vaisselle quand même, au lieu de deux ou trois plats cassés qui étaient son seul bien ; de trouver des armoires pleines de linge, que Catalina en personne avait mis là de ses mains maternelles pleines d’attention. Tout cela était comme un songe, comme un paysage fantastique des Mille et une nuits. Il craignait de se réveiller, et qu’autant de biens ne disparaissent en se frottant les yeux, le renvoyant à la si triste réalité de sa vie antérieure. Et pour comble de bonheur, il pourrait se consacrer sérieusement à un travail facile et qui lui plaisait beaucoup, la zincographie, car on allait lui préparer un local et des appareils exprès. Quel bonheur, quelle joie ! , quelle divine loterie ! Avec quelle langue, avec quels mots pourrait-il bénir sa céleste Providence, la sainte et aimante Halma.
Sa nouvelle vie écarta le parasite des endroits qu’il fréquentait ordinairement, sans qu’il cesse pour autant d’aller parfois le soir voir sa famille. Et en prenant connaissance des commentaires moqueurs qu’on faisait à propos du geste si noble de sa cousine, notre homme perdit les pédales, échangea de vives paroles avec le duc de Monterones et avec deux ou trois autres individus, dont les épouses ou les sœurs s’étaient permis de ridiculiser la comtesse, et il est certain, que si lui avait été différent, et que si les autres lui avaient accordé plus d’estime, il en serait résulté un incident. Feramor le calmait, car ses principes de bonne éducation répugnaient à cette forme violente et, jusqu’à un certain point, espagnole, de régler une affaire aussi délicate. Moins on en parlait, mieux c’était. Mais Urrea considérait le silence comme une lâche complicité avec les médisants, et voulait, au contraire, parler jusqu’à ce que les sourds l’entendent, proclamer à grands cris, non seulement l’immaculée vertu de Catalina, mais son intelligence et la supériorité de ses idées, que cette masse arrogante et corrompue ne pourrait jamais comprendre. Feramor lui dit d’un ton grave : « La forme, mon cher José Antonio, est une chose extrêmement importante dans la vie sociale, et il n’est pas possible d’en méconnaître la valeur positive sans s’exposer à des maux gravissimes. On peut tout faire, quand on le fait bien ; rien n’est faisable avec de mauvaises manières. »
Urrea se retira en maudissant son cousin, qu’il appelait l’homme en papier Bristol, et le lendemain matin, très tôt, il alla voir la comtesse, vers laquelle une attraction invincible l’entraînait corps et âme. La très vive reconnaissance se transformait en un attachement chevaleresque, en un amour fraternel et filial, car c’est ainsi qu’il faut l’appeler pour en exprimer bien la pureté, en un désir de lui être utile, et de lui rendre quelque service en rapport avec l’immensité du bien qu’il avait reçu de l’illustre dame. Mais chaque fois qu’il s’approchait d’elle, il se sentait accablé de tristesse, parce que sa conscience l’accusait d’offenses commises antérieurement à l’égard de la veuve généreuse, et ce jour-là il avait décidé fermement de décharger son cœur de ce poids, en confessant à sa bienfaitrice les péchés qu’il avait commis contre elle. Il la trouva, en train d’ourler, avec l’aide de sa servante, les draps et le linge de la salle à manger qui manquaient pour compléter le trousseau du vaurien régénéré. Prudencia se retira, et cousin et cousine eurent la conversation suivante : ce qui suit :
8
– Halma, je n’attendrai pas demain pour avoir avec toi une explication. Ma conscience me le demande, me l’exige. Grâce à toi, j’ai non seulement une maison et un lit où dormir, et des assiettes dans lesquelles manger, mais une conscience aussi. Cela m’accable : chaque fois que je viens, je me dis : « Cette fois-ci je lui dis tout. » Et chaque fois, le courage me manque. Mais pour ce qui est d’aujourd’hui, chère cousine, je lâche le morceau ou j’éclate.
– Mais, qu’est-ce que cela veut dire, José Antoio, tu as fait quelque chose de mal ?
– Non, non ; ne crains pas que je manque à ce que nous avons convenu. Ma régénération est aussi certaine que nous sommes en vie maintenant toi et moi. Il s’agit de petits péchés d’avant, sans grande gravité, je veux dire, si, ils en ont parce que c’était contre toi. N’importe quelle faute à ton encontre est gravissime. Je veux les confesser aujourd’hui… Tu vas voir….
– Mais, mon garçon, il vaut mieux que tu les racontes à un confesseur. Quant à moi, tes petits péchés sont pardonés. Encore faut-il que Dieu te les pardonne.
– Je n’ai pas d’autre pardon à chercher que le tien.
– Ça…, c’est presque, presque de l’irrévérence.
– Tu es mon confesseur, mon autel ; tu es ma sainte, ma Vierge Sainte, ma….
– Tais-toi, ne dis plus de sottises. Tu ressembles à un gamin.
– Je le suis. Tu m’as rendu à l’enfance, à l’innocence, à cet âge heureux où nous tous les deux nous vagabondions dans tous les coins perdus de Zaportela. Je suis et je veux être un enfant, et comme un enfant, à toi, qui est comme ma mère, je te confesse mes horribles péchés. Ecoute. En premier lieu…, quand ton frère m’a suggéré l’idée de demander de l’aide, je n’avais d’autre but que de te taper comme on dit, ni d’autre intention que d’employer cet argent à payer quelques dettes pressantes, peut-être à tenter fortune au jeu pour en sortir une plus grande somme. Eh bien, quand ton frère me l’a dit, je lui ai dit que tu étais folle. Tu vois quelle insolence !
– Et ce n’est que cela ? –dit Catalina en riant et en déchirant d’un coup un grand morceau de tissu, de sorte que son rire et le bruit strident de la toile se confondaient-. Eh bien, avec beaucoup d’autres abominations comme celle-ci, ton petit coin de Paradis, personne ne te l’enlèvera.
– Il y en a plus, beaucoup plus –ajouta Urrea en soupirant avec force-. J’ai dit aussi que tu étais idiote.
– Bah, bah !
– T’appeler idiote toi, qui est l’intelligence en personne… ! L’idiot, c’est lui, ton frère, avec la raideur amidonnée de son âme anglaise ; lui, incapable de rien de grand, ni même d’un geste de sensibilité…
– Oh, monsieur !…., vous êtes en train de pécher dans le confessionnal. D’un côté, vous vous s’épanchez, et de l’autre vous vous chargez charge de nouvelles fautes, en faisant des jugements téméraires.
– Eh bien, je ne dis rien de ton frère. Tu sauras aussi que j’ai pesté contre le très brave don Manuel, et que je l’ai traité d’anguille, et…
– Ha, ha !… Certainement qu’il te pardonnera s’il le sait.
– Et ensuite, un soir que j’avais mangé chez les Monterones, nous avons parlé ton frère et moi. Chaque fois que je me trouve à ses côtés, je ressens des mauvais instincts, je ne puis résister à l’envie de froisser sa belle éducation anglaise, qui ressemble au feutre bien repassé et lisse des chapeaux hauts de forme. J’aime le lui brosser à rebrousse-poil, m’exprimer avec des idées qui puissent le contrarier et le blesser. Eh bien, dans cette intention, et sans vouloir t’offenser, je lui ai dit que je pensais passer un contrat avec toi, de cinq mille douros, pour ramener en Espagne les cendres de ton cher époux, et j’ai ajouté mille et une âneries… Je te fais remarquer, à ma décharge, que j’avais bu plus que la normale… Le pire a été que je n’ai pas parlé du pauvre Carlos Federico avec le respect que mérite sa mémoire. Ma parole que non.
– Ça, c’est un petit peu plus grave –dit Halma avec sévérité les yeux fixés sur sa couture- ; mais je te pardonne aussi, puisque tu déclares que tu ne savais pas ce que tu disais, et que tu n’avais pas l’intention de m’offenser. Quoi de plus ?
– Pour l’instant, rien de plus. Cela te semble peu ? Je suis tout tranquille maintenant que je t’ai tout confessé. Et maintenant, parlons d’autres choses. Sais-tu que ta sœur et ta belle-sœur, et tout l’essaim de leurs amies te critiquent âprement parce que tu n’as pas répondu à leurs collectes comme elles s’y attendaient, et que, en outre, elles se moquent de toi et de don Manuel pour ce que vous faites pour moi ?
– Et alors ? Je ne me préoccupe pas de cela. Je leur pardonne tout ce qu’elles diront de moi, que ce soit des impertinence sans méchanceté, que ce soit de la véritable méchanceté.
– Elles ne s’arrêtent pas à la limite de la plaisanterie plus ou moins fine, mais elles la dépassent et finissent par t’offenser avec des propos calomnieux. Madame de San Salomó dit que tu es une hypocrite, et que les visites que tu m’as faites le matin pour arranger ma chambre ne relèvent pas de l’ordre de la bienfaisance à domicile.
– Tout ça pour moi –dit la veuve avec une auguste sérénité- c’est la même chose que le bruit du vent entre les tuiles du toit de la maison. .. Dieu me connaît de l’intérieur, et devant Lui j’expose ma conscience, telle qu’elle est réellement. Les jugements des hommes pour moi n’existent pas.
– Oh, je n’ai pas cette vertu ! Evidemment, comment pourrais-je avoir cette vertu qui est si difficile à obtenir, si je n’ai pas les autres très faciles à avoir ! Ce que je ressens, c’est un désir violent de vengeance quand j’entends de telles infamies. Je serais heureux si je pouvais tordre le cou à la gueuse qui pense ainsi et le dit.
– Oh, pour l’amour de Dieu, Pepe, si tu ne veux pas me blesser et perdre totalement mon estime, ne continues pas dans cette voie
– Hier soir, j’ai eu deux ou trois prises de bec chez les Monterones et les Cerdañola, parce que pour moi, il n’y a pas de plus grand plaisir que de mettre ton nom et tes actions au-dessus de tout ce qui existe au monde. Je suis capable de batailler avec quiconque ne te reconnaîtrait pas comme la vertu la plus grande et la plus pure qui existe à Madrid et dans toute l’Espagne ; et je ferais mordre la poussière à celui qui mettrais en doute ta sainteté, ton honnêteté, ta souveraine intelligence.
– Doux Jésus, tais-toi, pour l’amour de Dieu et ne dis plus de sottises, cousin ! Es-tu devenu fou ?
– Et si tu veux essayer, dis-moi qui t’a offensée dans ta dignité, dans ton honneur ou simplement dans ton amour-propre, pour l’écraser contre le sol comme un reptile, Catalina, pour le réduire en poussière…
Il disait cela debout, en gesticulant aec ardeur et emphase comme un personnage héroïque. Sa cousine, après avoir cassé le fil avec ses dents, en le regardant effrayée, le calma d’un franc et doux sourire.
– Je t’ai dit que tu étais un enfant, et maintenant tu y ressembles plus que jamais. Personne ne m’a offensée dans ma dignité ni dans mon honneur, mais même si quelqu’un m’offensait, je n’accepterais par tu joues pour moi au paladin sous cette forme criminelle et antichrétienne. Je suis sidérée de ton manque de christianisme. Mais, d’où sors-tu, malheureux ? Dans quel monde d’orgueil et d’erreurs as-tu vécu ? Mon cousin, si tu veux que je te protége et que je prenne soin de toi pour que tu sois une personne comme tout le monde, n’amènes pas ici ces bravades chevaleresques. Tuer ! Crois-tu que je puisse avoir de l’estime pour celui qui blesserait son semblable à cause d’un mot, d’une idée, et même d’un fait offensant? Non, José Antonio, avec moi, cela ne te sert à rien. Refoule ces sentiments de cruauté, de vengeance et de mépris des lois divines. Sinon, je ne t’aime pas, je ne pourrai pas t’aimer, tu ne seras jamais le bon petit garçon, dont je veux faire un homme…meilleur.
La gratitude et l’affection filiale débordait dans le cœur d’Urrea, et reconnaissant qu’Halma parlait conformément à ses sentiments chrétiens, il répliqua en exprimant sa soumission inconditionnelle à tout ce que la dame penserait ou déciderait. Il prit congé, parce que ce jour-là il devait voir et choisir des appareils pour son industrie, et demandant à sa protectrice s’il devait revenir l’après-midi, elle lui dit que non seulement elle le lui permettait, mais qu’elle lui demandait de revenir après le déjeuner.
Peu de temps après le départ d’Urrea, entra don Manuel Flórez. Celui-ci, après avoir informé la souveraine des démarches qu’il avait faites pour récupérer des notes et des factures du cousin pauvre, lui dit qu’il avait vu Nazarín ; mais qu’il ne pouvait pas encore formuler un jugement définitif sur cet homme qui ne ressemblait à personne. Il est certain que le Marquis, avec qui il avait évoqué cette affaire (cela Flórez le dit à la comtesse de la manière la plus délicate), ne trouvait pas convenable d’amener le malheureux prêtre de la Manche chez lui, parce que, comme celui-ci, à cette époque, était l’objet d’enquêtes d’informations par les journalistes de la Presse, si jamais ceux-ci apprenaient qu’on l’avait conduit chez les Feramor, ils en feraient un scandale, ce qui ne lui plaisait pas du tout. Par respect pour sa maison, par respect même pour l’apôtre vagabond, qu’il savait aussi respecter, il n’était pas pertinent, il n’était pas correct, il n’était pas opportun…, parce que…
– Mon frère a raison –dit Halma, devançant le conseil de son chancelier-. Ce n’est pas le moment, tant que le tumulte du public ne se sera pas calmé. Renoncez, donc, pour l’instant…
– Non, je n’ai pas renoncé –répliqua don Manuel, voulant faire remarquer son initiative.
Et sans ajouter quoique ce soit, il se retira. Après la tombée de la nuit, alors que la veuve finissait son repas, José Antonio entra, et poussé par une impatience nerveuse, il n’attendit pas longtemps pour lui dire :
– Je suis furieux, ma chère cousine. Sais-tu qu’en bas ils font des tas de supputations et se permettent des insinuations ridiculement méchantes… ? Devine pourquoi ? Ils disent qu’un soir tu es sortie avec ta bonne vers neuf heures, et que tu n’est revenue que très tard. Elles sont folles. C’est quand même un monde que tu ne puisses sortir ni entrer quand tu en as envie. Et puisqu’à cette heure-là, il n’y ni neuvaines, ni sermon, ni Quarante Heures, que ce n’est pas l’heure de la promenade, et que tu ne fréquentes pas les théâtres, voilà trois dames de haute naissance en train de se creuser la cervelle pour savoir où peut aller une dame vertueuse entre neuf et dix heures du soir, qui ne soit ni l’église, ni la promenade ni le théâtre.
– Laisse-les dire ce qu’elles veulent. Grâce à cela, elles s’amusent les pauvres. Au milieu de leur frivolité et du bruit qui les entoure, elles s’ennuient tellement !… Eh bien oui, hier soir nous sommes sorties. Sais-tu à quelle heure nous sommes revenues ? Onze heures avaient sonné.
Et se tournant vers sa bonne qui ramassait la couture, elle dit :
– Prudencia, ne ramasse rien. Ce soir tu restes ici à coudre. Mon cousin m’accompagnera.
– Tu sors aussi cette nuit ? –lui demanda monsieur de Urrea, stupéfait.
– Oui, et je t’emmène comme chaperon, en cas de mauvaise rencontre. Pourquoi fais-tu cette tête ? Prudencia, mon manteau, ma mantille.
En un instant, elle fut prête à sortir. Prenant un paquet de vêtements, bien enveloppé dans un grand fichu attaché avec des épingles, elle le remit à son cousin, et sans qu’elle lui prenne le bras, ils descendirent et sortirent dans la rue. À l’exception du concierge, personne ne les avait vus sortir.
– Bien que ce ne soit pas très loin –dit Catalina en se dirigeant vers Puerta Cerrada-, comme le sol est mauvais, nous allons prendre une voiture, si tu es d’accord.
Ils firent ainsi et la comtesse donna l’adresse : San Blas, numéro 3.
– Sais-tu qui j’ai vu quand nous passions devant San Justo ? –lui dit Urrea, ausitôt que le fiacre eût démarré. Eh bien Perico Morla. Sans doute il allait chez toi. Il s’est arrêté pour nous regarder. Il va aller tout raconter à Consuelo.
– Laisse-le raconter toutes les histoires qu’il voudra.
– Et certainement il nous a suivi aux aguets jusqu’à Puerta Cerrada, et nous a vus entrer dans le fiacre. Tu vas voir comme il va vite donner la nouvelle, qui sera la nouveauté de ce soir.
– Bien. Ça a une importance pour toi ?
– Pour moi ? Absolument pas. Parole.
– Eh bien, pour moi non plus.
– Ce qui m’a le plus ennuyé, en voyant Morla, et qui m’a laissé un goût amer dans la bouche, c’est que… Tu veux que je te le dises ?
– Mais si, voyons, dis-le moi.
– Eh bien, que je lui dois douze douros. J’avais déjà oublié….
– Ah ! Eh bien, rappelle-le moi demain pour qu’on les lui envoie, c’est-à-dire, pour que toi tu les lui envoies.
Ils ne tardèrent pas à arriver au terme de leur voyage, qui était une maison d’apparence assez quelconque, avec un portail étroit et une cage d’escalier sale, chancelante et bruyante. Depuis les paliers, on voyait une cour avec des galeries, et sur celles-ci, en haut et en bas, une multitude de portes ouvertes, desquelles venait un bruit de voix, une clarté et un relent de pétrole, des odeurs de dîners de pauvres. Catalina et son accompagnateur montèrent au troisième étage, et au moment où ils s’approchaient de la porte, Urrea lança une exclamation en disant :
– Ah ! Maintenant je sais où nous allons, ma cousine. Dès le moment où nous sommes entrés, j’ai eu l’impression de reconnaître la maison. Mais je ne trouvais pas. Quelle confusion ! Je n’arrivais pas à trouver. Maintenant, maintenant, je sais. Parce que je me suis trouvé ici la semaine dernière avec les journalistes. Ici vit Beatriz, la disciple de Nazarín.
– C’est bien cela. Frappe à la porte.
[1] Voir note : un douro = cinq pesetas.
[2] Une peseta égale quatre réaux et un douro vaut cinq pesetas..
[3] La « Villa » –une ville avec des franchises- est toujours Madrid.




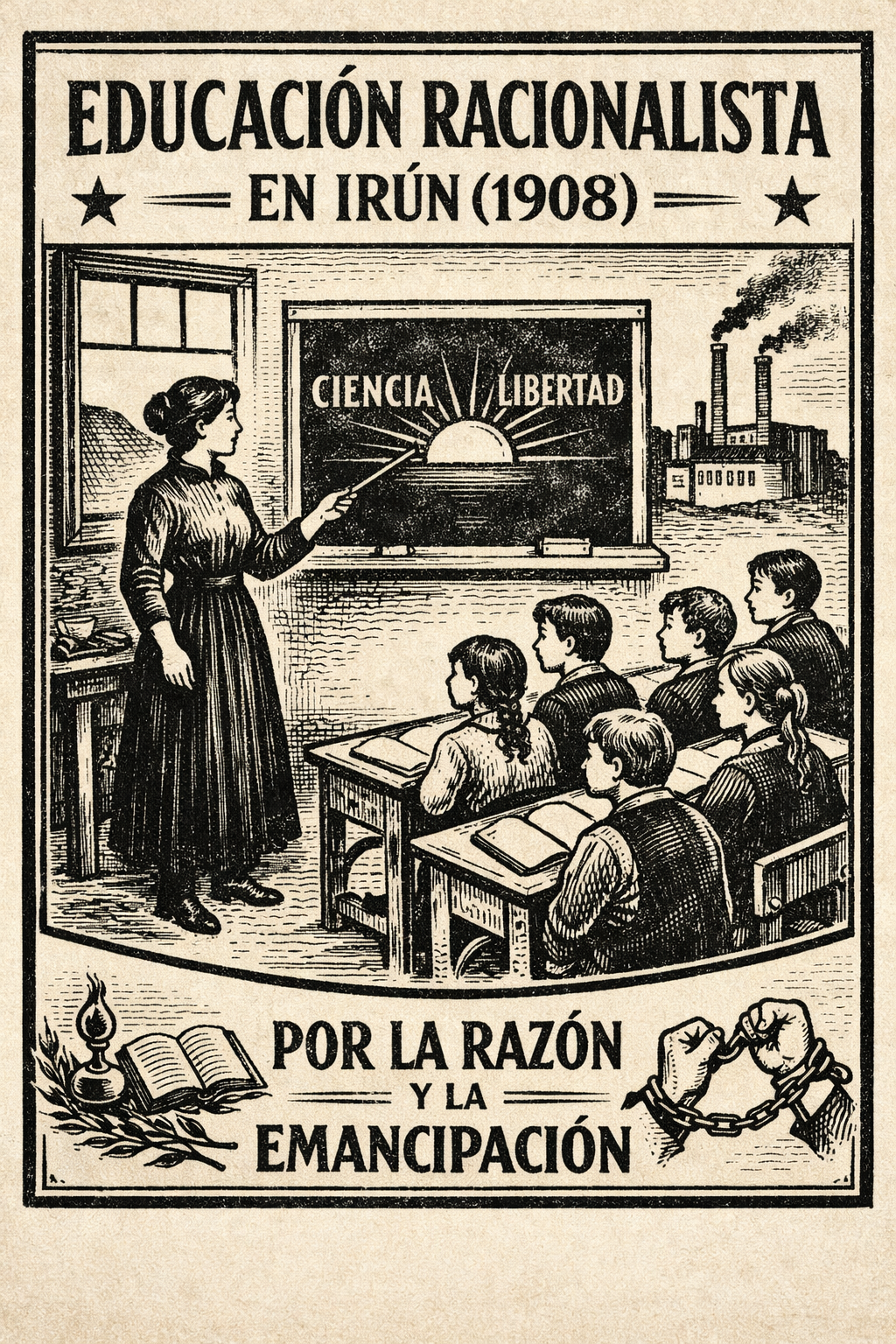











https://t.me/s/Top_BestCasino/10
I am not rattling great with English but I come up this very easy to interpret.
I was curious if you ever considered changing the structure of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two pictures. Maybe you could space it out better?
Good web site! I truly love how it is simple on my eyes and the data are well written. I am wondering how I could be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your RSS which must do the trick! Have a great day!
I truly appreciate this post. I’ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thanks again!