No hay productos en el carrito.

Traduction de Daniel Gautier
-I –
En mars 1808,[1] quatre mois après avoir commencé à travailler comme compositeur d’imprimerie, j’avais déjà assez d’habileté et je gagnais trois réaux pour cent lignes au Diario de Madrid. Je ne trouvais pas mon application au travail bien récompensée ni un grand avenir dans la carrière de typographe, car même si tout consiste au maniement des lettres, c’est plus abrutissant qu’instructif. Aussi, sans laisser mon travail, ni relâcher mon application, je cherchais en pensée des horizons plus lointains et une ambiance plus honorable que cette imprimerie réduite, sombre et suffocante.
Ce métier qui, comme ma vie, était si triste et monotone à ses débuts, rend l’intelligence esclave sans l’enrichir ; mais après avoir acquis une certaine pratique dans ces si fastidieuses manipulations, mon esprit apprit à rester libre, tandis que de mes doigts les vingt-cinq lettres s’échappaient pour passer de la caisse au moule. J’avais besoin de cette liberté pour supporter avec patience l’esclavage du sous-sol où nous travaillions, la fatigue de la composition et l’impertinence de notre régent, un cyclope noir et taché de suie, plus fait pour une forge que pour une imprimerie.
Je dois m’expliquer mieux. Je pensais à Inès, l’orpheline, et toutes les structures de ma vie spirituelle décrivaient de grandes orbites autour de l’image de ma discrète amie, comme les mondes subalternes qui tournent sans cesse autour de l’astre, base du système. Quand mes compagnons de travail parlaient de leurs amours et de leurs traficotages, moi, ayant besoin de parler avec quelqu’un, je leur racontais tout sans me faire prier et je leur disais :
- Mon amie est à Aranjuez avec son révérend oncle, le père don Celestino Santos del Malvar, un des meilleurs latinistes qu’on n’ait jamais vus. La malheureuse Inès est orpheline et pauvre ; mais elle n’en sera pas moins ma femme, avec l’aide de Dieu, qui rend grandes les petites choses. Elle a seize ans, c’est-à-dire un an de moins que moi ; elle est si jolie que son visage fait mourir de honte les roses du Site Royal. Mais, messieurs, sa beauté n’est rien en regard de son talent. Inès est un ahurissement, un prodige ; Inès vaut plus que tous les sages sans qu’on lui ait jamais rien enseigné. Elle sort tout de sa tête et elle a appris cela il y a des centaines de milliers d’années.
Quand je ne faisais pas ses éloges, je conversais avec elle mentalement. Pendant ce temps, les lettres passaient par mes doigts, de la muette matière brute à l’éloquent langage écrit. Quelle animation dans cette masse chaotique ! Dans la caisse, chaque signe semblait représenter les éléments de la création, jetés ici et là, avant de commencer la grande œuvre. Je les mettais en mouvement et, de ces morceaux de plomb surgissaient des syllabes, des mots, des idées, des jugements, des phrases, des propositions, des périodes, des paragraphes, des chapitres, des discours, la parole humaine en toute sa majesté ; ensuite, quand le moule avait rempli son rôle mécanique, mes doigts le décomposaient, distribuant les lettres ; chacune retournait dans sa case, comme les substances chimiques qui restent après les avoir séparés ; les caractères perdaient leur sens, c’est-à-dire leur âme, redevenant du plomb pur, et retombaient muets et insignifiants dans la caisse.
Ces pensées et ce mécanisme toutes les heures, tous les jours, semaine après semaine, mois après mois ! Il est vrai que les joies, l’ineffable plaisir du dimanche compensaient toutes les tristesses et angoissantes méditations des autres jours. Ah ! Permettez à ma vieillesse de s’extasier à ces souvenirs ; permettez à ce nuage noir de s’ensoleiller et de s’illuminer, traversé par un rayon. Le samedi était pour moi d’une beauté incomparable ; sa lumière me semblait plus claire, son environnement plus pur ; et qui donc pouvait douter que les visages des gens étaient plus joyeux et l’aspect de la ville plus joyeux aussi ?
Mais la joie n’existait que dans mon cœur. Le samedi est le précurseur du dimanche et, vers midi, mes préparatifs de voyage commençaient, ce voyage vers le ciel, que mon imagination renouvelle aujourd’hui, soixante-cinq ans après. Je me revois encore contacter les transporteurs de la rue Angosta de San Bernardo sur les conditions de voyage ; je finis par tomber d’accord et je ne peux m’empêcher de disserter un bon moment sur les probabilités d’avoir une belle nuit pour l’expédition. Aussitôt, je me lave, une, deux, trois, quatre fois jusqu’à faire disparaître de mon visage et de mes mains les dernières traces de cette encre horrible, et je me promène dans Madrid attendant que la nuit arrive. Je dors un peu ; si l’inquiétude n’est pas trop forte et, quand les douze coups retentissent au clocher de Buen Suceso, les douze coups les plus joyeux qui aient jamais résonné dans mon cerveau, je revêts à toute vitesse mon costume neuf ; je cours auprès de ces bons muletiers, qui sont sans conteste les meilleurs hommes de la terre, je monte sur le chariot et me voilà parti.
Avec une attention versatile, j’observe tous les accidents du chemin et mes questions fatiguent et fâchent les conducteurs. Nous passons le pont de Tolède, nous laissons à notre droite les chemins de Carabanchel et de Tolède, le péage de Delicias, la petite auberge de León ; les gargotes de Villaverde restent derrière nous ; nous laissons à droite les chemins de Getafe et de Parla, puis dans l’auberge de Pinto, l’attelage se repose un peu. Valdemoro nous voit passer dans son auguste enceinte, et la maison des Postes d’Espartinas offre un nouveau repos à nos mules paresseuses. Enfin, le petit matin nous surprend dans la côte de la Reina, d’où l’on voit l’immense étendue de la vallée, là où se rejoignent le Tage et le Jarama ; nous traversons le fameux grand pont, nous entrons un peu plus tard dans la grand-rue, et enfin, nous mettons le pied sur la place du Site Royal.
Mes yeux cherchent parmi les arbres et au-dessus des toits la modeste tour de l’église. J’y cours. Monsieur don Celestino est à la messe, c’est jour festif, donc la messe est chantée. De la porte, j’entends la voix de l’oncle d’Inès, qui proclame le Gloria in excelsis Deo. Moi aussi, je chante gloria à voix basse et j’entre dans l’église. Une joie solennelle et grave, qui donne une idée de la félicité éternelle, emplit ce temple et se reflète en mon cœur comme dans un miroir. Les vitres incolores permettent à la lumière d’entrer et de se répandre sur la voûte nue, sans autre peinture que le plâtre mat. Le grand autel est tout en or, les saints et les retables sont tout poussiéreux ; à l’autel, le saint homme se tourne vers le peuple et ouvre les bras ; ensuite il termine et dedans sonnent les clochettes et les cloches dehors ; tous s’agenouillent, se frappant la poitrine comme des pécheurs. L’office avance et finit ; pendant ce temps, j’ai regardé sans cesse les groupes de femmes assises par terre et de dos par rapport à moi ; parmi ces centaines de mantilles noires, je distingue celle qui couvre la magnifique tête d’Inès. Je la reconnaîtrais entre mille.
Inès se lève tout à la fin et ses yeux me cherchent parmi les hommes comme les miens la cherchent parmi les femmes. Elle finit par me voir, nous nous voyons ; mais nous ne nous disons pas un mot. Je lui offre de l’eau bénite et nous sortons. Nos premiers mots en nous voyant réunis devraient sans doute être impétueux et véhéments ; mais nous ne disons rien qui ne soit insignifiant. Nous rions de tout.
La maison est adossée à l’église, nous y entrons en nous tenant par la main. Il y a une cour avec une large galerie aux gros piliers. Une vieille treille y agrippe ses bras noirs, âpres et ligneux, près d’un jasmin qui attend le printemps pour jeter au monde ses mille fleurs. Nous montons et là, don Celestino nous reçoit. Son corps n’est plus revêtu de la soutane vert foncé d’autrefois, mais d’une autre resplendissante. Nous mangeons ensemble puis, tous les trois, Inès et moi devant, lui derrière, appuyé sur son bâton, nous allons nous promener dans le jardin du Prince, s’il fait beau temps et si les sols sont secs. Inès et moi, nous bavardons par les yeux ou par les mots ; mais je ne veux pas rapporter maintenant nos poèmes. A chaque instant, le père Celestino nous dit de ne pas marcher si vite car il ne peut nous suivre, et nous, qui voudrions voler, nous marquons le pas. Enfin, nous nous assoyons au bord de la rivière, là où le Tage et le Jarama se rencontrent par hasard, quand sûrement l’un ignorait l’existence de l’autre, s’embrassent et se confondent en un seul courant et, de leurs deux vies, n’en font plus qu’une. C’est exactement notre image, c’est ce qui nous arrive, à Inès et à moi.
Le jour tire à sa fin car même si nos cœurs croient le contraire, il n’y a aucune raison pour que soit altéré le système planétaire, en donnant à ce jour plus d’heures qu’il ne faut. Le soir tombe, le crépuscule, la nuit et je dois prendre congé pour retourner à ma galère ; je suis pensif, je dis mille bêtises et parfois j’ai l’impression d’être heureux et parfois d’être triste.
Je reviens à Madrid par le même chemin, et je retrouve mon auberge. C’est lundi, jour au visage antipathique, jour de somnolence, jour de malaise, de paresse et d’ennui ; mais il me faut revenir au travail et la caisse m’offre ses lettres de plomb qui n’attendent que mes doigts pour se rassembler et parler ; mais ma main ne connaît au tout début que quatre de ces signes noirs qui se joignent pour ne former qu’un seul nom : Inès.
Je sens une tape sur l’épaule : c’est le cyclope ou régent qui me traite de fainéant, il pose devant moi un bout de papier manuscrit que je dois composer tout de suite. C’est une de ces annonces intéressantes et émouvantes du Diario de Madrid qui dit ceci : «On cherche un jeune homme de dix-sept ou dix-huit ans qui sache compter, raser, coiffer un peu, les hommes seulement, et cuisiner au besoin. Celui qui remplirait ces conditions et de bonnes informations en plus, peut se présenter à la rue la Sal, au numéro 5, face aux marchands de peignes, place du marchand de laine et de tissu de don Mauro Requejo, où on discutera salaire et autre.»
En lisant le nom du boutiquier, un souvenir me vient en mémoire : don Mauro Requejo, dis-je. J’ai entendu ce nom quelque part.
– II –
J’ai rappelé des jours heureux, il me faut maintenant raconter ce qui m’arriva durant l’un de ces voyages. N’oubliez pas que j’ai commencé mon récit en mars 1808 et que j’avais déjà honoré le Site Royal de dix ou douze visites. Le jour dont je parle, j’arrivai à la fin de la messe et, du porche de la maison, un son harmonieux de flûte m’annonça que don Celestino était aussi heureux que d’habitude, signe que rien de désagréable n’était arrivé dans cette modeste famille. Inès vint à ma rencontre, et une fois terminées les salutations, elle me dit :
- L’oncle Celestino a reçu une lettre de Madrid qui l’a rendu très heureux.
- De qui ? demandai-je.
- Monsieur ne me l’a pas dit, je n’en connais pas non plus le contenu mais il est tout content… il dit que la lettre m’apporte de bonnes nouvelles.
- C’est bizarre, ajoutai-je, interloqué. Qui peut bien écrire de Madrid des lettres pour toi, t’apportant de bonnes nouvelles ?
- Je ne sais pas ; mais nous allons vite élucider l’affaire, répondit Inès. L’oncle m’a dit : «Quand Gabriel viendra, nous prendrons place à table et je vous ferai le récit de ce que dit la lettre. C’est une chose qui nous intéresse tous les trois : toi d’abord, parce que tu es la première intéressée, moi ensuite, parce que je suis ton oncle, et lui parce qu’il va être ton fiancé dès qu’il en aura l’âge.»
Nous ne parlâmes plus du sujet et j’entrai dans la chambre du brave prêtre et humaniste. Un lit couvert d’un dessus-de-lit blanc avec des dessins de branches vertes occupait la première place dans ce local réduit. Une table de pin, deux ou trois chaises pour aider à la symétrie, remplissaient le reste, il restait même un peu d’espace pour une commode baroque, rapiécée ici et là de quelques plaques de bois ou de métal. Pour compléter ce bien modeste mobilier, un crucifix et une vierge couverte de velours et percée d’épées et d’éclairs, chacune des deux statues avait un rameau de chêne ou d’olivier fixé dans plusieurs petits trous creusés dans le socle pour cela. Les livres, très nombreux, placés en ordre d’arrivée, ne couvraient qu’une moitié de la table et de la commode, laissant un vide pour des documents musicaux et des papiers sur lesquels le brave prêtre griffonnait des vers latins. De la fenêtre, on voyait un jardin assez bien tenu, et au loin, le haut sommet des fameux grands ormes qui garnissent comme de gigantesques sentinelles toutes les avenues du Site Royal. Tel était le logement du père Celestino.
Nous nous assîmes tous les trois et l’oncle d’Inès me dit :
- Mon petit Gabriel, je dois te lire une poésie latine que j’ai composée en l’honneur de notre sérénissime monsieur le Prince de la Paix, mon compatriote, mon ami et je crois même un peu parent. Il m’a bien fallu une semaine de travail ; c’est que composer des vers latins n’est pas aussi simple que d’ingurgiter des beignets. Tu vas voir, je vais te la lire, car même si tu n’es pas homme de lettre, qui sait… tu as un don magnifique pour comprendre les choses… Ensuite, je pense l’envoyer à Sánchez Barbero, le premier des poètes espagnols depuis que la poésie existe en Espagne ; et ne me parlez pas de fray Luis de León, de Rioja, d’Herrera, ni de tous ceux qui ont composé en espagnol. Des broutilles et des jeux d’enfants. Un vers latin de Sánchez Barbero vaut plus que tout ce jargon d’épîtres, sonnets, silves, églogues, chansons qui étourdissent le peuple ignorant… Mais, revenons à ce que l’on disait, et avant que ce phénix des génies modernes l’examine, je veux te la lire pour voir ce que tu en penses.
- Mais, monsieur don Celestino, je n’y connais rien au latin, sauf Dominus vobiscum et bobilis bobilis.
- Ce n’est pas grave. Ce sont justement les profanes qui apprécient le mieux l’harmonie, le ronflant, le vrai parler avec lequel il faut que les vers soient écrits, dit le prêtre d’un ton sans réplique.
Inès m’adressa un regard par lequel elle me recommandait, vu son habituelle sagesse, l’abnégation et la patience de supporter le prochain impertinent. Nous prêtâmes attention tous les deux et don Celestino nous lut quelque quatre cents vers, qui m’arrivaient aux oreilles comme des modulations absurdes. Lui paraissait satisfait et à chaque instant, il interrompait sa lecture pour nous dire :
- Qu’est-ce que vous pensez de ce petit passage ? Inès, on appelle cette figure une litote, et cette suite de mots qui imitent le bruit de la mer tempétueuse de la nation que sillonne le navire de l’Etat, habilement dirigé par le timonier que je connais, s’appelle une onomatopée, cette figure entre toujours avec une autre qui est l’allégorie.
C’est ainsi qu’il nous lut toute sa composition, vous imaginez ce que l’on pouvait comprendre… J’ai encore en ma possession l’œuvre de notre ami. Cela commence ainsi :
Te, Godoie, canam pacis : tua munera caelo
Inserere aegrediar: per te Pax alma biformem
Vincla recusantem conduxit carcere Janum.
Inès et moi, nous dûmes nous payer quatre cents vers dans ce style ; il faut dire qu’elle était attentive à la lecture de façon si sérieuse qu’on aurait dit qu’elle comprenait, et même dans les passages les plus tonitruants, elle faisait des signes d’acquiescement élogieux pour contenter le pauvre vieillard : telle était sa délicatesse !
- Puisque cela vous a beaucoup plu, mes enfants, dit don Celestino en ramassant son manuscrit, un autre jour, je vous lirai une partie du poème. Je le laisse pour une autre occasion, voilà comment on partage le plaisir sur plusieurs jours, évitant l’indigestion que produit la succession de plats trop sucrés et appétissants.
- Et pensez-vous la lire aussi au Prince de la Paix ?
- Mais pourquoi l’aurais-je écrit ? Son Altesse sérénissime adore les vers latins… parce que c’est un grand latiniste et je pense lui en donner une bonne partie un de ces jours. Mais, à propos, que dit-on à Madrid ? Ici, les gens paraissent assez inquiets. C’est la même chose là-bas ?
- Là-bas, on ne sait pas quoi penser. Rendez-vous compte, il y a de quoi. On craint les Français qui entrent en Espagne à qui mieux mieux. On dit que le Roi n’a pas donné sa permission pour que tant de gens entrent mais il semble que Napoléon se moque de la Cour d’Espagne et ne tient aucun compte des accords passés.
- Ce sont des gens de peu, à courte vue, ceux qui disent cela, répondit don Celestino. Godoy et Bonaparte savent bien ce qu’ils font. Ici, tout le monde veut en savoir autant que ceux qui gouvernent, de sorte qu’on entend dire des bêtises…
- Pour ce qui est du Portugal, le résultat est très différent de ce que l’on croyait. Un général français s’est présenté là-bas et quand la famille royale est partie pour l’Amérique, il a dit : «Ici, le seul à commander c’est l’Empereur, et moi, je commande en son nom ; par ici les quatre cent millions de réaux, par ici, les biens des nobles qui sont partis au Brésil avec la famille royale.»
- Ne jugeons pas sur les apparences, dit don Celestino ; Dieu doit bien savoir ce qu’il en est.
- En Espagne, on va faire pareil, ajoutai-je ; et comme les Souverains ont peur, le Prince de la Paix est si décontenancé qu’il ne sait plus quoi faire…
- Que dis-tu, petit sot ? Comment peux-tu avoir si peu de respect envers ce miroir des diplomates, cette crème des ministres ? Il ne sait pas ce qu’il fait ?
- Je maintiens ce que j’ai dit. Napoléon les trompe tous. A Madrid, il y en a beaucoup qui se réjouissent de voir entrer tant de troupes françaises parce qu’ils croient qu’elles viennent mettre le prince Fernando sur le trône. Quelle bande d’imbéciles !
- Des sots, des idiots, des imbéciles, s’écria, avec colère, le père Celestino.
- On verra bien ce qui se passera. S’ils viennent avec de nobles intentions, pourquoi s’emparent-ils par surprise des principales places et forteresses ? Ils sont d’abord entrés à Pampelune en trompant la garnison ; ensuite, ils se sont faufilés dans Barcelone là où il y a un grand château qu’on appelle Montjuich. Ensuite, ils sont allés à un autre château à Figueras, il n’est pas moins grand, c’est le plus grand du monde d’après Pacorro Chinitas, ils l’ont pris aussi, et enfin, ils sont entrés à Saint-Sébastien. On dira ce qu’on voudra, mais ces hommes ne viennent pas en amis. L’armée espagnole enrage ; surtout, il faut entendre les officiers qui reviennent du nord et qui ont vu les Français sur les places fortes… je vous le dis, ils sont furieux. Le Gouvernement du Roi Carlos IV est mort de peur, et tout le monde sait la bêtise qu’il a faite en laissant entrer les Français ; mais il n’y a plus rien à faire… Vous savez ce qui se dit à Madrid ?
- Quoi, mon garçon ? Sans doute ce genre d’aberrations vulgaires propres à des cervelles fatiguées. Je l’ai déjà dit : nous ne comprenons rien aux affaires d’Etat ; pourquoi commenter les combinaisons et les plans de ces hommes éminents qui se tuent à nous rendre heureux ?
- Eh bien, là-bas, on dit que la famille royale d’Espagne, se voyant prise dans les filets de Bonaparte, a décidé de partir en Amérique, et qu’elle ne va pas tarder à sortir d’Aranjuez pour rejoindre Cadix. Evidemment, les partisans du prince Fernando se réjouissent, ils pensent que cela tombe à pic pour que l’autre monte sur le trône.
- Des niais, des imbéciles, s’écria l’oncle d’Inès, s’énervant à nouveau. Dire que monsieur le Prince de la Paix consentirait à cela, lui, mon compatriote, mon ami et je crois même un peu parent !… Mais ne nous fâchons pas hors de propos, Gabriel, et sur des sujets sur lesquels nous ne pouvons rien. Allons manger, c’est l’heure et le corps le demande.
Inès, qui s’était retirée un moment avant, revint nous dire que le repas était prêt. C’est à ce moment-là que le respectable prêtre nous communiqua le contenu de la mystérieuse lettre, arrivée à la maison, le matin.
- Mes chers enfants, dit-il, après avoir pris place tous les trois. Je vais vous partager un événement heureux, et toi, ma petite Inès, réjouis-toi. La fortune entre par la porte et tu vas voir comment Dieu n’abandonne jamais les petits et les nécessiteux. Tu sais bien que ta bonne mère, Dieu ait son âme, avait un cousin appelé don Mauro Requejo, commerçant en toiles, dont la place, si je ne m’abuse, doit être vers la rue Postas, au coin de la rue de la Sal.
- Don Mauro Requejo… dis-je, me souvenant, justement. Doña Juana l’a nommé devant moi plusieurs fois à Madrid, et maintenant, je comprends que ce commerçant met dans le Diario des annonces qui me donnent pas mal de travail.
- Je m’en souviens, dit Inès. Lui et sa sœur étaient les uniques parents que ma mère avait à Madrid. Il est sûr qu’il s’est toujours refusé à nous aider, même quand nous étions dans le besoin : deux fois, je l’ai vu à la maison. Pensez-vous qu’il était venu pour nous consoler ou nous aider ? Non ! c’était pour que ma mère lui fasse quelques pièces de vêtements et après avoir marchandé, il n’a payé que la moitié du prix convenu, il disait : «En famille, on peut bien se rendre service.» Lui et sa sœur ne parlaient que de leur honnêteté ou de tout ce qui marchait bien dans leur boutique et ils nous reprochaient notre pauvreté, nous interdisant d’aller chez eux, alors que nous étions en grandes difficultés.
- Eh bien, dis-je, en colère, ce don Mauro et madame sa sœur ne sont que de grands voyous.
- Doucement, continua le prêtre. Laissez-moi terminer. Le cousin de ta mère a peut-être fauté ; mais pour ce qui est d’aujourd’hui, sans aucun doute, Dieu lui a touché le cœur et il est disposé à racheter ses errements, en t’accordant ses faveurs en bon parent et homme charitable. Tu sais qu’il est assez riche, grâce à son travail et son sens de l’économie. Eh bien ! dans la lettre que j’ai reçue ce matin, il me dit qu’il veut te recueillir chez lui pour te protéger, tu seras comme une reine, il ne te manquera rien, pas même ce qui plaît tant aux demoiselles d’aujourd’hui, comme les bijoux, les jolis vêtements, les parfums exquis, les gants et autres broutilles. Enfin, Dieu s’est souvenu de toi, ma chère nièce. Ah ! si tu voyais l’intérêt qu’il montre envers toi dans ses lettres ; il fait les éloges les plus chaleureux de tes mérites, si tu voyais comment il te porte aux nues, il regrette que tu sois orpheline, il s’attendrit et dit que tu es du même sang que lui et que malgré une naturelle suprématie, il a lui, ce qui te manque à toi ! Je répète qu’en travaillant beaucoup et en économisant encore plus, monsieur Requejo est devenu très riche. Quel avenir t’attend, ma petite Inès ! Le paragraphe le plus émouvant de la lettre de ton oncle et de ta tante, ajouta-t-il en la sortant, est celui-ci : «A qui devons-nous laisser ce que nous avons sinon à notre chère nièce ?»
Inès, troublée devant un changement si inattendu dans les sentiments et la conduite de cette famille auparavant si cruelle, ne savait quoi penser. Elle me regarda, cherchant sans doute dans mes yeux quelque chose qui l’éclaire sur une transformation si inexplicable ; mais moi, qui croyais comprendre un peu, je me suis bien gardé de le laisser transparaître par des mots ou des attitudes.
- Je suis étonnée, dit la jeune fille ; forcément pour que mon oncle et ma tante m’aiment à ce point, il doit y avoir un motif que nous ne comprenons pas.
- Il n’y a rien, sinon que Dieu leur a ouvert les yeux, dit don Celestino, solide dans son optimisme naïf. Pourquoi penser à mal ? Don Mauro est un homme d’honneur ; il a peut-être ses petits défauts ; mais que valent ces légers nuages de l’âme, s’il est illuminé par les splendeurs de la charité ?
Inès, en me regardant, semblait me dire :
- Qu’est-ce que tu en penses ?
Quelques mois avant cet événement, j’aurais accueilli les propositions de don Mauro Requejo avec l’optimisme imprévoyant, avec l’enthousiasme naïf qui jaillissaient de mon cœur juvénile devant les nouveaux éléments inattendus ; mais les contrariétés m’avaient donné un peu d’expérience ; je connaissais maintenant les rudiments de la science du cœur et le mien commençait à trouver ce trésor de méfiances, grâce auxquelles nous mesurons les dangereuses avancées de la vie. Je répondis donc simplement :
- Puisque ce révérend oncle était avant un voyou, je ne sais pas comment on peut le prendre pour un saint maintenant.
- Tu es un enfant sans expérience, me dit don Celestino, un peu fâché, je ne devrais pas te consulter là-dessus. Je sais bien, moi, distinguer le vrai du faux ! Et surtout, Inès, s’il veut t’accorder une faveur, en te mettant en lien avec des gens d’importance, si lui veut dépenser ses économies pour sa chère nièce, pourquoi ne pas accepter ? Je pourrais t’en dire beaucoup plus ; mais lui-même t’expliquera mieux la grande affection qu’il a.
- Mais, quoi ? demanda Inès, troublée, il va venir à Aranjuez ?
- Oui, ma petite, répliqua le prêtre. Je te réservais cette nouvelle en dernier. Dimanche prochain, tu vas avoir le plaisir de voir ici ton oncle bien aimé, ton protecteur. Ah ! Inès ! Je vais beaucoup regretter de me séparer de toi ; mais savoir que tu es heureuse, savoir que tu jouis de mille commodités que moi, je ne peux te donner, sera pour moi une consolation. Et quand ce vieil incapable ira se promener à Madrid pour te faire une visite, j’espère que tu le recevras avec joie et sans orgueil ; j’espère que la vile vanité de te sentir en position supérieure à la mienne ne t’aveuglera pas, parce que, oncle pour oncle, je suis le frère de ton défunt père, tandis que l’autre…
Don Celestino était ému et moi aussi, même si c’était pour des raisons différentes.
- Oui, poursuivit le prêtre. D’ici huit jours, nous aurons ici cet éminent commerçant de la rue de la Sal. Il me dit qu’il a acheté des terres à Aranjuez, juste auprès du lac d’Ontígola, il va venir ici avec la double intention de connaître sa propriété et de te voir. Il espère que tu iras à Madrid en sa compagnie et en la compagnie de sa sœur doña Restituta que nous aurons le plaisir de voir aussi chez nous.
En entendant cela, nous nous sommes tous tus. Repassant dans ma tête ces pensées étranges et bien peu joyeuses, je dis à Inès :
- Mais cet homme est marié ?
De son incomparable intuition, elle lut en moi et me répondit avec vivacité :
- Il est veuf.
Le silence s’installa à nouveau et, seul, don Celestino, fredonnant un air d’antienne, interrompait notre silence pesant.
[1] Edition de Madrid, Imp. de Noguera a cargo de M. Martínez, 1875.




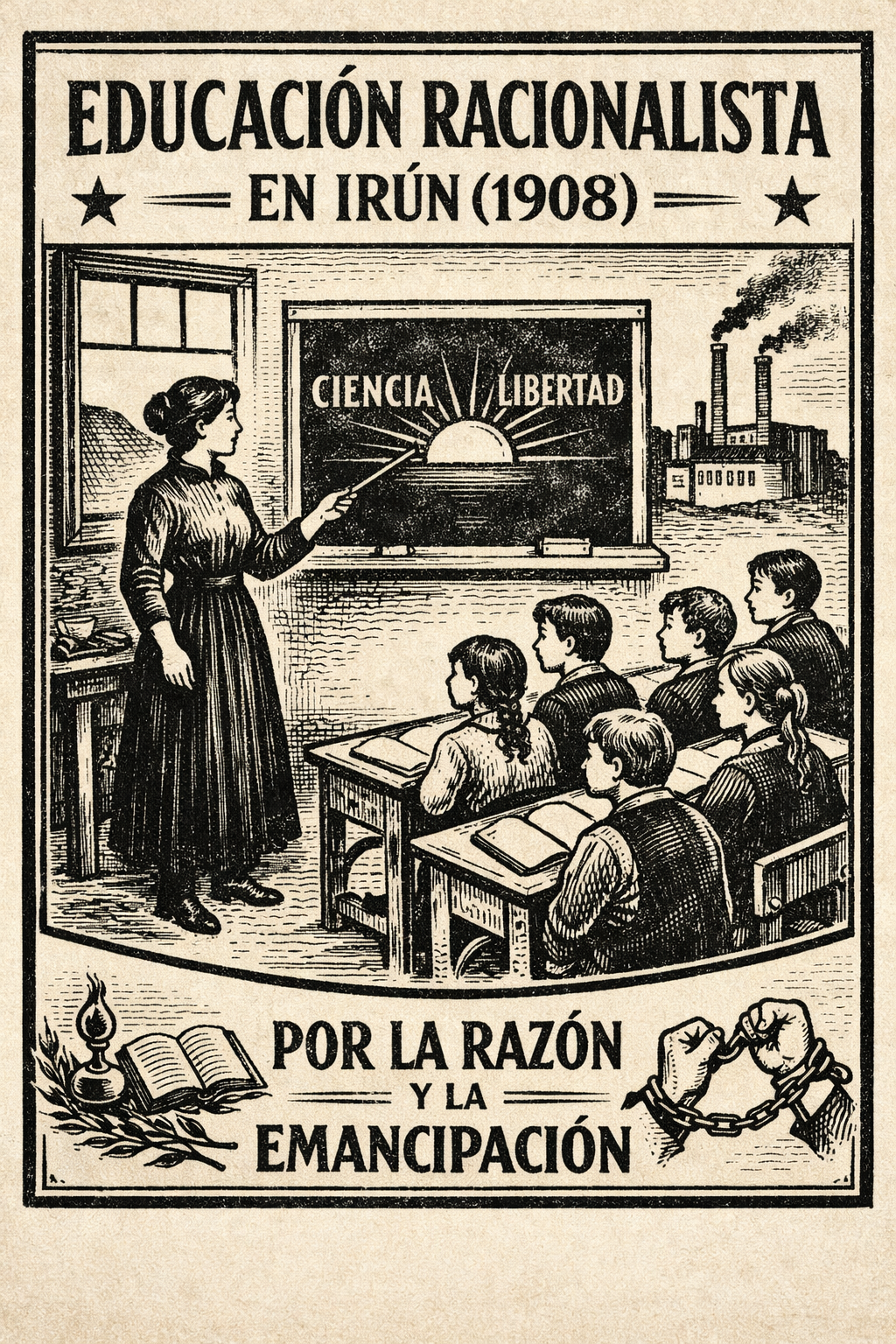











898bet777…the numbers are lucky, right? The site itself is okay. Standard stuff. Fair games and decent payouts. Not winning any awards, but not a bad option either. Check ‘em out at 898bet777.
Alright folks, gave one7899vn a go. So far, so good! They have a good selection. Could be something to dig in to. one7899vn
An fascinating dialogue is value comment. I feel that it is best to write more on this topic, it might not be a taboo subject but usually persons are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers
If you’re a slot fanatic, vn888slot is worth a look. They have a pretty impressive collection of slot games from all sorts of providers. I lost some, I won some, typical gambling experience, but the variety kept me entertained. Check out the slots selection: vn888slot.
Houseofluckcasino caught my eye with its promise of good fortune and I deposited some money. Wish me luck!. Check the house out here houseofluckcasino.