No hay productos en el carrito.

Daniel Gautier
Galdós nous a souvent étonnés par ses comparaisons surprenantes voire audacieuses. Angel Guerra se transforme de révolutionnaire en apôtre de la mystique, son nom même annonce cette étrange transformation. Isidora, dans sa quête de noblesse, est une sorte de don Quichotte qui en vient à se déconstruire et à se perdre parce qu’elle rêvait de grandeur. Villaamil est une sorte de crucifié dans un monde administratif où il ne trouve plus sa place et dans une famille où il n’a jamais été heureux. Par petites touches successives, en parfait observateur de la réalité quotidienne de la fin du XIXème siècle, Galdós nous entraîne vers des chemins qui doivent le surprendre lui-même. Il semble conduit par ses personnages alors qu’on le prend pour un auteur omniscient.
Les allusions sont parfois si surprenantes que certains pourraient s’en scandaliser. Lorsque Villaamil décide d’en finir avec la vie, il s’éloigne de cette ville où il n’a plus sa place en disant : «Tout est accompli… j’ai porté ma croix pendant trente ans, qu’un autre la porte… Tous m’ont abandonné…»[1] Tous ces mots prononcés ne sont pas sans nous rappeler les derniers moments de la vie du Christ. Il parle d’entrer dans «la Gloire Eternelle.»[2] Certains pourront penser que ce sont des rapprochements abusifs, mais la répétition de ces allusions fait qu’il n’est pas incongru d’observer d’un peu plus près ce qu’aurait pu vouloir dire Benito Pérez Galdós.
Le triptyque Nazarín-Halma-Misericordia confirme notre point de vue et Galdós montre bien que les allusions au monde évangélique ne sont pas dues à un simple concours de circonstances. Il y a bien une intention de mettre en lien, la vie de Nazarín avec la vie du Christ, l’engagement de la noble Halma avec sa recherche d’une vocation religieuse, la miséricorde de Benina et la miséricorde divine. Lorsque les derniers mots de Nina «va et ne pèche plus» correspondent avec les derniers mots du roman, cela ne peut plus être un hasard, quand on sait le soin que Galdós mettait aux paragraphes de transition ou aux fins de chapitre.
C’est donc alerté par ces nombreuses références que nous avons voulu relire son roman Gloria. Le titre lui-même a dû être soigneusement choisi. Nous voulons donc observer attentivement l’ensemble de l’ouvrage pour y chercher tous les rapprochements avec les Evangiles et essayer d’en dégager les intentions de l’auteur.
Gloria n’a rien à voir avec le Christ ?
Gloria, ce seul nom évoque la prière de la célébration eucharistique. C’est une prière de louange qui prend un reflet particulier dans la nuit de Pâques, où ce chant est repris après avoir été mis sous silence pendant tout le carême. Gloria, la gloire de Dieu prend ton son sens avec la résurrection du Christ dans la liturgie catholique. Comment donc Galdós a pu oser choisir ce nom pour désigner une jeune fille d’un village perdu du nord de l’Espagne après ce qui lui est arrivé. Une fille adorée ou jalousée, voilà ce qu’est la fille Lantigua. Qui donc pourrait penser à un rapprochement avec le Christ ?
C’est bien ce genre de rapprochement qui a fait de Benito Pérez Galdós un mécréant voltairien, comme disait son ami José María de Pereda. Une fille belle et intelligente qui se laisse aller à des fréquentations douteuses qui en font une «pécheresse et une hérétique» selon le chapitre 30. Gloria a beau être chrétienne, fille d’un grand défenseur de l’Eglise et nièce d’un évêque de renom, il n’est point possible d’en faire une copie de Jésus-Christ. De plus, Gloria est amoureuse. Les titres sont évocateurs «les amours de Gloria», «un prétendant», «l’autre est tout proche»… Il faut attendre le chapitre 35 pour enfin comprendre ou deviner l’acte de folie qu’elle vient de commettre ou qu’ils viennent de commettre. Et seul le chapitre 37 nous en révèle toute la gravité lorsqu’on apprend la religion de Daniel Morton. Pour un Espagnol du 19ième siècle, c’est le comble de l’horreur et c’est bien cela que Galdós veut faire comprendre au lecteur. Or, curieusement, le chapitre 35 s’intitule «les jugements de Dieu, le grand abîme». Il nous renvoie au psaume 35, précisément. Le voilà en entier :
C’est le péché qui parle
au cœur de l’impie ;
ses yeux ne voient pas
que Dieu est terrible.
Il se voit d’un œil trop flatteur
pour trouver et haïr sa faute ;
il n’a que ruse et fraude à la bouche,
il a perdu le sens du bien.
Il prépare en secret ses mauvais coups.
La route qu’il suit n’est pas celle du bien ;
il ne renonce pas au mal.
Dans les cieux, Seigneur, ton amour ;
jusqu’aux nues, ta vérité !
Ta justice, une haute montagne ;
tes jugements, le grand abîme !
Tu sauves, Seigneur, l’homme et les bêtes :
qu’il est précieux ton amour, ô mon Dieu !
A l’ombre de tes ailes, tu abrites les hommes :
ils savourent les festins de ta maison ;
aux torrents du paradis, tu les abreuves.
En toi est la source de vie ;
par ta lumière nous voyons la lumière.
Garde ton amour à ceux qui t’ont connu,
ta justice à tous les hommes droits.
Que l’orgueilleux n’entre pas chez moi,
que l’impie ne me jette pas dehors !
Voyez : ils sont tombés, les malfaisants ;
abattus, ils ne pourront se relever.
Gloria est-elle comme l’impie «qui se voit d’un œil trop flatteur pour trouver et haïr sa faute» ? Ou bien est-elle de ceux qui «savourent les festins de la maison du Seigneur» ? La vérité du psaume n’est pas de connaître la faute de l’un ou de l’autre mais d’apprendre que le Seigneur sauve l’homme et les bêtes, «qu’il est précieux ton amour, ô mon Dieu !»[3] Gloria est amoureuse mais n’est-ce pas ce qui compte aux yeux de Dieu ? Marthe et Marie étaient amies de Jésus. Marthe se démenait au service, Marie, amoureuse, ne faisait rien d’autre que d’écouter son Seigneur. Le Christ dit à Marthe : «Marie a choisi la meilleure part ; elle ne lui sera pas enlevée.»[4]
Tout de même, ronchonneront les bien-pensants de Ficóbriga,
«- Tout ce que peut faire de mieux la petite, c’est d’entrer dans un couvent, dit la Gouvernante avec énergie et conviction.
– C’est évident… Se fourrer dans un couvent, partir d’ici et qu’on n’entende plus parler d’elle de toute notre vie…»[5]
Les avis sont partagés et les lecteurs de Galdós ne sont pas loin de se mettre du côté des «bûcheronnes de Ficóbriga». Galdós serait-il trop laxiste ? Le chapitre 38 s’intitule «Job». Job le livre préféré des Krausistes. Job est quelqu’un qui ose se révolter devant son injuste condamnation. Ses amis essaient de le ramener à la raison en lui déroulant tous les principes moraux connus à l’époque : Dieu punit les méchants et récompense les bons. Est-ce là ce qu’ils constatent ou bien répètent-ils cela parce que c’est la «Tradition des Ancêtres»[6] ? Job veut crier à Dieu sa colère, il veut même «parvenir jusqu’à sa demeure et ouvrir un procès»[7]. Le comble pour les amis et les habitants de Ficóbriga c’est que Dieu prend la défense de son ami Job. «Vous n’avez pas bien parlé de moi comme l’a fait mon serviteur Job.»[8] Galdós, grand lecteur de la Bible fait une autre lecture des événements et pour lui, Gloria, en se laissant séduire par cet étranger, n’est pas nécessairement une fille perdue.
Faut-il donc entrer au couvent pour expier sa faute ? Faut-il souffrir pour racheter et «haïr sa faute» comme le dit le psaume 35 ? D’après la tante Serafina, Gloria ne peut pénétrer le sens des choses parce qu’elle n’est pas simple et humble dans ses critères, parce qu’elle n’a pas le mépris de ses propres jugements.»[9] On est bien loin de la fierté de Saint Irénée qui disait que «la fierté de Dieu c’est l’homme debout.» Serafina, toute de noir vêtue et qui tricotait des chaussettes noires… ne pouvait avoir que des idées noires et ne comprenait pas ce que voulait signifier sa nièce en disant : «Je suis mère, moi.»[10] Mais la tante n’entendait pas ce langage. Gloria lui dira même cette phrase terrible dans la bouche de Galdós :
«Vous êtes une sainte, mais vous n’avez jamais été mère.»[11]
Voilà toute la différence entre ceux qui respectent la loi et ceux qui vivent d’amour, entre ceux qui appliquent à la lettre tous les principes de la religion et ceux qui vivent comme ils peuvent l’amour des autres, entre ceux qui disent Seigneur, Seigneur et ceux qui entreront dans le Royaume des Cieux[12].
Si Gloria n’est pas comparable au Christ, elle nous prépare à son enseignement. Doit-on alors se tourner vers Daniel Morton pour trouver davantage de ressemblance ?
Daniel Morton, le portrait physique du Christ.
Les premiers indices de l’arrivée de Daniel Morton sont étrangement comparables à la tempête apaisée de saint Marc[13].
«Admirable effet de la miséricorde de Dieu ! Quand l’embarcation revint à terre, les vagues s’apaisèrent comme si l’Océan lui-même, qui ne pardonne jamais, s’était senti ému.»[14]
Au cas où le lecteur n’aurait pas saisi vraiment l’allusion, Galdós pose d’autres jalons :
«Il regardait ici et là, ouvrait de grands yeux bleus à la lumière joyeuse et dévisageait Gloria, don Juan et don Angel, l’un après l’autre. Ceux qui ressuscitent ne regardent pas autrement.»[15]
Galdós agit toujours ainsi. Par petites touches, il conduit le lecteur, sans le forcer, là où il veut l’emmener. Don Angel reconnaît d’ailleurs que Daniel «est une des plus réussies des actions de Dieu.»[16] C’est Caifas qui le premier va nous révéler une certaine ressemblance entre le Christ et Daniel, lorsqu’il avoue à Gloria qui est le généreux donateur qui l’a sorti de la misère.
«L’étranger, celui du bateau à vapeur… Je ne sais pas son nom, mais il ressemble à Notre Divin Sauveur.»[17]
Pendant un certain temps il semble que le lecteur ou l’auteur hésite. Lequel des deux personnages ressemblent le plus à Jésus-Christ ? Gloria, après avoir rêvé d’être l’ange rebelle, (n’a-t-on pas traité le Christ de Béelzéboul[18]) «inclina la tête sur sa poitrine en soupirant et la main devant les yeux, elle pleura en sentant l’amertume du calice.»[19] Mais pour Gloria, il n’y a pas de doute, lorsqu’elle voit dans la pinède le visage de Morton «dont l’admirable regard semblait descendre du haut de la croix.»[20] Au chapitre 38, juste avant de nous révéler qu’il est juif, ce qui ajoute à la ressemblance, le physique de l’un ne peut faire oublier le physique de l’autre.
«Il était pâle, grave, ses yeux bleus s’éteignaient dans une sombre tristesse. Quand on voyait de profil la ligne de son nez et de son front et sa jolie barbe pointue, c’était le portrait tout craché du visage mort du Sauveur du monde.»[21]
Que Gloria y voit une ressemblance, passe encore, mais que les femmes de Ficóbriga, si jalouses et si perfides, y voient les mêmes traits, cela augmente encore le trouble du lecteur.
«Il lui ressemble, oui, il n’y a pas de doute qu’il lui ressemble… Mais on ne peut pas le dire, ni même le penser. C’est un sacrilège.»[22]
La confusion qui règne dans les rues pendant la Semaine Sainte amplifie encore le rapprochement entre «le Sauveur, dans la rue», titre du chapitre 8 et l’arrivée d’un étrange cavalier que tout le monde appelle «le Juif.»
Or, au moment où il se voit refusé par tous et où le mendiant rend les pièces de monnaie, assimilées aux trente deniers de Judas, Daniel Morton s’écrie :
«Ah ! Nazaréen blasphémateur… jamais je ne ferai partie des tiens ! Jamais !»[23]
Non décidément, Daniel Morton est l’ennemi du Christ et toute comparaison serait scandaleuse. Caifas, lui qui trouvait une ressemblance avec le Divin Sauveur, ne veut plus voir en lui qu’un «diable déguisé en saint ou bien comme un ange en habit de Lucifer…»[24] D’ailleurs on ne voit pas comment rapprocher du Christ celui qui dit :
«Je sens un instinctif amour pour le Dieu de mes pères et une antipathie irrésistible pour l’innovation chrétienne inutile…»[25]
S’il lui faut abandonner sa religion, comment peut-il admettre celle d’un «faux prophète, celle du Nazaréen»[26] ? Mais les idées fausses qu’on peut se faire du christianisme ne sont-elles pas des vérités ternies, des vérités troublées, effacées par tant de siècles d’humanité ? Morton se pose donc à lui-même ces questions lancinantes :
«Trouves-tu dans le christianisme les éternelles vérités ? Elles existent, oui, mais défigurées, dénaturées…»[27]
On croit deviner déjà dans cette vive réaction de Morton l’optimisme d’un Jean XXIII. Lui aussi s’en prenait aux «disciples de malheur» qui ne voyaient que le mal et ne reconnaissaient plus dans l’Eglise, l’élan des origines.
«Dans le cours actuel des événements, alors que la société humaine semble à un tournant, il vaut mieux reconnaître les desseins mystérieux de la Providence divine qui, à travers la succession des temps et les travaux des hommes, la plupart du temps contre toute attente, atteignent leur fin et disposent tout avec sagesse pour le bien de l’Eglise, même les événements contraires.»[28]
Serafina parle à son tour de rédemption mais c’est Gloria qui pourrait obtenir le pardon pour Morton.
«Si tu fais à Dieu l’immense, le douloureux sacrifice que je t’ai proposé comme le meilleur chemin pour sauver ton âme, si tu lui consacres entièrement, absolument toute ta vie, t’arrachant au monde et à ses affections, si tu fais cela, mon amour, et si tu demandes à Dieu de t’accorder la rédemption d’une âme toujours aveugle à la vraie lumière, comment veux-tu que Dieu te le refuse ?»[29]
Si l’idée de rédemption apparaît c’est bien que la comparaison avec le Christ Rédempteur existe. Dans quel sens ? Jusqu’à quel point ? Comment cela ? C’est ce qui reste à démontrer car «l’espérance de salut»[30] dans la conversion de Morton n’est qu’une supercherie. Crois-tu «fermement que la doctrine de Notre Seigneur Jésus-Christ est non seulement la meilleure, mais la seule vraie et unique»[31] ? L’épreuve est vraiment trop forte, «Daniel, lorsqu’il étendit la main vers la croix, était aussi blanc que l’ivoire de la belle statue qui lui ressemblait tant.»[32] Morton entre là dans une démarche qui le dépasse. Sa conversion même feinte semble être inscrite dans un plan dont il n’a pas l’initiative réelle.
«Cette idée est trop grande pour être de moi seulement. Elle vient de Dieu.»[33]
D’ailleurs Morton finira par dire à Gloria : «Je ne ferai rien sans ta volonté.»[34] Mais curieusement c’est Gloria qui reprend les paroles du Christ au bon larron : «Tu seras avec moi au Paradis».[35] A Daniel qui s’étonne d’entendre toujours parler de «Jésus-Christ», Gloria répond :
«Toujours ! Je sais que tu entreras dans son royaume et c’est ma seule consolation.»[36]
Juif ou chrétien n’a plus beaucoup de sens, arrivé à un certain stade de la spiritualité.
«Il n’y a ni Juif ni Grec, il n’y a ni esclave ni homme libre, il n’y a ni homme ni femme ; car tous vous ne faites qu’un dans le Christ Jésus,»[37] disait saint Paul. Alors, est-ce réalité ou est-ce folie ?
Jésus-Christ n’est donc représenté par personne ou bien tantôt par Gloria, tantôt par Morton. Vers quoi Galdós veut-il entraîner le lecteur ?
Gloria est en réalité un personnage multiple. C’est un personnage christien pourrait-on dire qui veut transmettre un message aux lecteurs espagnols de l’époque et aux lecteurs de tous les pays, à toutes les époques.
Gloria avait un regard pur, elle savait voir ce que les autres ne voient pas. Par delà la nature, comme le Christ qui voie les fleurs des champs ou le semeur jeter sa semence, on disait de Gloria que «ses yeux intrépides veulent voir ce qu’il y a au-delà des montagnes»[38] Elle savait voir aussi en Caifas bien plus qu’un indigent ou un menteur comme les autres du village. Comme le Christ voyait en la pècheresse une personne aimante, Gloria devinait les pensées du cœur. Elle était en cela bonne disciple du Christ. Le message de Galdós est donc que le vrai chrétien est celui qui sait imiter le Christ, en mettant ses pas dans ses pas, sans jamais lui ressembler totalement. Elle voulait qu’on revienne à une société moins alambiquée et plus vraie. Mais elle pensait que Don Quichotte et Sancho Panza n’arriveraient jamais à se réconcilier.[39] L’idéal s’il n’est pas mêlé d’humanité risque fort d’être une idée en l’air sans réel retentissement sur le concret quotidien. Le Christ est plus attentif aux gestes de la femme pécheresse qu’aux pratiques des pharisiens. Il dit au pharisien qui l’avait invité :
«Tu vois cette femme ? dit-il à Simon. Je suis entré chez toi, et tu ne m’as pas versé d’eau sur les pieds ; elle, au contraire…»[40]
La vision de Galdós sur la souffrance est plus humaine que celle de la tante Serafina.
«Souffrir est peut-être méritoire, mais souffrir pour souffrir ne peut pas être une religion.»[41]
Cette réflexion de Daniel Morton transcrit bien l’idée de Galdós. Sans jamais l’expliciter, Galdós ne partage pas les idées de la tante Serafina. Ce n’est pas sans une pointe d’ironie qu’il précise :
«Pour juger Serafinita et la condamner pour cela, il aurait fallu que Dieu reprenne son Décalogue et le promulgue avec un onzième article qui aurait dit : «Tu ne comprendras pas de travers l’amour de Dieu.»[42]
Lorsque Gloria refuse d’entrer au couvent pour racheter sa faute par la souffrance, elle nous rappelle Job à qui Dieu donne raison. On retrouvera d’ailleurs cette attitude chez Torquemada. Gloria est humaine avant tout, transmettant ainsi le langage du Christ qui rappelle ce qui est écrit dans Osée, «c’est la miséricorde que je veux et non les sacrifices».[43]
Gloria donnera naissance à un petit «Jésus», qui aura trente trois ans… et dont l’histoire sera digne d’être racontée comme celle de ses parents…[44] Cette dernière allusion rend crédibles les rapprochements que nous avons faits tout au long de cet article. C’est une naissance douloureuse qui provoque la mort de la mère et la folie du père car c’est l’accouchement d’une religion qui n’a pas encore vu le jour. C’est l’avènement du Royaume de Dieu et force est de constater qu’il n’est point encore arrivé. Dans son discours d’ouverture au concile Vatican II, le pape Jean XXIII fait part de son désir.
«Il faut que, répondant au vif désir de tous ceux qui sont sincèrement attachés à tout ce qui est chrétien, catholique et apostolique, cette doctrine soit plus largement et hautement connue, que les âmes soient plus profondément imprégnées d’elle, transformées par elle. Il faut que cette doctrine certaine et immuable, qui doit être respectée fidèlement, soit approfondie et présentée de la façon qui répond aux exigences de notre époque… Il faudra attacher beaucoup d’importance à cette forme et travailler patiemment, s’il le faut, à son élaboration; et on devra recourir à une façon de présenter qui correspond mieux à un enseignement de caractère surtout pastoral.»[45]
Galdós avait, en réalité, cette même intuition. Le Royaume de Dieu n’est pas une réalité achevée, mais à construire. Le jeune homme riche des Evangiles demande à Jésus ce qu’il doit faire pour entrer dans la vie éternelle. Jésus lui dit : «Tu connais les commandements…» Mais s’il veut entrer dans le Royaume de Dieu, c’est une autre étape. «Qu’il est difficile d’entrer dans le Royaume de Dieu !»[46] Galdós nous le dit bien : «A dix heures du matin, la terre avait été ratissée sur le corps et le monde suivait son cours.»[47] Phrase terrible qui rappelle le verset de Luc : «Lorsque le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?»[48] Cela pourrait pousser au pessimisme s’il n’y avait cette autre phrase de Jean :
«Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul ; s’il meurt, il porte beaucoup de fruit.»[49]
Alors, Gloria peut s’endormir tranquille.
«De la demoiselle Gloria, personne ou presque personne ne se souvenait alors. L’auréole des mémoires humaines s’était fanée sur son front. Mais peu lui importait à elle qui possédait une autre lumière inextinguible…»[50]
Galdós achève son roman en ajoutant cette petite touche christique :
«On aurait dit de lui qu’il n’était pas né d’une mère mais de l’art et de la foi, recevant corps et vie de l’ardente inspiration de Murillo… On l’appelait et on l’appelle le Petit Nazaréen… Tous l’adorent.»[51]
Le passage du passé au présent marque bien le côté universel de la vie de cet enfant.
Ni Gloria, ni Morton ne sont vraiment comparables au Christ, mais l’union des deux, cet enfant auquel tout lecteur est invité à ressembler.
Daniel Gautier, 12 octobre 2012.
[1] Miau, ed. cátedra, Madrid, 2000, p. 410-411
[2] idem, p. 420
[3] Ps 35, 7.
[4] Luc 10/42.
[5] Gloria, II, chapitre 24, p. 206. (les pages correspondent à la publication Gloria, Isidora Ediciones, 2012)
[6] Job, 15/18.
[7] Job, 23/3-4.
[8] Job, 42/7.
[9] Gloria, II, chap. 18, p. 185-186.
[10] Ibid. II, chap. 19, p. 188
[11] Ibid. II, chap. 19, p. 190.
[12] Matthieu, 7/21.
[13] St Marc, 4/35-41.
[14] Gloria, I, chap. 18, p. 53.
[15] Ibid. I, chap. 19, p. 54.
[16] Ibid. I, chap. 20, p. 59.
[17] Ibid. I, chap. 25, p. 78.
[18] Luc 11/15.
[19] Gloria, I, chap. 26, p. 82.
[20] Ibid. I, chap. 28, p. 85.
[21] Ibid. I, chap. 37, p. 112.
[22] Ibid. II, chap. 5, p. 135.
[23] Ibid. II, chap. 9, p. 154.
[24] Ibid. II, chap. 10, p. 158
[25] Ibid. II, chap. 11, p. 163.
[26] Ibid. II, chap. 20, p. 192
[27] Ibid. II, chap. 20, p. 193
[28] «Gaudet Mater ecclesia…» du 11 octobre 1962.
[29] Gloria II, chap. 21, p. 197.
[30] Ibid. II, chap. 22.
[31] Ibid. II, chap. 22, p. 200.
[32] Ibid.
[33] Ibid. II, chap. 28, p. 219.
[34] Ibid. II, chap. 32, p. 235.
[35] Ibid. II, chap. 32, p. 237.
[36] Ibid.
[37] Gal. 3/28
[38] Ibid. I, chap. 1, p. 15.
[39] Ibid. I, chap. 6, p. 24.
[40] Luc 7/44…
[41] Gloria, II, chap. 32, p. 239.
[42] Ibid. II, chap. 31, p. 196
[43] Osée 6/6 rappelé dans Mat. 12/7.
[44] Gloria II, chap. 33, p. 245.
[45] Discours de Jean XXIII, du 11 octobre 1962.
[46] Marc 10/23-27.
[47] Gloria II, chap. 33, p. 243
[48] Luc 18/8
[49] Jean 12/24.
[50] Ibid, p. 244
[51] Ibid.


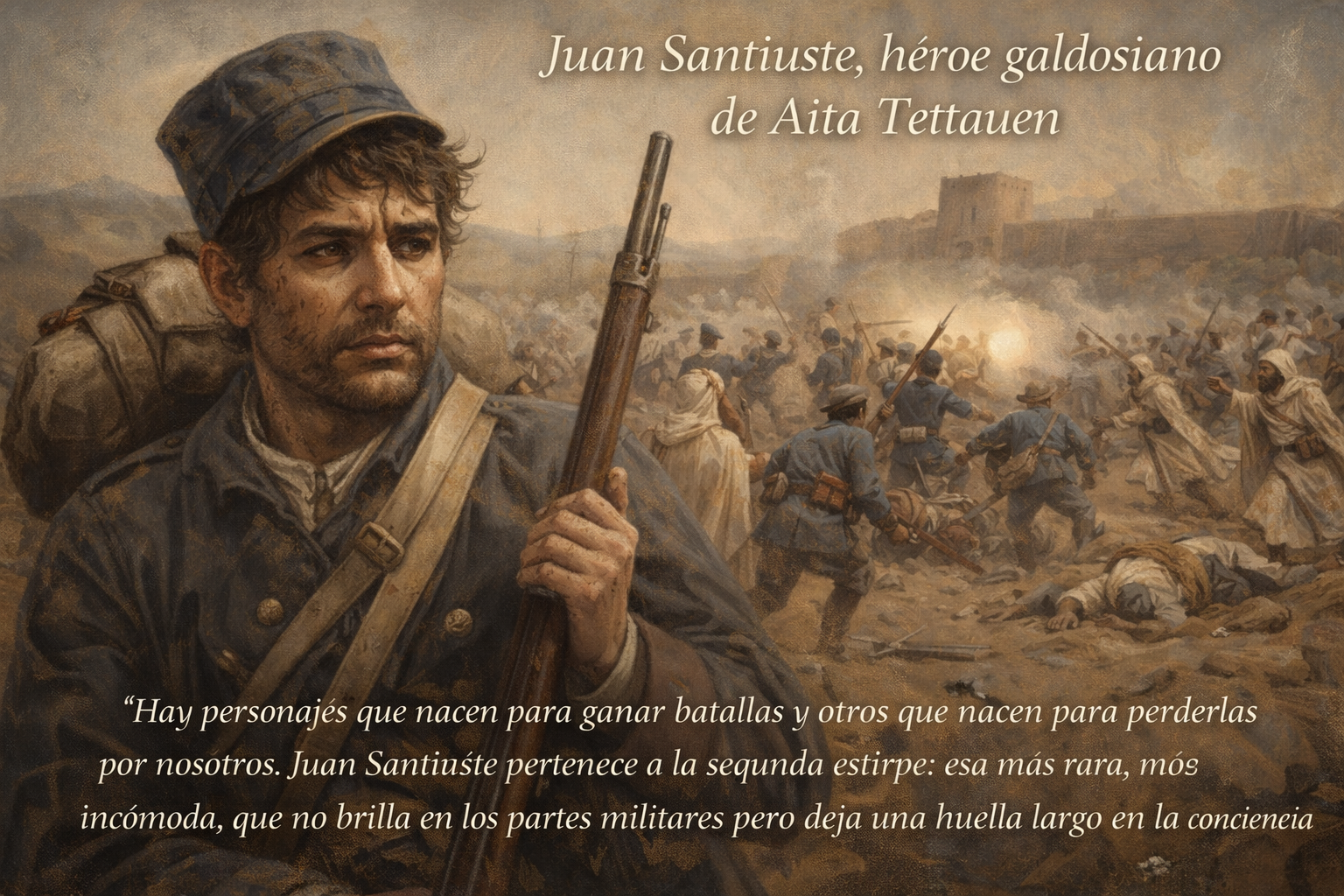
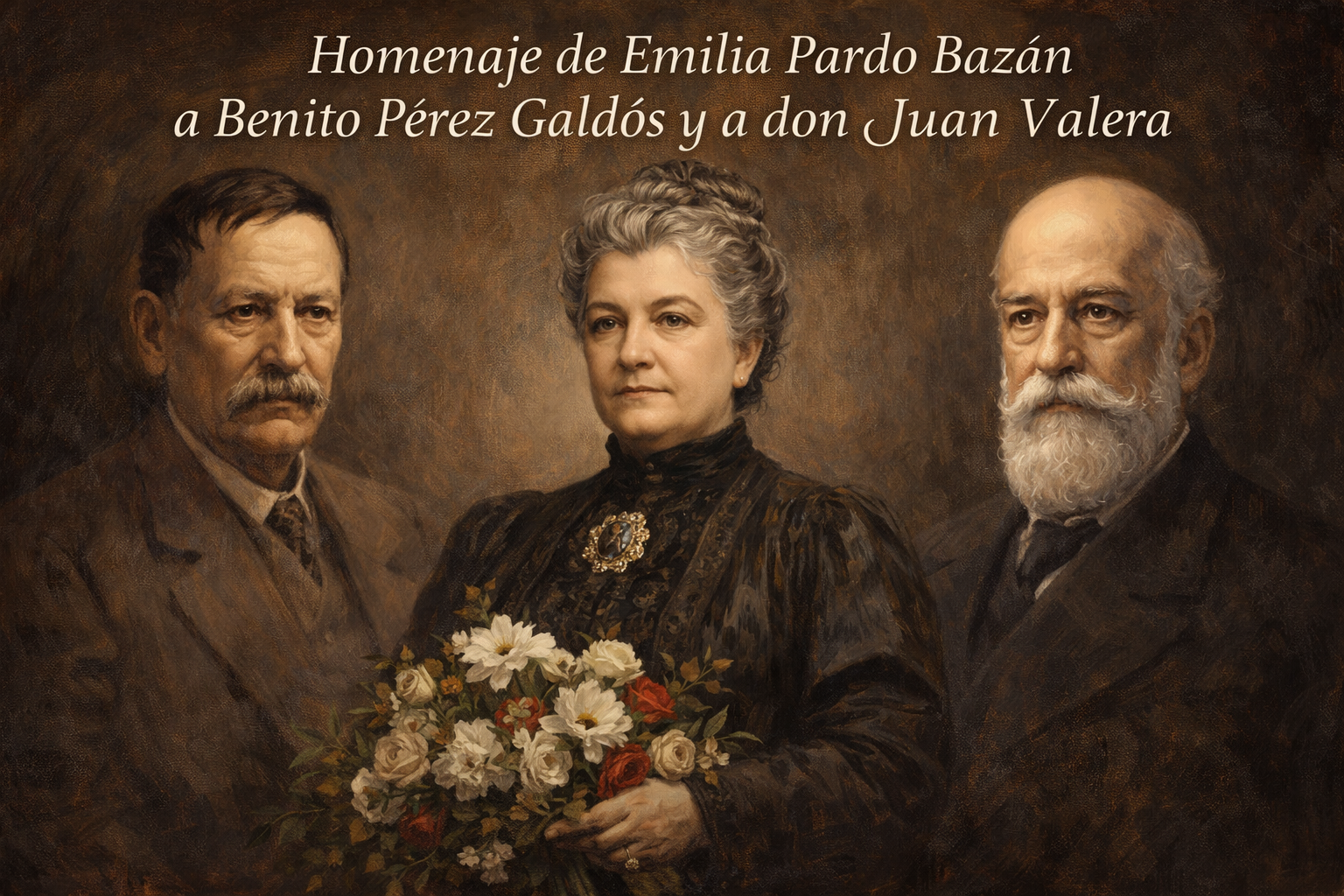












F*ckin¦ tremendous issues here. I¦m very happy to peer your article. Thanks a lot and i’m having a look forward to contact you. Will you kindly drop me a e-mail?
What i don’t realize is in reality how you are no longer actually a lot more smartly-favored than you may be right now. You’re very intelligent. You understand thus considerably on the subject of this topic, produced me in my view consider it from so many numerous angles. Its like women and men are not involved unless it?¦s something to accomplish with Girl gaga! Your own stuffs excellent. All the time take care of it up!
I like this website so much, saved to fav. «American soldiers must be turned into lambs and eating them is tolerated.» by Muammar Qaddafi.
Great awesome issues here. I?¦m very happy to see your post. Thanks a lot and i am taking a look ahead to touch you. Will you kindly drop me a mail?