No hay productos en el carrito.
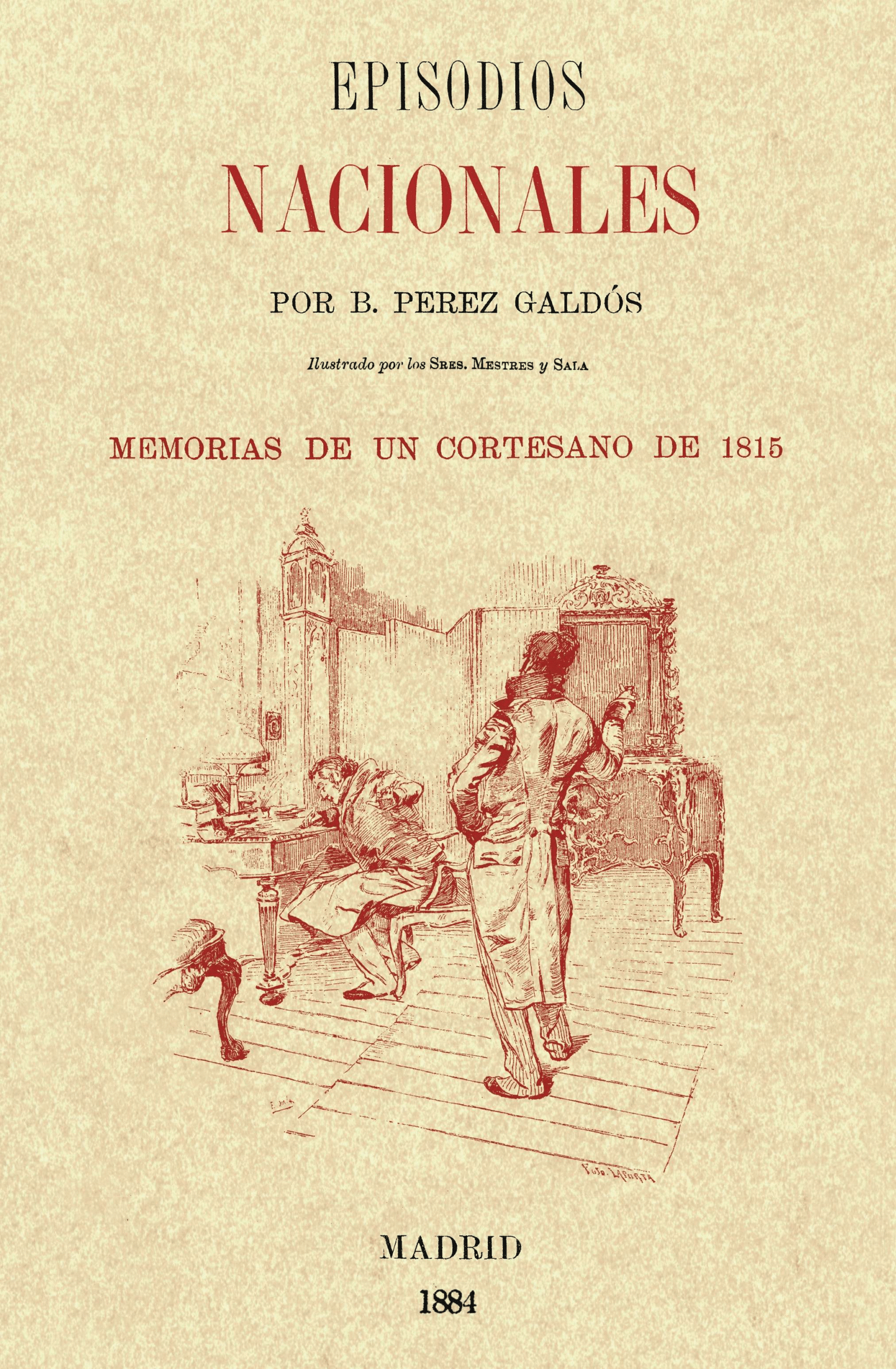
Traduction Daniel Gautier
– XI –
Je passai toute cette journée à dormir. A la tombée de la nuit, je sortis pour observer l’aspect de la ville et à la taverne, je rencontrai Lopito qui faisait avec son couteau mille rubriques dans les airs pour que Mariminguilla le voie. Puis, rangeant son arme il me dit :
- La fille me trouve pas mal, et si le père Malayerba ne la laisse pas sortir d’ici, il va apprendre qui est Lopito. Je me suis très bien comporté hier soir, Gabriel ! Tous sont enthousiastes vis-à-vis de moi et dès que le Prince sera sur son trône, on m’a déjà promis une place à huit mille réaux dans la comptabilité du Conseil du Trésor.
- Bien entendu, si tu as une belle écriture…
- Ni belle ni mauvaise parce que je ne sais pas écrire, mais ce sera le minimum. Juan, le cocher, m’a dit qu’on allait enlever de leur poste tous ceux que le Prince de la Paix a installés et comme il y en a des centaines de mille, il restera beaucoup de places vacantes. Donc, nous devons tous avoir un poste… parce que, mon vieux, toute cette histoire de la chasse à courre me fatigue et j’imagine que nos mères nous ont mis au monde pour autre chose que pour soigner les chiens et les garbons.
- Mais, le Prince des Asturies y va oui ou non ?
- Ils vont nous l’installer, sinon, à quoi servent les troupes de Napoléon ? Avec ce qui s’est passé hier soir, on aurait bonne mine ! On dit que le Roi tremblait comme une feuille morte et qu’il voulait venir nous calmer ; mais il semble que les ministres ne l’ont pas laissé. La Reine disait qu’on aurait dû nous tuer tous pour qu’il ne se passe pas ici la même chose qu’en France, où on a coupé la tête des Souverains avec un instrument qu’on appelle la mère Guillotine. Voilà ce que m’a raconté, ce matin, Pujitos, qui sait toutes ces choses-là et il les a lues sur un document qu’il a gardé. Nous aimons le Roi parce qu’il est Roi, et ce matin, quand il est apparu au balcon, nous avons beaucoup crié et nous l’avons acclamé. Lui portait sa main à ses yeux pour sécher ses larmes, mais la maudite Reine était là, raide comme un bâton, elle ne nous a pas salués. Pujitos, qui sait tout, dit que c’est parce qu’elle est navrée de ce que nous avons fait dans la maison du bandit, et elle assure qu’elle l’a caché dans ses appartements.
- C’est possible.
- Eh bien, moi, je me suis distingué, continua Lopito haussant le ton pour que Mariminguilla l’entende. Ce matin, quand on a pris don Diego Godoy, frère du ministre, on était tous en train de crier et moi, je lui ai lancé une pierre et si elle l’avait atteint en pleine figure, elle l’aurait laissé sur place.
- Qu’avait fait ce monsieur ?
- C’est le frère de ce pilleur, ça n’est pas rien… Il était colonel des gardes mais même ses soldats lui ont enlevé ses décorations et maintenant, ils vont l’emmener à un château.
Cette nuit-là, j’entendis un nouveau discours de Pujitos : mais je ferai à mes lecteurs l’insigne faveur de ne pas le recopier ici. Le poète de Calahorra, dont j’ai déjà parlé, chef de la conspiration littéraire forgée contre le Oui des demoiselles, s’approcha de nous, accompagné de Cuarta y Media, et à eux tous, ils nous balancèrent une demi-douzaine de sonnets et autres projectiles forgés dans leur cerveau. Mais après nous avoir assommés de coups de sonnets, Lopito commença une dispute avec le poète parce que celui-ci s’était imaginé couvrir Mariminguilla de galanteries, l’appelant nymphe de je ne sais quelles eaux ou mares poétiques. Le couteau de Lopito se remit à briller et, si le poète n’avait pas été le plus froussard des chevaucheurs de Pégase, on aurait vite mélangé, dans la rivière épouvantable, le sang d’un futur employé du Trésor et celui d’un ancien émule du vieil Homère.
Il ne se passa rien de plus cette nuit-là qui ne soit digne d’être transmis à la postérité ; mais le lendemain matin, il se répandit avec la rapidité de l’éclair dans toute la ville que le Prince de la Paix avait été trouvé dans sa propre maison. La taverne du père Malayerba se vida en deux minutes, et de partout arriva la foule pour le voir.
C’était vrai ! Godoy s’était réfugié dans un grenier où l’un de ses serviteurs l’avait enfermé, celui-ci, fait prisonnier ensuite, ne put aller l’en sortir. Après trente-six heures d’enfermement, le Prince, préférant sans doute la mort à l’angoisse, la faim et la soif le dévorant, sortit de sa cachette, se présentant aux gardes qui surveillaient sa maison. Ces derniers, au lieu de protéger celui qui, un jour avant, était leur chef, rameutèrent tout le voisinage, et la même foule que la nuit du 17 accourut, enthousiaste et héroïque, pour s’en emparer.
- Il est apparu, on l’a pris, il est à nous ! criaient de nombreuses voix.
Nous allâmes tous là-bas, et à la porte du palais, les gens entassés formaient un rempart. Les cris féroces, les hurlements de colère formaient un effrayant concert discordant. Je fus très surpris d’entendre parmi tant de brouhaha des voix de femmes qui criaient, déshonorant leur statut de sexe faible en demandant vengeance. Lopito, satisfait, n’en tenait plus et le couteau fut brandi au-dessus de nos têtes comme s’il avait voulu partager le firmament en deux morceaux.
Nous poussions tous, luttant chacun pour soi afin de s’approcher, et un coup de coude ici, un coup de coude là, Lopito et moi, nous pûmes arriver assez près de la porte. Le poète et Cuarta y Media étaient en première file. Le second de ces deux personnages se tourna vers moi et me dit avec jouissance :
- Je crois qu’il ne va pas sortir vivant des mains du peuple.
- Et qu’est-ce qu’il vous a fait à vous, ce monsieur ? demandai-je.
- Oh ! me répondit-il. Cet homme est un infâme, un voyou qui s’est enrichi sur le dos du royaume. Moi, je le déteste, je le hais ; je suis une victime de ses friponneries. Vous devez savoir que la boutique de ferraille que j’ai, c’est lui qui me l’a donnée parce que j’étais le fils de celle qui lui lavait son linge… L’année où j’ai eu la boutique, je me suis ruiné, et il m’a donné quelques sous pour que je puisse continuer ; mais comme je lui demandais un poste où sans travailler, sans rien faire, j’aurais gagné ma vie, il a eu le toupet de me répondre que je ne devais pas être fonctionnaire mais chaudronnier, et il ajouta que j’étais une bête. Voyez-vous ? Dire que je suis une bête !
Je ne voulus pas en entendre davantage et me tournai de l’autre côté. La foule criait ; je n’ai jamais pu oublier ces cris que j’ai toujours mis en lien avec la voix d’êtres les plus ignobles de la création ; et tandis que ces mille voix félines miaulaient, des griffes s’abattaient de manière décidée avec le courage irrévocable et semblable au courage qu’entraînent la supériorité physique et la fermeté de celui qui se sent chat en présence d’une souris.
La troupe retenait le peuple désireux d’entrer, quelques cavaliers de la garde se placèrent à droite et à gauche de la porte. Non loin de là, Pujitos, qui avait, comme je l’ai déjà dit, l’instinct, le génie de la règlementation du désordre, commandait à la foule de se mettre en rangs et il disait en brandissant son gourdin :
- Messieurs, sur le côté… deux par deux. Formez bataillon et ne poussez pas.
Tout à coup, une immense clameur, faite de déclamations grossières, de phrases maladroites, de cris de rancœur emplit la rue. A la porte, était apparu un homme de taille moyenne, les cheveux en désordre, le visage pâle comme du marbre, les yeux enfoncés et meurtris, les bras ballants, en manches de chemise et une cape jetée sur les épaules. C’était le ministre d’hier, le chef des armées de mer et de terre, l’arbitre du Gouvernement, le puissant Prince et homme illustre, seigneur d’immenses Etats, l’ami intime des Souverains, le dispensateur de grâces, le maître de l’Espagne et des Espagnols, car il disposait d’elle et d’eux comme de son propre bien ; le colosse de la fortune, celui qui de rien était devenu tout, de pauvre était devenu millionnaire, le garde, qui à vingt-cinq ans était monté des écuries de son régiment au trône des Rois, le comte d’Eboramonte et duc de Sueca et duc de la Alcudia et Prince de la Paix et Altesse Sérénissime, qui en un jour, en un instant, en un souffle, était tombé du plus haut de sa grandeur et du pouvoir à la mare de misère et de la nullité la plus épouvantable.
Quand il apparut, mille poings fermés se levèrent vers lui ; les chevaux durent reculer et les cavaliers faire usage de leurs sabres, pour que le corps du Prince ne disparaisse pas, brin de paille dans ce grand feu de la haine humaine. Le favori adressa au peuple un regard implorant la pitié ; mais le peuple, qui en de tels moments, n’est toujours qu’une bête féroce, s’irritait chaque fois qu’il le voyait ; c’est sans doute le plus grand plaisir de cette bête qu’on appelle foule, il consiste à voir descendre à son niveau ceux qu’il a vus longtemps dans les hauteurs.
Le piquet de gardes à cheval essaya de conduire le Prince à la caserne, il fallut pour cela le placer entre deux chevaux, appuyant les bras sur les arçons et suivant leurs pas ; au début, ils avançaient à pas lents mais on dut accélérer pour mettre fin à ce fatal chemin de croix. Pendant ce temps, la foule luttait pour écarter les chevaux ; là un bras s’allongeait, là une jambe ; les gourdins étaient brandis sous le ventre des coursiers, et les pierres par-dessus pleuvaient. Il en pleuvait tant que les cavaliers commencèrent à s’énerver et se mirent à répartir des coups de lanternes.
Lopito, ivre de joie, me dit :
- J’ai été plus malin qu’eux tous, parce que j’ai réussi à me faufiler entre les pattes des chevaux et je l’ai piqué de mon couteau : regarde, il y a encore du sang…
Cuarta y Media vociférait en disant :
- C’est inique ce qu’ils nous font. Ces gardes devraient être fusillés. Pourquoi ne nous laissent-ils pas nous approcher ?
Pujitos, qui en pétulance ne manquait pas de générosité, fut le seul, parmi ceux que je connaissais, à montrer quelques signes de compassion.
Il y eut des moments d’angoisse où la foule tourbillonnait et se resserrait, elle semblait prête à dévorer le prisonnier et les cavaliers qui le gardaient ; mais eux savaient s’ouvrir un passage et, quand le groupe était moins dense, on revoyait la tête du martyr, accrochées aux arçons par des mains abîmées, les yeux fermés, le front blessé et couvert de sang, les pieds flageolants et tremblants, porté presque dans les airs, presque traîné, respirant de manière haletante, la bouche écumante, les vêtements en lambeaux. Cela semblait incroyable de penser qu’il s’agissait du même homme qui, deux jours auparavant, me reçut dans son palais, le même que j’ai vu assiégé par les prétendants, agité et méfiant sans doute, mais sûr encore de son pouvoir, et bien éloigné de ce soudain changement du destin perfide et fourbe. Et les jeunes les plus déguenillés s’aventuraient entre les pattes des montures pour le frapper, et les femmes lui jetaient de la boue du chemin, moins répugnante que les cris des hommes… et si ces derniers ne tiraient pas avec leur fusil c’était pour ne pas blesser les soldats ! Je ne crois pas avoir vu une chute aussi dégradante. Sans doute est-il écrit que la chute doit être aussi ignominieuse que l’ascension.
Les favoris, qui ont laissé leur tête sur le billot d’un cachot, ont sans aucun doute été moins martyrs que don Manuel Godoy, porté en procession honteuse, au milieu de rires féroces et de grossièretés irrévérencieuses, sans mourir, parce que les pincements et les éraflures ne tuent pas.
– XII –
Enfin, le cortège entra dans la caserne et la populace, excitée sans arrêt par les laquais du palais, eut le sentiment de ne pas pouvoir montrer son héroïsme avec le succès désiré. L’un des plus zélés parmi tous ces braves champions s’en sortit avec une mauvaise blessure, conséquence du fait que toutes les pierres lancées contre le ministre ne suivaient pas la direction donnée par la main qui l’envoyait. Je dis ça parce qu’au moment où Santurrias était grimpé sur les épaules de deux balourds, afin de pouvoir asséner un coup bien placé au malheureux martyr, il reçut un galet de rivière sur le sourcil droit avec une telle force que le bienheureux sacristain tomba au sol sans connaissance. Immédiatement, ceux qui l’entouraient, Lopito et moi, accourûmes à son secours et, avec d’autres personnes charitables, nous emmenâmes ce gros sac chez lui car Santurrias vivait dans une maison touchant celle de mon brave ami don Celestino del Malvar. Dès que ce dernier vit entrer son subalterne dans un tel état, il croisa les mains et dit :
- C’est une punition de Dieu, pour tous les blasphèmes de cet homme et son abominable complicité avec les ennemis de l’Etat. Ce n’est pas le moment de montrer ma colère mais ma faiblesse ; je suis là pour le soigner et l’assister car c’est mon prochain, tout en étant un grand brigand. Laissez-le-moi là sur une natte, je vais préparer les emplâtres et l’onguent et il va s’en sortir comme tout neuf. Courage, ami Santurrias, vous êtes encore tout ébloui ! Voulez-vous que je sorte une de ces bouteilles que vous aimez tant ? Mère Gila, ajouta-t-il en donnant une clé à la femme qui le servait, ouvrez le placard et sortez tout de suite celle qui indique La Nava, du sec, pour voir si le seul fait de la voir ranime un petit peu notre homme. Et vous, les enfants, continua-t-il en s’adressant aux quatre fils de Santurrias qui poussaient des petits soupirs plaintifs autour du corps évanoui de leur père, ne pleurez pas, ce n’est qu’une égratignure qu’a eue notre brave homme dans une dispute. Ne pleurez pas, votre père est en vie et, dans une heure, il sera en bonne forme… S’il devait mourir, je vous promets de ne pas vous laisser orphelin parce que je suis là, moi, et je vais vous protéger comme un père. Allez, les enfants, vous ne faites que gêner, allez jouer… Bon, pour vous éloigner d’ici, je vous permets d’aller sonner les cloches un petit peu, bande de lascars… allez à la tour mais ne sonnez pas trop fort, juste pour un sermon ou pour les complies.
Comme une bande de moineaux s’envolent, surpris par le chasseur, ainsi s’envolèrent hors de la salle les quatre garçons et, l’instant d’après, toutes les vieilles de la ville sortaient sur le pas de leur porte et aux balcons en se demandant l’une l’autre : «Madame doña Blasa, cet après-midi, nous avons un sermon et les complies. Il ne manquait plus que ça, on va voir si c’est la fin de toutes ces hérésies.»
Santurrias, qui avait perdu beaucoup de sang, recouvra un peu tard l’usage complet de ses éminentes facultés et, ouvrant les yeux à la lumière du jour, resta tout hébété pendant un bon moment jusqu’à ce que sa langue retrouve le don de la faconde.
- Pendez-le, dit-il. Qu’on nous le donne ! on va le jeter par là et nous, on va faire justice. Tuons d’abord les gardes à cheval, puis, après, lui… Ne poussez pas messieurs. Tapez là où ça fait mal. Pique par en bas, toi… Agustinillo, et moi, avec cet instrument, je vais lui viser le milieu du nez. Sacrebleu ! Qui est-ce qui lance des pierres ?… Je suis mort !
- Non, vilaine herbe, tu es bien vivant, dit don Celestino en lui appliquant un bandeau sur la plaie. Regarde ce que je t’ai mis devant. C’est une bouteille, de tes préférées, ivrogne : elle sera à toi quand tu iras mieux, si tu promets de ne pas dire de bêtises.
Ensuite, il nous demanda dans quel genre de bagarre il avait reçu ce coup funeste et, Lopito et moi, chacun selon sa manière et son style, nous racontâmes ce qui s’était passé, la découverte du Prince, son emprisonnement et son supplice dans les rues de la ville.
- Je vais là-bas immédiatement, s’écria hors de lui, don Celestino. C’est mon bienfaiteur, mon ami, mon compatriote et je crois même un peu mon parent. Comment puis-je le protéger dans sa mésaventure ?
On voulut le dissuader d’une si périlleuse intention ; mais lui ne voyant pas les obstacles ni même le risque qu’il courait, rendait publics de manière notoire ses sentiments humanitaires en faveur du malheureux favori. Il n’entendait pas raison et, après avoir laissé Santurrias bien bandé et quelque peu remis de son malaise, il prit son manteau, s’habilla à toute vitesse et s’en alla en direction de la caserne.
- Ne vous exposez pas, lui disais-je en cours de chemin. Ecoutez, ce sont des barbares, et dès que vous allez dire que vous êtes ami du Prince, ils ne vont respecter ni vos cheveux blancs ni votre habit.
- Eh bien, qu’ils me tuent ! répondit-il. Je veux voir le Prince… Quand je pense comme il m’aimait ce brave monsieur… Ah ! Gabrielillo, ce qui se passe est épouvantable, c’est un cri vers le ciel. Passe encore qu’il y ait quelques mécontents de son gouvernement ; passe encore que les autres le prennent pour un mauvais ministre, même si, moi, je trouve que c’est le meilleur qu’on ait eu depuis bien longtemps ; on peut pardonner à ses ennemis de vouloir le renverser et de l’insulter ; on comprend que ces dits ennemis, en un moment de colère, l’attrapent, l’arrêtent, le pendent ; mais mon garçon, que ceux qui font ça soient ceux-là mêmes à qui il a fait tant de bien, ceux qu’il a sortis de la misère, ceux qui de matelots sont devenus capitaines, et de gratte-papier sont devenus ministres, ceux qui ont vécu à ses côtés et ont mangé sur les mêmes nappes, ceux qui l’ont adulé en vers et en prose… Ah ! cela n’est pas pardonnable et encore moins si on considère qu’ils se sont servis pour cela des laquais, des cuisiniers et des domestiques de messieurs les Infants… Ah ! mon garçon, j’ai l’impression de voir la couronne d’Espagne promenée par les rustres et les majos sur la pointe de leurs ignobles gourdins.
Nous arrivâmes à la caserne dont la porte était bloquée par la populace ; don Celestino se fit ouvrir un passage difficilement. Quelques-uns demandèrent sournoisement : «Où va le brave père ?» et lui, donnant du coude à gauche et à droite, répétait : «Je veux voir ce malheureux, c’est mon ami, mon bienfaiteur.»
Ces paroles furent très mal reçues ; mais, à la fin, le traditionnel respect qu’a le peuple espagnol pour les prêtres fit plus que la passion enthousiaste de la foule.
- Mes enfants, leur disait-il, soyez charitables, ne soyez pas cruels, pas même envers vos ennemis.
La foule s’amadoua et don Celestino put se faire ouvrir un passage entre deux rangées de gourdins, couteaux et fusils, sabres et poings vigoureux qui s’écartaient pour le laisser passer. Moi, j’étais effrayé en le voyant au milieu de tous ces gens et ma vive inquiétude ne fut vraiment calmée qu’en le retrouvant sain et sauf à l’intérieur de la caserne.
Et les quatre enfants de Santurrias continuaient à sonner les cloches pour appeler au sermon ou à complies et l’église se remplissait de vieilles qui, en prenant de l’eau bénite, se saluaient en disant : «Je crois que tout n’est pas fini et qu’on va avoir cet après-midi, une autre tournée.» Et le second acolyte, croyant que c’était pour de bon, alluma l’autel, prépara les habits et ouvrit les livres saints. Trois heures sonnèrent, trois heures et demie, quatre, quatre heures et demie et le curé ne venait pas et les vieilles s’impatientaient et le second acolyte devenait fou et les quatre enfants de Santurrias continuaient à sonner.
Moi aussi, j’allai à l’église et, assis sur un banc, je méditai tranquillement sur l’instabilité des gloires humaines, jusqu’à ce qu’enfin, voyant que l’impatience des vieilles était à son comble et qu’elles commençaient à entamer des dialogues pittoresques pour tuer l’ennui, je sorte à la recherche de mon ami. Je le trouvai juste au moment où il revenait de la caserne. Son visage était cadavérique, son parler tout tremblant.
- Ah ! Gabriel ! me dit-il. Je reviens, perclus de douleur. Sur un peu de paille pourrie, couvert de sang, demandant la mort à grands cris, j’ai vu celui qui gouvernait encore hier deux mondes. Pas une âme compatissante pour l’approcher et le consoler. Hier, cent mille soldats lui obéissaient, aujourd’hui, même les fourriers se moquent de sa misère. Je ne croyais pas qu’on pouvait tout perdre si vite ; mais, ah ! mon garçon, l’homme est ainsi. Il adore les chutes et le jour où tombe à terre le puissant est toujours un jour de bonheur.
- Calmez-vous, lui dis-je. Vous ne devez pas vous rappeler que vous avez fait sonner les cloches pour un sermon et pour l’office. L’église est pleine de gens. Il faut absolument monter en chaire.
- Je lui ai parlé, continua-t-il sans faire cas de ce que je venais de dire. Mon cœur en est brisé en me souvenant de cela. Depuis avant-hier soir jusqu’à ce matin, il était dans un grenier, enveloppé dans un sac de jute, mort de faim et de soif. La fièvre horrible le dévorait à tel point qu’il a préféré mourir. C’est pour cela qu’il est sorti, le malheureux. Mon pauvre ami ! Je lui ai dit : «Monsieur, si chacun de ceux qui ont reçu un bienfait de votre Altesse vous avait versé une goutte d’eau dans la bouche, votre soif aurait été étanchée.» Il me regarda avec une expression de reconnaissance et ne dit rien, mais moi, j’en avais les larmes aux yeux. Tout ça a été l’œuvre du Prince des Asturies et de ses amis. C’est tout vu. Quand le Prince est allé, sur ordre de son père, calmer le peuple pour ne pas lyncher le malheureux prisonnier, les conspirateurs l’acclamaient et lui obéissaient. Et cela ne va pas s’arrêter là. Ils veulent l’abdication du Roi et, voyant que cela ne va pas être facile à obtenir, ils essaient d’irriter la populace pour que don Carlos prenne peur et abandonne la couronne. Ils ont alors mis une voiture de bêtes de somme et le peuple, bêtement, a cru qu’on allait mettre le prisonnier à l’abri sur ordre du Roi. Comme on peut facilement tromper ces pauvres malheureux ! L’astuce a bien fonctionné parce que la foule a détruit la carriole et, ensuite, est accourue au Palais en criant : «Vive Fernando VII.»
- Vous m’expliquerez tout cela tranquillement, répondis-je. Maintenant, préparez-vous pour aller à l’église où vous attend une foule de femmes respectables.
- Qu’est-ce que tu dis ? Il n’y a pas de sermon cet après-midi…
- C’est vous qui avez demandé aux garçons de sonner les cloches…
- C’est vrai, quelle erreur ! dit-il, tout confus. Et les voilà ces braves femmes, doña Robustiana, doña Gumersinda, doña Nicolasa, la femme de l’écrivain. Oh ! Que va dire Nicolasa si je ne prêche pas ?
- Il faut que vous fassiez un effort.
- Mais, je n’ai pas d’idées, je ne sais pas quoi dire. Je ne peux écarter de mon esprit le spectacle que je viens de voir. Ah ! Comme il m’aimait ! Si tu avais vu comment il m’a serré la main ! Moi, je pleurais à chaudes larmes. Je lui dois tout. Il a été mon protecteur, il m’a donné ce bénéfice après quatorze ans de réclamation, immédiatement, comme on dit. Et le mieux, c’est que tout cela est sans mérite de ma part… Je ne peux pas prêcher… je suis étourdi… Ces damnés gamins n’arrêtent pas de sonner pour le sermon… Oh ! Il faut que je fasse un effort.
Don Celestino, comprenant la nécessité de ne pas fâcher ses fidèles, entra dans son église, pria un peu et se recueillit. Ensuite, il monta en chaire et prêcha un sermon sur l’ingratitude.
Toutes les vieilles pleurèrent.
– XIII –
Il faisait déjà nuit quand on me prévint qu’à dix heures une voiture partait pour Madrid. Je résolus de m’en aller et, pour occuper le temps jusqu’à l’heure du départ, j’allai à la taverne. Comme les jours précédents, les gens étaient très nombreux, les habits pittoresques et variés, les voix animées (bien que déjà enrouées par le patriotisme), les gestes parlants, les coups de pieds classiques, les pincements distribués à Mariminguilla infinis, le vin plus coupé d’eau que la veille car Aranjuez jouit encore des bienfaits de deux rivières abondantes.
Lopito et Cuarta y Media m’invitèrent par de grands gestes enthousiastes à boire et le premier de ces hommes politiques cohérents me dit :
- Aujourd’hui, on s’est vraiment distingué, Gabrielillo. Voilà que monsieur Cuarta y Media me dit que cette nuit, on installe le Prince des Asturies de sorte que nous devons aller crier des vivats au balcon.
Pujitos attira mon attention, disant qu’il pensait organiser une compagnie de bons Espagnols pour défiler devant le Palais, en formation martiale comme la troupe, avec l’intention de faire voir aux Souverains que le peuple sait faire demi-tour gauche comme l’armée. Quelle vocation ! Quel génie ! Quelle vision de l’avenir ! Je répondis à Pujitos que je ne pouvais pas faire partie d’une si brillante armée car je comptais abandonner le Site cette nuit même.
Il faisait noir. Mariminguilla prit le chandelier à quatre branches pour illuminer la scène tout entière même faiblement, et je me trouvais encore là quand l’heureuse nouvelle tant attendue arriva. Quelques-uns entrèrent en la donnant mais on ne les crut pas ; d’autres sortirent vérifier et revinrent peu de temps après confirmant la splendide nouvelle ; et enfin un groupe, le plus bruyant, le plus délinquant, le plus compromis de tous les groupes de ces jours-ci, la troupe des cuisiniers habillés en paysans de la Mancha, et en marmitons devenus majos, entra annonçant à coups de pied, coups de mains, hurlements et ruades que la couronne d’Espagne était passée de la tête du père à celle du fils. On ne cessait de donner raison à ces petits anges en s’enthousiasmant parce qu’apparemment, ce sont eux qui avaient tout fait.
Une fois communiquée la nouvelle par une si brillante pléiade, cela ne pouvait être que vrai, et la preuve que ces patres conscripti y croyaient, c’étaient les mille morceaux de verre cassé au moment de la prise de conscience du changement de monarque. Mariminguilla aussi, avait sur ses bras les signes évidents du bruyant fernandiste car les pincements redoublèrent. La foule, encouragée par Pujitos, partit aux abords du Palais demander que le nouveau Roi sorte afin de l’applaudir et la taverne se vida en deux minutes. Le peuple et les soldats, les femmes et les enfants, tous s’unirent au joyeux escadron ; leurs pas étaient une marche et une danse et une course et en même temps un cri de joie, qui m’auraient effrayé si moi, j’avais été le Prince, en l’honneur duquel les gorges humidifiées par le vin frauduleux du père Malayerba avaient entonné un hymne si discordant.
Je ne voulus pas voir ni entendre cela et je m’en allai prendre congé de l’incomparable don Celestino que je trouvai dans la pièce de Santurrias, occupé encore à appliquer des emplâtres et des soins sur ses blessures. Après avoir mis fin à cette opération, il s’occupa de faire coucher les quatre sonneurs de cloches qui, fatigués par la tâche de ce jour, gisaient à moitié endormis sur le sol. Il fallut les déshabiller comme des corps morts et, en même temps, les faire manger la soupe d’ail que la mère Gila leur avait apportée dans une grande casserole. Don Celestino, prenant sur ses genoux le plus petit de ces diablotins, lui approchait la cuillère de la bouche et s’efforçait de l’introduire entre les dents serrées. Ensuite, essayant de le réveiller, il disait :
- On va maintenant prier tous ensemble le Notre Père. Si tu savais, Gabrielillo, ce qu’ils m’en ont fait voir, ces quatre diablotins ! L’un m’accrochait des bouts de papier à ma soutane, l’autre tendait une corde entre le lit et la table pour qu’en passant, je me prenne les pieds dedans et je tombe par terre, l’autre chauffa la clé du placard et je me suis brûlé les doigts quand j’ai voulu l’ouvrir et, enfin, ils ont fait un bonhomme avec mon chapeau et l’ont appelé le Prince de la Paix, et, après l’avoir traîné dans la cour, ils allaient le mettre dans le foyer pour le brûler. Heureusement, la mère Gila est arrivée à temps. Mais, que faire, s’il n’y a pas d’autorité et si on n’obéit pas aux supérieurs ! J’ai l’impression que vont venir des temps calamiteux. Si chacun, quand ça lui plaît de se débarrasser d’un ministre, fait sortir les cochers des princes avec je ne sais combien de douzaines de laboureurs et de soldats de la garnison, soudoyés à l’avance, on peut s’attendre à tout. Gabriel, ici, entre nous, n’est-ce pas incorrect, humiliant et indigne qu’un Prince des Asturies arrache la couronne de la tête de son père, sous la menace des aboiements de laquais maladroits, de ploucs ignorants, de forgerons barbares et de la soldatesque stupide et corrompue ? Ah ! si je n’étais pas un homme si bête, j’aurais dit au Prince de la Paix ce qui se tramait ; si lui, suivant mes conseils, en avait mis à l’ombre deux ou trois voyous comme Santurrias et bien d’autres…Parce que, crois-moi, mon garçon, cet ivrogne est, d’après ce qu’on m’a dit, celui qui a débauché la moitié de la ville pour faire partie de ce vacarme… bien entendu, il y a eu de l’argent à circuler. Moi, volontiers, je punirais un garçon comme cet exécrable et perfide sacristain ; mais comment enlever le pain à un veuf et à ses quatre enfants ? Tu vois, j’en ai le cœur retourné de voir que ces petits anges courent les rues à demander l’aumône… Ce que je t’ai dit est certain… Le peuple, cette foule qui demande des choses sans savoir ce qu’ils demandent, et crie «Vive ça et encore ça !» sans avoir jamais étudié, c’est une calamité des nations, et moi, si j’étais roi, je ferais le contraire de ce que veut le peuple. La meilleure chose faite par le peuple est toujours mauvaise. C’est pourquoi, je répète toujours le grand auteur latin : Odi profanum vulgus et arceo, et arceo, et je le mets de côté… et arceo, et je le jette loin de moi… et arceo, et je ne veux rien savoir de lui.
Une fois terminée cette philippique, il me prit dans ses bras, me souhaitant mille bonheurs, me faisant jurer de le mettre au courant de manière précise de la situation d’Inès. Je partis enfin de la maison et de la ville et, quand la voiture qui me conduisait passa sur la place de San Antonio, j’entendis le brouhaha du peuple regroupé devant le Palais. Ses cris formaient une clameur retentissante qui faisait se taire de stupeur les grenouilles des étangs et effrayaient les grillons car les unes et les autres méconnaissaient cette monstruosité sonore qui, si soudainement, leur avait ôté la parole.
Le peuple applaudissait le nouveau Roi ; le plan conçu dans les antichambres du Palais avait été mis à exécution avec le succès le plus flatteur. Tout était fait et les courtisans qui, des balcons, contemplaient avec mépris l’enthousiasme de la bête, aussi brutale dans sa haine que dans sa joie, ne contenaient pas leur satisfaction, croyant avoir réalisé un grand prodige. Dans leur ignorance et leur bêtise, il ne leur venait pas à l’idée qu’ils avaient enlaidi le trône, faisant croire à Napoléon qu’une nation où des princes et des rois jouaient la couronne à pile ou face sur la cape trouée d’une populace, ne pouvait pas être invincible.
Avant d’être bien engagé dans la rue Larga, nous ne cessâmes d’entendre les cris. Ce fut la première mutinerie à laquelle j’avais assisté de ma vie et, malgré mes jeunes années, j’ai la satisfaction de n’avoir jamais sympathisé avec elle. Après j’en ai vu beaucoup, presque toutes mises à exécution par les mêmes éléments que cette fameuse mutinerie, première page du livre de nos révolutions contemporaines et je dois avouer que sans ces divertissements périodiques qui coûtent beaucoup de sang et pas moins d’argent, l’histoire moderne de l’héroïque Espagne serait essentiellement ennuyeuse.
Les années passent, les révolutions se succèdent, faites sous les ordres de grands hommes et par le peuple, sans que tout ce qu’il y a au milieu de ces extrêmes ne prenne la peine de faire sentir son existence. C’est pourquoi, à quatre-vingt-deux ans, ce que je dis aujourd’hui à mes quelques amis lors de nos réunions au café de Pombo, j’entends avec satisfaction qu’ils pensent la même chose que moi. Don Antero, progressiste vacciné, raconte la bêtise de O’Donnell en 56 ; don Buenaventura Luchana, progressiste fossile, fait dépendre tous les maux de l’Espagne de la chute d’Espartero en 43 ; don Aniceto Burguillos, qui fit partie de la Garde Royale au temps de María Cristina, se lamente de la chute du Statut[1]. Des jeunes étudiants, quelques capitaines et lieutenants d’infanterie se rassemblent près de notre table, ainsi que de nombreux parasites qui peuplent les cafés, prouvant que les prétendants sont aussi pénibles que les chômeurs. Tous nous prient de leur raconter quelque chose des bonheurs passés pour l’édification de l’âge présent et, sans se faire prier, don Antero raconte l’époque de la révolution de 56, don Buenaventura s’émeut un peu et raconte celle de 43, don Aniceto donne douze coups de poings sur la table, tandis qu’il raconte celle de 36 et moi, trempant un morceau de sucre pour le sucer ensuite, je leur dis sur un ton moqueur que je ne peux y échapper : «Vous avez vu plein de bonnes choses ; vous avez vu celle des grands soldats, celle des grands civils et celle des sergents ; mais vous n’avez pas vu celle des laquais et des cochers, ce fut la première, la toute première et de loin la plus savoureuse de toutes.»
– XIV –
Je suis un peu fatigué ; mais il faut que je continue à vous raconter. Vous êtes impatients de savoir ce qu’est devenue Inès ; je le sais, et c’est bien normal de ne pas l’oublier.
J’arrivai donc à Madrid très tôt et après avoir déposé mes bagages dans la maison qui avait l’honneur de m’héberger (rue San José, n° 12, face à la caserne de Monteleón), je fis un brin de toilette et je sortis dans la rue, résolu à visiter Inès chez son oncle et sa tante. Mais en chemin, il me vint à l’idée de ne pas me présenter chez ces gens-là sans m’informer d’abord sur leur véritable condition et caractère. Par chance, je connaissais un maître bourrelier installé dans la rue la Zapatería de Viejo, tout proche de la rue la Sal et je résolus de m’adresser à lui pour demander plus d’information sur ce monsieur Requejo.
Quand j’entrai par la rue Postas, mon émotion était très intense et, quand je vis la maison où demeurait Inès, les jambes se dérobèrent sous moi parce que la vie m’arrivait tout d’un coup au cœur. La boutique des Requejo était dans la rue la Sal, faisant le coin avec la rue Postas. Il y avait deux portes donnant sur les deux rues. Sur l’enseigne verte, on pouvait lire :»Mauro Requejo», inscription peinte en lettres jaunes et, des deux côtés de l’entrée, ainsi que de la bâche déchirée, pendaient des morceaux de toile, des ceintures de laine, des bas de laine, des mouchoirs de diverses tailles et de différentes couleurs. Comme la porte n’avait pas de vitres, je tournai le regard discrètement à l’intérieur et je vis plusieurs femmes à qui un homme jaune et maigre montrait des tissus, cet homme était à coup sûr le commis de la boutique. Au fond de la pièce, il y avait un Saint Antoine, patron sans doute de ce genre de commerce, encadré par deux bougies éteintes et, à droite du comptoir, une sorte de balustrade de bois, ressemblant à une grille derrière laquelle un homme en manches de chemise semblait tenir des comptes dans un livre. C’était Requejo ; vu à travers les barreaux, on aurait dit un ours en cage.
Je m’écartai de la porte et levai les yeux pour voir une autre enseigne placée à la fenêtre de l’entresol qui disait : «Prêts contre bijoux». A la fenêtre où apparaissait un appel si réconfortant, il n’y avait ni fleurs, ni cage à oiseaux, juste une multitude de capes qui respiraient hygiéniquement l’air matinal par les raccommodages et les trous de vermines. Derrière les vitres pendait un rideau crasseux. J’observai qu’une main écarta le rideau ; je vis la main puis un bras et un visage. Mon Dieu ! C’était Inès. Je la vis et elle me vit. J’eus l’impression que ses yeux exprimaient un je ne sais quoi de terreur et de joie. Ce rayon de lumière dura une seconde. Le rideau tomba et je ne la vis plus.
Cela aviva en moi le désir d’entrer. Comment est-ce que cela pouvait être les commodités, le luxe, les richesses que promettaient les Requejo au cours de leur visite inoubliable ? Pour écarter toute sorte de doute, je tournai au coin et je bombardai de questions le bourrelier.
- Ce Requejo, me dit-il, c’est l’animal de la pire espèce que j’aie jamais vu. Il est riche, mais on voit bien… ; dans une maison où on ne mange pas, il doit bien y avoir de l’argent. Parce qu’il faut que tu saches que, dans le quartier, le bruit court que lui s’alimente des chairs de sa sœur et sa sœur de celles du commis, c’est pourquoi elle est comme un cierge. Et attention, ils ont de l’argent ces bougres !… Avec la boutique et la maison des prêts, ils font leur beurre. C’est vrai que les vêtements ne représentent que le quart de leur valeur, avec l’intérêt à deux pésètes par douro chaque mois. Quand ils prennent des draps fins et de la vaisselle, ils donnent une once, avec un intérêt de quatre douros par mois. A la boutique, ils font crédit aux vendeurs qui vont dans les villages ; mais ils touchent quatre pésètes et demie par douro vendu. On dit que lorsque doña Restituta entre dans l’église, elle vole les morceaux de bougie pour s’éclairer la nuit et quand elle va sur la place, tous les trois jours, elle achète une tête de mouton et le suif qui va avec pour faire bouillir la marmite et ils vivent de cela en plus des légumes. Une fois l’an, ils vont au troquet et, là, ils demandent deux cafés. Ils boivent un peu, et le reste, elle le verse, elle, discrètement dans une cruche qu’elle a, cachée sous ses vêtements et elle rapporte ce café chez eux et, en y ajoutant de l’eau, ils le font durer huit jours. Ils font la même chose avec le chocolat. Don Mauro est un vaniteux et il dépenserait plus si sa sœur ne l’avait sous sa coupe comme on dit. Elle a les clés de tout et ne sort jamais de chez elle de peur qu’on ne la vole ; la maison est quelque chose d’attirant pour les voleurs parce qu’on dit que c’est dans la cave que se trouve le coffre de l’argent.
Ces nouvelles confirmèrent l’opinion que je m’étais forgée de la famille d’Inès. Je fus tout d’abord très chagriné en entendant le panégyrique de ces deux personnages car j’avais la certitude qu’il ne me serait pas facile de m’introduire et encore moins de lier amitié avec leurs propriétaires. Je pensais tristement à tout cela quand je me souvins d’une annonce que j’avais composée bien des fois dans l’imprimerie du Diario et qui disait : «On cherche un jeune homme de dix-sept ou dix-huit ans, qui sache compter, raser, coiffer un peu, les hommes seulement, et cuisiner au besoin. Celui qui remplirait ces conditions et de bonnes informations en plus, peut se présenter à la rue la Sal, au numéro 5, face aux marchands de peignes, place du marchand de laine et de tissu de don Mauro Requejo, où on discutera salaire et autre.»
Je courus à l’imprimerie du Diario voir si cette annonce était toujours insérée et j’eus le plaisir de savoir que les Requejo n’avaient pas trouvé quelqu’un pour se mettre à leur service. J’abandonnai ma profession de compositeur d’imprimerie et, sans consulter personne, car personne ne m’aurait compris, je me présentai à la maison de la rue la Sal, me déclarant possesseur des qualités requises dans l’annonce.
Mon unique crainte était que les Requejo se souviennent m’avoir vu à Aranjuez et aient des soupçons pour me prendre à leur service ; mais Dieu, qui sans doute protégeait ma bonne action, permit que ni l’un ni l’autre ne me reconnut, et si doña Restituta me regarda immédiatement avec une certaine expression soupçonneuse et comme se disant : «J’ai déjà vu cette tête quelque part», ce fut sans doute une pensée fugace qui ne fut pas décisive et ne mit pas d’empêchements à mon admission.
Quand j’entrai dans la boutique, la première personne à qui j’exposai mes demandes fut don Mauro. Il abandonna un vieux livre où il écrivait des chiffres tordus, se gratta les coudes et me dit :
- On va voir si tu fais l’affaire. En un mois, il en est venu au moins cinquante ; mais ils demandent trop d’argent. Comme aujourd’hui ils veulent tous se considérer comme des messieurs…
Appelée par son frère, doña Restituta se présenta et c’est à ce moment-là qu’elle me regarda comme je l’ai dit plus haut.
- Tu sais, me demanda la tante d’Inès, ce que nous donnons ici au commis ? Eh bien, nous le nourrissons et lui donnons douze réaux par mois. Ailleurs, ils donnent beaucoup moins, oui monsieur, chez Cobos, après les avoir tués par la faim, ils leur donnent huit réaux, et merci. Donc, mon garçon, tu restes ?
Je fis mine de trouver que ça faisait peu, j’essayai même de marchander pour qu’on ne découvre pas mon intention et pour finir, je dis que me trouvant sans ressources, j’acceptais ce qu’on m’offrait. Quant aux renseignements qu’ils exigeaient, il me fut facile de les obtenir grâce à une recommandation du régent du Diario.
- Douze réaux par mois plus la nourriture, répéta doña Restituta, croyant sans doute, vu mon accord, qu’elle m’avait trop offert. La nourriture oui, c’est ça l’important.
Ah ! Le lecteur ne sait pas encore tout le sarcasme enfermé dans ce mot «nourriture».
- Evidemment, dit Requejo, ici, on vient pour travailler. On verra bien si tu t’y connais en tout ce qu’il faut. Ici, on marche droit, oui, monsieur, parce que sinon… Regarde-moi bien ! moi aussi j’étais un traîne-misère comme toi, et à la fin… par mon honnêteté et mon…
- L’économie, c’est ça l’important, ajouta la sœur. Gabriel, prends le balai et balaye le magasin intérieur. Ensuite tu iras porter ces paquets à l’auberge de la rue Carnero ; ensuite tu copieras les comptes ; après tu laveras le dallage de la cuisine avant de peler les pommes de terre et il te restera quelque temps pour battre les capes, allumer le feu, souffler dessus, dévider le fil de la couture, mettre les numéros sur les bouts de papier, préparer la lampe, épousseter, cirer les chaussures de mon frère et tout ce qui se présentera.
– XV –
Immédiatement, je commençai les tâches indiquées, prenant soin de mettre tout le zèle possible pour satisfaire mes généreux patrons. Je dois avant tout faire connaître la maison où je me trouvais. La boutique, qui était déjà toute petite, était la pièce la plus spacieuse et la plus claire de toute cette triste demeure, un des nombreux trous où le commerce du vieux Madrid réalisait ses opérations. L’arrière-boutique faisait magasin en même temps que salle à manger et les paquets de mouchoirs et de laines servaient de buffet pour la poterie, dont le brillant se couvrait jour après jour de couches de poussière répétées. Tous les articles de commerce étaient réunis là et empilés dans un certain ordre. Les Requejo vendaient des tissus de laine ou de coton, c’est-à-dire des mouchoirs du Béarn, tissu très courant à l’époque, du percal anglais, qui défiait, à la frontière portugaise, les douanes du blocus continental, des articles de laine des fabriques de Béjar et de Segovie, quelques soieries de Talavera et de Tolède ; et enfin, comme don Mauro voyait que ses affaires marchaient toujours à souhait, il se mit dans les océans de la parfumerie, article éminemment lucratif. C’est ainsi que, outre les articles cités, il y avait, dans l’arrière boutique, une multitude de caisses qui contenaient des poudres fines, des pommades et des eaux aux odeurs infiniment variées, par exemple : odeurs de citron, de thym, de bergamote, de tabac aromatisé au musc, d’œillet, de musc, de lavande, de plantes médicinales, d’eau-de-vie et beaucoup d’autres. Comme le local où l’on gardait tous ces articles servait de salle à manger, vous pouvez imaginer les répugnants mélanges d’odeurs qui émanaient de toutes ces substances, aussi diverses qu’un vêtement de laine teint en blond, un flacon de vinaigre du Prince et une casserole de mie de pain ; mais les Requejo étaient habitués depuis longtemps à cette répugnante association d’odeurs disparates.
De l’arrière-boutique, on montait à l’entresol par un escalier construit, je suppose, par un très savant maître en gymnastique car vous ne vous imaginez pas les contorsions, les plis, les gesticulations et les mille tortures auxquelles il fallait se soumettre pour faire monter le fragile tas d’argile qu’est notre corps. Seule l’immatérielle doña Restituta passait par ces écueils aériens sans aucun dommage. Elle montait et descendait avec une singulière légèreté ; et comme par un don spécial accordé à elle seule, on ne l’entendait pas marcher, chaque fois que je la voyais glisser par cet escalier problématique, ses pas ne paraissaient point des pas, mais les cambrures ondulantes et glissantes d’une couleuvre.
Quand, une fois franchi l’escalier, on arrivait à l’entresol, il fallait faire un calcul mathématique pour savoir quelle direction prendre car le voyageur se trouvait au centre d’un couloir si sombre que, même en plein jour, il n’y entrait qu’une misérable lumière. A tâtons ici et là, on trouvait la porte de la salle, et ici, une fenêtre donnait sur la rue Postas, et bien entendu, je n’y vis aucun rideau vert avec des branches jaunes, mais un papier décoloré, qui en mille lambeaux, se tortillait de rire sur les murs. Un comptoir noir, très semblable aux petites tables, sur lesquelles les frères de la Paix et la Charité demandent l’aumône pour les justiciers, indiquait que, là, il y avait le cachot de la misère et l’autel de l’usure. Effectivement, un encrier à plume d’oie, plume de mauvaise qualité, servait à couvrir les bouts de papier, dont quelques-uns attendaient sur la table la victime désirée. Une commode et plusieurs coffres, protégés par des barreaux, étaient la Bastille des bijoux et l’Alger des linges fins. Les capes, draps et vêtements étaient dans la salle d’à-côté qui, de plus, avait le privilège de protéger le chaste sommeil du maître de la maison.
Outre cette salle, il y en avait une autre avec fenêtre qui donnait sur la rue la Sal, qui n’avait rien à envier à la salle antérieure en luxe et en meubles exquis car ses sièges de paille, ornés de festons voyants et si aériens que chaque pièce semblait prête à tomber d’elle-même, n’auraient pas trouvé acquéreurs même au Rastro. Dans cette salle, se trouvait l’atelier. L’atelier de quoi ? Les Requejo avaient trois industries : la vente, le prêt et la confection de chemises, qui, durant les jours auxquels je fais allusion, étaient coupées par doña Restituta et cousues par Inès. C’est là qu’était Inès, depuis cinq heures du matin jusqu’à onze heures du soir ; elle travaillait sans arrêt au bénéfice de la sordide avarice de sa famille. Un ordre express de doña Restituta l’empêchait de sortir de cette salle ; elle ne descendait pas à l’arrière-boutique sauf à l’heure du repas ; on ne lui permettait pas de se montrer à la fenêtre ; on ne lui permettait ni de chanter ni de lire ; on ne lui permettait ni de se distraire de son travail pérenne ni de mentionner son oncle, ni d’évoquer sa mère, ni de parler de rien d’autre que de l’honnêteté des Requejo et la longanimité des Requejo.
Mais, continuons la description de la maison. Dans une chambre intérieure, autrement dit une caverne, il y avait la chambre à coucher de la tante et de sa nièce, et, au fond du couloir, près de la cuisine s’ouvrait ma chambre, c’était une grande salle de deux mètres cinquante de long sur un et demi de large, avec une ouverture immense guère plus petite que la paume de ma main, et par cette clairevoie entraient, d’une cour mitoyenne, quelques rayons de lumière intrus qui s’évadaient au bout d’un quart d’heure après être passés comme des messieurs sur le mur d’en face. Mes meubles étaient un matelas moelleux de feuilles de maïs et une caisse vide qui me servait de pupitre, de table, de chaise, de commode et de sofa. Semblable trousseau était en réalité plus que suffisant et quant à la dense et providentielle obscurité qui enveloppait la maison d’un nuage perpétuel, elle me semblait faite exprès dans mon intention.
L’entresol communiquait par l’escalier général de la maison, partant majestueusement de la porte d’entrée même et, dans son grandiose départ de trois quarts avait un espace suffisant pour que, mathématiquement parlant, il soit impossible qu’une personne qui monte puisse croiser une autre occupée à la difficile tâche de descendre. Par ce tunnel ascendant devaient entrer ceux qui allaient engager quelque chose, et c’était en quelque sorte un passage symbolique et l’expression architecturale exacte des angoisses de l’âme misérable aux moments critiques de la vie. On pouvait bien l’appeler l’escalier des soupirs.
Je ne dois pas laisser sous silence que, dans la maison des Requejo, il y avait une certaine propreté, même si tout bien considéré, c’était la propreté de tous les lieux où il n’y a rien, exemple, la propreté de la table où on ne mange pas, de la cuisine où on ne cuisine pas, du couloir où on ne court pas, de la salle où n’entre aucun visiteur, la diaphanéité du verre où n’entre que de l’eau.
Il n’y avait là ni chiens ni chats, aucun animal, sauf les souris que don Mauro poursuivait avec un chat de fer, c’est-à-dire une souricière. Les malheureuses qui y tombaient étaient si maigres qu’on voyait bien qu’elles ne se nourrissaient que de parfums. Un chien aurait mangé beaucoup ; un chardonneret aurait nécessité plus de rentes qu’un évêque ; une perdrix aurait signifié jeter l’argent par les fenêtres ; les fleurs coûtent cher et en plus, l’eau… La faune et la flore furent donc, pour ces raisons, proscrites et pour admirer la création de l’Etre Suprême, les Requejo se limitaient à eux-mêmes.
Il me faut maintenant que je parle d’un autre être qui habitait la maison pendant le jour : je veux dire le commis.
Cet homme-là était un homme coagulé, je veux dire qu’il semblait s’être arrêté à un point de son existence, renonçant aux transformations progressives du corps et de l’âme. Juan de Dios offrait l’aspect des gens de trente ans, même s’il frisait les quarante. Son visage jaune avait une grande ressemblance avec celui de doña Restituta, mais jamais on n’y nota les contractions, les rougissements soudains, propres à cette dame. Il avait des gestes lents et rythmés, sa mobilité avait des limites fixes comme celles d’une machine et, si on peut parfaitement exprimer sa pensée dans les actes de l’organisme humain, Juan de Dios avait réalisé ce prodige. Arriver, ouvrir la boutique, la balayer, couper les plumes, pendre les pièces de toiles à la porte, recevoir l’acheteur, lui dire le prix, marchander toujours avec les mêmes mots, mesurer et couper le tissu, faire payer, compter l’argent le soir, mettant à part l’or, l’argent et le cuivre, telles étaient ses fonctions et telles étaient ses fonctions depuis vingt ans.
Juan de Dios mangeait chez les Requejo qu’ils traitaient comme un frère. Il les servait avec une fidélité incomparable et, si eux avaient confiance en quelqu’un, c’était bien en leur commis. Cinq ans avant mon arrivée dans cette maison, la tête organisatrice et géniale de don Mauro Requejo conçut un projet gigantesque, semblable à ceux qui, de siècle en siècle, transforment la face de la lignée humaine. Don Mauro, après avoir fait les comptes du jour, se gratta les coudes, se donna un coup sur le front serein, fit apparaître le blanc de ses yeux, se mit à rire bêtement, appela sa sœur à part et lui dit :
- Tu sais ce que je suis en train de penser ? Eh bien, je pense que tu devrais te marier avec Juan de Dios.
L’histoire dit que doña Restituta souleva les sourcils, porta un doigt au menton, inclina le regard lumineux vers le sol et pensa.
- Eh bien, oui, continua Requejo ; Juan de Dios est travailleur, économe, il comprend le commerce, et en ce qui concerne l’honnêteté, je crois que, nous à part, il n’y a personne au monde de meilleur. Moi, je ne pense pas me remarier et si nous voulons avoir des héritiers, je ne sais comme nous allons nous débrouiller.
Le commis fut mis au courant du projet et dès lors il y eut entre les deux promis, une communication amoureuse, dont je ne parle pas à mes lecteurs parce que je n’arrive pas à imaginer ce que ça pourrait être, même si je me creuse la cervelle. Ils durent sans doute traiter de ce sujet comme si le mariage n’était pas l’union de deux corps. Restituta devait penser à se marier et Juan de Dios devait penser à se marier, tous les deux sans peine ni joie, de telle façon que passées les cinq années, ils parlaient du sujet avec indifférence et considéraient l’affaire comme quelque chose de proche. Il semblait que la rapidité du temps qui passe ne leur faisait rien, ces deux êtres enfermés dans une boutique mesuraient sans doute la vie par mètres, sans considérer qu’un jour ils arriveraient à la fin de la pièce. Les deux fiancés étaient de ceux qui se pressent à se marier et finissent par se marier sans que les hommes, Dieu ou le diable ne sachent jamais pourquoi.
– XVI –
Le soir, après souper, nous priions le rosaire que dirigeait le maître de la maison d’une voix beuglante ; et une fois la prière au saint patron terminée, on restait dans l’arrière-boutique à discuter tranquillement pendant une heure et demie, et souvent s’y associaient quelques vieux amis ou voisins tout proches. Le soir de mon inauguration, on ne changea pas la coutume inaltérable. Don Mauro, sa sœur, Juan de Dios, Inès et moi, nous récitions le dernier ora pro nobis quand la cloche de l’entresol sonna et on m’envoya ouvrir.
- C’est notre voisin Lobo, dit ma maîtresse.
Imaginez, lecteurs, quelle fut ma surprise en ouvrant la porte de me trouver face à face avec l’épouvantable silhouette du licencié aux lunettes vertes, celui qui avait voulu m’attraper cinq mois auparavant à l’Escorial. La crainte de me voir reconnu me causa un grand trouble ; mais j’eus la chance que l’illustre gratte-papier ne se préoccupait pas de ma personne. Je ne sais si je vous l’ai dit mais on pouvait voir chez moi la transformation causée par l’âge et une soudaine croissance rendait mon corps plus fort et mon visage plus rond, visage où pointait un léger duvet. C’est sans doute pour cette raison que le licencié Lobo ne me reconnut pas, comme je le craignais.
- Mesdames et messieurs, dit Lobo en s’assoyant sur une caisse de chaussettes, aujourd’hui est un jour de bonheur universel. Notre Roi est enfin sur le trône. Vous n’êtes pas sortis ? Eh bien, Madrid semble sur des braises d’or. Que de prodiges ! Que de drapeaux ! Tous les gens sont dans la rue !
- Nous ne sortons pas voir les luminaires, répondit Requejo, nous avons largement à faire à la maison. Ah ! monsieur de Lobo, le travail ! Ici, il n’y a pas de fainéants, on gagne notre pain quotidien comme Dieu nous l’a demandé.
- Béni soit Dieu ! ajouta le gratte-papier et vive les hommes riches comme don Mauro Requejo qui, à force d’intelligence…
- D’honnêteté, c’est tout, l’honnêteté, dit le boutiquier en se grattant les coudes.
- Vive le commerce ! s’écria Lobo. La plume, monsieur don Mauro, ne fournit même pas les chaussures. Je suis là, moi, depuis vingt-deux ans à ma place du Conseil et Chambre de Castille, et Dieu sait que jusqu’à aujourd’hui, je ne suis pas sorti de la pauvreté. Beaucoup de chaussures usées à trimer et rien de plus. Maintenant, j’espère qu’on va me donner un poste de secrétaire de «la Chambre», ce corps mortel le mérite amplement.
- Comme vous avez servi le favori…
- Non… je vais vous dire… Je ne m’attache pas à des vétilles et j’ai servi le Gouvernement précédent en toute bonne foi et en toute loyauté. Mais, mon ami, qu’est-ce qu’il ne faut pas faire pour ce malheureux petit pois chiche qui nous coûte tant ! Dès que j’ai vu que le Généralissime était aux mains de la Confrérie de la Paix et de la Charité, j’ai fait une requête à celui des Asturies et j’ai écrit huit lettres à don Juan Escóiquiz pour voir s’il peut me trouver un poste de secrétaire de «la Chambre». Je les ai poursuivis lors de la fameuse cause ; mais ils ne s’en souviennent pas et au cas où ils s’en souviendraient, j’ai rédigé une rétractation en bonne et due forme disant qu’on m’avait obligé à faire telle et telle action en me mettant un pistolet sur la poitrine.
- Je n’ai pas vu de fourmi persévérante comme monsieur de Lobo.
- Le peuple espagnol est enchanté de son nouveau Roi ! continua l’officier. On en pleurerait, madame doña Restituta. Là, je suis parti emmener mon Angustias et les filles à la neuvaine de monsieur Saint-Joseph, et après avoir prié le rosaire à San Felipe, nous avons fait un tour dans les rues. Ah ! que c’est drôle ! Il semble qu’on ait brûlé la maison de Godoy, celle de sa mère et de son frère don Diego, ce qui est bien fait parce qu’avec tout ce qu’ils ont volé, il n’y a plus aucune pésète en vue. Après nous être amusés un peu, nous sommes rentrés ; elles se sont arrêtées au 13 chez Corchuelo et moi, je suis venu ici, parler un moment. Mais, j’avais oublié… Inesita, comment allez-vous ? Et vous, monsieur don Juan de Dios ?
Inès répondit brièvement au salut.
- Elle est un peu paresseuse, dit Restituta en regardant l’orpheline avec dédain. Aujourd’hui elle n’a cousu qu’une chemise et demie, c’est vraiment n’importe quoi.
- Eh bien, ça ne me paraît pas mal.
- Ah ! Monsieur de Lobo, ne dites pas que ce n’est pas mal. Ma grand-mère, d’après ce que disait ma mère, faisait la bagatelle de deux chemises. Mais cette gamine est habituée à la paresse ; on voit bien… sa mère ne faisait que traîner les pieds dans les rues… et la petite allait toute la journée ici ou là, je te mets ici, je te laisse là.
- Oui, il faut travailler, dit Requejo parce que, ma petite, le pois chiche, le lard, le pain et les pommes de terre ne tombent pas tout cuits du ciel, et celui qui vient ici se remplir la panse ne peut pas rester à se tourner les pouces. Sinon, faites comme moi qui ai gagné tout ce que j’ai, sou par sou, et quand j’étais jeune, boulot le matin, boulot l’après-midi, boulot à toutes les heures et toujours aussi gros et aussi beau.
- Elle est très habile, affirma Restituta, elle sait coudre, ce qui lui manque c’est la volonté. Ce n’est plus une gamine maintenant, elle a quinze ans accomplis, elle peut bien comprendre ça. A son âge, je dirigeais déjà la maison de mes parents. C’est vrai qu’il n’y en avait pas beaucoup comme moi, et on m’appelait le luminaire de Santiagomillas.
- Eh bien, je crois que la petite Inès est une perle, déclara Lobo avec bienveillance. Et elle est là sans parler, toute modeste, on ne peut que l’aimer.
- C’est bien ce que je lui ai dit quand elle est arrivée ici, continua Restituta, les temps sont durs, on ne gagne pas grand-chose, on ne vend pas beaucoup, et en haut ce n’est que misère. Elle comprendra que nous nous sommes mis une lourde charge en la recueillant, parce que… si vous voyiez monsieur de Lobo, la misère qu’il y avait chez le prêtre d’Aranjuez où était ma nièce ! Ah ! ça crevait le cœur !
- Eh bien, il faut qu’elle travaille, dit don Mauro. Ma nièce est une brave fille et je vous ai déjà dit que je l’adorais. En fin de compte, tout ce qui est dans la maison, c’est pour elle.
- Je le lui ai déjà dit, continua Restituta, demain elle doit laver tout le linge de la maison car, puisqu’elle est là, pourquoi embaucher une lavandière ? Evidemment sans laisser tomber la couture ; et si demain elle en fait plus de vingt mètres, je lui mettrai quelques gouttes de bergamote sur son mouchoir, du parfum des flacons périmés. Ce qu’il y a de bien avec cette fille, monsieur de Lobo, c’est qu’elle ne répond jamais. C’est vrai qu’elle n’est pas très délurée et qu’elle sait bien tout ce qu’elle nous doit, car elle a trouvé en nous son Ange Gardien. Ah ! vous ne pouvez pas imaginer la misère qu’il y avait dans la maison du prêtre d’Aranjuez !…
- Je le connais, oui, dit Lobo montrant en un rire féroce ses dents vertes. C’est un pauvre homme qui faisait des vers latins pour le Prince de la Paix. On va s’occuper de son cas. Il est prouvé que ce don Celestino, avec sa tête d’homme de bien, était l’homme de confiance du favori et il était chargé de la correspondance avec Napoléon pour se répartir l’Espagne.
- Mon Dieu ! Quelle iniquité ! Je me disais bien que cet homme avait une tête de méchant.
- Mais on va lui jouer un bon tour, continua Lobo. Comme la paroisse d’Aranjuez est demandée par un de mes cousins, on va la disputer à don Celestino et, moi et un compagnon, nous allons écrire huit mains de papier timbré qui prouvent que ce monsieur le curé est accusé de lèse-nation.
Pendant qu’ils parlaient je faisais des efforts pour retenir mon indignation. Inès, atterrée par la faconde de son oncle et de sa tante, n’osait pas dire un mot. Juan de Dios en faisait autant ; mais par un phénomène étrange, les traits glacés et tranquilles du commis montraient ce soir-là que ce qu’il entendait ne le laissait pas indifférent.
- On verra bien, répondit Lobo en se frottant les mains. Mais que fait donc là, sans rien dire, notre don Juan de Dios ? Ah ! Restituta, vous allez avoir là un mari bien muet ! Et on ne peut pas dire que vous allez vous disputer pour un mot de trop ou un mot de moins. Et la noce, c’est pour quand ? Allez, courage, du cœur à vous aussi monsieur don Mauro de mon cœur parce que vous voyez bien que la petite le vaut bien. Bon ! le mois qui vient, on passe à l’autel. Restituta avec mon cher monsieur Juan et vous, avec votre chère nièce Inès qui, si je ne m’abuse, a dû prier quelque Notre Père à Saint Antoine pour que ça se réalise.
Tous les regards se tournèrent vers Inès. Don Mauro étira les bras en croix, puis ferma les poings et les leva vers le haut comme s’il voulait toucher le plafond, se décrocha la mâchoire, et laissa ensuite tomber bruyamment ses deux mains sur la table et dit :
- Je le lui ai déjà dit, et c’est vrai que la petite n’a pas encore daigné me répondre.
- Eh bien que veut dire le silence dans ces cas-là ? Comment voulez-vous qu’une petite bien élevée vous dise : «Je veux me marier, mais oui, qu’on me présente un mari» ? Au contraire, c’est la loi qui veut que jusqu’au dernier moment, elles fassent les dégoûtées et qu’elles disent que ça leur fait honte.
- Je te l’ai dit, mon frère, fit remarquer doña Restituta, que, bien que ce soit le destin de cette gamine, si elle se comporte bien, si elle travaille, il n’y a pas lieu encore de traiter de ce sujet. Tu sais bien comment sont les filles, quand elles s’enthousiasment et qu’elles parlent de mariage, on ne les retient plus. Elle, je le sais, elle en sera très contente, mais tu as tort de lui dévoiler trop vite ton grand cœur, elle peut tout mettre par terre, en pensant tous les jours à ce petit amour, aux palabres, aux cadeaux. Ah ! Elle sait bien ce qu’elle fait, la friponne ! Elle sait bien qu’un homme comme toi n’est pas à la portée de toutes les filles de Madrid !
- Et pourquoi ne lui dirais-je pas tout de suite ? répondit Requejo en riant, c’est-à-dire en enclenchant le mécanisme du rire dans cet organisme brut. Ma nièce me plaît ; et même si nous connaissons une bonne quantité de femmes de la haute société qui me demandent et m’adorent, j’ai dit : «Il vaut mieux que tout reste en famille.» Pourquoi ne pas lui dire une bonne fois que je veux me marier avec elle ? Je sais bien qu’elle sera si contente qu’elle en restera huit nuits sans dormir et qu’elle en sera toute bouleversée et qu’elle n’en fichera plus une rame ; et si je faisais sa volonté… demain… mais une chose compensera l’autre… Alors, je dis : Si elle voyait le collier et les pendentifs d’or que j’ai convenu d’acheter à l’orfèvre de l’arc de Manguiteros !…
- Allez ! Va ! dit Restituta. A quoi ça sert de parler de tout ça ? A quoi ça sert de sortir la fille de ses gonds et lui bouleverser la cervelle ? A rien… pas de colliers ni de pendentifs. Comment veux-tu que la petite lave le linge et couse les chemises si on lui dit qu’elle va être, comme qui dirait, princesse ?
- Non, non… moi, je l’aime, je l’estime, affirma Requejo. Pourquoi la priver de ce plaisir ? Qu’elle le sache… je dirai même plus, ma chère sœur ; c’est que, même si je n’aime pas la fainéantise, parce que vous voyez bien, moi, depuis l’âge de quatorze ans… même si je n’aime pas la fainéantise, d’ici à ce qu’on se marie, si Inès veut travailler qu’elle travaille, sinon qu’elle ne travaille pas.
Don Mauro se remit à rire, allongeant le bras vers Inès pour lui toucher le menton. La fille en tressaillit comme au contact d’un animal dégoûtant et repoussa brusquement la caresse de son oncle impertinent.
- Qu’est-ce que ça veut dire, petite ? Qu’est-ce que c’est que ces manières ? dit don Mauro en fronçant le sourcil. Et dire que je te propose le mariage…
- Avec moi, s’écria l’orpheline sans pouvoir cacher son horreur.
- Avec toi, oui.
- Laisse-la, Mauro ; tu sais bien qu’elle est un peu mal élevée. Ma petite, on ne répond pas comme ça.
- Eh bien, elle a sa fierté, la cochonne.
- Moi, je ne me marie pas avec vous, je ne veux pas me marier, dit Inès avec énergie, retrouvant son aplomb dès les premiers mots.
- Ah ! Non ? demanda Restituta dans un cri de rage. Eh bien, indigne, morveuse, quand as-tu pu rêver avoir un mari pareil, un Mauro Requejo, un homme comme mon frère ? Et cela après t’avoir sortie de ta misère !…
- Moi, vous m’avez sortie du bien-être et du bonheur pour m’amener à cette misère, à ces affronts que je subis ici, dit l’orpheline en pleurant. Mais mon oncle va venir me chercher et je m’en irai pour ne jamais revenir et ne plus vous revoir. Me marier avec un homme pareil ! Je préfère mourir.
Oh ! En l’entendant, je l’aurais mangée. Inès était sublime. Je pleurais.
Quand les Requejo entendirent, dans la bouche de leur victime, un refus si absolu, la colère dans leur âme perverse s’enflamma de manière terrible. Restituta devint livide, don Mauro se leva en balbutiant des mots grossiers.
- Comment ça ? Venir manger mon pain, venir ici laver sa gale, venir ici après avoir couru les chemins pour demander l’aumône… et se comporter de cette manière !… Mais es-tu une Requejo ou bien es-tu d’une autre caste maudite ?… Attention, mademoiselle Profiteuse. Petite, tu sais qui je suis ? Tu sais que j’ai une main de cinq doigts… tu sais que je m’appelle Mauro Requejo… tu sais qu’aucune pissouse ne s’est moquée de moi… tu sais que les poux de ton espèce ne viennent pas me piquer ?… Passons la fête en paix… et tiens-toi-le pour dit, tu vas faire ce que je te demande, un point c’est tout.
Ceci dit, il attrapa de sa main de fer le bras de la fille et la secoua avec force. Il voulut mettre le principe d’autorité un peu plus haut et lança Inès contre le mur, s’avançant vers elle dans une attitude rageuse. Voyant cela, j’eus l’impression d’avoir les yeux brouillés et je sentis mon sang monter du cœur à la tête. J’étais debout près de la table et, à portée de main, il y avait un couteau à la pointe effilée. Le lecteur peut comprendre cette terrible situation, et impossible de blâmer ma conduite, si de tels faits, enfants d’une colère aveugle et sans préméditation, peuvent s’appeler conduite. Qui, en voyant une orpheline innocente et sans défense, maltraitée par le plus niais et le plus grossier des hommes, aurait pu rester sans réaction ? Durant cette scène d’une seconde, j’avançai la main jusqu’à toucher le manche du couteau et, d’un rapide coup d’œil, j’observai le corps difforme de don Mauro Requejo ; mais heureusement pour moi et pour tous, celui-ci, sans doute épouvanté devant la faiblesse de la victime, se retint et n’osa pas la toucher. Sur un mouvement insignifiant, un pas en arrière, un regard, une idée qui passe et s’enfuit repose la perdition de personnes honorables, et un grain de sable nous fait trébucher et nous précipite dans l’abîme du crime. Cette fois-ci, Dieu m’écarta du chemin qui mène au cachot et au bagne.
Le licencié Lobo et le commis aidèrent leur ami à calmer sa colère. Sur le visage du deuxième, je remarquai une très vive agitation, sa peau jaune s’enflamma d’un rouge inhabituel et je ne savais pas s’il fallait l’attribuer à l’indignation ou à la honte.
Doña Restituta, voulant mettre fin à une scène qui ne pouvait avoir que de fâcheuses conséquences, trancha l’affaire en disant :
- Ne t’échauffe pas, mon frère. Je la ferai retrouver la raison. Tu sais bien qu’elle est un peu mal élevée. Allez, ma fille, monte, et nous règlerons nos comptes.
Ce fut l’ordre de la retraite. Juan de Dios sortit de la boutique pour s’en aller chez lui et doña Restituta et Inès montèrent, je suivis car on me donna l’ordre aussi d’aller me coucher. Les deux femmes entrèrent dans leur chambre et moi dans la mienne ; mais ne pouvant maîtriser mon inquiétude et craignant que dans la chambre voisine se répète entre tante et nièce la scène violente de l’arrière-boutique, après un petit moment, je sortis doucement de mon coin et me glissai dans le couloir, retenant ma respiration pour ne pas être entendu. Installé près de la porte de la chambre, j’entendis la voix de doña Restituta qui disait : «Ne pleure pas, dors. Mon frère est une personne aimable ; sauf que soudain… Si lui t’aime beaucoup, ma petite…» Cette amabilité de la couleuvre me surprit ; mais je compris que ce n’était que pur artifice.
Les voix de don Mauro et de Lobo, restés dans l’arrière-boutique, m’arrivaient aussi confusément. J’avançai un peu jusqu’au bord de l’escalier et couché par terre je tendis l’oreille.
- Quand je vous donne ma parole que c’est ainsi, disait le gratte-papier. Inesita fut abandonnée et recueillie par doña Juana. Sa mère, une des principales dames de la Cour, désire la rencontrer et la protéger. Je possède les documents pour identifier la personnalité de la jeune fille. De sorte que, si vous vous mariez avec elle… mon ami, madame la comtesse a les meilleures oliveraies de Jaén, les meilleures pouliches de Cordoue, les meilleures prairies du Jarama, et plus de trente mille fanègues de pain en terre d’Olmedo et à don Benito, sans héritiers directs pour se disputer cette jolie qui, il y a peu, était en train de faire des grimaces ici même.
- Mais vous avez bien vu, dit don Mauro marchant à grands pas dans l’arrière-boutique. La jeune fille est un porc-épic. Je lui fais une caresse et elle me tape sur les doigts ; je lui dis que je l’aime et elle me crache à la figure.
- Mon ami don Mauro, répliqua le licencié, la méthode que vous employez, vous et votre sœur, n’est pas la plus appropriée pour vous faire aimer de la petite. Vous devriez la choyer et vous la maltraitez en la faisant travailler jusqu’à en crever. Qui peut croire qu’une princesse comme elle puisse faire la vaisselle et laver le linge ? De cette façon, elle haïra mon cher monsieur don Mauro comme si c’était le diable en personne.
- Ah ! dit mon maître en se donnant un coup sur la nuque majestueuse, monsieur le licencié a tout à fait raison. C’est ce que je disais à ma sœur ; mais Restituta est tellement ambitieuse qu’elle se laisserait écorcher vive pour un sou, elle s’obstine à exploiter la malheureuse. Sommes-nous riches, monsieur Lobo ? Eh bien oui, nous sommes riches. A quoi bon se démonter pour un sou ? Mais avec ma sœur, il n’y a rien à faire. Vous ne croyez pas ? Ici on vit comme à l’hospice : mon père s’appelle miche de pain et moi je meurs de faim, comme dit l’autre. Eh bien, je dis que ça va être comme je dis, et ma sœur n’a qu’à se marier avec Juan de Dios et garder ce qui lui revient… Un point c’est tout. Inesita ne travaillera plus parce que si elle meurt…
- En plus, dit Lobo, essayez d’être aimable avec elle. Soignez un peu plus que l’extérieur et ne vous présentez pas devant elle avec cet air rustique de portefaix parce que les filles sont les filles, monsieur don Mauro, et on n’entre dans le temple de l’amour que par la porte du bon paraître.
- C’est bien parlé. Si ça ne tenait qu’à moi… J’aime bien m’habiller, mais cette langouste de Restituta ne me laisse pas et elle dit que je ne dois mettre mon beau costume que pour la fête du Saint Sacrement. Non, non ; ici c’est moi qui commande, je vais me faire beau, parce que je… grâce à Dieu, je ne suis pas de ceux qui ont besoin d’un tas de fards et de mixtures pour paraître beau, et tout ce que je me mets me va à merveille. Je vais traiter Inesita comme elle le mérite et Dieu fera le reste. Avant un mois, je la conduis à l’autel.
- C’est la meilleure méthode, monsieur don Mauro. Les menaces, la séquestration, les privations, le travail excessif n’aboutissent à rien sauf à ce que la jeune fille vous déteste et s’éprenne du premier pauvre diable qui passera par là.
Voilà ce que disaient le commerçant et le gratte-papier. Ils se saluèrent et le second sortit dans la rue de la boutique. Je me retirai à toute vitesse et sans bruit, pourtant, doña Restituta, de son organe auditif ultra sensible, dut entendre je ne sais si ce fut ma respiration ou le léger bruit d’une brique cassée remuée sous mes pas. Cela produisit comme un cri d’alarme dans son esprit aux aguets, elle sortit à la rencontre de son frère qui montait et lui dit :
- Il me semble avoir entendu un bruit. Y aurait-il des voleurs ? Cette nuit, il y a eu un vol dans la rue Imperial, ils sont passés par les toits.
Ils fouillèrent toute la maison, tandis que moi, glissé dans mes draps, je feignais de dormir comme un loir. Enfin, convaincus qu’il n’y avait pas de voleurs, ils se couchèrent. Beaucoup plus tard, je remarquai que doña Restituta fouillait la maison une deuxième fois, jusqu’à ce que tout retombe dans le silence. Peu avant le petit matin, j’entendis un bruit de monnaie. C’était doña Restituta qui comptait son argent. Après je l’entendis sortir de sa chambre, descendre à l’arrière-boutique et de là au sous-sol, où elle resta plus d’une heure.
[1] Il s’agit d’une règle, promulguée par la régente María Cristina, qui fait le lien entre l’Ancien Régime et le début de l’État libéral, de 1834 à 1836.
















A powerful share, I simply given this onto a colleague who was doing somewhat evaluation on this. And he in truth bought me breakfast because I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! However yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If potential, as you develop into experience, would you mind updating your weblog with more details? It’s highly useful for me. Large thumb up for this weblog submit!
I like what you guys tend to be up too. This type of clever work and reporting! Keep up the superb works guys I’ve added you guys to our blogroll.
Pixbetcassino… alright, let’s see what you got! Gotta find that next favorite spot. Fingers crossed it’s great! Check it out here: pixbetcassino
Alright, I think I’ll give 777betninecasino a whirl and see what I think, The games seem diverse enough to keep my intention! Check it out: 777betninecasino