No hay productos en el carrito.

Daniel Gautier
La déshéritée
En remettant sur le tapis, sans savoir comment ni pourquoi, quelques unes des doléances sociales qui sont nées du manque de nourriture et du bien petit usage que l’on fait des reconstituants qu’on appelle Arithmétique, Logique, Morale et Sens Commun, il conviendrait de dédier ces pages à … A qui au fait ? Au malheureux patients, aux soigneurs et autres guérisseurs qui, en se donnant le titre de philosophes et de politiques, lui imposent leur recette jour après jour ? … Non ; je les dédie à ceux qui sont ou qui devraient être les vrais guérisseurs, je veux dire : les maîtres d’école.
B.P.G. Madrid, janvier, 1881
PERSONAGES DE CETTE PREMIERE PARTIE
ISIDORA RUFETE, personnage principal.
MARIANO RUFETE, son frère.
LA SANGUIJUELERA, tante.
AUGUSTO MIQUIS, étudiant en médecine.
JOAQUÍN PEZ, Marquis de (veuf)
SALDEORO, fils de
DON JUAN MANUEL JOSÉ DEL PEZ, Directeur général au Ministère des Finances.
DON JOSÉ DE RELIMPIO Y SASTRE, miroir des va-nu-pieds.
DOÑA LAURA, son épouse
MELCHOR DE RELIMPIO enfant
EMILIA enfant
LEONOR enfant
LA MARQUESA DE ARANSIS.
EL MAJITO, enfant.
ZARAPICOS voyou
GONZALETE voyou
TOMÁS RUFETE.
EL SEÑOR DE CANENCIA.
MATÍAS ALONSO, concierge de la maison de Aransis.
UN CONCEJAL.
UN COMISARIO DE BENEFICENCIA.
MI TÍO EL CANÓNIGO (qui n’intervient pas).
Hommes et femmes du peuple, enfants, Peces des deux sexes, domestiques, gardes civils, etc.
Chapitre 1
I-
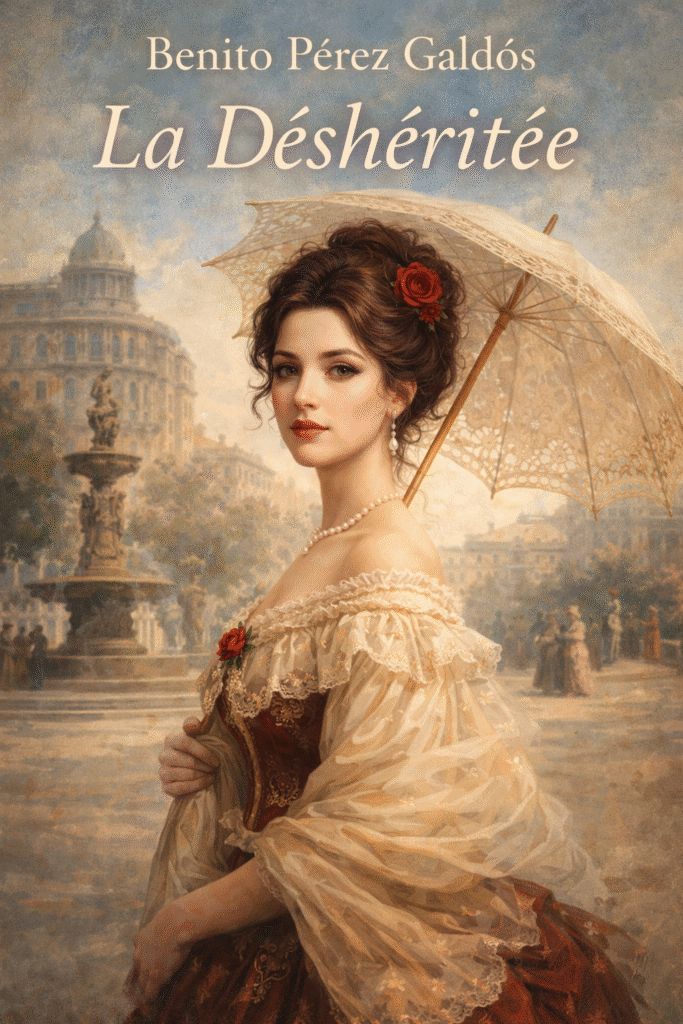
- Tous les ministres sont là ? On peut commencer le Conseil ? … La voiture, vite, vite, sinon je n’arriverai pas à temps au Sénat ! C’est vraiment intolérable ! Et ce pays, ce monstre béni – à tête de barbarie et queue d’ingratitude – ne sait pas apprécier notre abnégation, répond par des injures à tous nos sacrifices, et se réjouit de nous voir humiliés ! Mais, je vais t’en foutre, moi, pays de guenons. Comment tu t’appelles ? Tu t’appelles «Enviepolis», ville minable et sans envergures ; et comme tu n’es que fange tu sympathises avec tout ce qui dégringole… Il y en a combien ? Dix millions, vingt quatre millions, cent soixante sept millions, deux cent trente trois mille quatre cent douze pesetas et soixante cinq centimes … ; voilà, c’est la somme . Tu ne m’oublieras plus, friponne ; je t’ai eue, tu ne m’échapperas pas, oh ! somme tremblante, fuyante, imprenable, telle une goutte de mercure ! Je te tiens dans le creux de ma main, et pour que tu ne t’échappes pas, pour jouer, au chaos de l’oubli, je te mets dans un tiroir de mon cerveau, là où l’on dit : subvention personnelle… Permettez-moi, votre seigneurie que j’admire la désinvolture avec laquelle votre seigneurie et les amis de votre seigneurie avouent avoir enfreint la Constitution…. Je me moque des critiques. Je ferai évacuer les tribunes… Allez, allez, on vote ! Pour moi ? Voulez-vous savoir avec quels pouvoirs je gouverne ? Et bien voilà : on charge les fusils… Voilà mes votes : c’est Krupp[1] qui me les a fabriqués… Mais qu’est-ce que tout ce bruit ? Qui va là dans mon cerveau ? Eh là, qui marche là-haut ?… Ah bon, bon, c’est la goutte de mercure… qui s’est échappée de son tiroir.
Celui qui nous tient ce langage (si on peut appeler langage ce flot d’expressions confuses qui se bousculent, par lequel tous ces bouts de phrases traduisent un épouvantable tas d’idées en désordre) est un de ces hommes qui en est arrivé à perdre la normalité des apparences et avec cela l’empreinte floue des années qui passent. Se trouve-t-il au point central de sa vie, ou est-ce la misérable décrépitude ? La mobilité de ses traits et ses yeux pétillants annoncent-ils un caractère exalté ou une imbécillité inconsolable ? Ce n’est pas facile de le dire, et le spectateur en l’entendant ou en le voyant n’arrive guère à se décider entre la compassion et le rire. Il a la tête complètement dépourvue de cheveux, la barbe clairsemée, poivre et sel et rasée par endroits, comme une prairie mal fauchée. La lèvre supérieure trop longue et pendante, semble avoir grandi puis s’être ramollie tout récemment, et elle bouge de manière nerveuse, ce qui donne à sa bouche un air de museau de lapin qui ronge un morceau de chou. Il a un visage blanc, une peau qui ressemble à du papyrus, des jambes maigres, une petite taille et est légèrement voûté.
Sa voix sonore serait un régal pour l’oreille si les mots n’étaient pas un condensé de tout ce qui peut fait rire, de tout ce qu’on peut dire pour insulter, de tout ce qu’on peut imaginer pour divaguer, des tons qui vont des emphatiques discours au sermon pleurnichard.
Un homme sérieux et bonhomme s’en approche, lui met la main sur l’épaule avec douceur et sympathie, lui prend le pouls, lit rapidement sur sa physionomie bizarre, dans les pupilles noires de ses yeux, sur sa lèvre pendante, et se retournant vers un jeune homme qui l’accompagne, lui dit :
- Bromure de potassium[2], double dose.
Le médecin continue sa tournée, et le patient reprend son ton oratoire, essayant de convaincre un tronc d’arbre, parce que la scène se passe dans une grande cour carrée, fermée par de très hauts murs sans aucune prise qui puisse permettre l’évasion. Des arbres pas très grands, plantés en rangées, tristes comme une vie malingre, malgré les nombreux oiseaux, laissent tomber des marques d’ombres uniformes sur le sol sablonneux, pas une feuille, pas une pierre, pas un cailloux, tout est plat et lisse comme un tapis de poussière. Une petite trentaine d’individus se promènent dans ce lieu triste ; les uns lents et raides comme des fantômes, les autres courant et haletant. Celui-ci fait le tour de deux arbres, formant en passant des huit, bougeant sans cesse les bras, les mains et les doigts, se fatigant beaucoup sans aucune goutte de sueur, balbutiant sans rien dire, le sourcil froncé, fuyant, incroyablement angoissé, un poursuivant imaginaire. Celui-là, étendu par terre, applique son oreille dans la poussière pour écouter ceux qui parlent aux antipodes et son visage d’idiot, collé au sol ressemble à un melon jaune qui se met à rire. Un troisième chante à haute voix, tout en montrant un document ou bien l’état de l’ensemble des exercices européens, avec les divisions et les souverains ou chefs respectifs… tout cela doit être mis en musique.
Le médecin va de l’un à l’autre, les interrogeant, s’adaptant gentiment à leurs manies, sans cesser de faire de sages remarques pour chacun. Le voilà qui entame une conversation avec celui-là, visage stupide, qui porte sur la poitrine un tas de médailles, scapulaires et amulettes ; il discute rapidement avec un petit vieux malade et souriant qui se promène tout seul tranquillement près du mur, un Kempis[3] crasseux à la main ; on dirait un philosophe anachorète ou un Diogène du Christianisme par le négligé de son vêtement et l’onction bonasse de ses apparences. C’est un prêtre qui a eu toute sa tête. Il est maintenant en train de réfléchir à la lettre qu’il doit envoyer au Pape aujourd’hui, suivant une coutume qui se répète infailliblement tous les trois cent soixante cinq jours, et il est là depuis déjà vingt ans. Il serre avec beaucoup de sympathie la main du docteur, lui adresse quelques mots en latin, qui cadrent tout à fait avec la conversation, et pour finir demande si on a bien mis à la poste sa dernière lettre, ce à quoi le médecin répond que oui, et que bien sûr, Sa Sainteté doit être très distraite à Rome pour ne pas répondre à une correspondance aussi importante.
Le médecin revient à l’endroit où l’on a commencé ce récit et avant d’arriver à notre homme dit à l’infirmier :
- Ce malheureux Rufete va aller chez les pauvres car cela fait trois mois que sa famille ne paie plus sa pension. Il ne se rendra pas compte du changement de situation. Si son cas s’aggrave, il faudra l’enfermer.
En lui mettant la main sur l’épaule, le médecin dit à Rufete :
- Ca va, ça va, assez de violence. On a déjà dit qu’on serait amis tant que vous ne sortez pas des voies légales… Le pays vous fera justice… Un peu de calme et de sérénité. Si vous pouviez abandonner le pouvoir pendant quelques mois, qu’est-ce qu’on serait bien tous les deux ! On ne s’occuperait que de soigner ce rhume…
- Ce n’est pas un rhume – réplique Rufete, en faisant de grands cercles avec sa tête. – C’est une goutte de mercure… Elle rôde là, elle coule… Tiens ! la voilà à ma tempe droite… Tiens ! maintenant elle est rendue là, à la tempe gauche… Il y a cent soixante sept millions, deux cents…
- Je sais, je sais… Je voudrais bien que vous ne vous occupiez plus de tous ces chiffres, puis qu’ils sont sûrs.
- Non, ce n’est pas sûr – dit Rufete, se montrant terrorisé. Vous ne savez pas quelle guerre ils me mènent, ces vilains. Ils ne peuvent pas me voir. Mais, moi, je m’amuse de leurs infamies. Quand un vrai génie se met à monter vers la gloire, l’envie lui fournit des échelles. Donnez-moi une envie aussi grande qu’une montagne, et je vous promets une réputation aussi grande que le monde… Au revoir, je vais à l’Assemblée. Vous ne savez pas que les porteurs de massues se sont soulevés ? … Allez, adieu !
Le médecin fait signe à son compagnon qu’il n’y a rien à faire et continue sa route.
II-
On ne sait pas exactement si c’est ce jour-là ou le lendemain que le pauvre Rufete a été transféré du quartier des pensionnaires à celui des miséreux. Dans le premier il avait eu certains avantages en nourriture, aisance, lumière, loisirs ; dans le second il pouvait disposer d’une cour insalubre et étroite, d’un grand lit mal fichu, d’une nourriture médiocre. Ah ! Si l’un d’entre eux revenait tout d’un coup à la raison et se retrouvait dans ce quartier des pauvres, au beau milieu de cette foule déplorable d’êtres qui n’ont même plus figure humaine, et se voyait dans une cour ressemblant plus à poulailler qu’à une infirmerie, il retournerait sûrement vite à sa démence, s’imaginant être une bête nuisible. Dans ces locaux rudimentaires, bien peu visités par l’administration réformiste[4], dans ce long couloir où l’on trouve toute une série de cages, dans la cour en terre battue, où les fous se renversent et où les plus agités font des pirouettes, c’est là que l’on trouve toute l’horreur de ce secteur épouvantable de l’Assistance Publique, là où se rassemblent la charité chrétienne et la défense sociale, formant une bien lugubre forteresse qu’on appelle asile et qui est à la fois hôpital et prison. C’est là que la personne en bonne santé voit son sang se glacer et son esprit s’anéantir en voyant tout ce pan de l’humanité enfermée par maladie, et là il observe comment les fous peaufinent leur folie par l’exemple, comment ils perfectionnent leurs manies, comment ils deviennent des spécialistes dans cet art horrible qui consiste à faire le contraire de ce que le bon sens nous permet.
Si chez certains cette aphasie[5] leur ôte toute douleur, chez d’autres, la surface troublée de leur être manifeste d’indicibles tourments… Et force est de constater que cette triste colonie n’est rien d’autre que la représentation de nos exagérations ou la partie la plus irritable de nos nombreuses singularités morales ou intellectuelles … car tous, plus ou moins, nous avons cette inspiration, cette intuition d’idées drôles, et pour peu qu’on n’y prenne pas garde, nous entrons de plain-pied dans le sombre domaine de la science des maladies mentales. Parce que, non, non, il n’y a pas tant de différences. Les idées de ces malheureux sont nos idées, mais détachées, sans aucun fil conducteur, extraites de ce mystérieux fil qui les relie merveilleusement. Ces pauvres cinglés c’est nous qui nous endormons le soir avec dans la tête toute une gamme d’idées magnifiques et réalisables, et qui le lendemain les retrouvons réduites à une pauvre idée esseulée. Oh ! Leganés[6], si on voulait te représenter comme une ville théorique à la manière des philosophes, des saints et des reproducteurs d’images d’autrefois qui exprimaient un projet moral ou religieux, non, alors, il n’y aurait pas d’architectes ni de physiologistes qui oseraient dessiner tes murs hospitaliers de manière sûre. «Il y a beaucoup de sages qui ne sont que des fous raisonnables». C’est là une sentence de Rufete.
Ce dernier ne s’est pas rendu compte de cette chute brutale qui fut celle de passer des grandeurs de la pension à l’humilité de l’asile. La cour est étroite. Les malades s’y côtoient de trop près, simulant parfois l’existence d’un sentiment béni qu’on trouve rarement dans les asiles : l’amitié. Cela ressemble parfois à une Bourse d’embauche sur les folies. Il y a l’offre et la demande des délires. On se voit sans se voir. Chacun est assez occupé de soi pour ne pas s’occuper des autres. L’égoïsme a atteint là son point culminant. Les aliénés gisent par terre. On dirait qu’ils sont en train de paître. Quelques exaltés chantent dans un coin. Des groupes se font et se défont, parce s’il n’y a pas d’amitié, il y a là d’étranges sympathies ou antipathies qui naissent et meurent en un instant.
Deux gardiens, costauds, l’air grave, lassés de leur travail, se promènent attentifs comme des flics à la recherche d’un crime. Ce sont les inquisiteurs de la folie. Il n’y a pas de pitié sur leur visage, ni de douceur dans leurs mains, ni de charité chez eux. De tous les fonctionnaires que la tutelle de l’Etat a pu inventer, aucun n’est plus antipathique que ces dompteurs de fous. Le maton-infirmier est une montagne de muscles qui doit retenir dans ses bras de fer le rebelle et le furieux ; il tutoie les malades, leur donne à manger sans aucune affection, il les assomme s’il le faut, il est continuellement sur la défensive, emporte les fous sur son dos comme des sacs, habille les infirmes ; s’il n’était pas une brute, ce serait un saint. Le jour où on fera disparaître le bourreau, ce sera un grand jour si en même temps la charité fait disparaître le gardien de fous.
Rufete fuyait machinalement les gardiens, comme s’il leur en voulait. Les fonctionnaires étaient pour lui l’opposition, la minorité, la presse ; c’était aussi le pays qui le surveillait, qui lui demandait des comptes, le questionnait sur le commerce en ruines, l’industrie naissante, l’agriculture marquée par la routine et la pauvreté, le crédit disparu. Mais, il les forcerait à payer pour ce pays que ces deux messieurs rigides représentent, qui veulent se mêler de tout, qui veulent tout savoir, comme si, lui, l’éminent Rufete n’était pas au poste qu’il aurait dû occuper, pour le plaisir de ces épouvantails. Ils le regardaient attentivement, et de leurs yeux inquisiteurs, ils lui disaient : «Nous sommes l’envie qui te salit pour te polir et qui te traîne pour t’honorer.»
Tous les habitants de cette cour ont leur lieu privilégié. Cette attirance pour le bout de mur, pour l’angle, pour cette tache d’ombre, est ce qui reste de la sympathie locale que ces malheureux conservent aux ténèbres dans lesquelles vit leur esprit.
Rufete s’agitait toujours dans un angle de la cour, tribune pour ses discours, trône de son pouvoir. Le mur devenait les murailles égyptiennes, parce que le plâtre, en tombant, et la pluie, en faisant des taches, avaient dessiné là mille figures pharaoniques.
Quand Rufete était fatigué de marcher, il s’asseyait. Il avait beaucoup à faire, mille affaires à régler, entendre la foule des secrétaires, les généraux, les archevêques, les archi-quelque chose, et puis…, Ah ! il lui fallait apposer des milliers de signatures, des millions, des milliards de signatures. Il s’asseyait par terre, croisait les bras sur ses genoux, s’enfonçait la tête dans les mains, et passait ainsi des heures et des heures à écouter le bruit incessant du mercure qui coulait dans sa tête. Dans cette position, le malheureux se mettait à compter les cent soixante sept millions de pesetas. C’était facile, oui, très facile. Le plus terrible c’était l’appoint de cette somme. Pourquoi les chiffres s’échappaient-ils, fuyant et disparaissant souvent en fines particules de métal liquide par les interstices de la toile de sa pensée ? Il fallait penser plus fort et renforcer la toile pour saisir ces quelques pesetas et ses merveilleux rejetons, les centimes.
Les habits de ce pauvre sujet malchanceux étaient purement théoriques. Il y avait sur ses misérables chairs sèches des formes de toile qui prétendaient être des idées de chemises, de redingote, de pantalons ; mais c’était plus grâce aux morceaux qui manquaient que grâce aux morceaux qui subsistaient. Cela faisait tellement de temps que sa famille ne lui apportait plus de linge. Dernièrement on lui a mis une blouse bleue. Mais un matin il en a mangé la moitié. C’était le plus indocile et le moins bien éduqué de tous ceux de la maison. Cependant, par dessus tous ces oripeaux, il mettait tous les jours une cravate, pas si mal que ça. Il faisait un joli nœud, là devant le mur transformé en miroir par l’effort de son imagination. Ce gros nœud noir sur la chair nue d’un cou étiré, empêchait parfois ses mouvements ; mais il supportait avec patience cette gêne pour conserver les apparences.
Quand la nuit tombait ou quand le temps n’était pas beau, Rufete était le dernier à quitter la cour. C’était souvent que les gardiens étaient obligés de l’emmener de force. Il dormait dans une salle basse, humide, avec des barreaux, côté couloir, lequel couloir, avec des barreaux aussi, donnait sur un jardin. Depuis les lits bien peu moelleux on voyait l’épais feuillage des arbres ; mais, à travers la double grille, la joie de l’intense verdure arrivait aux yeux des malades diminuée ou complètement éteinte, avec un effet de pays brodé sur un canevas. Dans le dortoir et même jusqu’à une heure avancée, les chants et les cris ne disparaissaient pas. Les ténèbres pour la plus grande partie d’entre eux étaient identiques au jour. Quelques-uns dormaient les yeux ouverts. De la salle on entendait le murmure du jet d’eau de la fontaine. Ce filet d’eau stimulait toujours l’oreille de Rufete qui passait des heures entières en conversation ininterrompue avec l’eau bavarde en ces termes : «Dans tout ce que votre Seigneurie me dit, monsieur le jet d’eau, il y a beaucoup de vrai mais aussi des choses inadmissibles. J’ai accédé au pouvoir poussé par le peuple qui me réclamait, qui avait besoin de moi. La première marche a été mon mérite, la seconde, ma résolution, la troisième la flatterie, la quatrième l’envie… Mais pourquoi me parlez-vous d’accord privilégié, de pactes déshonorants ? Taisez-vous, ayez la bonté de vous taire ; je vous en prie, je vous demande de vous taire.»
Et très en colère, il s’élançait sur la grille, prêtait l’oreille, faisait signe qu’il était d’accord ou le contraire, serrait les barreaux. L’éloquente fluidité du jet d’eau n’en finissait pas. C’était comme ces orateurs infatigables qui n’arrêtent pas de parler d’eux-mêmes. L’aurore le retrouvait absorbé dans la même pensée, et Rufete disait d’une joie grinçante : «Je ne suis pas convaincu, je ne suis pas convaincu, votre seigneurie.»
L’aurore !, même dans une maison de fous, est joyeuse ; même là, ils sont beaux ces yeux du jour qui s’ouvrent, ces premiers regards que s’adressent ciel et terre, arbres, maisons, monts et vallées. Les oiseaux au lever matinal gazouillent aussi bien que dans les bouleaux du parc du Retiro au-dessus des couples d’amoureux ; le soleil, père de toute beauté, sème ici les mêmes formes et les mêmes couleurs merveilleuses que dans les villes et les villages, et ce petit souffle d’air piquant qui fait remuer les arbres, rafraîchit la campagne, pousse les hommes au travail et apporte partout la joie, l’appétit, le goût de vivre et la santé, laisse couler dans toutes les parties de l’établissement un souffle vivifiant. Les fleurs s’ouvrent, les mouches commencent leurs mouvements incessants, les pigeons s’élancent dans leurs éternels voyages aériens ; de haut en bas, chacun cède à l’excitante impulsion selon sa nature. Les fous sortent de leurs chambres ou des dortoirs avec cet appétit sauvage d’un instinct puissamment stimulé. A cette heure du réveil général, ils reprennent leurs folies coutumières, parlent plus haut, rient plus fort, se traînent et s’abrutissent encore plus ; quelques-uns prient, d’autres s’étonnent que le soleil soit sorti pendant la nuit, celui-là répond au lointain chant du coq, celui-ci salue le gardien avec une courtoisie raffinée ; l’un demande du papier et un crayon pour écrire une lettre, l’indispensable lettre du jour ! ; l’autre se met à courir, échappant à un poursuivant qui semble avoir pris son cheval quotidien et tout ce monde carnavalesque commence avec brio son extraordinaire existence.
Les nombreux employés de la maison commencent le travail de nettoyage, et le bruit des balais parcourt les salles et les couloirs, se mêlant au bruit des vêtements agités et des meubles remués. La cloche de la chapelle invite à la messe, le Directeur administratif sort de son bureau pour faire un tour des services, et les sœurs de la Charité, le cœur de cet asile pour ce qui concerne les tâches domestiques vont et viennent s’activant comme des mères de famille. Leurs jupes bleues, fouettées par un énorme chapelet, leurs coiffes aux grandes ailes blanches, respectables et respectées comme des signes de paix, sont visibles partout, dans la verdure du jardin, dans les étagères de la pharmacie, dans l’énorme cuisine, où les fours en bronze crachent le feu ; dans l’arrière-cuisine plein de victuailles ; dans la buanderie où jaillissent déjà des flots d’eau ; dans le haut grenier qui domine le jardin, et dans la cour des femmes, dans la partie réservée aux folles, qui est l’endroit où le travail est le plus pénible et les difficultés les plus grandes.
Les folles ! Nous sommes dans le lieu effrayant de ces sortes dede cette frontière masquée du monde. Les hommes inspirent pitié et terreur ; les filles d’Eve inspirent des sentiments difficiles à définir. Leur folie est, en général, plus pacifique que chez nous, sauf quelques cas pathologiques tout à fait propres à leur sexe. Leur cour, protégée du soleil à cet endroit, par des nattes, est un poulailler où caquètent jusqu’à vingt ou trente femmes dans un murmure de coquetterie, de jalousie, de discussions oiseuses et vaines qui n’ont ni fin ni commencement, sans sujet précis, sans pause, sans aucune variété. On entend au loin des disputes de commères dans la solitude d’un bois… Il y en a de fort judicieuses. Quelques pensionnaires, traitées avec soin sont là tranquilles et en silence dans une salle claire et propre, occupées à coudre, sous la surveillance et la direction de deux sœurs de la Charité. D’autres se font des guirlandes avec des guenilles, avec des fleurs séchées ou des plumes de poules. Elles sourient bêtement ou lancent au visiteur des regards bizarres.
Le beau sexe a aussi ses cages à double grilles. Ce ne serait plus des femmes si elles n’avaient nul besoin d’être sous clé. Il est fréquent de voir deux mains nerveuses et toutes maigres se saisir des grilles, et on entend alors la voix rauque d’une de ces malheureuses qui demandent qu’on lui rende ses enfants qu’elle n’a jamais eus. Il y en a une qui court dans les couloirs et dans les salles à la recherche de sa propre personne.
Retournons à la cour des hommes, dans le quartier pauvre. Ce jour-là, Rufete n’y était pas. On aurait pu croire qu’il avait eueu un problème une crise. Peu avant le lever du jour, il s’est adressé au gardien et lui a dit :
- Aujourd’hui, je ne suis là pour personne, absolument personne.
Puis il est tombé dans une profonde torpeur. Il est devenu muet. Le jet d’eau de la fontaine le réclamait et aucun des occupants de l’asile ne pouvait lui répondre.
On l’a emmené à l’infirmerie. Le médecin lui a fait prendre une douche, et on l’a pris dans les bras pour le porter à la question de l’eau. C’est une petite station thermale, savamment construite, où il y a divers appareils de torture. Là, ils frappent sur les côtes, donnent des coups dans le dos, font vibrer la tête, tout cela avec des tuyaux d’eau. Il y a une pression très forte, et les coups et les attaques sont vraiment féroces. L’eau arrivant en jets réduits ou larges, se divise en filets pénétrants comme des aiguilles glacées ou attaquent avec l’acharnement d’un acier grinçant. Rufete, qui connaissait déjà ce lieu et ses machines, s’est défendu farouchement de manière instinctive. Ils l’ont enveloppé et l’ont enserré dans un gros anneau de fer horizontal qui était fixé au mur, et là, sans qu’il puisse se défendre, nu, il a reçu l’assaut final. Peu après, il gisait comme en état léthargique sur un lit, avec toutes les apparences du bien-être. Enfin, il s’est endormi profondément.
III-
Juste à cette heure-là, une jeune fille est arrivée à la porte de l’établissement. Elle voulait voir monsieur le Directeur, le médecin, elle voulait voir un malade, son père, un certain don Tomás Rufete ; elle voulait entrer alors qu’on l’en empêchait ; elle voulait parler avec monsieur le chapelain, avec les sœurs, avec les éducateurs ; elle voulait voir l’établissement ; elle voulait remettre quelque chose ; elle voulait dire autre chose…
Ces multiples souhaits, qu’on pouvait rassembler en un, furent exprimés de manière un peu bousculée et avec trouble par la jeune fille. Elle était plus jolie que la moyenne, du point de vue vestimentaire, elle n’était pas très bien habillée et n’avait pas non plus des chaussures très soignées. Elle tremblait en posant ses questions et elle mettait beaucoup de courage dans l’expression de ses souhaits. Ses yeux expressifs avaient pleuré, et pleuraient encore un peu. Elle avait des Ses mains rugueuses, sans doute à cause de son travail,. Ses mainsserraient un tas de linge plus tout à fait neuf qu’elle tenait enveloppé dans un torchon rouge. Rouge était aussi le fichu qu’elle portait, négligemment noué sous le menton à la façon madrilène. Quel genre d’habit avait-elle ? Une soutane, un manteau, une gabardine d’homme ? Non : c’était un vêtement hybride, un accord entre russe et espagnol, un par-dessuspardessus de ville qui ne correspondait pas tout à fait à la mode du jour. En tous cas, son fichu rouge, ses larmes à peine séchées, sa gabardine usée et bien difficilement qualifiable de vêtement, son visage séduisant, ses gestes résignés, ses souliers trop grands et déjà bien usagés, inspiraient la pitié.
Elle arriva sans difficultés au bureau de monsieur le Directeur. En le voyant, elle se fit connaître et demanda à voir monsieur Rufete. Il lui vint tant de larmes aux yeux et sa gorge se serra de telle façon qu’elle dut garder arrêter de parler. Le Directeur, homme compatissant, la fit s’asseoir en la priant de se calmer.
- Cela fait trois mois qu’on n’a pas payé la pension, dit-elle à la fin, en mettant la main dans un endroit de son vêtement.
Il faut dire que sa gabardine avait une poche profonde. Son inventrice avait été très prodigue, supposant qu’il y avait plein de choses à y mettre. De ce puits de toile elle sortir sortit un paquet de papier qui semblait contenir de l’argent.
- Après, après, nous verrons cela, dit le Directeur, en hésitant à prendre la somme. – Ah ! Vous avez du linge aussi ? Je vois que vous êtes pleine d’attentions… C’est bien, c’est bien. Le pauvre Tomás en avait grand besoin… Laissez-le là. Après… Asseyez-vous et reposez-vous.
- Mais je ne peux pas le voir maintenant ? demanda-t-elle avec anxiété.
- Ce n’est pas facile, ce n’est pas facile. Vous savez bien qu’ils s’énervent beaucoup en voyant des personnes de leur famille. Et précisément, le pauvre monsieur Rufete souffre actuellement
d’un problèmed’une crise délicate assez inquiétante.
La femme au pardessus russe croisa les mains et se mit à regarder le plafond.
- Le médecin est en train de lui rendre visite… On lui parlera et on verra ce qu’il en dit. S’il est d’accord… Mais, il ne sera pas d’accord. Il vaut mieux que vous ne voyiez pas votre père maintenant. Plus tard… Asseyez-vous, calmez-vous. Oui, oui, je me souviens bien du jour où vous êtes venue avec lui, cela fait pas mal de temps maintenant. Vous vous appelez …
- Isidora, pour vous servir, monsieur… Pauvre petit papa ! Si on ne me laisse pas le voir, dites-lui, vous, que je suis ici, que sa petite Isidora est là, qu’elle vient lui donner un petit bisou, que demain je viendrai avec Mariano, mon petit frère… Ah ! mon Dieu ! ; mais lui ne comprendra pas, il ne comprendra rien. Le pauvre homme ! Et il n’y a pas d’espoir qu’il revienne à la raison ?
Le Directeur fit des signes de la tête et des lèvres, c’était extrêmement affligeant. On aurait dit qu’il s’efforçait de lui enlever tout espoir. Isidora, exténuée de fatigue, s’assit sur une banquette. De manière très conventionnelle, quoique plein de générosité, il la pria de rester résignée et de garder un calme impossible ; le Directeur sortit.
La jeune fille ne resta pas seule dans le bureau. Dans un angle il y avait un bureau. Assis à ce bureau, le dos au mur, un homme écrivait, le regard fixé sur son papier, traçant d’une main assurée de beaux caractères avec les pleins et déliés de la calligraphie espagnole. La table était remplie de papiers qui semblaient être des états civils, des listes de noms, des comptes avec leurs chiffres innombrables. Une haute étagère remplie de papiers et de livres annotés… montrait que ce brave homme scribouillard était au service du Directeur, dont le bureau n’était pas bien loin, dans le dédale administratif de cet établissement. Il avait le type de l’ancien fonctionnaire, des regrettés ronds de cuir, conservé ici, tel une relique du personnel méthodique, routinier et très honorable de notre bureaucratie primitive. Il était d’un âge avancé, petit, ridé, assez brun et rasé de près comme le clergé. Il avait sur la tête un bonnet de forme circulaire, ni tout neuf ni très usé, contemporain des manchons verts qu’il s’était accrochés aux coudes. Il écrivait d’un trait si assuré, si uniforme et ordonné qu’on aurait dit une écriture de machine à écrirequ’il écrivait à la machine. Sans lever les yeux de ses papiers, il tirait de temps en temps sur la peau de ses lèvres, montrant ses dents blanches, fines et clairsemées et par les interstices il aspirait une grande quantité d’air. Isidora, toute occupée à sa douleur, ne faisait aucun cas de l’ancien scribouillard ; mais celui-ci ne cessait de jeter des coups d’œil obliques à la jeune fille, comme s’il cherchait un motif de conversation. L’envie de parler étant plus forte que sa timidité, il rompit le silence ainsi:
- Mademoiselle, vous en avez marre d’attendre ? … Dieu soit béni. Il n’y a rien d’autre à faire que de se soumettre à sa sainte volonté.
Isidora, (pourquoi le cacher ?) apprécia qu’on l’appelle, mademoiselle. Mais comme son esprit n’était pas prêt à entendre des choses sans importance, elle fixa toute son attention aux paroles de consolation qu’elle venait d’entendre, y répondant par un regard et un profond soupir.
- Cette maison – ajouta notre homme tout aimable en faisant connaître un peu mieux sa voix mélodieuse et douce, qui touchait l’âme – n’est pas une maison de divertissement ; c’est un asile triste et lugubre, mademoiselle. Je prends en compte, si, si, je prends en compte votre douleur…
Il se referma sur lui-même en aspirant une autre grande quantité d’air entre ses dents. Il jouait en s’amusant avec sa plume, et la trempant et la séchant à petits coups secs, il continua :
- Mais, vous ne devez pas attendre de ce monde de fripons autre chose que peines et misères, ah ! … peines et amertume. Vous êtes jeune, vous n’êtes qu’une enfant, et déjà … enfin, vous ne connaissez encore que les fleurs qui ornent le bord des chemins ; mais à mesure que vous avancerez…
Isidora poussa de nouveau un soupir. Les paroles sensées et philosophiques du brave homme lui étaient d’un grand réconfort. Elle le prit, alors, pour un prêtre.
- Est-ce que par hasard, vous êtes prêtre ? lui demanda-t-elle toute timide.
- Non, madame – rétorqua l’autre, en se mettant à écrire – Je suis laïque. Cela fait trente deux ans que je travaille dans ce bureau. Mais, pour revenir à notre sujet, le monde, mademoiselle, est une vallée de larmes. Il faut se faire à cette idée. Heureusement que nous sommes nés et que nous vivons au sein de la vraie religion, et que nous savons qu’il y a un au-delà, nous savons que cet au-delà, mademoiselle, nous réserve une récompense à tous nos efforts ; nous savons que nous reverrons ceux que nous avons perdus…»
Le vieillard fut pris par l’émotion et Isidora en eut les larmes aux yeux. Elle porta à ces yeux la pointe de son fichu rouge et s’exclama :
- Mon pauvre malade ! …
- Ah ! que c’est beau la douleur d’une fille ! – dit le buveur d’air relâchant résolument sa plume – que de mérites auprès de Celui qui voit tout, qui pèse tout, qui rend à chacun selon son dû !… Pleurez, pleurez ; ce n’est pas moi qui essaierai de vous ôter la peine par des consolations grossières. La seule chose que je vais vous dire c’est que la religion et le temps seront le meilleur remède à ce mal : la religion élève l’esprit en lui faisant voir une seconde vie de récompense et de repos où nous qui avons pleuré serons consolés, où nous qui avons eu faim et soif de justice, nous serons rassasiés ; le temps en passant tout doucement sa main sur nos blessures les ferme peu à peu. Vous êtes encore très jeune. Il est possible que le Seigneur vous réserve ici sur cette terre quelque chose qui ressemble à du bonheur – si on veut l’appeler comme ça ; vous serez l’épouse d’un homme honnête, une mère de famille, une grand-mère très digne.
Il venait de rouler une cigarette, et avec beaucoup de délicatesse dit :
- La fumée de tabac vous gêne ?
- Oh ! non, monsieur, non monsieur.
- Vous serez plus à l’aise dans ce fauteuil que sur ce banc, pourquoi ne venez-vous pas vous asseoir ici ?
- Non, monsieur, merci beaucoup. Je suis bien ici.
Isidora était aux anges. Le sage discours de ce brave monsieur, renforcé par un ton de voix très doux, sa courtoisie sans fausses notes, un je ne sais quoi de tendre, paternel et sympathique qui se lisait sur son visage, avaient subjugué la jeune fille endolorie lui inspirant autant d’admiration que de gratitude. Le vieillard la regardait comme s’il voulait l’inonder, disons cela comme cela, des courants de bonté qui montaient à ses yeux. Il y avait dans son regard tant de pitié, un intérêt si pur et si chrétien, que la pauvre fille se félicita intérieurement de cette amitié que Dieu lui envoyait à ces moments d’affliction. Toute entière dans ces pensées et remerciant Dieu pour ce secours moral de tant de valeur, elle se sentit touchée par le désir de se confier, d’ouvrir un peu de son cœur pour montrer ses peines. Elle était naturellement expansive et les circonstances la mettaient en situation de l’être encore plus que d’ordinaire.
- Vous connaissez mon père ? – demanda-t-elle.
- Oui, ma fille, je le connais et ça me fait beaucoup de peine… On a fait beaucoup pour soulager ses peines et lutter contre ses folies… Mais Dieu n’a pas voulu. Contre Lui, on ne peut rien. Consolons-nous tous en pensant que la grandeur de l’harmonie du monde se trouve dans l’accomplissement de sa volonté souveraine.
Cette phrase affecta la fille de Rufete, lui faisant penser que cette harmonie totale lui coûtait bien cher. Séchant à nouveau ses larmes, elle dit :
- Et si vous saviez comme il a été bon ! … Il nous aimait tellement ! Il n’avait qu’un défaut, c’est qu’il ne se contentait jamais de son sort, il aspirait toujours à plus, toujours plus. C’est que le pauvre avait beaucoup de talents, il se retrouvait toujours en dernier alors qu’il aurait dû être en première ligne… Il y a dans le monde de ces injustices !… C’est pour cela qu’il ne se soumettait jamais, il était toujours de mauvaise humeur et se mettait en colère et se disputait avec ma mère. Comme c’était un grand monsieur et que ses possibilités ne lui permettaient pas de se comporter comme un monsieur, il souffrait de manière indicible. Et ce n’est pas qu’il ne travaillait pas … Il allait au bureau presque tous les jours et il y passait au moins deux heures. Il a été secrétaire de trois Gouvernements de province et n’a pas réussi à être gouverneur à cause des intrigues de ceux de son parti. Ma mère lui disait : «Ah ! il aurait mieux valu que tu apprennes un métier pratique plutôt que de vivre dépendant des ministres, un jour debout, un jour battu…» Mais, voilà ! Il ne connaissait du bureau que le journal la Gaceta[7], et quand il parlait de rentes, de devis et de ces choses qui gouvernent, tous ceux qui l’entendaient en étaient étonnés. Son père, mon grand père, avait été lui aussi un bureaucrate. Le pauvre est mort pareil. Vous l’avez connu ?
- Non, ma fille. Continuez, ça m’intéresse beaucoup.
- C’est, je ne sais plus si c’est pendant la Milice Nationale[8], qu’il a fait des barricades, il en parlait beaucoup, et pour lui, tous ceux qui gouvernaient étaient des voleurs. Quand j’étais petite, je jouais avec le képi de mon grand-père… Que de choses… Ecoutez… Celui que j’appelle mon père a été plus intelligent que celui que j’appelle mon grand-père. Oh ! oui, c’était un grand monsieur, il avait du talent. Dans son parti il était craint. Il le disait lui-même : «je dois arriver là où je dois arriver, ou bien je vais devenir fou…» Le pauvre ! Quand il était sans emploi, il était désespéré. Il allait aux séances du Congrès et il faisait beaucoup de bruit dans la tribune en applaudissant l’opposition. Il partait de Madrid avec des commissions secrètes. Il ne parlait que de ce qui allait arriver, d’une chose terrible… vous comprenez ?
Le vieillard, après avoir aspiré la moitié de l’atmosphère de la salle, fit un signe approbateur, fronçant les sourcils et souriant comme un homme qui connaît les faiblesses de ses semblables.
- La dernière fois qu’on lui a retiré son emploi, nous nous sommes vus très mal, si mal que on ne pouvait plus le reprendre. Je travaillais ; ma maman est tombée malade ; mon père est entré comme correcteur d’épreuves dans une imprimerie où on sortait un grand journal, un très grand journal… Il travaillait toutes les nuits à la lumière d’une lampe à pétrole qui lui brûlait le front. Il avalait mille discours, articles, dossiers, décrets, et quand arrivait le petit matin (parce qu’il travaillait toute la nuit) il revenait à la maison, ne se reposait pas, non, monsieur. Que croyez-vous qu’il faisait ? Et bien, il se mettait à écrire. Tous les jours il entrait avec
à la mainun stock de papier et il remplissait tout d’un bout à l’autre. Que croyez-vous qu’il écrivait ? - Des lettres au Roi, au Saint Père, aux ambassadeurs et aux ministres. C’est comme ça que ça commence pour beaucoup.
- Eh non, monsieur. Il écrivait des dossiers, des lois et des ordres royaux. Même s’il fermait toujours sa chambre en partant, j’ai trouvé, une nuit, un moyen d’ouvrir et j’ai tout vu. Maman et moi, nous nous sommes dit : «Il copie peut-être tout ça pour que nous puissions manger». Quelle déception ! Cela revenait toujours : Article un, telle chose ; article deux, telle chose. Et puis : Je suis chargé de l’exécution de ce présent décret. Il faisait des préambules pleins de sottises. A mesure qu’il remplissait les feuilles de papier il les collectionnait avec grand soin, et à chaque liasse il mettait des titres comme cela : «Dette publique, Pupilles de la nation, Douanes, Banque, … Il mettait aussi sur certains paquets des inscriptions que nous ne comprenions pas, parce que sa folie était déjà manifeste, c’était : Ruines, ou bien Fanatisme, Barbarie, Urbanisme de Enviepolis,
CarreauxPots cassés, Corruption, Subvention personnelle, et tout comme ça. «Ah ! mon Dieu – nous sommes-nous dit maman et moi ; nous n’avons plus de mari, nous n’avons plus de père. Cet homme est fou». Et nous avons pleuré toute la nuit. Tout pour DieuDieu soit béni – dit avec émotion le vieillard, en voyant que Isidora s’arrêtait pour pleurer. Mais qu’est-ce que cela ma fille en comparaison de ce que le Christ a souffert pour nous ?- Ma mère est morte ces jours-là – poursuivit Isidora, presque entièrement étouffée par les sanglots. Ce jour-là, oh mon Dieu ! quel jour ! mon père a fait les bêtises les plus atroces ; il n’a pas pleuré, il n’a été affecté en rien. Quand ma mère a expiré dans mes bras, lui, il a fait deux ou trois tours dans la salle et me regardant dans les yeux… doux Jésus, quels yeux !… il m’a dit : «On lui fera les honneurs de lieutenant général morte en campagne…» Je ne peux pas me souvenir de ces choses sans mourir de chagrin. On a dû l’enfermer ici. Un parent assez fortuné que nous avions
àà Tomelloso a eu pitié de moi et a offert de me donner une demi-pension. Je suis allée vivre dans La Mancha[9] avec lui, et mon petit frère est resté ici avec unede mes tantes, côté materneltante de ma mère. Après quelques temps, mon oncle, prêtre, a oublié de payer la pension. C’est le meilleur des hommes ; mais il a de ces idées bizarres…
Au beau milieu de son récit, Isidora devait boire ses larmes entre ses paroles… Le brave monsieur qui l’écoutait, attendri de tant de malheurs, se leva de son siège et fit quelques pas pour vaincre son émotion.
- Dieu soit béni ! – dit-il en roulant nerveusement une autre cigarette. Brave petite, votre jeunesse a été bien triste ; vous êtes née dans le dénuement…
- Et tout ce que j’ai souffert a été injuste – dit-elle encore rapidement, avalant elle aussi un peu d’air, car tout est contagieux dans ce bas monde. Je ne sais pas si je m’explique bien ; je veux dire que je me demande pourquoi c’est à moi de supporter les peines et les misères de Tomás Rufete, car même si je l’appelle mon père, et sa femme, ma mère, c’est parce qu’ils m’ont élevée, mais pas parce que je suis vraiment leur fille. Je suis…»
Tout pour Dieu
Elle s’arrêta brusquement de peur que sa franchise naturelle et expansive ne l’emporte, comme ça, à faire des révélations indiscrètes. Mais le secrétaire, avec cette rapacité de pensée qui caractérise les hommes perspicaces, s’empara de l’idée à peine émise et dit :
- Oui, je comprends, je comprends. Vous êtes, vous, par votre naissance d’une autre classe plus élevée ; ce ne sont que des circonstances trop longues à expliquer qui vous ont fait descendre… Ce sont des choses qu’accepte Notre Père qui est aux cieux ! Lui doit bien savoir pourquoi il l’a fait. Goûtons ses mystères divins, qui en fin de compte, sont toujours pour notre bien. Vous, mademoiselle, dit-il après une brève pause, enlevant poliment son bonnet -, vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas voir dans ce malheureux Rufete qu’un père putatif, comme le Saint Patriarche Saint Joseph était celui de Notre Seigneur Jésus-Christ.
Quel éclair d’orgueil sur le visage d’Isidora lorsqu’elle entendit ces paroles ! Elle rougit légèrement. Ses lèvres hésitèrent entre le sourire de la vanité et le refus poli imposé par les convenances.
- Moi, je ne voulais pas parler de cela – dit-elle en prenant un petit ton emphatique calme et digne qui n’allait pas bien avec son pardessus russe. Je respecte tant celui que j’appelle mon père, je l’aime tant, et lui nous a tant aimés, mon frère et moi ! … nous avons été gâtés quand nous étions gamins ! … Il nous avait donné le goût de tout, et comme il était alors à la tête du parti et qu’il avait une bonne situation car il
vivait dansétait employé dans lesles propriétésPropriétés de l’Etat, nous vivions très bien. A cette époque-là Rufete a mis beaucoup de luxe chez nous, un luxe … mon Dieu ! Comme lui, jene pensait qu’à apparaître, apparaître et être quelqu’un de notable… - Ma fille – dit l’ancien avec vivacité – une des maladies de l’âme que l’individu apporte le plus dans ce genre de maison, c’est l’ambition, le désir de grandeur, l’envie que ceux d’en bas aient un peu de hauteur, et le fait de vouloir bousculer ceux qui sont en haut, non pas par l’échelle du mérite ou du travail, mais par l’échelle plus souple de l’intrigue, de la violence, comme si on disait, poussez-vous, poussez-vous…»
Le vénérable personnage avait à peine abordé cette observation si substantielle qui était une marque de bon jugement autant que d’expérience, qu’il s’en alla d’un pas rythmé et rapide vers le coin opposé du bureau.. Isidora réfléchissait à ces sages paroles, les yeux fixés sur les rayures de la natte du cordonnet ; mais sa peine et la situation dans laquelle elle était revinrent et elle se remit à soupirer et à s’étonner que le Directeur tarde tant. Quand elle leva les yeux, l’ancien passa devant elle en direction de la table ; tout de suite après il retournait en direction de l’angle du bureau. Sans se rendre compte que le vieux monsieur était très agité, sans doute parce qu’il prenait part aux peines qu’il venait d’entendre, Isidora s’amusait un peu, car si grande soit un malheur et il a beau nous paralyser et nous étouffer, il y a des moments où l’esprit reste libre pour faire quelques petits tours par les chemins de la distraction, et redonne des forces avant de retourner au martyre. Un très long ennui, un bon moment d’antichambre facilitent parfois ces phénomènes de l’âme.
Comme dans ce bureau-là, régnaient le silence et le calme ; comme dans les aller et retour du vieux secrétaire il y avait quelque chose de l’oscillation du pendule ; comme, en plus, en elle-même Isidora dérivait vers une douce somnolence qui endormait sa douleur, la jeune fille, s’amusa, donc, à contempler la salle. Quelle était belle la carte d’Espagne, toute pleine de traits qui divisaient et qui compartimentaient, de colonnes de chiffres qui montaient en augmentant, des lignes de statistiques qui descendaient en diminuant, de cercles et de banderoles qui marquaient les villages, les villes, les capitales ! Dans la partie bleue qui représentait la mer, une multitude de bateaux précédés de flèches montraient les lignes de navigation, et sur la grande illustration de l’en-tête, une multitudes multitude de locomotives, de bateaux à vapeur, de phares, et en plus les quais pleins de ballots, de cheminées d’usines, de roues dentées, de ballons d’essais, tout cela présidé par un lion furieux à grande crinière et une femme dont la chair était découverte plus que ne l’exige la pudeur… Quel silence profond et doux s’emparait de la pièce toute calme, et comme on sentait la pure atmosphère de la campagne ! Il n’y a que lorsque la porte s’ouvrait qu’on pouvait entendre par la porte ouverte l’écho des rires lointains et énervants et des cris qui n’étaient pas les cris et les rires du monde. Et que de jolis livres étaient enfermés dans cet armoire d’acajou, sur lequel régnait un buste de plâtre ! Ce monsieur de couleur blanche sans pupille dans les yeux, les épaules nues comme une dame avec décolleté, devait être un de ces nombreux savants qui ont existé dans un temps très reculé, et là, sur l’étagère des livres et sur la carte avec ses graphismes et ses statistiques, on mesurait toute la sagesse des siècles.
Isidora ne mit pas plus d’une minute à parcourir les lieux. Soudain, elle se fixa sur le vieillard qui passait devant elle de plus en plus vite, et elle s’étonna de voir l’agitation de ses mains, le tremblement de ses lèvres et la vivacité de ses yeux, apparences très différentes de ce visage sympathique et plein de bonté. S’arrêtant devant Isidora, il dit de manière maladroite et très émue :
- Madame, je n’aurais jamais cru cela d’une personne comme vous.
- Moi, murmura Isidora, remplie d’épouvante.
- Oui – dit l’autre en haussant la voix, vous m’insultez ; vous êtes en train de m’insulter.
Le jugement absurde, la voix altérée du vieillard, son agitation croissante, furent un trait de lumière pour Isidora. Elle se leva brusquement et chercha la porte ; elle y courut horrifiée. La terreur lui donnait des ailes. Pendant ce temps-là, la le vieillard criait :
- En train de m’insulter, si, sans aucun respect pour mes cheveux blancs, pour mes souffrances de père… Oh ! Seigneur, pardonnez-lui, pardonnez-lui, Seigneur, elle ne sait pas ce qu’elle dit.
Isidora sortit dans le couloir quand le Directeur arrivait, qui comprit tout de suite la cause de sa peur. Tout en souriant il la prit par la main et l’obligea à entrer.
- Le pauvre Canencia… – dit-il. C’est bizarre, cela fait tant de temps qu’il est calme… Mais c’est un ange, il est incapable de faire le moindre mal.
Tous deux le regardèrent. Le visage de l’ancien n’exprimait plus la colère, mais l’émotion, et deux larmes roulaient sur ses joues.
- Vous aussi, vous m’insultez, monsieur le Directeur – dit-il en appuyant sur sa poitrine et avec les intonations et les gestes d’un acteur médiocre.. Je n’en peux plus, je n’en peux plus… Adieu, adieu, bandes d’ingrats !
Et il s’échappa.
- Cela lui passe vite – indiqua le Directeur à Isidora, que n’était pas encore revenue de son épouvante. Il est bien brave ; cela fait trente deux ans qu’il est dans la maison et il a de longs moments, parfois deux ou trois ans sans la moindre petite perturbation. Ses accès ne sont rien de plus que ceux que vous avez vus. Il commence par dire qu’il a deux machines électriques dans la tête, puis
il sort sous prétextevoilà que je l’insulte. Il se met à courir, il fait quelques tours de jardin, et au bout d’un moment il redevient serein. Il travaille bien, m’aide beaucoup, et, comme vous l’avez vu si vous l’avez écouté, il est incroyable pour donner des conseils. On dirait un saint ou un philosophe. Moi, je l’aime bien ce pauvre Canencia. Il est venu pour des problèmes de procès avec ses enfants… Longue histoire et bien triste qui serait hors sujet. Parlons de votre affaire qui n’est pas drôle non plus, et aujourd’hui plus que jamais.
Le Directeur fit un soupir, expression officielle de ses sentiments compatissants, et Isidora resta de marbre, s’attendant à de terribles nouvelles. Comme elle regardait ce brave homme, elle essaya de lire sur son visage, et elle voyait bien que ce visage ne lui disait rien de bon !
- Je voudrais le voir … – balbutia Isidora.
- Cela est impossible. Le voir ! et pourquoi ?… Mal, très mal, le pauvre Rufete est très mal – affirma le Directeur en remuant la tête. Chargez-vous de patience, parce que, vraiment, si cette maladie est incurable, si celui qui en souffre ne cesse de se tourmenter, mieux vaut qu’il s’en aille au repos… Je le dis tout net, si j’avais quelqu’un de ma famille dans cet état, je voudrais…»
Cela lui coûta à Isidora d’admettre la funeste vérité qu’on voulait lui annoncer avec d’infinies précautions, et avalant sa salive pour faire partir le nœud qui se formait dans sa gorge, elle se mit à parler à mi-mots ainsi :
- Qui sait… Encore… Mais je veux le voir.
- Allons, c’est non… puisque …
Le brave monsieur s’impatientait Il avait à faire.
- Asseyez-vous… -murmura-t-il en approchant un fauteuil. Voulez-vous que je vous apporte un verre d’eau ?
Isidora ne disait rien. Ses yeux, atterrés, fixaient le buste de plâtre. Elle l’examina bien et bêtement, en le voyant si clairement, de la même façon bizarre qu’au moment de recevoir une nouvelle d’importance, on fixe ses sentiments sur n’importe quel objet matériel, objet qui reste ensuite pour quelque temps associé à la nouvelle elle-même…
IV
A l’instant même où Isidora racontait ses déboires à l’innocent Canencia, il se passait non loin de là un événement qui, même s’il était très triste, n’affectait pas beaucoup ceux qui étaient présents. C’était le Directeur médical, l’administrateur, un médecin, élève en Médecine, l’aumônier et un infirmier. Le moribond, car il s’agit de la mort d’un homme, c’était Rufete. La crise était violente et calme, au dénouement facile et à la fin décisive. Le malade ne bougeait plus, seule la tête donnait signe de vie ; il ne souffrait pas ; il allait par une pente rapide et lisse, sans heurts, sans lutte, sans convulsions, sans défenses.
- C’est une belle mort» – dit à voix basse le médecin.
Le malade poussa un long soupir, ouvrit les yeux, regarda tout le monde un par un ; et sans colère, sans les convulsions des fous, sans colère revendicatrice, mais d’une voix toute calme, avec une impression paisible, qui n’était qu’une sorte d’apitoiement très profond sur lui-même, il prononça ces mots :
- Messieurs, c’est vrai ce que je crois ?… C’est vrai que je suis à Leganés ?
Le médecin voulut le consoler par des paroles bon enfant.
- Bon, ne dites pas de sottises… ; vous êtes chez vous… Bon, ça va aller mieux..
Le malade remua la tête tristement. Il resta là sans rien dire pendant un long moment. Puis, il prit la main du prêtre, l’embrassa… Il voulu parler, mais n’y arriva pas. On le vit lutter pour sortir quelques mots. A la fin, après un effort de volonté désespéré, il réussit à dire à mi-voix :
- Mes enfants…, la marquise…
Et il se tut à jamais. Le médecin et son élève observèrent avec l’attention et la froideur de la science ce cas transitoire, et ils allèrent faire leur rapport. Le Directeur s’approcha d’eux, leur signalant avec plus de pitié que de préoccupation la présence dans la maison de la fille du mort. L’élève du médecin déclara la connaître et se réjouissant de sa présence, il voulut se joindre à la difficile tâche d’annoncer la nouvelle et d’essayer de la consoler et de lui apporter quelque secours s’il en était besoin.
Le Directeur s’en alla dans son bureau à la recherche de Isidora, et c’est là que s’est passé ce que nous avons déjà raconté. La malheureuse jeune fille au pardessus russe commençait à comprendre avec certitude son malheur, quand un jeune homme de vingt quatre ans environ entra dans le bureau. Ce jeune homme s’approcha d’elle avec des marques de confiance et lui dit :
- Alors, comme ça, vous voilà, Isidora ? … Pour une si triste occasion ! Mais, vous ne me reconnaissez pas ? Perdez-vous la mémoire à ce point, Isidora ? Vous ne vous souvenez pas de don Pedro Miquis, du Toboso,
j’allaisqui allait souvent à Tomelloso chercher votre oncle, monsieur le chanoine, pour sortir ensemble ? Et bien, moi, je suis le fils de Pedro Miquis. Vous ne vous souvenez pas non plus de mon frère Alejandro ? Vous ne vous souvenez pas que parfois, pendant les vacances, on accompagnait mon père ? … Et bien, ça fait cinq ans que je suis ici à étudier Médecine. Et comment va monsieur votre oncle ? Cela fait longtemps que vous êtes partie de ce célèbre Tomelloso?
Isidora le regardait par la déchirure que la peine lui avait faite ; elle le regardait et le reconnaissait. Oui, sa mémoire s’illuminait peu à peu devant ce visage qu’on ne pouvait confondre avec aucun autre. Ce visage pâle et brun, si brun et si pâle qu’on aurait dit une grande olive ; ce nez si court qui faisait contraste avec le charme d’une grande bouche, dont les dents d’une blancheur extrême se faisaient toujours voir ; ces larges sourcils, si noirs et si épais qu’on aurait dit une bande de velours noir, et ces yeux pers où se nichaient toujours toutes les fausses malices et toute l’ironie du monde ; cette belle laideur, cette désinvolture dans la manière, ce négligé dans l’habillement, et, enfin, cette manière légère des sous-entendus, étaient la preuve criante, sans aucun doute, qu’il s’agissait bien du petit Augusto, fils de Pedro Miquis, celui de Tomelloso. Immédiatement revinrent à l’esprit d’Isidora des idées par milliers et des souvenirs d’une époque où l’enfance et l’adolescence se confondent, époques des espiègleries, des peurs, des confiances innocentes et d’événements qui ne sont pas toujours agréables à la mémoire. Elle ne réussit à répondre que quelques mots à peine qu’à mi-mots. Miquis se rendit compte de la situation, et devenant aussi sérieux qu’il pouvait, chose difficile pour lui, dit d’un ton compassé et grotesque :
- La première chose à faire est de sortir de cette maison… Ah ! quelle maison ! Il n’y a rien à faire ici. Si vous allez à Madrid, j’aurai beaucoup de plaisir à vous accompagner.
Isidora manifesta le désir de s’en aller très vite. Elle voulut laisser l’argent qu’elle avait apporté pour payer les retards de la pension de Rufete, mais le Directeur n’accepta pas. Quant aux vêtements, elle insista tellement auprès du brave homme pour qu’il les accepte, qu’il dut la laisser, la remerciant au nom de tous les autres pauvres malades qui en avaient besoin.
Isidora et Augusto sortirent de cette maison de fous et s’éloignèrent en silence de ce triste village dans lequel presque toutes les maisons hébergeaient des déments. Isidora ne parlait pas, et Miquis, le bavard, par respect pour sa douleur, ne dit que cela :
- A Carabanchel, nous trouverons des voitures. On dit qu’ils vont installer un tramway.
En arrivant à la rivière de Butarque, Miquis crut opportun de distraire un peu sa compagne de voyage, parce que, vraiment, à quoi cela servait-il de pleurer sans cesse, si on n’y était pour rien ? Il fallait faire face à la douleur, ennemie sauvage qui se nourrit sur le dos des faibles ; il fallait se surpasser, et donc, … se rendre compte que… Après ces apaisantes interventions, qui comme toujours, n’ont strictement aucun effet, Miquis se mit à parler de la beauté de ce jour printanier (c’était un de ces beaux jours d’avril), du ravin de Butarque, auquel il donna le nom d’oasis, et finalement il invita Isidora à se reposer à l’ombre de l’épaisse verdure d’un orme, car le soleil tapait fort et la journée allait être longue.
Assis côte à côte, ils restèrent en silence un bon moment, lui en contemplation, elle dans sa douleur. Miquis chantonnait entre les dents. Isidora essayait de cacher ses pieds pour que Miquis ne voie pas qu’elle était mal chaussée.
- Isidora…
- Quoi ?
- Il y a une chose dont je ne me souviens pas, rappelez-moi… C’est vrai ou non que à Tomelloso, on se tutoyait ?
[1] Krupp AG était une compagnie industrielle allemande du secteur de l’acier dirigée par la famille du même nom et qui s’est notamment enrichie dans la fabrication des armes.
[2] Le bromure de potassium (KBr) est utilisé en tant que sédatif.
[3] Thomas a Kempis (1380-1471) est un moine chrétien du moyen-âge. On lui attribue L’Imitation de Jésus-Christ, l’un des livres de dévotion chrétienne les plus connus.
[4] Galdós fait allusion aux années 1868-1873 et aux désirs de réformes, ces années seront suivies par la Restauration (1874-1885), époque plus conservatrice.
[5] L’aphasie est une pathologie du système nerveux central, due à une lésion d’une aire cérébrale. Le mot « aphasie » vient du grec et signifie « sans parole ». Ce terme a été créé en 1864 par Armand Trousseau. Depuis cette époque, le mot a pris du sens, en désignant un trouble du langage affectant l’expression ou la compréhension du langage parlé ou écrit survenant en dehors de tout déficit sensoriel ou de dysfonctionnement de l’appareil phonatoire.
[6] Asile d’aliénés toujours existant. Il fut fondé en 1852 et pendant plus d’un siècle la ville a été identifiée à cet établissement.
[7] La Gaceta de Madrid, publication où l’on faisait les annonces officielles, elle sera remplacée par le Journal Officiel.
[8] Galdós doit faire allusion à l’époque entre 1834 et 1843 où la Milica Nationale a eu un rôle actif.
[9] L’auteur commence à établir un parallèle toponymique avec le lieu de naissance de don Quichotte pour assimiler le caractère de Isidora à celui du Chevalier de la Mancha.















