No hay productos en el carrito.
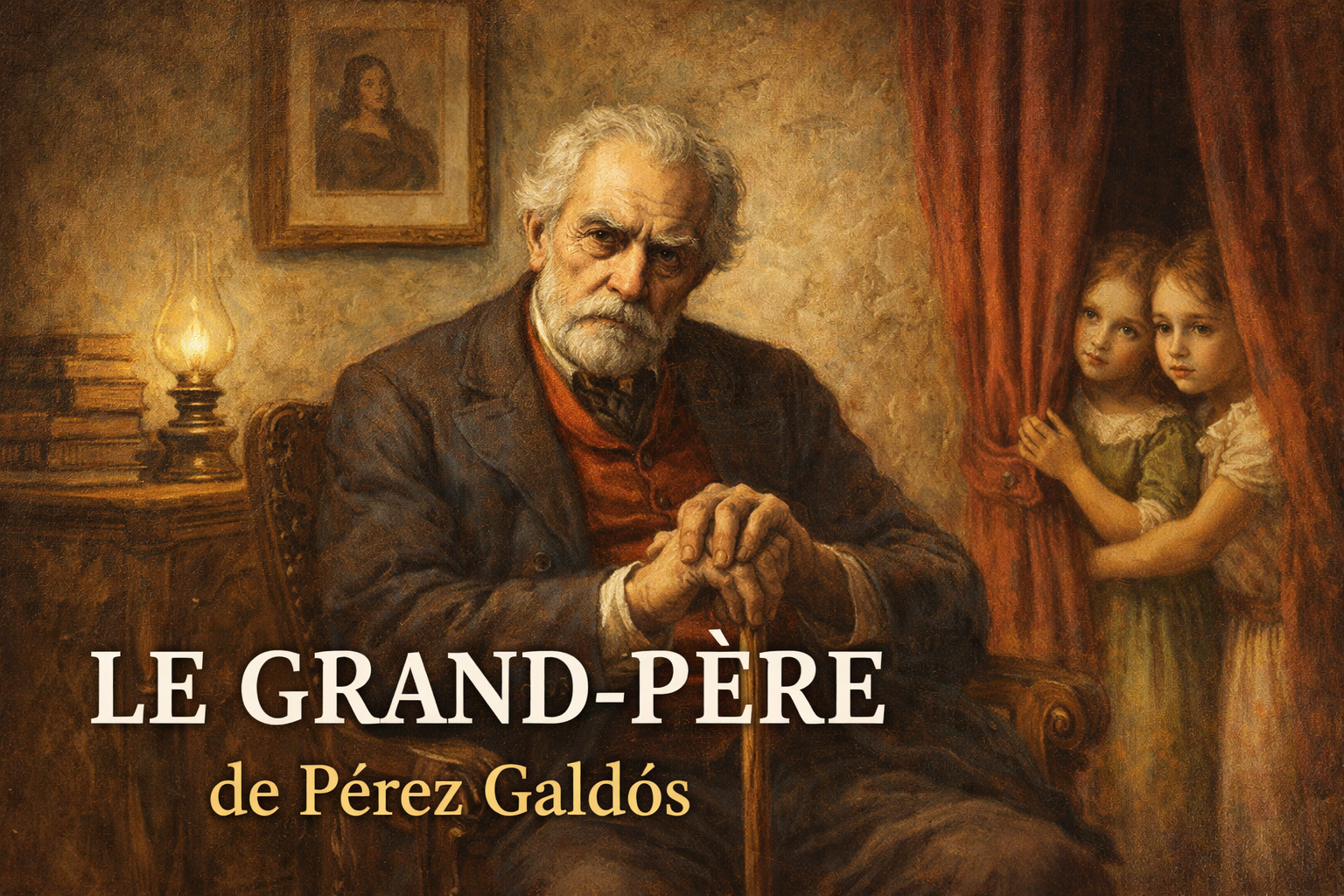
Daniel Gautier
Scène I
Salle du rez-de-chaussée chez monsieur le maire de Jerusa, don José María Monedero, décor luxueux mais bon marché, le type même de la pédanterie des nouveaux riches. Les murs sont couverts de paysages peints à l’huile, ce genre de tableaux qu’on vend par deux dans les rues du centre de Madrid, œuvres d’artistes ratés. Ils sont associés à ces croûtes, images de scènes de chasse ou de revues navales, de figures de bazar, de broutilles brodées, de mille petits travaux de bonnes femmes, faciles à réaliser, ce genre de travaux dont les explications et les reproductions attirent les journaux de mode dans leur colonne de loisirs. Des fleurs artificielles dans des pots de carton qui exhalent par les coins leur odeur de colle et d’encre décomposées. Un piano désaccordé, un meuble à musique, des portraits accrochés sur des estampes japonaises et des poissons dans leur bocal.
Nell, Dolly et Lucrecia, comtesse veuve de Laín.
C’est une belle femme de trente-quatre ans, ce qu’on appelle habituellement un type «intéressant», mélange heureux de beauté, de douceur et de mélancolie : les cheveux sont châtains, elle a un visage d’albâtre au profil élégant, précieux modèle de race anglo-saxonne, élevé en Amérique. Elle a de grands yeux sombres avec des reflets dorés, le regard serein et triste comme celui d’un tigre encagé qui s’est endormi et qui n’a plus le souvenir d’être une bête féroce. Elle est svelte mais on commence à percevoir quelques rondeurs, faciles à corriger encore par la sculpture orthopédique du corset. Elle est élégamment habillée de noir, en signe de deuil. Dans son parler, c’est à peine si on perçoit un léger accent étranger.
Lucrecia – (Elle enlace et embrasse les petites.) Mes filles, je ne me lasse pas de vous embrasser. Aviez-vous grande envie de me voir ?
Nell – Devine.
Dolly – Nous sommes venues à toute vitesse… Que de gens ! J’ai cru qu’on ne pourrait pas entrer et qu’on allait se faire renverser par les voitures.
Lucrecia – Quelle contrariété ! Je viens à Jerusa uniquement pour voir mes petites et je me trouve devant cet horrible désagrément de l’enthousiasme public.
Nell – Maman, c’est la reconnaissance du peuple…
Lucrecia – Croyez bien que ça me cause bien des ennuis et j’en ai même honte…
Dolly – C’est qu’ils t’aiment bien.
Lucrecia – Ce sont des manifestations aussi ennuyeuses que ridicules. Pourquoi est-ce qu’on m’acclame, moi ?… Enfin, le mauvais moment de l’entrée triomphale est passé… (En les regardant affectueusement.) Vous avez bonne mine… Vous avez des visages tout bronzés. C’est ça que je veux : que vous ayez le teint comme des pommes reinettes grises du Canada ; c’est signe de bonne santé et d’un sang pur…
Nell – Maman, toi, c’est sûr, tu es très belle.
Lucrecia – (En les embrassant à nouveau.) Vous, vous êtes mes petits anges sauvages, oh oui, vous êtes belles et braves, et… (La femme du maire l’interrompt en arrivant à l’improviste.)
Scène II
Les mêmes et la femme du maire, une femme sèche et menue, qui n’a d’autre préoccupation en ce moment que de paraître distinguée, et ce singulier état d’esprit, ajouté à l’embarras que cela produit, se voit dans tous ses gestes, dans ses paroles mielleuses et même dans les moues bien travaillées de la bouche et du nez. Elle porte une robe bleue, élégante, qu’on lui a fait parvenir de Madrid. Le maire la suit de près, c’est un gros monsieur, un peu massif, sain et jovial ; à l’opposé de sa femme, il met toute son attention à paraître un peu ours, laissant voir, dénué de toute recherche rhétorique, son naturel spontané et l’armature un peu rustre de son être moral. Il entend que les hommes doivent être «clairs», se révélant tels que Dieu les a faits. D’origine très humble, il a commencé à sortir les pieds de la fange en passant au monde des charretiers ; il a ensuite travaillé en toute honnêteté dans plusieurs usines, jusqu’à trouver sa voie dans la fabrication de vermicelles. Son acharnement au travail l’a rendu riche et l’héritage d’un oncle d’Amérique l’a fait devenir millionnaire. Il porte une redingote et son chapeau haut-de-forme, qu’il garde souvent à cause de ses fonctions, est, sans discussion, le plus beau de toute la localité. Son épouse prend bien soin de renouveler cette pièce de vêtement de façon opportune pour ne pas être ridicule.
La femme du maire – (Très distinguée.) Excusez-moi, Comtesse. Mon époux et moi-même avons dû convaincre les notables de la ville que, en raison de votre deuil et de votre fatigue, vous ne pouviez recevoir personne…
Nell – (En apparaissant à la fenêtre.) Maman, maman, c’est vrai, la place est remplie de monde !
Dolly – Ils veulent que tu te montres pour crier les «vivats».
Lucrecia – Mon Dieu, Vicenta, débarrassez-moi de cette histoire… Des vivats pour moi ! Moi, je ne sors pas ; je ne suis pas faite pour ça… Grand Dieu, qu’ils s’en aillent et qu’on me laisse. Et je remercie de tout cœur…
La femme du maire – Les ovations populaires ont beau être méritées, cela fatigue et c’est gênant… Jerusa ne peut se montrer ingrate, elle n’oublie pas les bienfaits que vous lui avez prodigués…
Lucrecia – (Atterrée par la rumeur populaire.) Mais quels bienfaits, quels fichus bienfaits ? Moi, je n’ai rien fait, absolument rien. Ils sont fous ici ? Croyez-moi, Vicenta, la «vox populi» me fait peur.
Nell – Maman, il faut que tu te montres… Ils veulent te saluer avant de partir.
Dolly – Il y a le peuple et les notables… il y a même des prêtres… Ma petite maman, qu’est-ce que ça peut faire s’ils t’acclament ? Ecoute, si tu ne sors pas, c’est à nous qu’ils vont lancer les vivats.
Lucrecia – Je ne vais pas sortir, non, allons ! Vicenta, pour l’amour de Dieu, que votre mari me fasse le plaisir de leur faire un discours et de leur dire… que je suis malade et que je les remercie infiniment pour leurs manifestations… que je ne les mérite pas… Bref, il va bien savoir quoi dire…
Le maire – (En essuyant la sueur de son front, la redingote défaite, le gilet à moitié déboutonné.) C’est bon, c’est bon, ils partent… Mais qu’est-ce qui vous en coûtait, Comtesse, de vous montrer un petit peu ? Un simple geste de la tête et vous étiez quitte. Mais, enfin, je respecte votre répugnance à ce genre d’apothéose. C’est aussi vrai pour moi. Chaque fois qu’on m’ovationne, je me mets à pleurer et j’ai mal au ventre.
Lucrecia – Mais qu’ai-je fait, moi, mon cher monsieur don José ? Comment expliquer ces prévenances, cet enthousiasme ?
La femme du maire – Mais voyons, la route de Forbes, la station télégraphique… la remise de la dette.
Lucrecia – Il m’a suffi de le demander au ministre…
Le maire – Plus que tout c’est l’Institut d’Enseignement Secondaire que nous disputaient ceux de Durante. Les gens ne sont jamais tant reconnaissants, ma chère madame, que lorsqu’on leur donne ce qu’on prend au voisin. C’est une question d’amour propre : la nature du peuple est semblable à la nature de la personne. Embêter le voisin et advienne que pourra. Jerusa verra toujours dans l’illustre comtesse de Laín une personne digne de tout notre respect. Et moi, qui ai le cœur sur la main, moi qui dis toujours la vérité pure et simple… Je suis comme ça, brut mais franc… je vous assure que nous vous aimons beaucoup ici… comme Jerusa sait aimer et si on parvenait à ce qu’on nous cède l’Ecole de commerce que ceux de Durante prétendent avoir, je ne vous dis pas !… La Chine serait au courant de l’apothéose qu’on vous ferait.
Lucrecia – (Souriante.) Moi, c’est sûr, je n’en reviens pas de mon apothéose !
Dolly – (De la fenêtre.) ça y est, ils partent.
Nell – On dirait qu’ils ne sont pas contents. Ils nous regardent drôlement !
La femme du maire – Ne vous étonnez pas, Comtesse, de la véhémence de mon mari. Depuis qu’il est ‘magistrat’ (En insistant bien sur le terme.) il ne vit plus. La fièvre de la chose publique altère un peu son caractère paisible. Il faut dire qu’il est imbattable dans ces affaires, et personne ne se dévoue plus pleinement à cette charge épineuse.
Lucrecia – (Histoire de dire quelque chose.) Voilà ce qu’on appelle des hommes, voilà ce qu’on appelle de grands citoyens…
Une domestique – (En entrant avec un plateau rempli d’entremets aux œufs.) Ce sont les sœurs dominicaines qui envoient cela à madame la Comtesse.
Nell – (En courant pour voir.) Des entremets aux œufs ! Hum ! Que c’est bon !
Dolly – C’est un beau cadeau, maman !
Le maire – Pour que vous disiez que les petites sœurs de chez nous se comportent mal.
Lucrecia – Les pauvres ! Il faudra que j’aille leur faire une visite.
La femme du maire – C’est cela, elles sont très gentilles.
Une autre domestique – (En entrant avec un énorme bouquet de fleurs.) De la part des contremaîtres de la «ferme-modèle»…
Lucrecia – J’irai leur faire une visite à eux aussi.
Le maire – C’est cela, oui, madame. Vous verrez les béliers qu’ils ont fait venir pour la reproduction !
La femme du maire – (Elle était sortie un instant et revient avec un ouvrage de tapisserie et de verroterie.) Regardez ça, Lucrecia, c’est ce qu’envoie la maîtresse de l’école des filles.
Nell – Oh ! C’est joli !
Dolly – Dis, maman. C’est un bonnet ?
Lucrecia – Non, enfin, c’est un cosy pour couvrir les théières…
La femme du maire – (Vexée de ne pas avoir su avant à quoi pouvait servir ce truc-là.) C’est un accessoire étranger. Ici, on ne s’en sert pas.
Le maire – Il faut que vous alliez visiter l’école.
La femme du maire – Pauvre Comtesse ! Vous allez en avoir à faire.
Le maire – Et vous pourrez dire que nulle part ailleurs dans le monde on fait d’aussi belles choses que dans l’école de doña Severiana.
La femme du maire – Elles brodent à merveille… Vous voyez bien… Là, les petites sont sur leur métier toute la journée…
Le maire – (En regardant sa montre, énorme pièce en or.) Et avec tout cela, Vicenta, il est déjà l’heure et on n’a toujours pas mangé. Ma chère doña Lucrecia a de l’appétit… ; les petites vont défaillir. N’est-ce pas Nell et Dolly que vous avez envie de vous asseoir à table ? … Moi aussi… pourquoi ne pas le dire ? J’ai l’estomac dans les talons… Donc…
Lucrecia – Je vais faire un brin de toilette, juste un instant.
La femme du maire – Montons à mon cabinet de toilette. Pendant que vous vous préparez, je vais faire en sorte qu’on nous serve le repas.
Le maire – Et moi, si madame la Comtesse me le permet, je vais la délivrer d’un autre ennui horrible.
Lucrecia – Lequel ?
Le maire – La fanfare municipale veut venir chanter pendant le repas.
Lucrecia – Oh ! Non, de grâce.
Le maire – Voilà son directeur. Je vais lui enlever ça de la tête.
Lucrecia – Oui, oui, dites que je le remercie, je regrette beaucoup, mais…
La femme du maire – Qu’elle est très fatiguée. Soyez sûre qu’on ne perd rien. Ils jouent comme des pieds…
Le maire – Et puis, vu votre deuil, vous n’êtes pas disposée à entendre de la musique… C’est bon, c’est bon, je vais les renvoyer… Et surtout, c’est moi qui commande, moi, allez… (Il s’en va, précipitamment.)
Scène III
Cabinet de toilette de la femme du maire.
Lucrecia, Dolly et Nell, une domestique étrangère qui aide sa maîtresse à s’habiller mais ne parle pas ; puis, la femme du maire.
Lucrecia – Ouf ! Un peu de repos ! Enfin toutes seules un moment. Je préfère la maladie aux élans populaires de Jerusa.
Nell – Maman, c’est qu’ils t’aiment.
Lucrecia – Oui, oui, des tendresses qui réclament la fuite immédiate comme on échappe à une épidémie. C’est très dur de devoir montrer de la gratitude devant ces mascarades.
Dolly – Maman, aie un peu de patience.
Lucrecia – (En baissant le ton.) C’est la même chose que de supporter les amabilités de ces bobos minables… Ce sont de braves personnes, je le reconnais… et je les apprécie vraiment, mais à Jerusa, je ne veux voir que vous.
Nell – Maman, quand est-ce que nous allons partir avec toi ?
Lucrecia – (Elle réfléchit.) Je ne sais pas… Peut-être bientôt. Cela dépend de certaines circonstances…
Dolly – (Avec vivacité.) Maman, tu ne sais pas ? Notre cher grand-père est arrivé.
Lucrecia – (Cachant son aversion qui ne transparaît que par quelques détails rapides dans ses yeux étoilés d’or.) Je sais, je sais, oui… Il est arrivé ce matin. Et alors ? Il est toujours aussi grognon et hargneux que d’habitude.
Nell – Nous, il nous aime beaucoup.
Dolly – Tu vas aller le voir…
Lucrecia – Sans doute. Je sais qu’il mange aujourd’hui chez don Carmelo… Et avec vous, il parle…? Qu’est-ce que vous faisiez quand il est arrivé ?
Nell – On l’a trouvé dans le bois. On a d’abord eu peur parce qu’on ne le reconnaissait pas.
Lucrecia – Et après l’avoir reconnu, vous aviez encore plus peur ?
Nell – Non, non ; le pauvre n’en finissait pas de nous cajoler. Ça nous fait de la peine de le voir si fatigué, si vieux, presqu’aveugle.
Lucrecia – Et sur le chemin du bois vers La Pardina, il n’a parlé à personne ? Il n’y a pas quelqu’un qui est allé à sa rencontre ?
Dolly – Si, maman, Senén.
Lucrecia – (Contrariée.) On m’a déjà dit que ce frelon était là. Il est tellement soûlant et… il pique. Je vous recommande d’avoir le moins de contacts possibles avec ce type.
La femme du maire – (En entrant.) Quand vous voudrez.
Lucrecia – J’arrive.
La femme du maire – (Elle la conduit à la fenêtre, et lui montre le maire qui parle à un jeune homme dans la rue.) Voyez-vous les problèmes qu’a mon époux pour vous protéger de toutes les impertinences. Celui-là avec qui il parle, c’est Pepito Cea, le journaliste de Jerusa, qui veut entrer ici pour vous interviewer…
Lucrecia – M’interviewer ? Mais il est fou cet homme ?
La femme du maire – Regardez… Regardez José María, rouge comme un dindon… On dirait qu’il va lui casser son bâton sur la figure… Voilà qu’il l’attrape par le colback. Enfin, je crois qu’il a réussi à le convaincre.
Lucrecia – Mais qu’est-ce qu’il veut me demander ce type, qu’est-ce qu’il veut que je lui dise ?
La femme du maire – Oh, rien ! A quelle heure vous êtes montée dans le train, si le paysage vous a plu ; si Jerusa vous convient ; si vous avez été contente de l’ovation ou si vous avez trouvé que c’était bien peu et, enfin, ce que vous pensez de l’affaire de la Chambre de Commerce, c’est-à-dire, si vous appuierez à fond les demandes de cette ville à Madrid.
Lucrecia – Dieu m’en garde !
La femme du maire – (Elle continue à regarder.) ça y est, il l’a renvoyé. Voilà le pauvre Cea renvoyé pour de bon. Il va sans doute nous mettre ce soir, les sornettes que José Maria lui aura soi-disant balancées… Que vous adorez cette ville ; que vous êtes arrivée très fatiguée et que vous souffrez de rhumatisme, que vous allez tout faire pour nous obtenir cette affaire de la Chambre de Commerce, laissant ceux de Durante décontenancés… Tenez, voilà mon mari. On peut descendre à la salle à manger.
Lucrecia – (Les deux femmes sortent en se tenant par le bras derrière les filles.) C’est charmant. Mais je ne trouve pas drôle du tout que cet abruti puisse mettre ces fausses nouvelles de mes rhumatismes. C’est une maladie qui me gêne plus que le reste, parce que ce n’est pas très grave mais ça fait grossir.
La femme du maire – (Descendant l’escalier.) C’est une fine mouche et il dira que c’est nerveux.
Lucrecia – Encore heureux !
Elles trouvent le maire à la porte de la salle à manger. Il offre son bras à la comtesse. Tout suffoqué mais de bonne humeur, il rend compte de ce charmant renvoi qu’il a réussi à faire pour éviter le formidable désagrément dont les menaçait cet audacieux journaleux. Il faut dire que, rapportant à la vérité les honneurs qui lui sont dus, le repas fut copieux et excellent, un heureux mariage de style «auberge» et «maison» habituel dans les maisons riches : le service un peu bousculé et lent, car les pauvres serveuses ne réussissaient pas à s’y retrouver dans ce va-et-vient, cette valse de plats et de saucières. S’assirent à la table, en plus de la comtesse et de ses filles et les maîtres de la maison, leurs deux enfants, scolaires exquis, se trouvant en plein âge bête étaient on ne peut plus désagréables comme on en voit tant de nos jours. Comme personnes étrangères il n’y en avait qu’une que tout Jerusa connaissait sous le nom de Consuelito, la Solitaire, cousine du maire, riche veuve sans enfants qui passait une bonne partie de son temps à fouiller dans la vie des autres et était, par conséquent, une archive vivante de légendes, d’imbroglios et d’histoires drôles. Monsieur le maire égaya le repas d’un ennuyeux discours sur les meilleurs travaux passés, présents et à venir à Jérusa, et personne ne pouvait placer un mot. Son épouse s’efforçait d’intervenir par de fines observations au beau milieu du baratin habituel du brave Monedero ; mais ses élogieux efforts n’étaient guère couronnés de succès. Alors qu’on servait le café (qui entre parenthèses, arriva à table, mal fait, réchauffé et froid), monsieur le curé entra pour saluer la comtesse qu’il avait déjà entrevue, ainsi que Senén, qui n’avait pas encore eu l’honneur de lui baiser la main.
Scène IV
Jardin qu’il est inutile de décrire, car on comprend tout de suite qu’il s’agit d’un plagiat maniéré et ridicule en petit du style anglais en grand ; tracé en valons avec des prairies, des massifs, des petits bosquets et des plantations d’ornements de différentes couleurs.
Lucrecia, Nell et Dolly, le maire, sa femme, ses deux fils, qui ne disent rien, et ce serait bien pire s’ils se mettaient à parler ; Consuelito, le curé et Senén. Ils forment différents groupes et les silhouettes changent.
Le curé – (En s’assoyant avec la comtesse et la femme du maire sur un des bancs «rustiques» qui abondent dans le jardin, en alternance avec les bancs «civilisés».) Madame la Comtesse comprendra bien que je ne suis pas venu ce soir uniquement pour le plaisir de vous voir, bien grand pourtant, mais que…
Lucrecia – Oui, oui… Vous avez mangé avec «lui»… et vous m’apportez un message, une commission du moins.
Le curé – Excusez-moi, mais vous vous trompez. Monsieur le comte ne m’a donné aucune commission ou message pour la Comtesse de Laín.
Lucrecia – Alors…
Le curé – Ce que je vais dire est de mon propre chef, juste mon avis et un conseil d’ami.
Lucrecia – (A la femme du maire qui s’éloigne discrètement.) Non, non, ne vous en allez pas, Vicenta. Il n’y a pas de secret. Vous pouvez bien entendre. Continuez, don Carmelo. Mon illustre beau-père a dû vous parler de moi, bien entendu… Il a dû dire… je ne sais pas… des horreurs épouvantables.
Le curé – Non, madame. Pas une seule fois il n’a prononcé votre nom de tout le repas.
Lucrecia – Monsieur le curé, don Carmelo, permettez-moi de ne pas vous croire, avec tout le respect que je vous dois. Vous êtes un saint, qui, en cet instant, ne dit pas la vérité… par excès de vertu. Cela arrive…
Le curé – Il a beaucoup parlé de son fils mort, votre très digne époux ; il a vanté ses vertus, son mérite hors du commun, il a pleuré…
Lucrecia – (Elle pâlit et essaie de détourner la conversation.) Il a dû parler aussi de son triste voyage en Amérique. Il l’avait entrepris poussé par l’illusion, par le mirage d’une fortune que son grand-père, vice-roi, lui avait laissée, et après mille fatigues et difficultés, souffrant vexations et persécutions, est revenu, écœuré, et sans un sou. Que diantre allait-il faire au Pérou pour réclamer ces fameuses mines de Hualgayoc, oubliées pendant un siècle.
Le curé – Il nous a parlé de cela oui… et de bien d’autres choses. Il manifeste un particulier attachement à ses petites-filles. Quand il parle d’elles, Angulo et moi, nous avons observé une certaine ardeur de sentiments paternels et une ténacité monomaniaque à vouloir étudier et démêler le caractère de l’une et de l’autre… L’incohérence de ses propos ne nous a pas permis de mesurer sa pensée, s’il en a une. Angulo croit plutôt qu’il y a dans sa tête un triste désordre, des idées de grandeur, de vengeance, d’orgueil et de misère qui enragent de cohabiter.
Lucrecia – Cela ne serait pas très étonnant que les malheurs qui lui aigrissent le cœur, fier et hautain, ne conduisent le brave don Rodrigo à la folie.
Le curé – Je n’irai pas jusque-là. Je note seulement que monsieur le comte, à cause de son ancienneté, de sa pauvreté, de l’état d’amertume et d’irritation de son esprit, mérite et réclame les plus grands soins, et c’est de cela précisément que je voulais que nous parlions, vous et moi.
Lucrecia – Pour ma part, il ne va pas rester. Je pense dire à Venancio que si le comte reste à La Pardina, qu’il ait envers lui toutes sortes d’égards ; qu’il le soigne, lui fasse bon accueil, soit attentif à tous ses besoins. Mais je doute qu’il accepte ces secours venant de moi. Vous le connaissez…
Le curé – Oui, je sais qu’il est revêche, toujours mécontent, et que sa dignité fougueuse va le pousser à refuser le bien que vous pourriez lui faire.
Lucrecia – (Tout en se croisant les bras.) Alors, que dois-je faire ? Vicenta, d’après vous ?
La femme du maire – (Avec finesse.) Moi… Que voulez-vous que je vous dise ? Il me semble que cela ne va pas être difficile de lui donner une protection digne, selon son lignage, sans que la dignité de cristal de don Rodrigo se sente offensée.
Le curé – (Approuvant visiblement.) Tout à fait, tout à fait… Vicenta, vous avez un admirable talent, vous nous indiquez le meilleur chemin. Bien : j’ai une idée, je veux la soumettre à votre sens critique…
Le maire – (Empressé, il s’adresse à la comtesse.) Lucrecia, voilà une visite pour vous. Le prieur et deux pères hiéronymites du couvent de Zaratán viennent vous offrir leurs respects.
Lucrecia – Ah !… Zaratán… Je me souviens. J’ai donné une certaine somme pour sa restauration… et Rafael a obtenu du Gouvernement une petite fortune pour que ces saints hommes puissent s’y installer.
La femme du maire – Ils sont dans le salon ? Allons-y un instant. N’ayez pas peur, ils ne vont pas vous retenir longtemps, ils sont très courtois.
Le curé – Allons-y… Quelle occasion, quelle heureuse coïncidence ! (Lucrecia entre dans la maison ainsi que le curé, le maire et sa femme.)
Senén – (Dans un autre groupe, avec Nell et Dolly, Consuelito et les enfants du maire qui ne parlent pas même si on les force.) Voulez-vous voir la volière ?
Nell – Ce que nous aimerions voir c’est les bagues que tu portes à ton petit doigt.
Dolly – Elles sont magnifiques. Tu aurais bien pu nous en faire cadeau.
Senén – Elles sont à votre disposition.
Dolly – Bandit ! Tu sais bien qu’on ne va pas te les prendre.
Senén – Pourquoi pas ? Essayez.
Nell – Tu en mourrais de rage.
Consuelito – Il en a besoin pour éblouir les filles de la ville.
Dolly – Combien de copines as-tu ? Dis-nous la vérité.
Nell – Au moins deux douzaines.
Consuelito – Que je sache, trois… Tu ne me raconteras pas de bobards à moi, coquin, menteur. J’ai vu que tu télégraphiais à Delfina, la fille du marchand de bonbons. Je sais que tu échanges des lettres avec Amalia Ruiz, et c’est de notoriété publique que tu envoies des poèmes à cette espèce de Hilaria Sevillano, et qu’elle t’envoie par la femme du cantonnier, des poires de son jardin. Tout le monde est au courant, mon ami.
Senén – Oui, et ce qu’on sait surtout c’est que vous faites mieux que La Correspondencia[1]. Vous vérifiez tout et vous confondez tout. Pour votre gouverne, sachez que ce n’étaient pas des poires mais des pêches.
Consuelito – Et elle est en train de te préparer un gâteau à la rhubarbe. C’est une fille riche bien qu’un peu voûtée ; mais les parents, des bijoutiers, savent tout de l’or artificiel, tu ne les tromperas pas… Tu as là un alliage… (On n’entend pas ce que lui répond Senén parce que Nell et Dolly, voyant passer un individu à travers les grilles qui donnent sur la rue de Potestad, se mettent à l’appeler toutes joyeuses.)
Dolly – Don Pío, Pío, notre cher Pío, allez, viens par là… Entre !
Consuelito – (Laissant Senén, le mot sur la langue.) C’est Coronado, votre maître ?
Nell – (En criant.) Maître, cher maître, entre. Maman veut te voir.
Dolly – N’aie pas honte… Viens.
Senén – Il n’entrera pas même si vous le forcez. Il est très timide. (Ils courent tous les quatre et voient un vieillard qui s’éloigne en saluant de la main tout souriant.)
Nell – Le pauvre !… Nous l’aimons beaucoup… (Les deux enfants du maire s’occupent, avec une persévérance digne des meilleures causes, à s’enduire les mains de terre mouillée. La «Solitaire», voyant partir les moines et les dames qui les saluent des grilles de la place, court pour être au courant des nouvelles. De nouveaux groupes se forment : d’un côté, le curé, la femme du maire et Consuelito ; de l’autre, le maire, la comtesse et ses filles.)
Consuelito – (A la femme du maire.) On peut savoir ce que sont venus faire les petits pères de Zaratán ?
La femme du maire – Une visite de courtoisie, rien de plus. (Au curé.) Franchement, don Carmelo, maintenant que personne ne nous entend : Don Rodrigo vous a dit ou pas les horreurs qui courent sur Lucrecia ?
Le curé – (Se dérobant.) Psch !… Des exagérations… des marottes, des radotages…
Consuelito – Cette brave dame ferait bien de regarder un peu à sa réputation… Elle est peut-être bien brave, mais personne ne la croit.
La femme du maire – Chut, Consuelo. Lucrecia est ici chez moi.
Le curé – De toutes les histoires qui courent par là, il faut retirer ce qui tient à la malice, la jalousie, le goût pour les plaisanteries…
Consuelito – Vous aurez beau ôter toute la critique que vous voudrez, il restera toujours ce qui est public et notoire.
La femme du maire – Et qui te dit que ce ne sont pas des inventions ?
Consuelito – Je ne crois pas aux inventions, pas plus qu’à celle de la poudre… Ah ! Cette Vicenta, quand elle se met à ne pas vouloir comprendre les choses…
La femme du maire – Nous disions que ça pouvait bien être une invention.
Consuelito – Ai-je inventé, moi, que cette brave femme n’avait pas la moindre petite once d’amour pour son mari… et qu’elle l’a laissé mourir comme un chien dans une auberge de Valence ?
La femme du maire – Consuelo, de grâce !
Consuelito – Mais, j’ai entendu ça à Madrid… les garçons de la rue ne parlaient que de cela. Bon, ce n’est pas vrai. Voulez-vous que je vous dise et vous soutienne que tout le monde ment ? Bon, d’accord : il n’y a pas plus charitable que moi. Mais je vous assure aussi une chose : en mon for intérieur, je crois que le comte d’Albrit a raison de haïr sa belle-fille, et je le prouve, comme dirait Senén.
Le curé – (En riant.) Remettez-vous-en à votre for intérieur, il ne doit pas être si malicieux.
Consuelito – Mais je ne peux pas commander à mes yeux de ne pas voir ce qu’ils voient ; et ils ont vu la tête de la comtesse quand on lui parle de son beau-père, un vrai marbre.
Le curé – De marbre blanc. C’est qu’elle a un teint que j’aimerais que vous ayez les jours de fête.
Consuelito – Je ne prétends rien.
Le curé – Vous pourriez…
La femme du maire – (Mettant fin à la question.) C’est bon. Tant que cette dame sera chez moi, je n’accepte pas qu’on…
Consuelito – Bien entendu !… Mais qu’il soit bien dit qu’elle vient retrouver son honneur chez toi… Ce n’est pas toi qui lui fais honneur en la recevant et en la flattant. Dis donc ! Ce n’est pas rien l’ovation qui lui a été faite aujourd’hui… Et elle dit qu’elle n’aime pas les vivats… Elle crève d’orgueil, c’est tout.
Le curé – Madame doña Consuelito, vous êtes incapable d’ouvrir la bouche sans dire du mal de votre prochain. Ecoutez-moi un peu, moi qui vous aime bien : mesurez vos paroles et réfrénez un peu votre curiosité sur la vie des autres.
Consuelito – Quel mal y a-t-il à savoir ce qui se passe, si c’est vrai ? La curiosité est fille de Dieu, et c’est de la curiosité que naît l’Histoire que vous aimez, et de la curiosité que naît la Science qui découvre tant de choses.
Le curé – C’est la curiosité qui a perdu Eve.
Consuelito – ça dépend des opinions…
Le curé – (En riant.) C’est un dogme.
Consuelito – Bon… Je veux bien croire si c’est un dogme, sinon, je n’y croirais pas. Je regrette une chose, à propos du Paradis… Oui, monsieur, je regrette de ne pas l’avoir vu, moi, sans que personne ne vienne me le raconter.
La femme du maire – (Voyant la comtesse arriver.) Silence ! Elle arrive.
Lucrecia – Pauvre Senén ! Les petites le rendent fou. (La présence inopinée du journaliste à la grille de l’entrée exige une nouvelle intervention du très habile monsieur le maire. Le chef de la fanfare municipale se présente aussi. La femme du maire se voit obligée de mettre fin aux jeux innocents de ses chers enfants et accourt au bassin où ils se lavent les mains, mouillant leurs tout nouveaux vêtements. Nell et Dolly appellent Consuelito et le curé. Senén et la comtesse se retrouvent seuls un moment.)
Lucrecia – (Assise à l’ombre d’un magnolia très épais.) Je sais bien que tu as vu cet homme et que tu lui as parlé.
Senén – (Debout, respectueux.) Il est de mauvaise humeur.
Lucrecia – (Dissimulant sa peur.) Et qu’est-ce que ça peut me faire ? Il faut bien lui donner quelque chose pour vivre… et il me fichera la paix.
Senén – J’en doute… Il est tellement orgueilleux, il ne voudra pas d’une aumône ; il est chatouilleux et belliqueux, il va vouloir faire un scandale.
Lucrecia – (Tremblante.) Un scandale !… Quoi ?… Il t’a dit quelque chose ?
Senén – (Jouant au mystérieux.) A moi, non… A Madrid, un ami à moi qui a vécu à Valence avec monsieur le comte, m’a dit que ce dernier, depuis que son fils est mort (qu’il repose en paix !), ne vit plus que pour une chose : remuer le passé, les restes du passé…
Lucrecia – Comme les chiffonniers sur les tas d’ordures.
Senén – Revenir sur le passé pour en sortir… ce qu’il trouvera.
Lucrecia – (Très inquiète.) A toi, il a dû te poser un tas de questions… Il sait que tu as été mon domestique… et les domestiques ont toujours quelque secret… ; ce n’est pas ce que je veux dire, je veux parler de quelques détails sur l’intimité de leurs maîtres.
Senén – (De manière emphatique.) En moi, madame la Comtesse aura toujours un serviteur loyal…
Lucrecia – Je le sais… J’ai confiance en toi.
Senén – Et même si les motifs de reconnaissance qui me rendent esclave de madame, ne m’obligeaient pas à la loyauté, je lui serai fidèle et fiable, parce que j’ai l’honneur fixé aux entrailles…
Lucrecia – Je le sais… (Fatiguée de l’insupportable parfum héliotrope qui s’échappe des vêtements de Senén, elle sort un mouchoir et se caresse le nez, faisant croire à un rhume.)
Senén – Je sers, de manière désintéressée, la Comtesse de Laín, vous pouvez me demander n’importe quoi… Mais que madame n’oublie pas son humble protégé, le pauvre Senén qui ne mérite pas d’abandonner sa carrière à mi-chemin.
Lucrecia – (Fatiguée et dédaigneuse.) Mais, quoi, tu veux encore plus ? Tu sollicites un autre avancement ? C’est impossible pour le moment.
Senén – (Il ronchonne.) Ce n’est pas cela. Mais l’Administration, comme ça tout court, ne mène à rien.
Lucrecia – A quoi prétends-tu ?… Dis-le vite et terminons-en. Tu veux l’archevêché de Tolède ou la croix d’honneur de San Fernando[2] ?
Senén – J’aspire à une position obscure et qui requiert beaucoup de travail de façon à m’assurer une subsistance pour ce qui me reste à vivre.
Lucrecia – (Impatiente, désirant qu’il s’en aille.) Bon ; tu l’auras. Est-ce quelque chose qui est à ma portée ?
Senén – Très facilement, si on ne laisse pas passer l’occasion. C’est une chose très simple : me nommer cadre dans le recouvrement des Droits royaux.
Lucrecia – Et ça rapporte de l’argent ?
Senén – ça en rapporte, oui.
Lucrecia – De sorte qu’en le demandant au Ministre…
Senén – C’est comme si c’était fait.
Lucrecia – (Se levant pour fuir parfum et parfumeur.) Si c’est vrai, tu peux compter dessus.
Senén – Permettez-moi, madame, un petit moment…
Lucrecia – Quémandeur insatiable ! Quoi encore ?
Senén – J’ai oublié de dire à madame que pour remplir cette tâche, il me faut une caution.
Lucrecia – (Très acerbe.) Encore ?
Senén – Une forte caution.
Lucrecia – (Suffoquant de colère.) Moi, je ne peux pas te la procurer…
Senén – (Faisant un pas vers elle.) Mais monsieur le marquis de Pescara peut me la procurer, il suffit que madame le lui dise… ou le lui commande.
Lucrecia – Oh ! C’est tout à fait absurde… Tu demandes des choses difficiles, des choses qui fâchent.
Senén – (Faisant un pas à la suite de la comtesse qui s’éloigne.) Si madame ne veut pas se gêner pour me faire sortir de la pauvreté, je ne dis plus rien… J’oubliais de vous dire que l’argent serait en lieu sûr et que monsieur le marquis touchera des intérêts de la Caisse des dépôts.
Lucrecia – (Désirant en finir.) C’est bon… Mais ça me paraît douteux que je puisse voir Ricardo…
Senén – (Sûr de lui.) Vous le verrez demain ou après-demain.
Lucrecia – (Subitement intéressée, en s’approchant de lui, sans craindre le parfum héliotrope.) Où ? Qu’est-ce que tu dis ? Où ?
Senén – A Verola, où madame ira après ici.
Lucrecia – Comment sais-tu cela ?
Senén – Si je le dis c’est que je le sais…, et je le prouve.
Lucrecia – Lui aussi à Verola… ! Ah ! Tu le sais par son aide de camp, c’est ton cousin. Tu en es sûr ?
Senén – Que Madame me promette, si vous trouvez là-bas monsieur le marquis, de lui demander ma caution. Et ce sera tout.
Lucrecia – (Elle a tout à coup honte d’entretenir une conversation avec un inférieur.) Je verrai… J’ignore dans quelles dispositions je trouverai Ricardo.
Senén – (Très agité.) Promettez-moi de lui parler de ma caution si vous le trouvez en de bonnes dispositions. Je me contente de cela.
Lucrecia – Je te promets de ne pas oublier ton affaire, d’y faire très attention… du moment que toi, tu m’assures une loyauté à toute épreuve…
Senén – (Avec force gestes d’adhésion.) Madame !…
Lucrecia – (En se tamponnant le nez.) Tu peux te retirer…
Senén – Quoi ?… Madame est enrhumée ?
Lucrecia – (Moqueuse.) Non, mon vieux… C’est que tu utilises des parfums si forts qu’on ne peut pas rester à tes côtés… Va-t-en maintenant.
Senén – (Troublé.) Eh bien, moi qui croyais… Je ne vous dérange pas davantage… (Saluant à distance.) Madame…
Lucrecia – (Agitant son mouchoir pour écarter tous ces miasmes odorants.) Que je suis malheureuse, mon Dieu ! Devoir supporter un tel énergumène, l’écouter et le sentir… Tout ça parce que je le crains… !
La femme du maire – (Elle remet ses enfants dans le droit chemin.) Que faites-vous, Lucrecia ?
Lucrecia – Nettoyer l’atmosphère des parfums que se met cet abruti.
La femme du maire – (En riant.) C’est vrai, c’est vrai. C’est une infection… pour toute la ville. (Capitán, le petit chien de La Pardina entre dans le jardin, et court vers les filles, en faisant des bonds joyeux, il remue ce qui lui tient de queue.)
Dolly – (En se baissant pour le prendre par les pattes avant.) Dis-donc, coquin, tu viens voir tes copines ?
Nell – Qu’est-ce qu’il a ramené notre petit chien à nous ? Tu n’es pas venu tout seul, Capitán ?
Dolly – Avec qui est-il venu ?
Le maire – (A Lucrecia.) Voilà Venancio, avec une commission de la part du lion d’Albrit… Attention, ce n’est pas moi qui l’ai traité de gros ou de maigre, hein ! Je ne veux pas lui secouer les puces.
Lucrecia – (Altérée.) J’y vais… Qu’est-ce que ça peut être ? (Elle entre à la maison accompagnée de la femme du maire.)
Le maire – (A Consuelito qui, avide de nouvelles, s’approche.) Cet après-midi, nous ne pourrons pas échapper à la fanfare municipale. J’ai déjà dit à Fandiño que deux ou trois cantates nous satisferaient, pas plus.
Consuelito – Et, en pensant à ton amie, ils vont entonner le morceau à Isabelle la Catholique, le «Salut, excellente maîtresse…» (En chantant.)
Le maire – Cet empoisonneur de Cea doit sans doute vouloir faire son interview avec toi. Mais comme tu es sourde, je vais lui conseiller d’apporter une petite trompette.
Consuelito – (Le menaçant de son éventail.) Sourde, moi !
Le maire – Je veux dire que tu devrais l’être… et muette en plus.
Consuelito – C’est ce que tu voudrais, pour faire ce qui te chante à la mairie.
Lucrecia – (Elle revient de la maison avec la femme du maire et le curé.) Mon noble beau-père me demande une heure et un lieu pour notre entrevue. J’ai dit à Venancio que je lui répondrai cet après-midi.
Le curé – Il me paraît bien de ne pas remettre ce face à face. Soyez humble, si lui est orgueilleux. Vous avez la jeunesse, la force ; je ne sais pas si cela vous donne raison… Lui, c’est l’ancien, le malheureux… Il a droit à l’indulgence.
Lucrecia – (Regardant plus le sol que ceux qui l’entourent.) Je ne sais pas ce qu’il prétend… Nous le saurons demain.
Le maire – Donnons-lui rendez-vous ici. Vous verrez qu’avec moi, il n’y aura pas de poursuite. Il croit peut-être me faire peur avec ses lions ?[3]
Lucrecia – (Hésitante.) Je ne sais pas… je ne sais…
Consuelito – Si vous voulez fêter l’entrevue chez moi, je mets une magnifique salle à votre disposition… En toute franchise. Vous y serez tout seuls… Les portes ferment bien…
Lucrecia – Non, merci… J’irai à La Pardina.
Le curé – Fixez l’heure et je vais moi-même lui porter la commission.
Lucrecia – Demain à dix heures.
La femme du maire – (Inconsolable.) Demain ! Moi qui pensais vous emmener faire une visite chez les petites sœurs !
Le maire – Et le collège et l’usine et l’abattoir et les casinos de la «masse ouvrière» et l’hôpital et l’institut et les écoles… Comtesse, le lion peut bien attendre un jour de plus…
Lucrecia – Ce n’est pas possible, mon cher don José María, parce que je m’en vais demain…
La femme du maire – (Etonnée et presque indignée, à l’image de son mari.) Comment cela ? Lucrecia, de grâce !…
Le maire – (Soufflant comme un bœuf.) Sacrebleu ! Ce n’était pas convenu comme cela.
La femme du maire – Non, ma fille, nous ne sommes pas d’accord. Vous aviez dit quatre jours.
Le maire – Je m’y oppose ! Je vais sortir le bâton.
Le curé – Et moi, le crucifix.
Consuelito – Ingrate ! Nous abandonner si vite !
Lucrecia – (Faisant des manières, soupire.) Je regrette de tout cœur…
Le curé – Mais, nous nous comportons donc si mal avec vous ?
Consuelito – (Faisant la moue.) Sans aucun doute, dans le château de ses amis les Donesteve ceux de Verola se comportent mieux.
Lucrecia – Obligation inévitable. On m’attend demain. Mais il ne faut pas vous en faire… Je reviendrai…
Le maire – (Sans délicatesse.) Vraiment ? Vous n’êtes pas en train de vous moquer de nous ?
La femme du maire – Non, elle ne nous trompe pas, elle reviendra.
Lucrecia – Comme il est très probable que je déciderai là-bas si je reprends mes filles ou non… Franchement, ça m’inquiète un peu de les laisser à Jerusa.
Le curé – (Fronçant les sourcils.) Peut-être que…
Nell – (Courant vers sa mère.) Maman, la fanfare municipale !
Dolly – La fanfare municipale. Les voilà !
Nell – (Battant des mains.) Que c’est bien !
Dolly – Quelle joie !
Consuelito – (Chantant tout bas.) «Salut, excellente maîtresse…»
Scène V
Salle du rez-de-chaussée de La Pardina.
Lucrecia, assise, mélancolique, regarde par terre et le comte entre par le fond.
Le comte – Madame la Comtesse… (Il s’incline respectueusement. Elle salue d’une froide révérence.) Je vous suis très reconnaissant d’avoir bien voulu avoir la bonté de m’accorder cette entrevue, bien que pour mériter cette faveur insigne, j’aie dû venir à Jerusa. (Il prend une chaise et s’assoit près d’elle.)
Lucrecia – C’est pour moi un devoir sacré d’accéder à votre requête… ici ou ailleurs. Je dis devoir : pendant un certain temps vous m’avez appelée votre fille.
Le comte – Mais, maintenant, je ne le fais plus… Ces temps sont passés… Vous avez été, comme qui dirait, une fille occasionnelle… transitoire : une fille de passage…
Lucrecia – (En s’efforçant de sourire pour tromper sa peur.) Et les filles de passage… méritent le bâton.
Le comte – Etrangère par la nationalité et plus encore par les sentiments, vous ne vous êtes jamais identifiée à ma famille ni au caractère espagnol. Contre ma volonté Rafael, mon fils adoré, a choisi comme épouse la fille d’un Irlandais, installé aux Etats-Unis, venu ici pour une histoire de négoce en pétrole… (Poussant un soupir.) L’Amérique a été pour moi funeste !… Donc… comme tout le monde le sait, je me suis opposé au mariage du comte de Laín ; j’ai lutté contre son obstination et son aveuglement… J’ai perdu. Le temps m’a donné raison et vous aussi ; vous, oui, en rendant mon fils malheureux et en précipitant sa mort.
Lucrecia – (Fâchée et toujours craintive.) Monsieur le Comte… Ce n’est pas vrai !
Le comte – (Froid et autoritaire.) Madame la Comtesse, ce que je dis est vrai. Mon pauvre fils est mort de tristesse, de douleur et de honte.
Lucrecia – (Puisant des forces de sa faiblesse.) Je ne peux tolérer…
Le comte – Du calme, du calme. Ne vous mettez pas en colère si vite… Nous ne faisons que commencer…
Lucrecia – Il est monstrueux de me demander une entrevue pour me mortifier, pour m’outrager. (Affligée.) Monsieur le Comte, vous ne m’avez jamais aimée.
Le comte – Jamais !… Vous voyez bien que je suis sincère. Ma sagacité, ma connaissance du monde ne me trompaient pas. Dès que j’ai vu Lucrecia Richmond, j’ai su qu’elle était méchante et, si mes prévisions se sont trompées, c’est que… vous avez été pire que ce que je pensais, que je craignais.
Lucrecia – (Se levant, hautaine.) Si cette réunion, que moi, je n’ai pas sollicitée, est pour m’insulter, je me retire.
Le comte – (Sans s’émouvoir.) Comme vous voudrez. Si vous préférez que ce que j’ai à vous dire, je le dise à tout le monde, retirez-vous à temps. Si vous prenez cela en compte, vous allez préférer, sans doute, entendre seule, quel que soit le désagrément que vous causent ma voix et mes accusations. N’est-ce pas ? L’infamie dont je veux vous parler restera entre nous deux. Nous la partagerons à égalité, sans rien laisser aux autres. N’est-ce pas mieux que de tout jeter en public, à foison sur la foule ? (La comtesse, qui hésite entre partir ou rester, fait un pas vers son siège.) Vous voyez bien que ce n’est pas mieux pour vous de me laisser garder ça pour moi…. C’est mieux ainsi.
Lucrecia – (Angoissée, se passant les mains sur les yeux et le front….) Oui, oui… Je vous supplie d’être bref… Ce que vous voulez me dire, dites-le vite, vite.
Le comte – C’est un peu long… (Il lui montre le siège.) Pourquoi tant de précipitation ? Il vaut bien mieux que vous soyez avec moi à entendre les terribles vérités qui sortent de ma bouche, qu’au milieu de ces gens qui flattent et mentent, vous acclament publiquement et vous dénigrent en privé ! Etes-vous à ce point candide que vous vous sentiez satisfaite de cette farce stupide de l’ovation de la rue et des vivats et des fusées ? Tous ceux qui sont revenus avec la voix rauque d’avoir acclamé la comtesse de Laín, s’éclaircissent la voix en racontant des aventures galantes, des anecdotes malicieuses. Et je dis aussi que, si vous êtes méchante, vous ne l’êtes pas tant que croient tous ces imbéciles qui vous ont acclamée hier.
Lucrecia – (Voulant se rasséréner.) C’est mieux ainsi !… C’est toujours une consolation d’être meilleur que ce que croient les amis.
Le comte – Assoyez-vous. Après avoir entendu tant de mensonges et de flatteries, il n’est pas mauvais d’entendre la voix de la justice, de la vérité… et l’entendre avec patience, en bonne chrétienne…
Lucrecia – La patience ! Vous voyez bien que j’en ai, même si ma patience n’égale pas votre méchanceté. Mais il ne faut pas abuser, mon cher monsieur ; ne voyez pas de la couardise là où ce n’est que le respect à l’ancienneté, aux liens qui nous unissent et que vous ne pouvez ignorer, à vos terribles infortunes…
Le comte – (Très abattu.) Oui, oui ; je suis un malheureux !
Lucrecia – (Elle s’enhardit en voyant son ennemi défaillir.) Mais, monsieur don Rodrigo, vous n’apprenez jamais. Les malheurs sont des leçons et des avertissements de la Providence, ils domptent les plus orgueilleux et adoucissent les plus acariâtres. Cette loi n’est sans doute pas pour vous. Franchement, j’ai pensé que la perte totale de votre fortune et l’horrible erreur de l’Amérique aurait adouci votre orgueil… Je vois que non. Le lion, décrépit et pauvre, revient en Espagne encore plus sauvage.
Le comte – Que voulez-vous !… Dieu m’a fait sauvage et sauvage je mourrai.
Lucrecia – (Essayant de prendre une attitude offensive.) Vous êtes, d’après moi, l’homme des méprises, et on peut dire que tout ce que vous effleurez tourne mal. On vous fait croire que le gouvernement péruvien est prêt à vous concéder la propriété des mines de Hualgayoc, et vous voilà embarqué, des idées plein la tête, croyant rapporter une fortune qu’on vous gardait au frais là-bas… Mais la réalité ne vous a procuré que des camouflets, une fatigue inutile et des humiliations… Et comme vous n’aviez personne sur qui déverser votre dépit, vous vous prenez à une pauvre femme, vous l’injuriez et vous la calomniez.
Le comte – Si en revenant de cette excursion qui a achevé ma ruine, j’avais trouvé mon fils vivant, son affection m’aurait fait oublier ma triste situation. Mais la mort de Rafael, il y a quatre mois, a avivé mon irascibilité, mon dépit, si vous voulez ; le goût amer que les malheurs ont laissé dans mon âme… elle a ravivé la haine envers la personne que je crois responsable du malheur et de la mort de cet homme bon et loyal.
Lucrecia – (Hautaine.) Responsable de sa mort, moi ! C’est une infamie, monsieur le Comte.
Le comte – (Avec une grande fermeté.) Mon fils est mort… abattu, honteux des scandales de sa femme. Cela est su de tout le monde.
Lucrecia – (En colère, elle se lève.) Vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Vous vous faites l’écho de vilaines calomnies. J’ai des ennemis.
Le comte – Plus que les ennemis, ce sont les amis qui diffament Lucrecia Richmond…
Lucrecia – (Déconcertée.) Je répète que c’est une calomnie.
Le comte – (En se levant aussi.) Nous allons bien voir… (Avec une certaine douceur.) Lucrecia… il est encore possible que je me sois trompé, que vous êtes meilleure que ce que je suppose… Vous pourriez apporter une confirmation à cette erreur et me donner une rude leçon si vous aviez le courage de me dire la vérité…
Lucrecia – (Abasourdie.) La vérité ?…
Le comte – Oui, sur un point très délicat sur lequel je vais vous interroger.
Lucrecia – (Effrayée.) Quand ?
Le comte – Là, tout de suite… oui, en me répondant sans perdre plus de temps, vous me donnerez le plaisir ineffable de vous pardonner. Croyez bien qu’à la fin de ma vie, brisé, triste et quasi moribond, le pardon est pour moi une grande consolation.
Lucrecia – (Terrorisée.) M’interroger ! Suis-je donc une criminelle ?
Le comte – Oui.
Lucrecia – (Luttant contre sa conscience qui veut se manifester.) Nous sommes tous imparfaits… Je ne me considère pas irréprochable… Mais, vous, qui vous a fait confesseur… et juge ?
Le comte – Je me fais moi-même… Je veux et je dois l’être, comme chef de famille de la famille d’Albrit et gardien de son honneur.
Lucrecia – (Paniquée, voulant fuir.) C’est insupportable… Je n’en peux plus…
Le comte – (La retenant par le bras.) Non, non. Vous ne pouvez pas refuser de me répondre… au moins pour me montrer que j’ai tort, si en effet j’avais tort et que vous pouviez le prouver. Ce que je vais vous demander est grave et le fait de vous le demander et vous de me répondre revêt un caractère solennel. Ce n’est plus moi qui parle, c’est le mari de celle qui m’écoute, c’est mon fils qui ressuscite en moi… (Pause.) Asseyez-vous. (Il la conduit à son fauteuil.)
Lucrecia – (Elle tombe presque évanouie sur le fauteuil.) De grâce, monsieur… Vous me martyrisez.
Le comte – Excusez-moi… Il le faut… Il faut souffrir un peu, Lucrecia. Il n’y a pas que le plaisir et le divertissement. (Pause. La comtesse, anxieuse, n’ose pas le regarder.) En arrivant à Cadiz, après mon voyage raté, on m’a remis une lettre de Rafael dans laquelle il me manifestait sa douleur, son amertume extrême. La vie avait perdu pour lui tout intérêt. Il était malade et, désespéré, il ne désirait même pas guérir. Le découragement le consumait, la perte de toute illusion, la honte de voir son nom outragé…
Lucrecia – (En se retournant.) Monsieur le Comte, je vous en prie…
Le comte – Mon fils vivait séparé de son épouse depuis l’année précédente.
Lucrecia – Et qui dit que ce fut de ma faute ?
Le comte – Moi, je le dis, de votre faute, exactement.
Lucrecia – Rien n’est moins sûr.
Le comte – (En colère.) Ne me démentez pas. Taisez-vous et écoutez. (Reprenant le ton de la narration.) Rafael ne me disait rien de concret. Il exprimait seulement l’état de son âme, sans m’en exposer les causes…
Lucrecia – (Vivement.) Il ne disait rien de concret. Donc…
Le comte – Mais peu après avoir reçu cette lettre, un ami très cher m’a rendu compte des aventures de la comtesse de Laín ; cet ami est une personne irréprochable sur le plan de la vérité, non seulement il me rapportait ce qui était de notoriété publique mais aussi ce que des circonstances exceptionnelles lui avaient permis de connaître et de vérifier ; c’est un homme qui n’a jamais menti, bon et noble et, en me faisant le récit de cette triste histoire de scandales, il essayait presque de les atténuer… Je n’ai pas besoin de vous le nommer. Vous le connaissez.
Lucrecia – (Terrifiée, presque sans voix.) Moi… non.
Le comte – Vous savez qui c’est et vous n’osez pas soutenir qu’il a menti parce que votre conscience, Lucrecia, va au-delà de votre cynisme et vous douterez plus de la lumière que de la vérité de cet homme, vénéré par tous, gloire de la magistrature…
Lucrecia – (S’accrochant à une planche de salut.) L’homme le plus droit peut se tromper… surtout s’il respire une atmosphère malsaine de commérages et de mensonges…
Le comte – Je continue. Il m’a tout rapporté, tout… c’est-à-dire… tout non. Il manque une chose, si secrète qu’il n’y a que vous à la savoir… Et vous allez me la dire !
Lucrecia – (Angoissée jusqu’à en mourir.) Quel supplice ! Mon Dieu !
Le comte – Un supplice ! Vous ne vous souvenez pas du supplice de votre époux, en fuite, tout seul, mort de tristesse sans aucune affection pour le consoler… parce que j’étais absent et que vous, vous ne l’aimiez pas, vous ne faisiez que chercher des prétextes pour vous éloigner de lui… Bien sûr, dès réception de la lettre et en apprenant les informations de mon ami, il m’a fallu du temps pour accourir au chevet de Rafael. J’ai pris le train et sans m’arrêter nulle part, je suis allé à Valence.
Lucrecia – Ah ! Malheur !
Le comte – (D’une voix lugubre.) Deux heures avant mon arrivée, mon fils adoré est mort. Sa maladie s’était aggravée ces derniers jours. Lui s’en moquait… Un terrible accès de dyspnée, le spasme… la mort. Tout cela en quelques heures… (Il pleure. Pause.) Il est mort dans une chambre d’auberge… tout habillé sur son lit… mal assisté par des mercenaires… Mon Dieu ! Quelle douleur !…
Lucrecia – (Très émue, en sanglots.) Oh ! Monsieur le Comte, même si vous n’y croyez pas, je l’aimais…
Le comte – (Enervé, il sèche ses larmes.) Ce n’est pas vrai ! Si vous l’aimiez, pourquoi n’êtes-vous pas accourue à son chevet, sachant qu’il était malade ?
Lucrecia – (Ne sachant que dire.) Parce que… je ne sais pas… Ce sont les contretemps de la vie que je ne peux expliquer en quelques mots. Moi…
Le comte – Laissez-moi conclure… Vous comprendrez facilement mon désespoir de le trouver mort. Sans pouvoir entendre de ses lèvres les explications qu’il était le seul à pouvoir me donner ! C’était terrible de le perdre, mais plus terrible encore de le voir inerte, froid, muet pour toujours, tel que je l’ai vu, moi… et ne pas pouvoir le consoler, sans pouvoir lui dire : «Raconte-moi tes souffrances et ton père te racontera les siennes.» (Il croise les mains et sanglote.) Oh ! Peine immense, lente agonie de ma vieillesse, plus épouvantable que tous les maux dont j’ai souffert ! Voir son cadavre, lui parler sans obtenir de réponse, sans qu’à mes caresses, il ne réponde par un geste, un regard, un son. Et sachant l’infinie douleur qui a ulcéré ses derniers jours, voir qu’il emportait tout avec lui, tout, dans l’abîme du silence, dans la mort, sans m’en donner une part, un peu de sa douleur, un peu de son âme… (La comtesse, agitée et profondément émue, pleure en serrant son mouchoir contre ses yeux.) Horrible, épouvantable !… Vous n’avez pas de cœur et vous ne savez pas ce que cela représente. (Il la voit pleurer. Pause.) Que ce serait beau de pouvoir pleurer ensemble, vous et moi, en ce moment, sur cet être cher !… (La comtesse fait quelques pas vers lui… ils vont s’embrasser… ils hésitent… Le comte la repousse sèchement.) Non… Toi, non… Vous, non.
Lucrecia – Mes larmes sont sincères.
Le comte – Naturellement… En voyant ma peine… Vous n’êtes pas de bronze, vous n’êtes pas une sauvage… Mais, non, ne me soutenez pas que vous aimiez votre époux ; l’homme qu’on aime, on ne le trompe pas en cachette, foulant aux pieds son honneur et jetant à la raillerie publique son nom sans tache. (La comtesse incline la tête et fixe le sol des yeux, sans rien dire.) Enfin, vous vous taisez. Je vois enfin, enfin je vois la malheureuse Lucrecia sur l’unique terrain où elle doit se placer, celui de la soumission résignée, attendre le jugement de la justice. (Pause.) Avouez-vous que votre conduite envers mon fils, au moins en certaines circonstances précises, n’a pas toujours été bonne ?
Lucrecia – (Timidement.) Je l’avoue… Mais je dois dire une chose à ma décharge…
Le comte – Je vous écoute.
Lucrecia – Mes désaccords avec Rafael sont anciens.
Le comte – Je sais… Ils datent des premières années de mariage, parce que vous, c’est bien pénible à dire, vous n’avez pas attendu beaucoup avant de vous lancer sur une mauvaise voie. Le niez-vous ?
Lucrecia – (Intimidée, accablée, ne sachant s’il faut dire oui ou non.) Accusée avec tant de sauvagerie, je n’arrive pas à chercher les raisons, il doit bien y en avoir, pour me disculper.
Le comte – Cherchez-les… Mais avant, reconnaissez-vous vos fautes ?
Lucrecia – (Elle fait un grand effort.) Je les reconnais. Ce serait hypocrite de ma part et indigne de tout nier. Mais…
Le comte – Mais quoi ?…
Lucrecia – Je veux dire que Rafael, m’entraînant dès le début, contre mon gré, dans le milieu social plus propice au relâchement du lien matrimonial, a contribué à me perdre. Je me suis vue entourée de gens frivoles, de flatteurs, de personnes sans aucun sens moral…
Le comte – Sans aucun sens moral ! Si vous en aviez, peu importait le sens moral des autres !
Lucrecia – (De manière maladroite.) Dans ce milieu-là, je n’ai pas su ou n’ai pas pu combattre le mal. Je n’avais pas à mes côtés un censeur sévère de ma propre faiblesse, un gardien vigilant…
Le comte – Il est difficile de garder quelqu’un qui ne le veut pas.
Lucrecia – (Se battant désespérément.) Oh, monsieur le Comte, si vous aviez retrouvé votre fils vivant, si vous aviez pu l’entendre dire de sa propre bouche la confidence ou la confession que vous désiriez… j’en suis sûre, Rafael, un homme sincère et juste, vous aurait dit en toute honnêteté et rectitude : «Ce n’est pas seulement de sa faute, c’est aussi de la mienne…» !
Le comte – Il n’aurait pas dit cela, non.
Lucrecia – (Sûre d’elle-même.) Je crois, comme le veilleur croit à l’aurore, que Rafael, en me jugeant, n’aurait pas été très sévère.
Le comte – Il a été plus que sévère, implacable.
Lucrecia – Dans ses derniers moments ?
Le comte – Dans ses derniers moments ; écoutez bien ce que je vais vous affirmer.
Lucrecia – (Avec stupeur.) Mais, vous venez de me dire que…
Le comte – Que je l’ai trouvé mort… Oui.
Lucrecia – Alors… (Pause. Ils se regardent tous les deux.)
Le comte – Les morts parlent.
Lucrecia – (Terrifiée.) Et Rafael… ! (Elle hésite entre incrédulité et une certaine crainte superstitieuse.)
Le comte – Désespéré, comme fou, je suis resté… je ne sais combien d’heures… devant le cadavre de mon pauvre fils, sans me rendre compte de rien, en dehors de lui et le mystère immense de la mort. Après un certain temps, j’ai commencé à fixer mon attention sur ce qui m’entourait, sur ses vêtements, sur les objets qui lui avaient appartenu, sur les meubles qu’il avait utilisés, sur la pièce… (Pause. La comtesse l’écoute, anxieuse, attentive.) Dans la pièce, il y avait une table avec quelques livres et des papiers, au milieu des papiers, une lettre…
Lucrecia – (Toute tremblante.) Une lettre… !
Le comte – Oui. Rafael était en train de l’écrire à trois heures du matin, quand il s’est senti mal. La mort est venue brusquement, l’a attaqué avec furie. Ah !… Le malheureux a appelé, on est accouru… On lui a procuré les soins les plus urgents… Mais inutilement… La lettre est restée là, à moitié écrite… Elle était là, elle parlait d’elle-même… elle était vivante ! Elle parlait… C’est lui qui parlait… Je l’ai lue sans la prendre, sans la toucher, penché sur la table, comme je me serais penché sur son lit si je l’avais trouvé vivant… La lettre dit…
Lucrecia – (Presque sans souffle, la gorge sèche.) Etait-elle pour moi ?
Le comte – Oui.
Lucrecia – Donnez-la-moi. (Le comte fait non de la tête.) Eh bien, comment puis-je être au courant ?…
Le comte – Il suffit que je vous répète son contenu. Je la connais par cœur.
Lucrecia – Non, cela ne suffit pas… Si vous m’accusez, j’ai besoin de la lire, de reconnaître son écriture…
Le comte – Ce n’est pas la peine. Je ne mens pas, moi. Vous le savez bien… Cela commence par un paragraphe rempli de plaintes amères sur votre brouille conjugale, vos caractères irréconciliables. Puis viennent ces graves concepts (Reprenant mot à mot.) : «Je te préviens, si tu ne fais pas venir ma fille tout de suite, je porterai plainte. Je veux l’avoir à mes côtés. L’autre… celle qui, selon tes propres dires dans la malheureuse lettre que tu as écrite à Eraul et que ses ennemis m’ont remise entre les mains…, n’est pas ma fille, je te la laisse, je te la retourne, je te la balance à la figure…» (Pause silencieuse.)
Lucrecia – (Stupéfiée et presque abrutie.) Il disait cela… c’est ce qu’il dit ?…
Le comte – C’est ce qu’il dit… (Répétant après une pause.) «L’autre…, celle qui n’est pas ma fille, je te la laisse, je te la retourne, je te la balance à la figure.» Et il ajoute ensuite : «Tu sais bien que je sais. Tu ne peux pas le nier… J’ai des preuves.»
Lucrecia – (Cherchant une sortie.) Des preuves !… Je veux voir la lettre !
Le comte – Vous doutez de ce que je dis… ?
Lucrecia – Non, je ne doute pas… je n’en sais rien… Mais la lettre peut être fausse. C’est peut-être un ennemi qui l’a écrite pour me discréditer.
Le comte – (Il fait le geste de sortir la lettre.) C’est mon fils qui l’a écrite.
Lucrecia – (Epouvantée.) Non, je ne veux pas la voir… Quelle horreur !
Le comte – Vous niez donc…
Lucrecia – (Machinalement.) Je nie !
Le comte – Et moi, imbécile que je suis, je croyais trouver en vous suffisamment de grandeur pour me révéler la vérité, sans rien me cacher, la seule façon d’obtenir mon pardon. Porté par ce noble désir, j’ai sollicité cette entrevue et j’aspirais, j’aspire à ce que la malheureuse Lucrecia complète sa révélation en me disant…
Lucrecia – (Au comble de l’horreur.) Quoi… Quoi encore ?…
Le comte – (Avec une austérité froide.) En me disant… laquelle de vos deux filles est celle qui usurpe mon nom, celle qui est symbole et personnification de mon déshonneur.
Lucrecia – C’est une idée infâme… ! Non, ce n’est pas vrai.
Le comte – (Répétant les mots très graves.) «Tu sais bien que je sais… Tu ne peux pas le nier !»
Lucrecia – (Décidée à ne pas accepter et niant avec acharnement.) Je le nie !… C’est faux !…
Le comte – Vous niez que vous avez fait… à Carlos Eraul, peintre, mort il y a un an… la grave révélation que je vous demande à présent ?
Lucrecia – (Vivement, sans pouvoir se retenir.) Vous l’avez ?
Le comte – Donc elle existe…
Lucrecia – (Revenant à elle.) Je veux dire que si vous l’avez, si vous possédez quelque document qui puisse me compromettre, cela ne peut être qu’un faux… on a dû imiter mon écriture.
Le comte – Comme je ne peux pas mentir, je vais vous dire que je ne possède pas ce précieux document. Je l’ai cherché inutilement dans les papiers de mon fils.
Lucrecia – (Elle respire.) Tout n’est qu’une farce, une imposture que je n’impute à personne… sinon à mon destin.
Le comte – Puisque vous ne voulez pas satisfaire mon désir de la vérité, répondez au moins à ceci : Aimez-vous vos deux filles de la même façon?…
Lucrecia – (En colère, elle va et vient très agitée.) Non, de la même façon, non… Je veux dire, si… les deux pareilles… Enlevez-vous cette bêtise de la tête…
Le comte – Il vaudrait mieux croire que vous allez transformer la nuit en jour et le jour en nuit plutôt que de m’enlever de l’esprit que ce qu’a écrit mon fils est la pure vérité. (De manière autoritaire.) Dites-moi vite, vite, laquelle de ces deux adorables petites est la fausse… ou quelle est la vraie : c’est la même chose. J’ai besoin de le savoir, j’ai le droit de le savoir, en tant que chef de la maison d’Albrit, qui n’a jamais eu d’enfants bâtards, produits du vice. Cette maison historique, au grand passé, mère de rois et de princes à l’origine, féconde en seigneurs et guerriers, en saintes femmes, a maintenu intact l’honneur de son nom. Sans tache je l’ai conservée dans ma splendeur comme dans ma misère… Je ne peux empêcher aujourd’hui, quelle tristesse, ce cas honteux de bâtardise légale ; je ne peux empêcher que la loi transmette mon nom à mes deux héritières, ces petites innocentes. Mais je veux faire en faveur de l’authentique, celle qui est de mon sang, une transmission morale exclusive. C’est celle-là qui sera ma vraie descendante, c’est elle qui sera mon honneur et ma noble lignée dans la postérité… L’autre, non. Fausse branche des Albrit, je la répudie, je la maudis… je maudis ses origines roturières et son existence usurpée.
Lucrecia – Par pitié !… Je n’en peux plus. (Elle tombe dans le fauteuil, en sanglots, consternée. Longue pause.)
Le comte – Lucrecia, voyez-vous enfin le motif qui m’anime ?… Vous pleurez… (Pensant que la douceur fera plus que la sévérité.) J’expose sans doute mes griefs avec trop de sévérité ; je pose sans doute des questions de manière hautaine… Je ne peux vaincre la férocité de mon caractère. Pardonnez-moi. (Avec douceur.) Maintenant, je ne donne plus d’ordre… je n’accuse pas… Je ne suis pas juge… je suis l’ami… le père, et c’est en tant que tel que je vous supplie de m’ôter cet horrible doute. (La comtesse se tait, mordant dans son mouchoir.) Courage… Un mot me suffit… Après vous avoir entendue, je ne vous dirai plus rien de désagréable… La vérité, Lucrecia, la vérité, c’est ce qui sauve.
Lucrecia – (Après d’horribles combats, elle se lève brusquement et, désespérée, comme folle, parcourt la pièce.) Oh ! Je n’en peux plus !… Vite, un balcon et je me jette… Fuir, voler, me cacher… Cet homme me tue… De grâce !
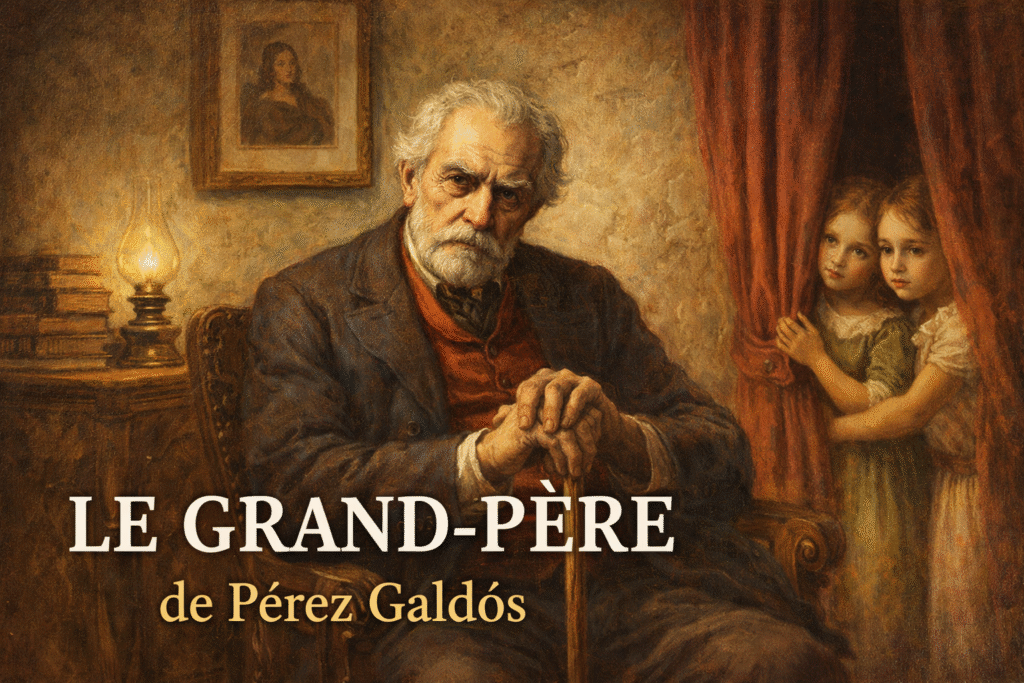
Le comte – Bon, bon… Je vois que vous ne voulez pas entendre raison… Vous ne me répondez pas ?
Lucrecia – (Sauvagement, résolument inébranlable, elle s’arrête devant lui.) Jamais !
Le comte – Vraiment ?
Lucrecia – (Avec encore plus d’énergie.) Jamais… Plutôt mourir !
Le comte – (Il s’assoit calmement.) Eh bien ce que vous ne voulez pas me dire, je le vérifierai moi-même.
Lucrecia – Comment ?
Le comte – Ah !… Je me comprends.
Lucrecia – Vous êtes fou… Votre démence m’inspire de la compassion.
Le comte – La vôtre ne m’inspire que de la pitié. On n’a pas pitié des êtres corrompus, enfoncés dans le mal.
Lucrecia – (En colère.) Vous continuez à m’injurier, moi, la veuve de votre fils !
Le comte – (Se levant, altier.) Celle qui me parle n’est pas la veuve de mon fils, car, même si la loi, une loi imparfaite en décide ainsi, il y a au-dessus de cette loi, une autorité morale du chef de la famille des Albrit, qui vous saisit et vous arrache, comme quelque chose d’étranger et de collant, et vous jette au fumier sur lequel vous voulez vivre.
Lucrecia – (Furieuse et défaite.) Albrit !… Race de fous… chevaliers burlesques… honneur de pacotille pour cacher la mendicité. Que deviendrait le vieux lion si je ne le protégeais pas ! Je suis généreuse, je lui pardonne toutes ses injures et je fais en sorte qu’il ne meure pas dans un hôpital ou qu’il n’aille pas traîner sa misère sur les chemins.
Le comte – (Dans un suprême mépris.) Lucrecia Richmond, Dieu vous pardonne peut-être. Moi, je vous pardonnerais aussi… si on pouvait joindre le pardon et le mépris.
Lucrecia – (En se dirigeant vers la porte.) Ça suffit ! (Aux petites qui entrouvrent la porte, sans oser entrer.) Vous pouvez venir.
[1] Journal de l’époque, fondé en 1859.
[2] Equivalent de la légion d’honneur.
[3] Allusion à Don Quichotte, traduction d’Aline Schulman, éditions du Seuil, 1997, collections Points, Livre II, chap. 17, p. 133, et avec le «lion d’Albrit».
















I?¦ve recently started a website, the information you offer on this site has helped me greatly. Thank you for all of your time & work.