No hay productos en el carrito.

Traduit par Claire Nicolle Robin
Première parti
1
Je donne à mes lecteurs la meilleure preuve de mon estime en leur sacrifiant mon amour-propre de scrutateur de généalogies… ; disons que je les épargne en omettant ici la très longue et fastidieuse étude des lignages, grâce auxquels j’ai pu vérifier que doña Catalina de Artal, Xavierre, Iraeta y Merchán de Caracciolo, comtesse de Halma-Lautenberg appartient au gratin de la noblesse d’Aragon et de Castille, et que, parmi ses ancêtres figurent les Borgias, les Toledos, les Pignatelli, les Gurreas, et autres noms illustres. En explorant cette jungle généalogique, plutôt qu’un arbre, où se croisent et se fondent des lignages aussi anciens et prestigieux, on découvre que, par l’union de doña Urianda de Galcerán avec un prince italien, en 1319, les Artales s’apparentent aux familles des Gonzagues et des Carraciolos. Par ailleurs, si les Xavierre d’Aragon se greffent aux Guzmán de Castille, dans la branche des Iraetas coule la sève des Loyolas, et dans celle des Moncadas de Catalogne, celle des Borromées de Milan. De tout cela, il en résulte que la noble dame compte parmi ses ancêtres non seulement des hommes insignes par leurs prouesses guerrières, mais aussi des saints glorieux, vénérés sur les autels de toute la Chrétienté
Comme j’ai donné ma parole à mon cher lecteur de ne pas l’ennuyer, je réserve pour une meilleure occasion les mille cinq cents preuves que j’ai réunies, en avalant la poussière des archives, afin de démontrer la parenté de doña Catalina avec l’antipape don Pedro de Luna, Benoît XIII. A force de chercher, j’ai trouvé aussi une parenté lointaine avec des Papes légitimes, car, comme il existe une branche des Artales et des Ferrench qui s’est unie aux familles italiennes des Aldobrandini et Odescalchi, il apparaît clair comme le jour que les Papes Clément VIII et Innocent XI sont des parents lointains de la comtesse.
Pour ce qui est des monarques, inutile d’en parler, car l’arbre généalogique est couvert, comme d’un fruit exubérant, de noms royaux, et vous y voyez les Albrit et Foix de Navarre, les Cerdas y Trastámara de chez nous, et une infinité de noms, qui, à cent lieues, ont une odeur de royauté, comme ceux des Rohan, Bouillon, Lancaster, Montmorency etc… Fidèle à ma parole, je rengaine mon érudition, et je commence mon compte-rendu, en disant que doña Catalina-María del Refugio-Aloysa-Tecla-Consolación-Leovigilda, etcétera, de Artal y Xavierre, était la troisième fille des marquis de Feramor. Orpheline de père et de mère à l’âge de sept ans, c’est l’aîné, actuellement marquis de Feramor, et sa sœur, doña María del Carmen Ignacia, duchesse de Monterones, qui s’en occupèrent. En 1890, elle épousa un jeune attaché de l’Ambassade d’Allemagne, le comte de Halma-Lautenberg, mariage qui dut se réaliser contre vents et marées, parce que ses frères et soeurs et toute la famille s’y opposèrent avec ténacité par tous les moyens que leur suggéraient leur morgue et leur obstination Ils voulaient la marier avec un membre de la famille des Muñoz de Moreno-Isla, de noblesse marchande, mais bien pétrie d’écus d’or. Catalina qui, depuis sa plus tendre enfance, faisait montre d’une répugnance incroyable pour le vil métal, s’éprit du diplomate allemand qui, à sa séduisante image, alliait un fort beau mépris pour les petites choses de l’existence. Il y eut des histoires à n’en plus finir et des désordres dans la famille à cause de la tyrannique autorité de ses aînés, et de la résistance héroïque, jusqu’au martyr, de la jeune amoureuse. Mariés enfin, non sans l’intervention de l’autorité judiciaire, l’époux fut envoyé en mission en Bulgarie et de là, à Constantinople, et doña Catalina le suivit là-bas, rompant toute relation avec ses frères et sœurs. Des calamités, des privations, des malheurs sans fin l’attendaient en Orient, et quand sa famille d’ici en avait connaissance, par des informations provenant de diplomates étrangers ou espagnols, elle ne voyait dans tout cela que la main de Dieu punissant durement Catalina de Artal pour sa folie amoureuse qui l’avait conduite à s’unir avec un parvenu, de famille inconnue, un homme sans cervelle, aux idées désordonnées, aux nerfs fragiles, et qui promenait son ennui dans les régions de l’imaginaire. Pour comble d’infortune, Carlos Federico était pauvre, avec simplement son titre, et sans autre rente que son salaire, tout seul, car la famille de Halma-Lautenberg, qui descend, d’après mes sources que je considère comme fiables, du Landgrave de Thuringe et de Hesse Hermann II, avait sombré comme n’importe quelle famille de chez nous, de celles qui, après mille chutes et retournements, tombent au fond de l’abîme social pour ne plus jamais se relever.
Dans ces lointaines contrées, la malheureuse doña Catalina avait subi des contretemps sans nombre, des revers de fortune, la pauvreté et même la faim, sans autre consolation que l’amour de son époux, qui jamais ne lui fit défaut, et dont jamais elle n’eut à se plaindre, car Dieu, en la privant de tellement de biens, lui avait concédé à profusion la paix conjugale. Tendrement aimée et aimante, le bonheur intime de son couple compensait pour elle tous les malheurs d’ordre externe : Carlos Federico était bon, gentil, bien qu’à moitié fou, d’après les uns, et totalement fou, selon les autres. Cette opinion quant à son fonctionnement cérébral, dut monter jusqu’à la Chancellerie de Berlin, parce qu’on le destitua de sa charge. Le jeune couple se trouva à la merci de la Volonté Divine, qui, sans aucun doute, voulait soumettre à cette très dure l’épreuve la force d’âme de la dame espagnole : en effet, deux mois après cette destitution et alors que, dans l’attente de moyens pour revenir en Occident, le ménage vivait obscurément et avec résignation dans une petite maison de Pera, la phtisie se déclara chez le mari, avec des signes d’une telle gravité, qu’il n’était pas difficile de présager un dénouement funèbre à brève échéance.
C’est alors que l’âme de Catalaina révéla combien elle était bien trempée, car, reprenant courage avec ce nouveau coup, elle s’enhardit à demander de l’aide à ses frères et sœurs de Madrid, qui, si au début se firent quelque peu prier au début, cédèrent à la fin, plus pour le bon renom de la famille que par charité chrétienne. Avec les maigres moyens qu’ils lui envoyèrent, notre héroïne put faire transporter son pauvre malade sur l’île de Corfou, connue pour la douceur de son climat. Ils vécurent là, si on peut appeler cela vivre, au prix d’une miraculeuse économie ; remplaçant par l’amour, les ressources matérielles et le confort, par des prodiges d’intelligence : lui résigné, elle vaillante et sublime comme infirmière, aimante comme épouse, s’activant dans les besognes de l’humble demeure, jusqu’à ce qu’à la fin, Dieu rappelle à lui le malheureux comte de Halma au matin du 8 septembre, jour de la Nativité de Notre Dame.
2
Que ceux qui possèdent une inspiration mystique et sont habitués à narrer la vie et la mort de glorieux martyrs, racontent à loisir les souffrances de Catalina durant ces tristes jours et ceux qui suivirent la mort de son époux adoré. Je ne sais pas le faire, et laissant ce travail à des plumes expertes, qui certainement écriront cette histoire édifiante, je ne fais que noter les faits principaux, comme antécédents ou fondement de ce que je me propose de vous raconter. Que puis-je dire de la profonde douleur de la dame en voyant expirer dans ses bras celui qui était toute sa vie, son premier amour, sa joie dernière, l’unique bien terrestre de son âme ? L’opinion du monde, qui rarement ne manque pas de se tromper dans ses jugements précipités et vains, avait déformé la personne morale de monsieur le comte, en le peignant dans les cercles de Madrid avec une volonté de médire. Mais à l’historien consciencieux, bien au fait de son sujet, il revient d’effacer toute déformation avec laquelle les bavards et les envieux noircissent un noble caractère. C’est ce que je fais maintenant, en certifiant que Carlos Federico de Halma était un brave homme et que l’enquête la plus tatillonne et pessimiste ne trouvera pas dans sa conduite, une fois marié, le moindre reproche à lui faire. Il avait résolument démonté la réputation que des langues trop bavardes lui avaient faite à Madrid, et il avait reconstruit sa véritable personnalité d’homme droit, loyal, sincère, ajoutant à ces qualités celles qu’il avait acquises au contact de sa digne épouse.
Quant à la douteuse réputation de l’Allemand avant son mariage, avaient joué un grand rôle et avaient fini par constituer une véritable mine d’anecdotes, la volubilité de ses idées, la légèreté de ses jugements, ses distractions ; ses humeurs noires qui alternaient avec des accès d’enthousiasme fou pour n’importe quel sujet artistique ou amoureux, sa pesante prolixité dans les discussions, une infinité de manies, dont quelques-unes lui étaient restées jusqu’à sa mort. Il s’échauffait la cervelle en pensant à l’habitabilité de toutes les planètes du ciel, grandes et petites, et celui qui voulait le faire sortir de ses gonds n’avait qu’à mettre en doute la diffusion infinie de la famille humaine dans l’immensité planétaire. De l’absolu mépris pour toute religion positive, il était passé, peu avant de se marier, et grâce à l’influence de notre angélique Catalina, à une fervente ardeur chrétienne, relevant plus de l’imagination que de la piété, soif de l’âme qui désirait, sans se jamais satisfaire, non pas des dévotions extérieures et des pratiques liturgiques, mais des ivresses de l’imagination, plus sensible à la légende fascinante qu’au dogme sévère. En Orient, l’épouse était parvenue à mettre un certain ordre dans les enthousiasmes échevelés de Carlos Federico, jusqu’à ce que, victime d’une cruelle maladie, il fut aussi difficile de combattre chez lui la fièvre brûlante que son spiritualisme délirant. L’un et l’autre feu le consumaient à part égale, et on aurait dit que tous deux, unissant leurs flammes, l’avaient réduit à l’état de cendre impalpable.
La nuit même de sa mort, il raconta à sa femme, entre deux attaques de dyspnée, un rêve qu’il avait fait l’après-midi, et comme Catalina avait vu dans ce récit une étrange logique et une certaine lucidité classique, elle en ressentit un grand chagrin, en pensant que son pauvre malade entrevoyait déjà les horizons du royaume de l’éternelle vérité. Autant de bon sens, autant de jugement dans la composition de ce petit poème fantastique, car le rêve si bien raconté n’était pas autre chose, que pouvaient-ils signifier sinon que le poète se mourait ? Il en fut ainsi, en effet. Dans les dernières minutes de vie, il se lançait, avec une imagination débridée, dans un voyage au travers de l’Asie Mineure et de la Palestine, dans le double but de visiter les ruines de Troie d’abord, et le pays de Galilée, ensuite. (Faites le rapprochement). Dans son esprit deux noms s’étaient unis: Homère-le Christ. Et en voulant donner l’explication de cette rencontre historique et poétique, il gémit, poussa un grand cri… : « Ah ! » et expira.
On pourrait croire que la mort du comte avait été la dernière souffrance de la malheureuse Catalina Artal et, qu’après ce chagrin, le Ciel lui avait accordé des jours de repos sinon de bonheur. Mais il n’en fut pas ainsi. Outre la tristesse du veuvage et le souvenir toujours présent du pauvre mort, elle se vit accablée par des calamités d’un autre ordre. Jusqu’alors, elle avait connu les humiliations et les privations choquantes qui blessaient sa dignité d’aristocrate. Mais peu de temps après avoir perdu son mari, et alors qu’elle résidait encore à Corfou, parce qu’elle n’avait pas les moyens d’aller dans un autre endroit, elle sut ce que c’est que la misère, la misère réelle, horripilante et subit des vexations qui auraient abattu des âmes moins bien trempées que la sienne. Logée comme par charité dans une maison anglaise, d’abord ; dans une auberge grecque, ensuite, Catalina de Artal se vit certains jours privée de nourriture, obligée de laver les quelques vêtements qu’elle possédait, à raccommoder ses chaussures et à assurer des services qui répugnaient à son délicat organisme. Mais elle supportait tout avec patience, elle acceptait tout pour amour du Christ, désirant se purifier par la souffrance. Comme une occasion favorable d’en finir avec cette situation s’était présentée, elle voulut en profiter, plus que pour améliorer ses conditions de vie, pour se retrouver avec des parents, sur qui déployer la tendresse que renfermait sa belle âme. Un jour, inopinément était arrivé sur l’île ionique un frère de Carlos Federico, grand amateur de voyages maritimes, et qui cabotait dans l’archipel sur un yacht de commerçants du Pirée. Celui-ci lui proposa de l’emmener à Rhodes, où était consul le comte Ernesto de Lautenberg, son oncle et aussi celui de son défunt époux, personne très brave et simple, que la malheureuse dame avait connu à Constantinople.
La dame se laissa emmener par Félix Mauricio (c’est ainsi que s’appelait son beau-frère), attirée, essentiellement, par l’espoir de vivre en compagnie de la comtesse Ernesto de Lautenberg, dame hongroise très sympathique et qui avait manifesté à l’espagnole, durant les quelques jours de leur rencontre, une cordiale sympathie. Ils partirent, donc, de Corfou sur le bateau grec, qui portait mal son nom de yacht car, vu sa petitesse et son faible tonnage, il n’était rien de plus qu’un joli voilier bon pour des régates et de courtes excursions. Son équipage était composé de dilettanti de la mer. À cause du mauvais pilotage et de l’ignorance de celui qui faisait office de capitaine, ils ne purent éviter une furieuse tempête qui les surprit entre Zante et Céphalonie, et poussés par le vent et la houle vers le golfe de Patras, ils accostèrent à Missolonghi avec de grandes avaries. Ils y restèrent des jours et des jours, attendant le beau temps, et repartis sur la mer, ils arrivaient toujours là où ils ne voulaient pas aller. Félix Mauricio et son compère athénien qui dirigeait la fragile embarcation soutenaient la théorie que les tempêtes avec du vin sont moindres et prenaient cuites sur cuites, que c’en était un malheur. De cette façon, avec de telles inquiétudes et de telles vicissitudes, navigant au gré de Neptune et sans l’art aucun de le dominer, ils firent en zig zag toute la côte sud du Péloponèse. Comme celui qui décrit des S dans le labyrinthe des ruelles d’une ville tortueuse, ils se retrouvaient aussi bien à Candie qu’à Cérigo (l’ancienne Cythère) ; ils pénétrèrent au petit bonheur dans les Cyclades, touchant terre à Milo et Paros ;ensuite ils parcoururent les Sporades, visitant Samos, Cos et d’autres îles jusqu’à ce qu’ils parviennent à Rhodes, après deux mois d’une navigation infernale.
Comme tout allait à l’encontre des souhaits de la malheureuse veuve, il se trouva que le comte Ernest était parti en Allemagne avec une permission, et que son épouse, la sympathique et très gentille hongroise, était morte trois mois auparavant. La comtesse de Halma accepta avec résignation cette nouvelle déception, et parlant avec son beau-frère de la nécessité de l’emmener à Corinthe ou Athènes, d’où elle pourrait entrer en contact avec sa famille, et préparer son retour en Espagne, le jeune homme lui répondit d’une manière si crue et grossière, que la dame, malgré ses efforts, ne put dans sa réponse, mettre son humilité au-dessus de son orgueil. Ils se trouvaient dans une gargote proche des quais. La dame renonça à l’hospitalité à bord, que le capitaine du voilier lui offrait et, ayant appris qu’il existait à Rhodes un couvent de l’Ordre Terciaire, elle s’y dirigea, tournant le dos pour toujours au comte Félix Maurice et à ses extravagants compagnons d’aventures maritimes.
Grâce aux braves franciscains, la noble dame fut logée décemment, et les négociations pour son retour dans la mère patrie commencèrent. Disons au passage, pour compléter les informations que ce Félix Maurice était ce qu’il y avait de pire dans la famille Halma-Lautenberg. Il avait appartenu au corps consulaire, exerçant à Alicante et à Smyrne. Là, il s’était marié avec une grecque fortunée, et abandonnant la carrière diplomatique, il s’était consacré au commerce d’éponges avec plus ou moins de bonheur. Quand nous l’avons trouvé sur le voilier, il était parvenu à se refaire de sa première faillite. Son caractère violent et susceptible, son allure désagréable, et plus que tout, son penchant irrésistible pour les libations alcooliques, le rendaient peu estimable et peu estimé de ses proches et des étrangers. Un après-midi, alors que Catalina devisait avec le concierge du couvent, elle vit le yacht prendre la mer, et elle se signa. Elle avait pardonné au bateau et à son équipage, et rendit grâce à Dieu d’être sortie indemne de son aventure si périlleuse dans les mers de Grèce.
Les charitables religieux parvinrent à arranger pour la malheureuse comtesse son retour en Occident et, lui prenant un billet à la Lloyd Autrichienne, ils l’envoyèrent à Malte, où d’autres religieux du même ordre se chargeraient de l’envoyer à Marseille, et de là à Barcelone. Mais comme la Lloyd Autrichienne ne faisait pas escale à Rhodes, la voyageuse dut faire la traversée entre cette île et le port d’attache, qui était Smyrne, sur une goélette turque, qui avait une cargaison de fruits et de blé. Nouveaux contretemps pour la comtesse, car ces diables de Turcs avaient eu l’heureuse idée de charger une contrebande considérable, et dans les eaux de Chio, une felouque militaire inspecta, arraisonna et confisqua la goélette avec tout son équipage, jusqu’à ce que le pacha de Smyrne ait décidé du nombre de coups de bâton que l’on devait administrer au patron. Pendant ce temps, doña Catalina supportait privations et tourments à foison, parce que là, il n’y avait pas de religieux franciscains pour veiller sur elle. Et bien heureuse encore, qu’à la fin elle ait pu se voir à bord d’un vapeur autrichien, lequel, pour que le destin de la malheureuse dame soit complet, était un véritable invalide. Elle avait peur de tout, de la mer et du ciel, et des débordements de la racaille de plusieurs races orientales qui, sur ces embarcations, monte et descend continuellement. Mais ce ne fut ni le ciel, ni la mer, ni les voyageurs qui occasionnèrent des déboires à la dame. Ce fut cette satanée machine à vapeur qui se chargea d’interrompre lamentablement la navigation, en se brisant sur la route de Candie. Le bateau se retrouva comme une bouée, l’arbre de l’hélice cassé en deux, le gouvernail inutilisable à cause de la rupture des drosses. Enfin, un vapeur anglais le remorqua, et le conduisit à Damiette ; là, ils changèrent de bateau, en direction d’Alexandrie, où, pour varier le programme, ils durent prendre à grand-peine un autre bateau, après avoir perdu tous les bagages et avoir été mouillés jusqu’aux os. En route pour Malte, avec une grande symphonie de siroccos violents, coups de mer, et pour terminer la fête, à l’entrée de La Valette, rupture d’une des pales de l’hélice, retard, danger… A Malte, la dame errante fut saisie de fièvres intermittentes. Deux semaines d’hôpital, danger de mort, consternation, solitude. Enfin, parce que dans ce triste cas se réalisait l’aphorisme Dieu ne veut pas la mort du pécheur, Catalina de Halma débarqua à Marseille dans un état lamentable tant au point de vue physique que dans ses vêtements et ses chaussures, et cinq jours après, monsieur et madame les marquis de Feramor virent entrer chez eux une femme qui ressemblait plutôt à un spectre, le visage décharné, comme mangé par la terre, les yeux brillants et fiévreux, les vêtements abîmés par le temps, le vent et la mer, les chaussures percées…, une pitoyable figure en vérité. Et comme monsieur le marquis, pris d’épouvante, la regardait sévèrement et lui disait :
– Qui êtes-vous ?
Catalina dut lui répondre :
– Mais, est-ce vrai que tu ne me reconnais pas ? Je suis ta sœur.
3
Lors des premières explications et des premières conversations avec son frère et sa sœur, c’est-à-dire avec le marquis de Feramor et la duchesse de Monterones, la comtesse de Halma n’avait cédé sur aucun point, c’est-à-dire qu’elle n’avait manifesté aucun regret de son mariage, et ne le désavouait pas, en dépit des épreuves et des malheurs sans fin qu’avait entraînés son union avec l’Allemand. La mémoire de son époux chez elle l’emportait sur toute autre considération, et elle ne permettait pas que ses aînés lui portent la moindre atteinte par des accusations ou des plaisanteries cruelles. Elle était venue pour qu’ils la protègent, en lui donnant le reste de son héritage, s’il restait quelque chose, après avoir soldé ses comptes avec le chef de famille. Mais elle ne s’humiliait pas et, ni en le demandant ni en le prenant au cas où on le lui donnerait, elle ne voulait abdiquer de sa dignité, en se rabaissant moralement devant ses aînés et en leur donnant raison à propos de son mariage. Non, mille fois non. S’ils ne lui venaient pas en aide même par aumône, elle trouverait bien un couvent de religieuses dans lequel entrer. Elle n’aurait aucune répugnance à entrer dans n’importe quel de ces Ordres modernes, qui se consacrent à s’occuper de vieillards, ou à assister des malades, parce que, parmi tant de Congrégations, il devait bien en avoir une qui admettrait des veuves sans dot. A tout ceci, son frère lui avait répondu gravement de ne pas se précipiter, et que, pour l’instant, elle ne devait penser qu’à se remettre de tant de maux et d’ennuis.
Pendant presque un mois, doña Catalina était restée chez son frère, sans voir personne ni recevoir des visites, sans se laisser voir de personne d’autre que la famille et de la domestique qui la servait. Des vêtements qu’on lui offrit, elle n’accepta que deux habits noirs, très simples, faisant le vœu de ne plus porter, sa vie durant, de vêtement de couleur, ni en soie, ni des atours d’aucune sorte. Modestie et propreté seraient ses uniques parures, et en vérité, rien ne seyait mieux à son visage très blanc et à son allure simple et mélancolique. Comme il faut tout dire, c’est le moment de déclarer que doña Catalina n’était pas belle, du moins, dans le sens mondain de la beauté. Mais le passage de tant de malheurs avait laissé sur son visage une ombre placide, et dans ses yeux, une expression de béatitude qui était un plaisir pour tous ceux qui la regardaient. Elle avait les cheveux blonds, tirant sur le roux ; le nez un peu fort , la lèvre inférieure trop proéminente, le teint mat et lisse, le regard doux et serein, une expression totale de gravité, une taille haute, le corps raide et un maintien cérémonieux. Les quelques personnes qui, durant ces jours-là, parvinrent à la voir, affirmaient lui trouver une certaine ressemblance avec Jeanne la Folle, telle que la légende et le pinceau nous ont transmis l’image de cette dame. Il serait hasardeux d’évoquer d’autres ressemblances d’ordre spirituel, en dehors du fait que la comtesse de Halma parlait l’allemand avec la même perfection et la même aisance que l’espagnol.
Cet isolement monastique dans lequel vivait sa sœur, n’était guère du goût de monsieur le marquis, et il ne voyait pas d’un bon œil ses désirs de renoncer absolument à la vie sociale. Elle pouvait encore, selon lui, aspirer à un second mariage, qui l’indemniserait des désastres du premier ; mais pour cela, il lui fallait abandonner sa raideur d’image hiératique, les inflexions attristées de sa voix, ne pas s’habiller comme la veuve d’un lieutenant, et fréquenter le cercle des amis de la maison. La marquise était du même avis et tous deux la sermonnaient à ce sujet ; mais la fermeté avec laquelle Catalina défendait ses convictions, manies ou ce que l’on voudra, leur fit comprendre qu’ils n’aboutiraient à rien pour le moment, et qu’ils devaient laisser au temps et aux lentes évolutions de la volonté humaine, la solution de ce problème de famille.
Bien qu’il soit un personnage fort connu à Madrid, je veux dire quelques mots maintenant du caractère de monsieur le marquis de Feramor, dont la correction anglaise est un modèle pour tant de gens. Si, par son intelligence plus solide que brillante, il inspire de l’admiration à un grand nombre, à peu de gens ou à personne, pour parler franc, il n’inspire de la sympathie. Ceci est dû au fait que les caractères exotiques, formés dans le moule anglo-saxon, ne s’allient et ne se fondent pas avec notre pâte indigène, pétrie avec des farines et des laits différents. Don Francisco de Paula-Rodrigo-José de Calasanz-Carlos Alberto-María de la Regla-Facundo de Artal y Xavierre, avait manifesté depuis sa plus tendre enfance des aptitudes pour le sérieux, contrevenant à tel point aux habitudes de l’enfance que ses petits amis l’appelaient le Vieux. Il collectionnait des timbres, soignait sa tirelire et nettoyait lui-même ses vêtements. Il ramassait du sol aiguilles et épingles, et même des bouchons en liège en bon état. On raconte qu’il faisait des échanges de tant de douzaines de boutons contre un timbre du Nicaragua, et qu’il vendait ceux qu’il avait en double à des prix exorbitants. Interne chez les Frères des Ecoles chrétiennes, ces derniers l’avaient pris en affection, et lui donnaient des notes excellentes à tous ses examens, parce que l’enfant savait ses leçons, et là où n’arrivait pas son intelligence, qui n’était pas mince, arrivait son amour propre, qui était excessif. Très fier de son fils, et voulant en faire un vrai personnage, utile à l’Etat, et qui serait un gardien courageux des intérêt moraux et matériels du pays, son père l’envoya faire son éducation en Angleterre. Monsieur le marquis était anglomane par goût ou par seconde nature, parce qu’il n’avait jamais traversé le canal de la Manche, et ce n’était que par de vagues connaissances acquises dans des réunions, qu’il savait que les meilleures machines et les meilleurs hommes d’État viennent d’Albion.
Et Paquito, s’en alla là-bas, avec de bonnes recommandations, et ils le mirent dans l’un des plus célèbres collèges de Cambridge où il resta deux ans, parce que, comme son père ne se trouvait pas dans les meilleurs conditions pécuniaires, il dut chercher pour son fils une école moins dispendieuse. Dans un modeste collège de Peterborough, dirigé par des catholiques, l’aîné compléta son éducation, devenant un véritable anglais par ses idées et ses manières, ses pensée et son comportement social. A Peterborough il n’y avait pas les études classiques raffinées d’Oxford, ni les scientifiques de Cambridge ; les jeunes gens grandissaient dans un milieu de bourgeoisie éclairée, sachant beaucoup de choses utiles, quelques-unes élégantes, cultivant modérément le horse racing, le boat racing et une pratique suffisante du lawn-tennis pour passer dans n’importe quelle ville du continent pour de parfaites créatures d’Albion.
L’héritier de Feramor parlait parfaitement la langue anglaise, et connaissait assez bien la littérature du pays qui avait été sa mère intellectuelle, préférant les études politiques et historiques aux littéraires, et dans les premières, plus ami de Macaulay que de Carlyle ; dans les secondes, plus admirateur de Milton que de Shakespeare. Il gardait toujours sa veine latine. Au sortir du collège, son père lui avait obtenu un poste à l’Ambassade, pour qu’il y reste quelques années de plus afin de bien s’imprégner de la sève britannique. C’est à cette époque que s’éveilla et se développa son goût pour la politique, jusqu’à devenir une véritable passion ; il étudia à fond le Parlement, et ses prérogatives, ses anciennes pratiques consolidées par le temps et il ne perdait pas un seul discours que prononçaient, sur n’importe quel sujet d’importance, ces maîtres de l’éloquence, si différents des nôtres, comme le fruit l’est de la fleur, ou le tronc droit et massif de l’arbuste tordu.
Don Francisco de Paula approchait déjà de la trentaine quand, à la suite du décès de monsieur son père, il hérita du marquisat ; il revint en Espagne, et dix mois après il se maria avec doña María de Consolación Ossorio de Moscoso y Sherman, de la noblesse de Malaga, descendante d’Anglais et d’Espagnols, jeune fille de grande valeur, moins belle que riche et d’une éducation qui était tellement correcte et façonnée à la manière étrangère, qu’elle ne déparait en rien celle de son époux. Peu après, la sœur aînée du marquis se maria avec le duc de Monterones. Catalina, qui était la plus jeune, ne fut comtesse de Halma que six ans après.
Donc, monsieur, le dix-septième marquis de Feramor était entré dans la vie sociale et aristocratique de la ville, à laquelle il avait apporté l’intelligence anglaise et l’orthodoxie parlementaire du pays de John Bull , avec tous les atouts de son côté. Très heureux en ménage, parce que Consuelo et lui avaient été taillés sur le même patron, il ne le fut pas moins en politique, car dès le moment où il était entré au Sénat, représentant une province du Levant[1], il avait commencé à se distinguer , comme une personne tout ce qu’il y avait de plus sérieuse, qui venait rafraîchir notre parlementarisme vieillot avec le sang et le souffle du pays parlementaire par excellence. Son éloquence était sèche, ajustée, mate et sans effet. Il traitait des affaires économiques avec une exactitude et une connaissance qui faisaient le vide sur les bancs de l’Assemblée. Mais , quelle importance ? On va au Parlement pour convaincre, non pour chercher des applaudissements ; le Parlement est quelque chose de plus sérieux qu’un combat de coqs. Ce qu’il y avait de certain c’est que, dans cette solitude des bancs rouges des parlementaires, Feramor avait des admirateurs sincères et même enthousiastes, deux ou trois et même cinq sénateurs déjà mûrs, qui l’écoutaient avec ravissement, et ensuite sortaient en le portant aux nues.
– Voilà comment on traite les problèmes. C’est ici, ici, dans ce miroir que tous vous devez vous regardez : voilà ce qui est bien, le vrai anglais de l’Angleterre, la marque London véritable, patentée.
4
En dehors du Sénat, le marquis avait aussi son petit cercle d’admirateurs qui le citaient continuellement comme un modèle digne d’admiration. A cause de lui et de quelques autres hommes éminents peu nombreux, on disait cette phrase toute faite : « Ah ! si toute notre noblesse était comme ça, il en irait autrement pour notre pays ! ». L’argument spécieux d’imputer nos malheurs politiques au fait de ne pas avoir une noblesse de style anglais , avec des habitudes parlementaires et un véritable pouvoir politique, finissait par être une cantilène insupportable.
Il faut toutefois remarquer que Feramor démentait la croyance populaire que tout Anglais de la haute, devait être féru de chevaux et délirer pour n’importe que sport que l’on pratique à Albion. Soit dit en son honneur, il n’avait importé du pays sérieux que le sérieux, laissant de l’autre côté du canal les folies hippiques. Quoi qu’il s’y connût un peu et même plus, dans ce qui touche au turf, il ne s’en occupait qu’avec une froideur polie, signalant toujours la distance qu’il y a intellectuellement entre un handicap et un discours politique, même s’il est ministériel. Et s’il était chasseur, et bon chasseur, il ne manifestait pas pour cette distraction une préférence systématique et absorbante. Ainsi, les plaisirs comme les obligations existaient chez lui avec une valeur propre et naturelle, et l’intelligence était la maîtresse et l’âme de tout. Dans l’ordonnance de ses facultés, dominait celle que Dieu lui avait donné pour qu’il dirige les autres : la faculté d’administrer ; et en attendant qu’arrive l’occasion de faire les comptes de la nation, il faisait les siens avec une justesse tatillonne qui était un nouvelle occasion d’applaudissement pour ses admirateurs. « Un aristocrate qui sait administrer ! Oh ! s’il y avait beaucoup de Feramor dans notre noblesse, la nation n’en serait pas là ! »
La fortune patrimoniale du marquis n’était pas grande, car son père avait mis en pratique des doctrines qui allaient à l’encontre de la régularité administrative. Mais la richesse apportée au ménage par la marquise renforçait considérablement la maison, dans laquelle régnait un ordre parfait et on ne dépensait que la moitié des revenus. ils vivaient, donc, avec dignité et modestie, se soumettant volontiers à un régime de prévision délimité par deux jalons : celui de devant qui fixait la limite que ne devait pas dépasser le luxe, pour éviter des gaspillages; celui de derrière, qui marquait la ligne de l’économie, pour ne pas tomber dans la sordidité. Mieux encore, la marquise qui semblait faite à l’image et ressemblance de son époux, et qui par la vie en commun assimilait prodigieusement ses idées, se révéla être aussi administrative et administratrice que lui et elle l’aidait à soutenir cet heureux équilibre. Tous deux faisaient merveille dans la gestion de la maison, avec une parfaite harmonie économique, si on me permet de le dire ainsi. Les opinions des gens sur cette manière de vivre étaient diverses, car si certaines les critiquaient parce qu’ils n’avaient pas une écurie de grande importance hippique, comme il convenait connaissant les goûts du marquis pour ce qui était anglais, d’autres n’avaient pas assez d’éloges pour son excellente bibliothèque, essentiellement consacrée, oh !…., aux sciences morales et politiques. Sa table était inférieure à sa bibliothèque et supérieure à son écurie. Il n’y avait que cinq convives une fois par semaine.
Après avoir dit ces opinions, il convient de noter les médisances, même si celles-ci jettent une petite ombre sur la noble figure des Feramor. Des langues, qui évidemment étaient méchantes, disaient que le marquis prêtait ce qui restait de ses revenus à des taux énormes, tirant d’embarras ses amis de l’aristocratie, compromis par des dettes de jeu, le sport [2] ou d’autres vices. Sur ce point, les médisants se trompaient, comme cela se produit presque toujours, car les prêts du marquis n’étaient pas extrêmement usuraires. Il se consolidait, ça oui, avec de bonnes hypothèques, et quand la garantie était faible et le remboursement problématique, ses principes économiques lui conseillaient d’augmenter prudemment les intérêts. Le fait est que, si en vérité il ne fallait pas l’appeler usurier, il aurait été tout à fait injuste de lui appliquer le qualificatif de généreux. Même l’adulation, qui peut tout faire, ne pouvait l’appeler ainsi. Ses amis les plus bienveillantes n’arrivaient pas à trouver chez lui un trait de libéralité, ou un exemple d’une faveur désintéressée. Il n’était qu’exactitude dans la pensée, précision mathématique dans les actes, telle une machine de vie sociale dans laquelle on aurait supprimé les mouvements du ressort affectif. Il ne manquait jamais à ses devoirs, on ne pouvait le prendre en flagrant délit de négligence dans ses engagements ; mais il ne tombait non plus dans la sensiblerie de faire le bien pour le bien. Toujours sur ses gardes, il se protégeait lui-même avec des clés de sûreté que lui seul maniait, il ne permettait jamais que la spontanéité fasse une brèche dans son intérieur en fer, et encore moins qu’une main profane y pénètre.
Voilà pourquoi il ne jouissait d’aucun sympathie, et ceux qui l’admiraient comme le dernier modèle anglais pour façonner des personnes ne l’aimaient pas. Tous les trouvaient peu espagnol, privé des qualités et des défauts de la complexe race péninsulaire. Ils l’auraient voulu moins réglementé moralement, moins exact, et un tout petit peu débauché. Physiquement, il était beau, mais sans expression, avec des traits où l’on ne trouvait pas le moindre défaut, qui se terminait par une couronne négative, c’est-à-dire, par une calvitie précoce, brillante et nette, que lui considérait comme le plus élégant couvre-chef du sérieux britannique. Son comportement hors de chez lui était empreint de délicatesse, de finesse, dans les limites d’une élégante tiédeur, et dans l’intimité domestique, il était sec et autoritaire, sans aucune dissonance, mais aussi sans un atome de douceur comme un précepteur ou un intendant, plus que comme un père et un époux. De madame la marquise, qui n’était que le féminin du caractère de son mari, il y a peu à dire. L’assimilation était arrivée à être si parfaite, qu’ils pensaient et disaient la même chose, utilisant les mêmes locutions familières. Tous deux s’exprimaient en anglais avec une remarquable aisance. Et l’assimilation ne s’arrêtait pas à cela, car il se produisait dans ce jeune couple ce qui se produit dans quelques vieux couples, d’être réduits, par une longue vie en commun, à une seule personne dans deux figures différentes. Le marquis et la marquise se ressemblaient physiquement : que dis-je se ressemblaient ? ils étaient semblables , bien qu’elle se fît remarquer par son absence de beauté et lui, parce qu’il était assez bel homme ; semblables le regard, la façon de respirer, les mouvements musculaires du visage, la gravité du front, le tremblement imperceptible des narines, la façon de porter des lunettes, parce que tous deux étaient myopes ; la bouche, le sourire de bonne éducation plutôt que de gentillesse. Un plaisantin, ami de la maison, disait que si l’un des deux mourait, le survivant serait veuf de lui-même.
Ils vivaient dans la maison patriarcale des Feramor, sur une des petites places irrégulières proches de San Justo, avec vue sur la rue de Ségovie et sur le viaduc à l’ouest ; une maison vétuste, mais qui, avec les réparations et les redistributions faites par le marquis, n’était pas mal. Le rez-de-chaussée, agrandi et considérablement amélioré, se divisait en deux pièces de rapport, et avaient été louées, l’une à un atelier de lithographie, l’autre aux bureaux d’une Confrérie religieuse. Le second, distribué au début en trois pièces à louer, fut par la suite annexé à la maison pour loger convenablement les grands enfants, l’institutrice et une partie de la domesticité. C’est dans ce logement que doña Catalina choisit sa chambre, ne permettant pas qu’elle soit meublée avec luxe mais plutôt comme la cellule d’un couvent, ce à quoi s’opposèrent le marquis et son épouse, ennemis jurés de toute exagération. L’exagération les mettait hors d’eux-mêmes, et donc, ils arrangèrent la pièce modestement, mais en évitant l’affectation d’une pauvreté monastique.
Un mois après son retour à Madrid, la triste veuve commença à émerger de cette douloureuse stupeur dans laquelle elle était arrivée. Elle prenait maintenant goût à la vie de famille, rompait la mélancolique solennité de son silence, et se distrayait parfois dans le monde innocent de ses petits neveux, en les faisant manger, aidant l’institutrice ou bien en les amusant avec des petits contes et des jeux du moment qui n’étaient pas bruyants. Elle ne descendait jamais à la grande salle à manger à l’heure officielle des repas. Ou on la servait dans sa chambre, ou alors avec la petite famille, dans la salle à manger du haut. Sa vie était très simple et d’une régularité conventuelle ; elle se levait au lever du jour, écoutait la messe au Sacramento ou à San Justo, revenait vers huit heures, priait ou lisait, en faisant du crochet, et le reste de la journée elle l’employait à faire réciter leurs leçons aux petits ; reprenant de temps en temps son travail de lecture, de crochet et de la prière. Sa belle-sœur montait souvent pour lui faire la conversation et la distraire ; son frère faisait rarement monter son sérieux jusqu’au deuxième étage, et quand il avait quelque chose d’important à lui communiquer, il l’appelait dans son bureau. Un matin, après avoir préparé le discours qu’il devait prononcer cet après-midi-là au Sénat, en tirant toutes sortes d’informations de revues et de journaux qui traitaient de balivernes économiques, il parla longuement avec sa sœur de ce qu’on on verra à la suite.
5
– Et moi je te demande, ma chère sœur, vas-tu rester comme cela toute ta vie ? N’as-tu pas assez pleuré ? Ne te lasses-tu pas encore de l’obscurité, du silence, des prières monacales et de ce quiétisme qui finira par briser ta santé et même ta vie ?… Tu ne réponds rien ? Bon. Connaissant ton obstination, ce silence m’indique que la mélancolie et la nostalgie vont encore durer un moment. Ah ! Catalina, pourquoi n’es-tu pas comme moi ? Pourquoi n’as-tu pas un peu de sens pratique et n’abandonnes-tu pas ces exagérations ? Voyons ! Posons clairement le problème. Penses-tu consacrer absolument ta vie aux dévotions, à la religion, en un mot ?
– Oui –répondit la comtesse de Halma avec une laconique fermeté.
– Bon. On a une affirmation, c’est déjà quelque chose, quoi que ce soit une bêtise. La vie religieuse : d’accord. Et tu y as bien pensé ? Ne crains-tu pas que puisse survenir le découragement, un changement d’idées quand il sera trop tard pour y remédier ?
– Non.
– D’accord. Une négation aussi catégorique, c’est déjà quelque chose ; Continuons…. Donc ta détermination est irrévocable ; donc tu te sens avec les forces nécessaires pour affronter cette vie, que je suis le premier à louer et à exalter… ; cette vie, ah ! dont nous trouvons des exemples si beaux dans les temps anciens, mais qui à notre époque…, ah !… Pour résumer : tu as certainement l’intention d’entrer dans l’un des Ordres existants, et finir tes jours dans un cloître. Parfaitement : mais c’est là que j’interviens, c’est là où intervient ton grand frère, le chef de famille actuel, qui a la chance de voir les choses avec une grande clarté, et de poser tous les problèmes sur un terrain positif. Moi, je te le demande : est-ce ton souhait de faire partie de l’un des Ordres cloîtrés et reclus, ou de ces Ordres modernes, à la française, qui poursuivent des buts essentiellement pratiques et sociaux ? Je te le demande, ma chère sœur, non pas parce que je pense m’opposer à ta décision en aucun cas, mais pour bien définir les termes du problème et préciser tes relations ultérieures avec la famille du point de vue social et économique. Il faut considérer la question de ta dot, c’est-à-dire de ta religiosité depuis l’aspect des intérêts matériels… Parce que si nous ne fixons pas bien…, si nous ne délimitons pas bien…
Doña Catalina interrompit avec une impatience nerveuse son frère au moment où celui-ci accentuait son argumentation avec les deux doigts sur le bord de la très élégante table de son bureau.
– Ne te fatigue pas à traiter cette affaire comme si c’était une discussion au Sénat. C’est très simple, et si simple, que moi tout seule je peux le résoudre sans le conseil ni l’aide de personne. Garde ton savoir pour des choses plus importantes. Moi, j’ai mon idée.
Arrivée à ce point, il l’interrompit rapidement en s’emparant de la phrase pour la commenter avec une certaine aigreur :
– Voilà ce que je crains, madame ma sœur, et quand je t’entends dire : « J’ai mon idée » je me mets à trembler, parce que les faits me prouvent que tes idées de sont pas d’une parfaite congruité avec la réalité.
– Le fait est que je l’ai, mon cher frère –dit la comtesse de Halma avec humilité-, et toi, tu as les tiennes. Il n’est pas difficile de voir qu’elles ne seront pas en concordance. Nous pensons, nous sentons la vie d’une manière très différente. Laisse-moi sur mon chemin, et continue le tien. Peut-être nous rencontrerons-nous, peut-être pas. Cela, qui peut le savoir ? C’est un fait que je veux mener une vie religieuse. Je ne peux encore te dire si j’entrerai dans les ordres anciens ou dans les modernes. Je suis un peu lente dans mes résolutions et mes idées doivent beaucoup mûrir pour que je me décide à les mettres en pratique ? Peut-être te surprendrai-je avec un petit projet qui ira un peu plus loin que la ligne habituelle. Je ne sais pas. Chacun a ses aspirations. Moi je les ai dans ma sphère, comme toi dans la tienne.
– Oui, oui –dit le marquis, trouvant un motif facile pour argumenter humoristiquement-. Madame ma sœur vise très haut. La force de son humilité lui suggère des idées qui ressemblent à l’orgueil comme une goutte d’eau à une autre. Elle ne trouve pas dignes de son ardeur religieuse les Ordres consacrés par le temps, et elle aspire à éclipser la gloire des sainte Thérèse et des sainte Claire, en fondant une nouvelle règle monastique pour son usage personnel… Et moi, je demande : les facultés intellectuelles de ma chère sœur seront-elles à la hauteur des aspirations très nobles de son âme généreuse ? Je me permets d’en douter… Ne me dis pas que tu n’y as pas pensé, Catalina, et que tu ne rêves pas de la célébrité d’une fondatrice. Je l’ai vu dans ce que tu ne dis pas, quand tu me parles, plus que dans ce que tu me dis. Je l’ai vu à cause de certaines réticences que j’ai surprises chez toi, quand nous parlons parfois indirectement de ce que tu vas faire des restes de ta dot. Et maintenant, ma sœur, j’aborde à nouveau la question des intérêts, à nouveau pris d’un doute. Je pose la question : madame ma sœur, dans l’état cérébral fort particulier qui est le produit infaillible du mysticisme, ma sœur est-elle en mesure d’apprécier exactement le montant de sa dot après les aides données en Orient, point n’est besoin de le rappeler maintenant ?
– Je crois pouvoir l’apprécier –dit madame de Halma avec fermeté- ; bien que, d’après toi, il me manque le sens des choses matérielles
– Ce n’est pas une opinion en l’air, car elle est fondée sur une triste expérience. Parce que tu n’as pas su à temps dominer ton imagination, celle-ci te déforme les faits, agrandis tout ce qui appartient au registre avantage, et amoindrit ce qui…
– Mais non –répliqua vivement la veuve -. Tu penses que mon imagination amoindrit ce qui est mauvais ?… Dis plutôt le contraire. Je vois toujours dans toute son extension ce qui me porte préjudice.
– Tu dois certainement croire que la part de ton héritage qui se trouve en mon pouvoir –dit don Francisco de Paula avec une certaine commisération- s’élève à un chiffre fabuleux. Outre que ton héritage était en soi assez inférieur à ce que nous aurions pu croire du vivant de notre cher père (qu’il repose en paix ), il faut tenir compte que ton mariage extravagant a servi plus à le diminuer qu’à l’augmenter.
– Nous laisserons cette question pour quand il sera plus opportun de la traiter-dit doña Catalina en se levant.
– Comme tu voudras. Mais ne te presse pas de remonter dans ton nid, et écoute encore les remarques que je veux te faire à propos de tes projets de vie monastique. Assieds-toi un peu plus longtemps, et ce ne serait pas mauvais que tu écoutes maintenant, plus que tu ne l’as fait les autres fois, les salutaires observations de ton frère, qui, à défaut de savoir autre chose, sait présenter les problèmes sous leur aspect sérieux. Je ne te reproche pas de te lancer avec ardeur dans la vie religieuse et sainte. Cela aussi, en dépit des apparences imaginatives, peut présenter un aspect pratique, essentiellement pratique. Si ta conscience, si ton cœur te poussent sur ce chemin, suis-le, car ton caractère et les habitudes acquises ne te permettront peut-être pas et le peut-être est de trop, d’aller vers un autre. J’approuve sur toute la ligne. Tout ce qui relève de la piété et de suprêmes intérêts spirituels, me trouvera toujours favorablement disposé. Mais limite-toi à un rôle purement passif, parce que tu n’es pas née ni pour prendre des initiatives ni pour agir, dans son sens le plus large. J’ai très peur de tes ambitions de fondatrice, et je vois que les faibles intérêts de ton héritage sont en danger. On pourrait t’en faire une dot honorable, et j’irais jusqu’à dire, une dot splendide. Mais si au lieu de te limiter à être une humble brebis, comme le réclament ton caractère faible, ton peu d’intelligence, tu veux jouer les bergères, tu n’as pas même de quoi te lancer. Ah ! Nous vivons dans une époque dans laquelle on ne peut aller à l’encontre des lois économiques, ma chère sœur ; et celui qui ne tiendra pas compte des lois économiques, échouera dans toutes les affaires qu’il entreprendra, même celles d’ordre spirituel. Ainsi, de même qu’on ne peut faire une omelette sans casser des œufs, on ne peut rien entreprendre sans capital. Aujourd’hui on ne crée pas d’Ordres ou de Congrégations avec la seule force de la foi ou d’exemples édifiants. Il faut que le fondateur ait une fortune à consacrer à Dieu, ou qu’il trouve des protecteurs riches et bons croyants. Tu ne les trouveras pas pour réaliser ton projet si tu penses chercher un appui dans la famille. Les proches parents, je peux te les citer un par un, ne sont pas en mesure de consacrer leurs maigres rentes à une affaire aussi risquée que le salut de leurs propres âmes et de celui des autres. De sorte que, si tu t’obstines à vouloir mener un projet trop ambitieux, tu n’arriveras à rien de bien et tu perdras en vaines tentatives le peu que tu possèdes. Notre époque admet les extases mystiques, mais toujours avec la raison devant ; elle admet la charité à un degré héroïque, mais avec un capital par derrière, un capital pour tout faire, même pour aplanir, les chemins du ciel à l’Humanité. Toi, tu ne possèdes ni ce capital encéphalique qui s’appelle la raison, ni cette raison suprême des actes collectifs qui s’appelle capital. Essaye quelque chose qui sorte du commun et tu verras comme aussitôt c’est une sottise. Sème ta pauvre initiative, et tu récolteras une moisson de tristes déboires.
– Tu as fini ? … Comme monsieur le sénateur explique bien les choses ! –dit Catalina avec humour-. Et si je te disais que tu ne m’as pas convaincue ? Tu me gronderas un petit peu plus. Et si quand tu me grondes, je me permettais l’audace de ne pas tenir compte de tes paroles ? Mais si tu ne connais ni mes idées ni mes plans, pourquoi les critiques-tu ? C’est un vrai malheur que tu sois aussi parlementaire, parce que tout prend avec toi une dimension de discussion d’une affaire grave, et un débat politique te sort par tous les pores. Et je ne discute pas, je ne critique pas, je ne parlemente pas. Ce que je pense faire, je le ferai si je peux, sinon, non. Es-tu en train de prendre tes précautions croyant que je vais te demander quelque chose qui ne m’appartienne pas ? Respire tranquillement, homme pratique, apôtre du dogme économique et des sacro-saintes doctrines du capital et de la rente, de ça et que sais-je encore ? Essaie de me nier qu’il y ait un capital plus efficace que celui qui se constitue avec la raison et l’argent.
– Voyons…, lequel ?
-La foi…. Ne ris pas…
– Mais je ne ris pas. Il ferait beau voir que je rie de la foi… ; non, ma chère sœur respectée…Je dois mettre aujourd’hui un point final à ces discussions. Je sais que je ne vais pas te convaincre. Et moi je dis : « Obstination, ton nom est Catalina de Halma… » J’espère qu’un autre aura plus de chance que moi.
– Qui ?
– Don Manuel … Notre cher ami va triompher de tes manies.
A ce momen la marquise, qui revenait de la messe, entra dans le bureau, et saisissant au vol les dernières paroles, elle intervint dans le débat, en répétant, comme un écho de son mari :
– Don Manuel, c’est don Manuel qui va la convaincre.
[1] Nom donné à l’actuelle communauté de Valence.
[2] L’espagnol garda longtemps le mot anglais avant de le remplacer définitivement dans les années 20 par le terme espagnol deporte. En revanche, le terme « fútbol », longtemps appelé « balonpié », et repris durant l’époque franquiste (comme au stade de Séville), ne s’imposa réellement que lorsque l’Espagne put présenter des équipes capables de battre les équipes étrangères, comme aux Jeux de la Paix à
Anvers, en 1920.


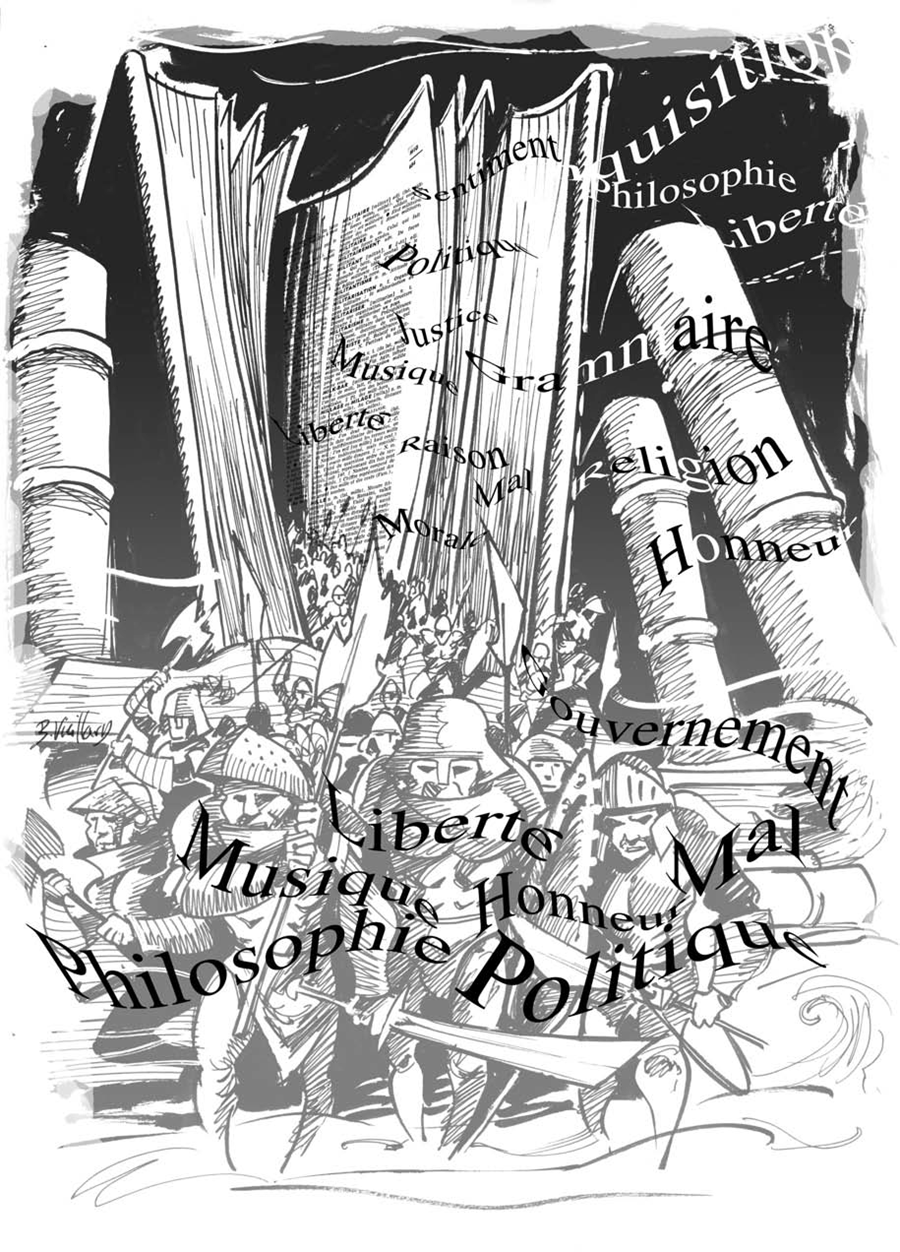













I consider something genuinely interesting about your web blog so I bookmarked.
Just what I was searching for, thankyou for putting up.
Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s truly informative. I am gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!