No hay productos en el carrito.
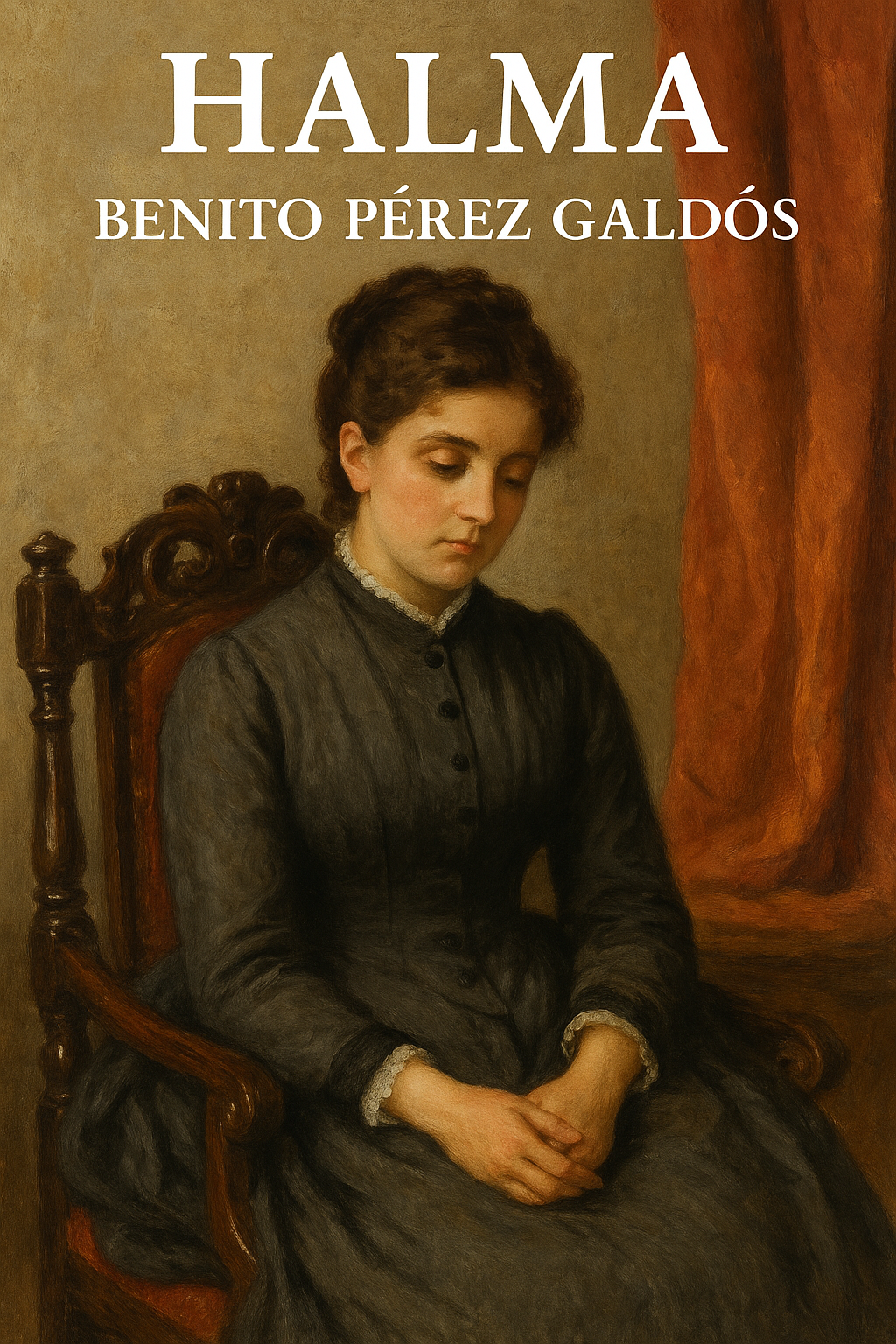
1
Si don Manuel Flórez avast commencé ses visites au mystique vagabond don Nazario Zaharín pour faire plaisir à sa maîtresse et souveraine, la comtesse de Halma-Lautenberg, bientôt il les refit pour son compte et sa satisfaction personnelle, parce que, il faut l’avouer, le mystérieux apôtre arabe de la Manche le ravissait, et plus il le voyait, plus il avait envie de le voir et de jouir de sa belle simplicité, de la sérénité de son esprit, exprimée par une parole aisée et concise. Et chaque fois le brave prêtre mondain en ressortait plus déconcerté, parce que la personnalité de cet ecclésiastique éprouvé grandissait à ses yeux, et à la fin, il le voyait avec une telle dimension qu’il ne parvenait pas formuler un jugement catégorique. « Je ne sais si c’est un saint ; mais pour ce qui est de la pureté de la conscience, personne ne l’égale. Assurément, moi je le déclarerais digne de la canonisation, si sa conduite, en se lançant à l’aventure sur les chemins, ne m’offrait pas un point noir, la rébellion contre son supérieur… De tout cela je déduis que chez cet homme existent confondues et amalgamées les deux natures, le saint et le fou, sans qu’il soit facile séparer l’une de l’autre, ni tracer une ligne de partage entre les deux. Cet homme est singulier, et au cours de ma longue vie, je n’ai vu aucun cas semblable, et qui même de loin puisse lui ressembler. J’ai connu des prêtres plus qu’exemplaires, des séculiers de grande vertu, et sans aller plus loin, moi-même, car je peux bien, pour moi, sans modestie, m’offrir comme exemple de prêtres irréprochables… Mais ni ceux que j’ai connu, ni moi-même, nous ne sortons de certaines limites… Pour quelle raison, Dieu Tout Puissant ? Est-ce parce que celui-ci œuvre en toute liberté, et que nous, nous vivons attachés par mille liens qui compriment nos idées et nos actions, sans les laisser sortir des dimensions établies ? Je ne sais, je ne sais… » Et avec ce je ne sais, je ne sais, Flórez exprimait le trouble et les doutes de son esprit.
Durant ces jours-là, l’agitation journalistique s’amplifia, parce qu’allait bientôt être jugé le procès dans lequel se trouvaient impliqués don Nazario et Andara, et les interrogations, qu’on appelle des interviews se multipliaient ; les reporters, ne laissaient en paix aucune des célébrités de ce procès tapageur, et en même temps qu’ils stimulaient par des récits piquants la curiosité du public, ils se dépensaient pour lui donner jour après jour une abondante pâture, en cherchant des incidents dans la vie privée des héros de ce drame ou de cette comédie. Flórez était en train de grimper l’escalier qui conduit aux étages supérieurs de l’hôpital, quand il entendit derrière lui des voix joyeuses, et deux jeunes gens qui d’un pas rapide montaient deux par deux les marches, le rattrapèrent avant qu’il n’arrive au troisième.
– Monsieur don Manuel, même si vous ne voulez pas… Comment allons-nous ?
– Pas aussi bien que vous ….-répondit le prêtre en s’arrêtant, plus pour reprendre son souflle que pour répondre au salut. Et après les avoir regardés fixement et les avoir reconnus, il ajouta avec sévérité- : Donc, messieurs les journalistes sont à nouveau ici ? Mais, voyons, n’avez-vous pas assez fatigué ce pauvre homme ? Franchement, cela me semble être le délire de la publicité.

– Que voulez-vous, don Manuel. Le fauve nous demande plus de chair, plus de nouvelles, et il n’y a pas d’autre moyen que de les lui donner –dit l’un des deux, pétulant et sympathique.
– Le filon est déjà épuisé –indiqua le second- ; mais comme il faut servir le public chaque jour, hier je lui ai fait une description exacte de ce que mange Nazarín, et une intéressante information sur les mauvais accouchements que sa mère avait eus.
– Mais, mes enfants –dit Flórez, avec plus de bonté que de colère- votre information va nous rendre tous fous. Vous avez dit un tas de choses malséantes, d’autres qui n’intéressent personne ? Je ne sais comment ces pauvres prisonniers supportent votre feu roulant de questions, et ne vous envoient pas promener cent fois par jour.
– Nous servons le public.
– Mais ne serait-il pas mieux de le servir en le dirigeant, plutôt que de vous laisser entraîner par ce public entiché de romanesque fantasque et malsain ? – Ah don Manuel ! Ce n’est pas nous, pauvres reporters, qui allumons le feu. On nous demande d’apporter tout le combustible que l’on peut trouver, du bois bien sec s’il y en a ; sinon, du bois vert, pour qu’il éclate, et même de la paille, si nous ne trouvons pas autre chose.
– Bon, monsieur, bon.
– Eh bien, hier, mon cher don Manuel –dit le pétulant en montrant un journal-, vous m’avez sorti d’un mauvais pas. Ne sachant qu’écrire, je suis allé avec vous. Voyez, voyez ce que je dis : « Le vénérable prêtre don Manuel Flórez, qui soutient avec l’accusé des controverses acharnées sur des points très subtils de théologie et de haute morale, lui rend visite tous les jours… »
– Jésus Marie !…. Quel mensonge ! Mais nous n’avons jamais parlé de théologie, ni… ! Et en plus, je vous ai déjà dit que vous ne deviez pas me nommer en aucune façon. Je viens ici pour accomplir mes devoirs de chrétiens de consoler celui qui est triste, et donner un bon conseil à celui qui en a besoin.
– Vous êtes un saint, don Manuel. Et puis, je vous fais drôlement de la réclame, là plus bas ! Regardez…
– Je n’ai pas besoin de votre réclame, et je vous serais reconnaissant d’enlever mon nom de cette symphonie d’information.
– Laissez-moi vous la lire. Je dis : « Ce prêtre vénérable et exemplaire , qui est le premier à accourir là où il y a des misères à secourir et de grands malheurs à adoucir avec l’ineffable consolation de la piété chrétienne ; cet homme si respectable, dont la modestie égale la vertu, dont l’activité au service des grands idéaux religieux… »
– Ça suffit, ça suffit… Je ne veux pas en entendre davantage.
Ils arrivèrent au couloir d’en haut qui fait le tour de la cour, et le pétulant s’avança en disant :
– Je crains qu’aujourd’hui l’apôtre n’ait beaucoup de gens et que nous ne puissions lui parler.
– Mais c’est un vrai scandale –dit don Manuel-. Ici arrive, pour satisfaire sa curiosité, un public à peine moins nombreux que celui qui va au théâtre et aux courses de chevaux. Le pauvre Nazarín, il le rendrait fou, s’il ne l’était déjà, et comme c’est un homme qui ne sait se refuser à personne, ni être mal élevé ni hautain, parce qu’il y a des cas où l’impolitesse et un peu de morgue ne sont pas superflues, il arrive que nous qui venons pour le consoler et remettre un peu d’ordre dans ses idées, nous ne pouvons réaliser notre mission.
Le prêtre et le deuxième journaliste s’approchèrent d’une fenêtre pour fumer une cigarette, tandis que le premier entrait dans la cellule de Nazarín. Flórez sortit ses petites pinces d’argent ; en effet il ne fumait pas sans cet accessoire, et l’autre, en lui donnant du feu, lui parla de cette manière :
– Dites-moi, monsieur de Flórez : vous, que pensez-vous du résultat ,du procès ? Croyez-vous que le Tribunal verra dans cet homme un criminel ?
– Mon fils, je ne sais. Je ne m’y connais pas en jurisprudence criminelle.
– Eh bien, hier, à l’Assemblée –continua l’autre avec gravité- don Antonio Cánovas del Castillo[1] m’a dit à moi… Mot pour mot : « Condamner Nazarín serait la plus grande des iniquités. »
– Je crois la même chose.
– Mais les avis sont partagés, bien que la majorité de l’opinion soit favorable à la non culpabilité de l’apôtre. Je vous le dis à vous en vrai. Moi, il m’a à moitié conquis. Un peu, plus, et j’iais à la Rédaction pieds nus, j’abandonnerais la pension de famille, et je passerais la nuit dans le creux d’un porche… Voilà, cet homme me séduit, il m’attire.
– Son humilité portée à l’extrême, sa résignation absolue face au malheur –affirma le prêtre, pensif, en regardant le sol et en enlevangt la cendre de son cigare avec le petit doigt-, sont, il faut le reconnaître, une force colossale pour le prosélytisme. Tous ceux qui souffrent doivent sentir une formidable attraction.
– Eh bien, il n’y a pas autant de gens que je le croyais –dit l’autre garçon de la Presse en revenant très pressé-. Il y a un acteur…, je ne me souviens pas de son nom…, qui veut étudier le type du Christ pour les représentations de la Passion et de la Mort, dans je ne sais quel théâtre. Il y a aussi les peintres Sorolla et Moreno Carbonero[2] et, qui veulent faire une étude de tête, et José Antonio de Urrea, qui prétend revenir à la photographie.
– Eh bien, il a de quoi faire, le pauvre Nazarín –dit Flórez, déçu-. Nous allons entrer un petit moment, et nous essayerons de vider la cellule. Et vous, messieurs, vous vous en allez bientôt ?
– Oh, oui ! Nous devons voir Ándara. Venez-vous avec nous, monsieur don Manuel ? Nous vous emmenons en voiture.
– Merci.
– Eh bien, Ándara est une femme délicieuse : plus laide qu’une nuit d’orage, mais avec un esprit de réplique, et une vivacité, et une énergie de caractère qui vous sidèrent.
– Et une foi en Nazarín qui vaut plus que tout. Si on la mettait sur des charbons ardents pour qu’elle renie son maître, elle mourrait grillée, en crachant du sang sur ses bourreaux, et en proclamant Nazarín, comme elle dit, le préféré de tous les saints de la Terre et du Ciel.
Deux autres personnes du même métier arrivèrent, et, saluant avec courtoisie le brave ecclésiastique, ils firent un petit cercle près d’une fenêtre de la galerie.
– Cela ressemble à l’antichambre d’un ministre –dit l’un de ceux qui venaient d’arriver, appelé Zárate, homme fort instruit, aux dires des gens, ce qui signifie qu’il lisait beaucoup.
– Ou d’un souverain de l’ancien régime. Ici, nous attendons que sorte l’équipe qui se trouve à l’intérieur.
– Mais il manque un chambellan pour mettre de l’ordre dans ces audiences.
– Eh bien aujourd’hui –dit Zárate, en repoussant vers l’arrière son chapeau- je ne m’en vais sans l’interroger sur les concomitances que je vois entre l’idéal nazariste…
– Et quoi ?
– Et le mysticisme russe.
– Voyons, par le Ciel !
– Je vois une étroite parenté, une filiation directe entre les florescences spiritualistes d’hier et d’aujourd’hui, et qui ne sont rien d’autre qu’une manifestation de plus de l’orgueil humain.
2

– Eh bien, hier- déclara le pétulant-, je l’ai interrogé sur ce problème du russisme. Il s’est montré surpris, et m’a dit que ses actes sont l’expression de ses idées, et que celles-ci lui viennent de Dieu, qu’il ne connaît la littérature russe que par ouï-dire et que, l’Humanité formant un tout, les sentiments humains ne sont pas délimités dans des secteurs géographiques, par des lignes que l’on appelle frontières. Il a affirmé ensuite que pour lui les idées de nationalité, de race, sont secondaires, comme l’est cet élargissement du sentiment casanier que nous appelons patriotisme. Tout cela, notre don Nazario le considère comme extravagant et conventionnel. Il ne regarde que ce qui est fondamental, et à cause de cela il finit par trouver tout naturel qu’en Orient et en Occident il y ait des âmes qui aient les mêmes sentiments, et des plumes qui écrivent des choses similaires.
-C’est bien ce que je dis – indiqua celui qui était entré avec Zárate-. Il s’agit d’un gars très malin, mais très malin… Vous ne m’ôterez pas cette idée que je me suis faite de lui le premier jour. Nous sommes ici en train de faire la cour au patriarche des fainéants, et de populariser le Messie du parasitisme… Oh ! Il faut reconnaître qu’il tient son rôle avec une parfaite maîtrise et qu’il a su porter jusqu’au sublime le personnage de l’aventurier menteur et vagabond. Je soutiens que ce type est la condensation la plus achevée de l’espagnolisme sous toutes ses formes…, sans nier que ce qui est très espagnol peut aussi être très russe…, comprenons-nous bien.
– Mais venez un peu ici, messieurs –dit don Manuel en attirant par son geste et ses paroles l’attention bienveillante et polie de tout le groupe-. Pardonnez-moi si j’interviens dans vos discussions. Que chacun pense ce qu’il voudra de ce pauvre Nazarín. Mais pourquoi, diable, chercher la filiation des idées de cet homme rien moins qu’en Russie. Vous avez dit que c’est un mystique. Pourquoi chercher si loin ce qui est né chez nous, ce que nous avons ici dans la terre et dans l’air et dans la langue ? Eh bien quoi, messieurs, l’abnégation, l’amour de la pauvreté, le mépris des biens matériels, la patience, le sacrifice, le désir de n’être rien, fruits naturels de notre terre, comme le démontrent l’histoire et la littérature, que vous devez connaître, ont-ils besoin d’être amenés de pays étrangers ? Une importation mystique, quand nous en avons assez pour en fournir aux cinq continents du monde ! Ne soyez pas inconséquents, et apprenez à connaître où vous vivez et à apprendre votre ascendance. C’est comme si nous les Castillans, nous allions chercher des pois chiches sur les rives du Don, et si les Andalous allaient demander des olives aux Chinois. Rappelez-vous que vous vivez dans le pays du mysticisme, que nous le respirons, que nous le mangeons, que nous le portons dans le dernier globule de notre sang et que nous sommes rigoureusement des mystiques, et que nous nous conduisons comme tels sans nous en rendre compte. N’allez pas si loin pour chercher la filiation de notre Nazarín, car vous l’avez clairement chez nous, dans la patrie de la sainteté et de la chevalerie, deux choses que se ressemblent tellement et qui sont peut-être la même chose, car mystique est l’homme politique, ne riez pas, qui se lance dans l’inconnu, rêvant de la perfection des lois ; mystique est le soldat, qui ne désire que se battre, et se bat sans manger ; mystique est le prêtre, qui sacrifie tout à son ministère spirituel ; mystique est le maître d’école qui, mort de faim, apprend à lire aux enfants ; sont mystiques et chevaleresques le laboureur, le marin, l’artisan, et même vous, puisque vous vagabondez dans les champs des idées, adorant une Dulcinée qui n’existe pas, ou cherchant un au-delà que vous ne trouvez pas parce que vous êtes tombés dans l’étrange aberration d’êtres mystiques sans être religieux.
Les braves garçons applaudirent le discours du vénérable don Manuel, et alors que l’un d’eux, avec le respect qui lui était dû, allait lui répondre, des nouveaux visiteurs arrivèrent, deux dames et deux messieurs de l’aristocratie, qui désiraient connaître Nazarín, et trois ou quatre personnes en plus, hommes de lettres ou politiciens, qui l’avaient déjà vu et qui désiraient le questionner à nouveau, parce qu’ils s’étaient embarqués dans une grande discussion très embrouillée pour savoir si c’était un coquin très malin ou un simplet un peu dérangé.
– Quoi, nous ne pouvons pas le voir ? –dit une des dames en sursautant.
– Il faudra attendre que sortent ceux qui se trouvent dedans…, la peinture, la photographie et les arts du dessins.
– Et quoi ? – demanda aux journalistes un de ceux de la corporation littéraire qui venait d’entrer-. Savez-vous s’il a lu le petit livre qui porte son nom et qui circule en ville ?
– Il l’a lu –répondit un de ceux qui étaient arrivés avec Flórez-, et il dit que, l’auteur, poussé par son désir de romancer les faits, le loue de trop, en exaltant excessivement des actes habituels qui n’appartiennent pas au registre de l’héroïsme, ni même à celui de la vertu extraordinaire.
– A moi, il m’a affirmé qu’il ne se reconnaît pas dans le héros humanitaire de Villamanta, que lui se considère comme un homme très commun et non comme un personnage de poème ou de roman.
– Et il dit que, lors de sa dispute avec les bandits dans la prison de Móstoles, il n’avait pas eu autant de peine à vaincre sa colère comme on le dit dans le livre ; qu’il l’avait vaincue toute de suite et sans trop d’effort.
– Eh bien, pour moi –déclara le monsieur aristocratique-, le livre est un tissu de mensonges. Toute la scène avec le monsieur de la Coreja, je la considère comme une invention de l’écrivain, parce don Pedro de Belmonte est mon cousin, je le connais bien et je sais qu’en aucun cas il n’aurait fait asseoir à sa table un mendiant en haillons. Cela ne passe pas. Que mon cousin ait pris un bâton et l’ait roué de coups, et qu’il l’ait laissé au milieu du chemin après avoir lâché les chiens, c’est très naturel, très vraisemblable. C’est dans son style; il est comme ça ; on ne peut rien attendre d’autre de sa folie furieuse. Mais l’accueillir chaleureusement, se mettre à parler avec lui du Pape et du Verbe divin, ça je ne le crois pas, ce n’est pas la vérité, c’est falsifier mon cousin Belmonte. Figurez-vous que la semaine dernière je suis allé à la Coreja, et peu après être entré chez lui, j’ai dû partir à toute vitesse pour chercher deux gendarmes.
A ce moment ils virent sortir Urrea de la cellule, suivi des peintres et de l’acteur.
– Tiens ! Voici le chambellan qui vient nous annoncer que son excellence nous attend.
Mais le chambellan amenait des ordres fort différents.
– Messieurs- leur dit-il-, j’ai le regret de vous communiquer que notre ami Nazarín vous supplie par mon intermédiaire de le laisser seul. Il se sent fatigué, et si je ne me trompe pas, il a pas mal de fièvre. Je lui ai pris le pouls. Il a besoin de repos, de tranquillité, de silence.
L’effet de ces mots fut désastreux. Les deux dames étaient inconsolables.
-Mais, ne pouvons-nous pas le voir, même un instant ?
– Il m’a supplié de le libérer aujourd’hui du vertige des visites.
– Et il fait bien de fermer sa porte –dit Flórez-. Je ne sais comment il supporte autant d’impertinence. Allons, messieurs !, ici nous sommes de trop.
– Doucement –dit Urrea-. L’ordre a une exception. Il a su que don Manuel était ici, et il a manifesté le désir de le voir. Passez ; mais tout seul.
– Hélas ! Nous…, nous pourrions passer aussi, lui parler un petit moment….- indiqua l’une des dames.
– Oh ! Non…, il veut sans doute se confesser. Allons.
– Quel ennui !… Nous reviendrons un autre jour. Moi, je veux le voir. Dites-moi messieurs les journalistes : comment est Nazarín ? Est-il certain que son visage a une telle expression qu’elle déconcerte quiconque le regarde ? Et comment est-il habillé ? Que dit-il ? Rit-il ou pleure-t-il ? Parle-t-il avec les autres qui lui rendent visite, les bénit-il ou ne fait-il que les regarder ?
Les bons garçons répondaient à ces questions, excitant la curiosité des nobles dames, au lieu de la calmer. Inconsolables d’avoir essuyé un fiasco, et ne pouvant noyer leurs yeux, assoiffés de cette grande nouveauté, dans la physionomie de l’apôtre errant, elles les fixaient sur la porte. Ah ! Il était derrière cette porte… Elles reviendraient le lendemain matin.
Don Manuel entra, et tous les autres défilèrent en descendant les escaliers. L’un d’entre eux proposa aux aristocrates de les emmener voir Ándara. Mais après avoir exprimé spontanément leur accord, l’une des deux réfléchit et dit :
– Impossible ! Êtes-vous fou ? Nous, entrer dans la Galera[3] ?
Ensuite, on suggéra l’idée de rendre visite à Beatriz, et cela ne sembla pas aux deux dames être une mauvaise idée. Oui, oui, elles pourraient voir, la mystique vagabonde et rêveuse. Le groupe se divisa dans la rue et les uns se dirigèrent vers la rue voisine de San Blas, et les autres vers la lointaine rue de Quiñones.
Ándara vint au parloir, et la première chose que lui demandèrent les garçons fut si elle avait lu le livre intitulé Nazarín.
– On me l’a lu –répondit la prisonnière-, parce que l’encre noire me brouille la vue. Ah ! les mensonges qu’il peut dire ! Moi si j’étais vous je mettrais sur le papier que le scribouillard de ce livre est un menteur, et vous lui feriez honte, pour qu’il s’en aille se faire voir ailleurs avec ses bobards. Parce que, ne dit-il pas que j’ai mis le feu à la maison ?
– Toi aussi, tu l’as dit au début ; mais maintenant, loin de ton maître Nazarín, qui ne te permet pas de mentir, tu as arrangé avec ton avocat, qui est un malin, cette explication d’un feu accidentel. Le fait reste, pour le moins, douteux et la peine sera relativement courte.
– Ça été de l’accidentel, allez !…Au diable les mômes de la Presse ! Moi, au début, je n’ai pas su ce que je disais. Le sacré pétrole s’est répandu… Je suis restée dans l’obscurité… J’ai craqué une allumette, et voilà que tout brûle… Vous ne le croyez pas ? C’est pourtant comme ça… Et qui me dit le contraire ? Qui me prouve que ce fut de ma volonté propre ? Si l’un d’entre vous est celui qui a écrit ce livre misérable qu’il finisse en misérable, sacrebleu.
– Sais-tu que tu recommences à être très mal élevée ?
– Depuis qu’elle n’est plus avec l’apôtre, elle est retournée à ses habitudes.
– Ándara, nous, nous sommes tes amis, et nous t’aimons beaucoup. Mais si tu dis de vilains mots, nous le dirons à don Nazario, et tu verras, tu verras.
– Non, ne le lui dites pas. C’est l’habitude d’avant, qui ressort… Mais un vilain mot, dit sans penser, n’est pas un péché. C’est que je m’énerve quand on me parle du maudit livre. Rendez-vous compte, que cet auteur mal foutu dit de moi que je ressemble à une perche habillée ! Je suis laide, je veux dire, jolie, je ne le suis plus maintenant comme je l’étais avant, même si c’est une mauvaise comparaison… ; mais je ne suis pas laide à faire peur aux gens. Lui, ça doit être un épouvantail, et dans ses écritures, il veut faire de moi une déxagération. Pas tant que ça, pas vrai ?
– Tu as raison, pas tant que ça, Andarilla. Autre chose : désires-tu beaucoup voir ton maître ?
– Ah !, ne m’en parlez pas ! Qu’est-ce que je ne donnerais pas pour le voir, entendre sa voix !… Croyez-moi, messieurs de la Presse, et vous pouvez le mettre dans votre journal, si vous en avez l’occasion. Pour le voir, je donnerais la santé que j’ai maintenant, et celle que j’aurai pendant longtemps encore. Je me résignerais à rester dans cette prison, ou dans un bagne toute ma vie si je savais que je devais le voir tous les jours, même si ce n’était qu’un quart d’heure.
– Cela s’appelle aimer, Ándara.
– Cela s’appelle aimer, et croire en lui, parce que Dieu n’a envoyé dans le monde personne d’autre qui lui ressemble…, je dis et je le soutiens, même si on me cloue sur une croix pour que je dise autre chose. Qu’on m’écorche vive pour que je dise que je ne l’aime pas et même en les aidant à m’arracher la peau, je dirai que c’est mon père, et mon maître, et mon tout.
– Bravo, vaillante Ándara !
– Beatriz nous a raconté qu’elle le voit en esprit, et que chaque fois qu’elle veut, elle le fait revivre dans son imagination.
– Elle, elle est très rêvasseuse. Moi, comme je suis plus bête que ma soeur Beatriz, bénie soit-elle, je ne le vois pas quand je veux, mais quand lui, veut bien se laisser voir.
– Tiens, tiens. Explique-nous cela.
– Ne soyez pas matériels et comprenez-le sans plus d’explications. La nuit, quand je me couche sur ma paillasse, au milieu d’une obscurité comme celle de l’âme de Caïn, si je me suis bien conduite dans la journée, si je n’ai pas eu de mauvais pensées, j’ouvre les yeux, et dans le plus noir du tout noir, je vois une clarté, et mon Nazarín qui y passe…, il ne fait que passer et me regarder sans rien dire… Mais d‘après les yeux qu’il me fait, je sais qu’il veut me parler. Parfois il me gronde un tout petit peu, d’autres, il me dit qu’il est content de moi.
– Eh bien, si tu le vois ce soir, il va te passer un bon savon.
– Pourquoi ?
– A cause de ce gros mensonge sur l’incendie qui a été d’accidentel.
-Eh, ce n’est pas un mensonge !… C’est le livre qui dit un mensonge, rapport à ce que j’aurais voulu enfumer la pièce… Bon, ça fait déjà une bonne conférence ! Filez au journal, là-bas vous aurez de quoi gribouiller.
– Avant nous devons te demander autre chose, que diable !
– Je ne réponds plus.
– Tu paries ? La Beatriz, elle vient te voir ?
– Deux fois par semaine. Hier elle m’a apporté un vêtement qu’une dame de la noblesse lui avait donné pour moi.
– Oh lala ! Ça c’est une nouvelle. Elle ne t’a pas dit le nom de cette dame ?
Et tous sortirent crayon et papier.
– Oui, mais je ne m’en souviens pas. C’était un nom très joli…, comme… Seigneur, comment était-ce ?
– Fais un effort, Andarilla. Ne serait-ce pas la comtesse de Halma ?
– Elle-même… Je me disais bien que c’est quelque chose de bien, oui, de la très sainte âme[4].
– Bien, Ándara…, nous te laissons maintenant, sacrebleu !
– Au revoir, au revoir.
3
C’est pour son malheur que don Manuel avait entrepris des séances d’exploration spirituelle avec l’apôtre errant, parce que chaque fois, il sortait de la cellule très troublé, croyant tantôt voir en Nazarín la plus grande perfection à laquelle peut parvenir une âme chrétienne, le croyant et le jugeant parfois comme un être fou, complètement hors de la société dans laquelle il vivait. « Ce n’est pas possible, Seigneur, ce n’est pas possible –se disait le brave vieillard, se frappant la tête de la main, une fois retiré chez lui et se reposant des besognes de la journée-. Chaque époque amène sa forme et son style de sainteté. Ne nous séparons pas, Seigneur, ne nous écartons pas de notre groupe planétaire, si nous ne voulons pas être un bolide errant, perdu dans les espaces. C’est ce que je dis : la folie n’est rien d’autre que cela, ou, plus précisément cela, le fait d’échapper par la tangente…, et cet homme, avec toutes ses qualités, qu’il faut reconnaître, a pris beaucoup d’élan, et il s’échappe, il se lance hors de l’orbite… Quel dommage, Seigneur, quel dommage ! Parce que… je le dis en toute vérité… On pourrait ddificilement trouver un esprit doté d’une plus grande rectitude, d’une plus grande pureté… Mais il a pris la doctrine dans son sens le plus rigoureux, sa partie la plus étroite, par là où ça fait mal, et … je ne sais pas, je ne sais pas… Lui, il croit que celui qui se trompe c’est moi, et moi, que c’est lui. Lui, il dit qu’il agit conformément à la raison et avec une pleine conscience de s’adapter parfaitement à la loi du Christ, et moi je dis… Non, Seigneur, je ne dis rien, je ne sais pas, j’ai perdu mes repères, cet homme m’a tourné la tête, me l’a remplie de confusion. Non, je ne le reverrai plus. La folie est contagieuse. Un fou en fait mille. Plus jamais, plus jamais. »
Et malgré tout, il revenait, car il lui restait toujours quelque petit point à élucider ou un coin caché à explorer dans la pensée du pèlerin. Il revenait et, à nouvel entretien, nouveau trouble et nouveaudésarroi du brave prêtre mondain. On va croire que ce qui est raconté ici est une exagération, mais c’est la pure vérité. Don Manuel en était arrivé à perdre l’appétit, chose d’une extraordinaire nouveauté chez lui ; il dormait mal et son visage se flétrit. Ses amis crurent qu’il avait baissé à l’approche des soixante-dix ans, et certains attribuèrent à une cause morale la perte de ce merveilleux aplomb qui était sa caractéristique. Peut-être sa bonté s’était-elle ressentie d’avoir trouvé une bonté supérieure, ou qui lui semblait telle, et comme il vivait dans la routine de ne frayer qu’avec des gens inférieurs, sur le plan de la conscience, la soudaine rencontre d’un être, devant lequel une des énergies de son âme devait faire la révérence, l’avait peut-être mis de mauvaise humeur, quoique, sans arriver jamais, aux tristesses de l’envie, car il était incapable de ressentir cet odieux sentiment.
Serait-ce que, peut-être, du fait que dans les relations sociales, la considération et même les louanges dont il était l’objet, en étaient arrivé à former dans son âme une carapace d’amour propre (à laquelle les caractères les plus maîtres d’eux-mêmes n’échappent pas) et que la connaissance et ses relations avec Nazarín avaient rabaissé un petit peu l’idée qu’il avait de sa propre valeur morale ? Indépendamment de l’humiliation et de mépris de soi-même qu’impose l’idée chrétienne, tout être conserve un pouvoir d’appréciation d’évaluation psychique, grâce auquel,sans s’en rendre compte, il s’estime lui-même et s’évalue. Sans doute, Flórez avait-il commencé à se rendre compte qu’il s’était évalué un peu plus que ce qu’il valait réellement. Comme il était droit et noble, il finissait par se résigner, en se disant : « Bien, Seigneur, bien. J’avais cru faire partie de ce qu’il y avait de mieux, et maintenant voilà que je trouve quelqu’un qui me bat sur toute la ligne. Eh bien reconnaissons, notre insignifiance ou notre infériorité manifeste, et louée soit la perfection où qu’elle soit. »
Le brave homme n’arrivait pas à penser à autre chose, et la fixité de cette idée sapait sa santé. Parfois il passait ses nuits en d’habiles distinguos et parallèles, désirant grandir l’opinion qu’il avait de lui-même, sans rabaisser excessivement celle d’autrui : « Il est bon, moi aussi . Nous ne dirons pas des saints, parce que la sainteté, à notre époque, où est-elle ? Moi, je suis sociable, lui individualiste, ma sphère, c’est le monde des riches, la sienne, celle des pauvres. Dans les deux sphères, on sert Dieu, et comment ! Lui fortifie son âme dans la solitude, moi, dans l’agitation ; travail pour travail, je ne sais lequel est le meilleur. Il est vrai que si nous considérons la doctrine pure et son application à nos actes, lui apparaît à son avantage, et moi, à mon désavantage ; mais regardons les résultats pratiques de l’une et l’autre forme d’exercer notre ministère, et alors, comment douter que la suprématie se trouve de mon côté ? Et, enfin, Seigneur, lui il se laisse emporter, lui il passe du possible à l’impossible, chez lui la vertu se permet de faire des escapades dans le domaine de l’extravagance, et … »
Levant les bras, et regardant le plafond de sa chambre à coucher, dans laquelle il se promenait pour faire passer son insomnie, il ajoutait : «Seigneur, Seigneur, mettre en pratique la doctrine dans toute sa rigueur et sa pureté, ce n’est pas possible, ce n’est pas possible. Pour cela, il faudrait détruire tout ce qui existe. Eh bien quoi, Jésus, ta Sainte Église ne vit-elle pas dans la civilisation ? Où allons-nous si… ? Non, non, il faut y réfléchir… Je dis que c’est impossible… Seigneur, n’est-ce pas que c’est impossible ? »
Comme les jours et les jours passaient, sans que Catalina ne l’interroge, sur l’examen ou l’étude psychologique de l’apôtre vagabond, don Manuel se crut tenu de prendre l’initiative dans cette affaire, car il valait mieux qu’il donne son opinion avant que la dame n’arrive à s’en faire une par elle-même ou par d’autres voies. Il craignait tout de son subtil esprit, affiné par une volonté constante.
– Et alors ? –lui demanda Halma, en manifestant moins de curiosité que Flórez ne s’attendait.
– Je commence par déclarer –dit don Manuel avec une sincère solennité, la main sur le cœur- que je ne connais pas âme plus belle que celle du malheureux prêtre, que la loi poursuit pour vagabondage et parce qu’il a donné aide et protection à une femme criminelle. Si j’ai encore des doutes sur l’état de son intelligence, de sa conscience, de son intention purement et droitement chrétienne, je n’ai aucun doute. Je veux dire, ma chère madame, que je trouve une inadéquation irréductible entre la conscience et l’intellectus de cet homme singulier, et que si je trouvais une manière de concilier l’une avec l’autre, il me faudrait déclarer que Nazarín est l’être le plus parfait qui ait jamais pu être fait dans le moule humain.
– D’après cela, vous continuez à voir en lui les deux natures, le saint et le fou, et vous ne savez pas les séparer, ni les fondre, parce que folie et sainteté ne peuvent être la même chose.
– Exactement.
– On pourrait bien déduire de tout cela que, dans notre si imparfaite compréhension des choses de l’âme, nous ne savons pas ce qu’est la folie, nous ne savons pas ce qu’est la sainteté.
– Je ne sais pas, je ne sais pas ! –s’exclama l’aumônier extraordinairement troublé, en portant les mains à sa tête.
– Calmez-vous, don Manuel. Serait-ce que vous, dans votre longue vie, vous ne vous êtes jamais trouvé devant un problème similaire ? Répondez-moi maintenant : le bon Nazarín pratique-t-il la doctrine du Christ telle que les très saints Évangiles nous l’enseignent ?
– Oui, madame.
– Et malgré cela, la conduite de notre brave homme nous paraît dérangeante…, parce que nos idées nous l’imposent. Si nous croyions autre chose, nous devrions l’imiter, renoncer à tout, en embrassant l’état d’absolue pauvreté.
– Oui, madame.
– Et cela est impossible. Il y a quelque chose à l’intérieur de nous-mêmes, et dans l’atmosphère que nous respirons et dans le monde qui nous entoure, qui nous dit que ce n’est pas possible.
– Si…, c’est possible… ; mais c’est impossible… Être, ne pas être… C’est là, madame, le grand doute.
– Je continue mes questions : Nazarín est-il humble ?
– Très humble. C’est étonnant de voir sa tranquillité devant le résultat probable du procès. S’ils le condamnent au bagne, il l’accepte content, de même que si on l’envoyait à l’échafaud. Si on l’enferme dans une maison de fous, il entrera dans la maison de fous et vivra sans protester. Il ne se plaint pas de la loi, ni des juges, ni de ses accusateurs, ni de l’opinion qui le jugent avec des critères si divers.
– Et au cas où il sortirait libre, se soumettrait-il à son supérieur ecclésiastique, sacrifiant son indépendance à la rigueur de la discipline ?
– Aussi. Parce que c’est cela qui est admirable. Il dit que si on l’absout librement, il se soumettra et que …
– Et quoi de plus ?… Je vais continuer, car, mon cher monsieur don Manuel, vous n’avez pas aujourd’hui la parole aussi facile que d’habitude. Notre bon Nazarín dit aussi que lorsqu’il sera libre, il maintiendra le voeu de pauvreté qu’il a fait au Seigneur.
– Chose impossible, presque aussi absolument, car la mendicité, en dehors des Ordres qui la pratiquent pour leur Institution, est contraire à la dignité ecclésiastique.
– Et il dit plus encore…
– Mais comment savez-vous…,
– Il dit aussi que le plus grand désir de son cœur c’est qu’on lui rende les licences pour qu’il puisse célébrer la messe…, et qu’il ira vivre au bagne où sera envoyé le Sacrilego[5], si les lois pénitentiaires le permettent, ou sinon, dans la même ville, pour pouvoir le voir tous les jours. Il s’est engagé à conduire au Ciel l’âme de ce criminel, et il l’y conduira. Il a les mêmes desseins en ce qui concerne Ándara, et sa plus grande joie serait que les prisons auxquelles les deux délinquants seraient destinés, se trouvent dans la même ville. Sinon, il partagerait son temps entre le voisinage d’Ándara et la proximité du Sacrílego , emmenant avec lui Beatriz, sans crainte d’être blâmé et raillé à cause de la compagnie d’une femme.
– Telles sont ses idées, oui, madame… Ceci est aussi vrai que le fait que vous êtes un peu devineresse –dit don Manuel sans dissimuler son étonnement-. Mais vous…, peut-être l’avez-vous vu, l’avez-vous entendu… ?
– Non ; mais je vois Beatriz, dont je suis l’amie, et amie de cœur. Je n’ai pas voulu vous le dire jusqu’à ce que se présente une occasion favorable.
– Ah ! Cela me semble bien… Beatriz, la disciple…
– Eh bien, monsieur don Manuel de mon cœur, ces idées et ces desseins de don Nazario abâtardissent un peu cette pureté de l’âme dont vous me parliez tout à l’heure. L’extrême humilité, ne va-t-elle pas de pair avec l’orgueil ?
– Peut-être, peut-être.
– C’est pourquoi, moi, plus décidée que vous, sans doute parce que je suis plus ignorante, je vois clairement la folie de ce saint homme… Est-ce un fou saint ou un saint fou ?
– Folie…, sainteté… – murmurait Flórez en regardant le sol, soutenant sa tête des deux mains, les coudes appuyés sur les genoux avec tous les signes sur son visage et dans la voix d’un trouble profond.
4
Ils ne purent s’attarder, comme ils le désiraient, pour chercher l’explication de ce contresens, parce que Urrea entra avec des nouvelles fraîches, qui faisaient revivre l’intérêt pour l’affaire nazariste. D’après ce que raconta le jeune homme amendé, on connaissait déjà par les journalistes la sentence du Tribunal, que l’on publierait sous peu. La Cour ne trouvait pas chez don Nazario Zaharín de culpabilité : l’errance, l’abandon de ses devoirs sacerdotaux, la suggestion exercée sur les mendiants et les criminels n’étaient que le résultat du lamentable état mental du prêtre, et comme dans aucun de ses actes on ne voyait d’instigation au délit, mais au contraire, que ses délires tendaient à une fin noble et chrétienne, on l’acquittait sans réserve. Comme du rapport des médecins qui l’avaient examiné plusieurs fois, il ressortait que les actes de l’apôtre errant étaient inconscients, parce qu’il souffrait d’une mélancolie religieuse, forme de névrose épileptique, on le remettait aux autorités ecclésiastiques pour qu’elles s’occupent de le soigner et de le garder dans un Asile religieux, ou bien là où elles voudraient.
Don Manuel et Catalina gardèrent un profond silence en entendant cette partie très intéressante de la sentence.
– Beatriz est acquittée –continua Urrea- parce que rien n’est retenu à son encontre, et on estime que la peine, qu’elle méritait pour vagabondage, a été accomplie avec les deux semaines qu’elle avait subies de prison correctionnelle.
Ándara s’en sortait plus mal, quoique moins mal que ce qu’on avait cru au début. D’après ses premières déclarations, et celles de Nazarín, c’était elle l’auteur de l’incendie de la maison numéro 3 de la rue de las Amazonas. Mais son avocat, homme très avisé, avait mené l’affaire avec une rare habileté, démontrant que ce que Nazarín avait déposé n’avait aucune valeur de témoignage, puisqu’il se trouvait en plein délire piétiste, en proie à la monomanie du sacrifice et de la mort. Ándara, dans ses premières déclarations, avait obéi, d’après son avocat, à l’influence hypnotique du faux apôtre. Élargissant le jugement et soutenant la non intentionnalité de l’incendie, la Cour avait admis la preuve, condamnant la Tiñosa pour coups et blessures, à quatorze mois de réclusion pénitentiaire. Le procès du Sacrilego n’avait rien à voir avec le vagabondage et les abus nazaristes. Le jugement n’avait pas encore été rendu, et même s’il s’en sortait, il n’échapperait pas à une peine de quatorze ou quinze ans de bagne, parce qu’il avait fait montre de beaucoup d’audace exécrable en emportant tout l’argent et les vases sacrés de l’église.
– Vous voyez bien –dit à la fin Catalina à son ami et aumônier- comme la Cour, faisant sienne l’opinion des médecins, tient pour certain que le saint homme n’a pas toute sa tête.
– Et sans tête il n’y a pas de conscience –indiqua le prêtre avec une certaine joie, comme s’il entrevoyait une solution à ses doutes.
– Malgré tout –ajouta la comtesse-, nous ne devons pas accepter ce jugement comme définitif. Les Cours se trompent, les médecins se trompent. N’affirmons rien, et continuons, mon cher monsieur don Manuel, à douter.
– Continuons, oui, à douter –répéta le prêtre, pour qui c’était déjà un peu de repos que ne plus penser par lui-même.
– Et douter va être le point de départ pour résoudre le problème, parce que si nous ne doutions pas, nous ne nous proposerions pas, comme nous le faisons, d’arriver à la vérité.
– Oui, madame –dit Flórez, en parlant comme une machine.
– La sentence de la Cour, que j’attendais, m’ouvre un chemin pour mettre en oeuvre une idée qui me tourne dans la tête depuis plusieurs jours.
– Une idée ! Voyons… -murmura don Manuel perplexe, admirant d’avance et craignant en même temps les initiatives de son illustre amie.
– Moi, je veux dire, nous, saurons, à la fin, si notre pauvre pèlerin est un saint, ou un dément. J’espère que nous pourrons trouver chez lui l’un des deux états, à l’exclusion de l’autre. Et au cas où existeraient conjointement folie et sainteté, dans ce cas…
– Nous arracherons la folie pour la jeter au feu, comme la mauvaise herbe qui a poussé au milieu du blé –dit don Manuel-, tout en conservant la sainteté pure et intacte.
– Et si toutes les deux existaient ensemble et mêlées en une même plante –ajouta Halma-, nous respecterions ce phénomène incompréhensible, et nous serions tristes et inconsolables, mais avec la conscience tranquille.
Flórez regardait le sol, et Urrea ne quittait pas des yeux sa cousine, dont il lisait les mots sur les lèvres, en même temps qu’il les entendait. Après une courte pause, et voulant devancer la pensée de la dame, le prêtre dit :
– Eh bien, pour arriver à cette connaissance et à les séparer l’une de l’autre, madame, nous devrions…, je veux dire, nous essayerions…
– Non, vous aurez beau raisonner, vous ne pouvez deviner ce que j’ai pensé, ce que nous ferons, si Dieu m’aide, et je crois qu’il m’aidera, car la sentence que nous venons de connaître vient, à point nommé, pour favoriser mon idée, une grande oeuvre, don Manuel, un projet de charité qui méritera votre approbation. Vous allez voir –ajouta-t-elle après une autre petite pause, en rapprochant sa chaise basse du fauteuil de l’aumônier-. Eh bien, monsieur, maintenant la loi civile dit à la loi ecclésiastique : Moi, m’appuyant sur l’opinion de la science, j’ai dû déclarer et je déclare que cet homme est fou. Comme sa folie est inoffensive, simplement une monomanie piétiste, qui n’exige ni surveillance ni vigilance très stricte, je renonce à l’héberger dans mes maisons de fous, où j’ai des fous furieux, des lunatiques, mille cas des innombrables sortes de désordre mental. Voilà cet homme, charge toi toi-même, Église, d’en prendre soin, et, si tu peux, de faire retrouver l’équilibre à son esprit. Il est pacifique, il est bon, il est doux dans ses délires. Il ne te sera pas difficile de reconstituer en lui l’homme à la conduite exemplaire, le prêtre soumis et obéissant…
– Et nous le prenons –dit Flórez- et nous l’envoyons dans un couvent de Capucins ou dans l’une de ces pensions religieuses qui existent pour ces cas-là, et nous le gardons là durant un an, deux, trois, et au bout, il sera dans le même état que lorsqu’il y est entré.
– Vous voulez dire qu’ils ne le soigneront pas, qu’ils ne le mettront pas en observation, veillant sur sa vie et sa raison avec l’intérêt paternel que l’on doit à une âme comme la sienne, bonne pieuse, à une âme de Dieu…
– Je ne dis pas que…
– Mais rien de tout cela n’arrivera –affirma la comtesse, en se levant nerveusement, et, prenant la canne d’Urrea pour renforcer le geste décidé avec lequel elle accentuait les mots.
– Eh bien, qu’est-ce qui se fera, madame ?
– C’est à vous, mon cher monsieur don Manuel, que reviendra dans notre monde la gloire de cette épreuve, si, comme je le crois, Dieu la couronne pleinement de succès.
– Et que dois-je faire, chère Madame ? –demanda le curé un peu ennuyé, parce que cela ne lui plaisait pas du tout de faire des choses dont il n’avait aucune idée, ni de voir que son autorité en était réduite à exécuter des ordres qui venaient d’en haut, comme un vulgaire secrétaire.
– Une chose très simple et qui me paraît facile. Demain même…, il ne faut pas perdre un seul jour…, demain même, don Manuel Flórez y del Campo, le prêtre très exemplaire, le grand diplomate de la charité, prend son chapeau et va voir monsieur l’évêque. Son Ilustrissime, naturellement, vous reçoit les bras ouverts ; et vous lui dites : « Monsieur l’évêque, une dame de notre aristocratie… »
– Ah ! Oui… Une dame de notre aristocratie….
– Vous le devinez, vous le savez, je n’ai à dire de plus ! Eh bien, quoi, n’avez-vous pas pensé la même chose que moi ? Ne remuez-vous pas dans votre esprit depuis plusieurs jours cette solution ? N’attendiez-vous pas de savoir la sentence pour me la proposer ?
– Oui, oui, Je pensais… en effet… L’idée est bonne –dit l’aumônier, en voulant attraper au vol celles de sa noble amie-. Bien sûr que j’y avais pensé. Eh bien…. « Mfonseigneur : Une dame de notre aristocratie, personne aux grandes vertus et très bonne chrétienne, qui veut consacrer sa vie au saint exercice de la charité, a imaginé que… »
Don Manuel s’arrêta brusquement, hésitant, fixa son regard sur Halma, ensuite sur Urrea, pour regarder à nouveau avec une fixité pénétrante l’illustre dame, et à ce moment, comme s’il avait reçu une inspiration du Ciel, ou qu’un génie invisible lui avait sussurré à l’oreille, il vit la pensée de la comtesse en toute clarté. Et se souvenant immédiatement des mots et des phrases éparses de conversations antérieures, le prêtre fin n’eut pas besoin de plus pour retrouver tout son aplomb moral et se sentir maître de lui, et sur le point de l’être aussi de la situation. Il se racla la gorge pour s’éclaircir la voix, prit des mains d’Halma le bâton d’Urrea et martela sur le tapis ces mots ou d’autres semblables :
– Madame la comtesse a eu une grande et belle idée, comme venant d’elle. Il y a longtemps déjà qu’elle a conçu le projet de destiner sa maison de Pedralba à une fin caritative, en s’y établissant à la tête d’une petite société de déshérités et de nécessiteux, de pauvres malades et de vieillards sans ressources. Bon, Seigneur, Bon. Eh bien maintenant, madame la Comtesse, par mon entremise, s’adresse à monsieur l’évêque, et lui dit : « Ce pauvre prêtre poursuivi, absous et accusé de folie, je l’emmène à Pedralba, là-bas, je vais le soigner, là-bas je vais l’entourer de calme, d’un bien-être modeste ; je vais donner à son esprit la solitude des champs, et à son corps fatigué du repos, et comme lui est bon et simple, et que son cœur a gardé toute sa pureté, je réponds qu’en peu de temps je pourrai le rendre à l’Église libre des brumes qui avaient embué son esprit. Remettez-moi le vagabond et je vous rendrai le prêtre ; donnez-moi le malade et je vous rendrai le saint. »
– Et cela est-il possible ? –demanda vivement la veuve, sans s’étonner de voir comme le sagace Flórez avait bien su deviner ses intentions-. Je veux dire : est-ce que Monseigneur l’évêque acceptera… ?
– Ah !… Nous verrons bien. Votre nom, madame, fera beaucoup.
– Et encore plus votre intervention.
– Dans un cas comme celui de Nazarín, le Prélat adoptera l’une des deux procédures : ou remettre au malade un bon perpétuel pour l’asile des Ecclésiastiques, ou le mettre sous la sauvegarde d’une famille respectable à la moralité et la piété reconnue. Ceci s’est pratiqué il y a peu de temps avec un pauvre prêtre qui souffrait d’attaques d’aliénation.
– Eh bien, la famille respectable à laquelle on confiera la garde et le soin de ce saint homme, ce sera moi.
– Sans doute. Et mieux encore si on constitue l’Asile ou le Foyer sous forme légale et canonique, en le mettant, comme il est naturel, sous la tutelle du diocèse.
-Enfin –dit Halma toute joyeuse- Nazarín est à nous. Et Monseigneur l’évêque, je le vois d’ici, louera beaucoup ce plan en sachant que cette idée vient de vous.
– De moi, non –répliqua Flórez, sans regarder la dame-. Oui peut-être, en partie… Nous pensons tous les deux la même chose. Mais je n’arrivais pas à dire sur ce sujet le premier mot, et j’ai dû attendre que le dise la personne qui devait le dire.
– Donc, demain même….
– Demain même, oui, madame.
– Que personne ne nous prenne de vitesse….
– Ah ! Quant à cela… Ne vous en faites pas.
Don Manuel se retira chez lui, et cette nuit-là, il fut saisi d’une lugubre angoisse, dont le brave prêtre n’arrivait pas à expliquer le fondement. « Cette tristesse profonde et qui, semble-t-il, détruit tout mon être –se disait-il sans pouvoir trouver le sommeil- ne provient pas d’une cause purement morale. Il doit y avoir un trouble grave dans la machine. Ou c’est le foie qui s’en va en lambeau, ou la tête qui se révolte, ou le cœur qui se fatigue et qui me présente sa démission. »
5
Tout ce fit comme Catalina de Artal le désirait, sans que les démarches du brave Flórez se heurtent à une difficulté quelconque ou à des obstacles d’importance. Tous ceux qui, à cette occasion l’avaient vu, aussi bien dans les officines ecclésiastiques que dans les maisons nobles qu’il visitait habituellement, remarquèrent un important déclin physique, lequel semblait encore plus grave par la perte de la jovialité. En outre, on notait clairement un certain manque d’assurance dans les idées et une dispersion de celles-ci quand il voulait les exprimer, disons, comme s’il perdait la boule, selon l’expression populaire. Ce n’était, plus le même homme ; en quelques jours, lui qui avait tellement d’allure, s’était voûté ; son visage était devenu terreux, ses mains tremblaient, et quand il voulait sourire, son expression, habituellement aimable, devenait funèbre.
– Ou don Manuel est très malade –disaient ses amis-, ou un profond chagrin le mine silencieusement.
Un matin, le marquis de Feramor l’appela alors qu’il descendait de chez la comtesse, et s’enfermant avec lui dans son bureau, il prit son visage des grands jours pour lui dire :
– C’est incroyable que notre cher Flórez, démentant la gravité de son caractère, ait consenti à favoriser les incroyables extravagances de ma sœur ! D’abord, la sottise de jouer les rédempteurs de José Antonio, se ridiculisant et donnant lieu à un débordement de médisances et de grosses plaisanteries. Ce n’était pas suffisant, et ma sœur et son aumônier inventent cette grotesque comédie d’emmener à Pedralba toute l’équipe nazariste…, parce que je suppose que les disciples iront elles aussi, pour comble d’édification… Le chœur des risées a déjà commencé, moi, cela ne me fait rien, non, monsieur, parce que tout le monde sait que je permets à ma sœur de se lancer à ses risques et périls dans ces folles aventures, pour qu’elle puisse trouver dans la ruine et les ricanements des gens le châtiment de son orgueil.
L’attitude et le langage de monsieur le marquis était pompeux, suivant le rite anglais du parlement et de l’économie.
– Ce qui m’ennuie –ajouta-t-il- c’est que notre bon ami, au lieu de mettre un frein à ce que je qualifie gentiment en les appelant des extravagances, l’ait encouragé et appuyé de son autorité…
En entendant cela, une vague de sang monta du cœur au cerveau du prêtre, et la colère, qui était de par son caractère et ses habitudes, un sentiment presque inconnu, s’alluma soudainement dans son cœur. Au moment de l’exprimer, les mots se bousculèrent dans sa bouche, son visage devint tout rouge, ses yeux s’allumèrent. Avec une parole maladroite, il put seulement dire :
– Toi qu’est-ce que t’en sais ? … Tu es un niais !
Et il sortit, comme s’il se fuyait lui-même, en traînant son manteau, le chapeau poussé à l’arrière de la tête, en murmurant des phrases incohérentes en descendant l’escalier. Il marchait dans la rue en se cognant contre tout, se soutenant par un effort démesuré de la volonté, et en arrivant chez lui, sa force s’étant soudainement épuisée, il tomba raide sur le pas de la porte. Le concierge aidé des voisins qui descendaient, le relevèrent du sol et, tel un corps mort ils le conduisirent au quatrième à droite où il vivait. Sa gouvernante et sa nièce, deux femmes fort simples, toutes deux assez âgées, qui l’aimaient profondément, éclatèrent bruyamment en pleurs en le voyant entrer en un si misérable état, et la nièce s’exclamait ;
– Sainte Vierge de Valvanera ! Je l’avais bien dit ! Mon oncle ne se sentait pas bien depuis la semaine passée.
Elles le couchèrent, et il mit environ une demi heure à reprendre connaissance ; mais pas la parole. Le brave homme voulait dire quelque chose, et sa langue inerte ne lui obéissait pas. Le médecin arriva, on lui appliqua les soins élémentaires, et fort tard dans la nuit, après quelques heures de repos, il put s’exprimer avec quelque clarté :
– Ne soyez pas sottes –dit-il à sa gouvernante et à sa nièce qui, chacune d’un côté du lit, le regardaient consternées-, et ne prenez pas maintenant la manie de vous effrayer…. Ce n’est qu’un courant d’air. Il m’a saisi en sortant de chez les Feramor. Je me trouve maintenant beaucoup mieux, et avec l’aide du Dieu de miséricorde et de la très Sainte Vierge, demain je pourrai aller dehors. Au cas où ils auraient décidé que je suis de trop dans ce monde inique, que pouvons-nous faire d’autre que nous résigner tous : moi, d’aller là où mon Père céleste me destine, selon mes mérites ou mes fautes ; vous, avec le fait que je m’en aille et vous laisse tranquilles ?
Le docteur ordonna ne pas lui parler et de le laisser se reposer toute la nuit, prescrivant quelques médications internes et externes. Le lendemain matin, l’amélioration était évidente, et dès le matin très tôt, une multitude de personnes se pressa chez lui. L’une des premières fut Urrea ; peu après arrivèrent Consuelo Feramor et madame de Monterones, et bien d’autres dames et messieurs de différentes classes. Tous prodiguèrent au malade d’affectueuses consolations, lui présentant tous leurs vœux de rétablissement. Ils entraient dans la chambre à coucher par bandes, et ensuite, se réunissant dans le salon, déploraient le soudain accident du sympathique prêtre.
Consuelo prit José Antonio à part pour lui dire :
– Je crois que toi et Catalina vous n’êtes pas pour peu dans ce malaise de notre ami. Ah ! Sa maladie vient du moral … Quoi…, tu fais semblant de ne pas comprendre? Ne comprends-tu pas ta part de responsabilité et celle de ma petite belle-sœur, cette folle qui ne serait pas en liberté si elle ne portait pas le nom qu’elle porte ? Te rends-tu compte maintenant que vous avez discrédité ce saint homme, et que vous l’avez ridiculisé aux yeux du clergé, de tous ses amis et de ses relations ?
Urrea avait pensé lui répondre énergiquement ; mais il préféra se taire pour ne pas troubler une maison qui n’était pas la sienne. Peu de temps après, entra Catalina de Halma, vêtue de noir, humble et l’allure sévère, et sa sœur et sa belle-sœur la saluèrent avec une froideur pleine de compassion. Elle ne leur prêtait aucune attention et ne se souciait pas de les entendre exprimer un sentiment ou un autre à son égard. Alors que tout le monde se retirait, la comtesse manifesta à la gouvernante et à la nièce son désir de les aider nuit et jour dans ce pénible travail d’infirmières. Connaissant la sincérité de la bonne dame, le famille du prêtre accepta une offre aussi généreuse, se félicitant de ce que bientôt cela serait inutile, parce que don Manuel guérirait avec l’aide de Dieu. Catalina passa le voir, et lui, se réjouissant de sa présence, s’excita un peu, et présenta quelques vagues symptômes dr gêne pour parler et d’imprécision dans les idées.
– Madame –lui dit-il-, votre aumônier est bien mal. Cela a été un courant d’air,… J’ai rêvé de la Retraite de Pedralba, où nous serions si bien…, oh ! si bien ! L’air d’ici, est très mauvais… La vie sociale…, le vertige social, cette agitation, ce mensonge continuel…, un mauvais air, madame… La destruction des corps, préjudice des âmes ! … Dieu veut m’emmener maintenant. Il a vu que je ne sers à rien…, que je suis arrivé à la vieillesse, sans avoir rien fait de grand, ni de beau, ni de bon pour les âmes. Ma conscience me parle et me dit : » Il n’y a en toi et autour de toi que vanité de vanités. » Vous êtes grande, madame la comtesse ; moi, je suis petit, si petit, que je me regarde et je ne me vois pas plus grand qu’un grain de sable. Un courant d’air m’amène, un autre m’emmène…. Ah ! la solitude de Pedralba… !. Mais non, je ne suis pas digne… Monsieur le marquis me regarde du haut de sa sottise, et m’humilie tout comme je le mérite. Qu’ai-je été ? Un fantoche… Il ne faut pas se renier. Qu’ai-je fait pour sauver des âmes ? Rien… Et vous, qui êtes sainte, vous daignez venir me consoler dans ma peine !… Quelle bonté, quelle grandeur d’âme ! Parce que personne mieux que vous ne connaît mon insignifiance… Dieu me dit : « Tu n’es rien…, tu es le tout venant chrétien, ce qui est et n’existe pas… Tu es bien habillé et tu as de jolies chaussures avec des boucles d’argent… Et alors ? Tu es prévenant quand tu parles, prévenant avec tout le monde ; respectueux à mon égard ; mais sans amour. Le feu de l’amour divin est en toi un feu en peinture, avec des flammes ocre rouges comme celles des tableaux de l’Enfer. Tu distribues des aumônes comme l’Administration des Postes distribue des lettres… ; mais ton coeur…, ah ! Moi, qui vois tout, je l’ai vu, je l’ai senti palpiter, plus que pour la misère humaine, pour l’élégance de tes boucles d’argent… » Ensuite vient un courant d’air…. Elle doit être belle la mort pour ceux qui meurent dans le Seigneur ! Moi aussi je veux mourir en Lui, je le veux, je le veux !…
La comtesse, profondément alarmée, se retira de la chambre à coucher, pensant que l’amélioration de ce cher don Manuel avait été trompeuse. Et Ferme dans sa résolution d’assumer dans la maison les travaux les plus humbles, durant la maladie de son très cher ami, elle convint avec la gouvernante et la nièce des taches auxquelles elle devait se consacrer, et toutes trois décidèrent que, puisque la présence de la dame excitait le malade, sans doute en raison de l’affection que ce dernier avait pour elle, il ne fallait pas qu’elle entre dans la chambre à coucher sauf en cas d’absolue nécessité. Ayant ôté sa mantille, elle travaillait aussi bien dans la cuisine que dans le salon où elle se présentait pour recevoir les visites de laïcs ou de prêtres. Elle mangea avec les femmes de la maison et ne voulut pas qu’on lui prépare un lit, car il lui suffisait de faire un somme assise sur une chaise. La maladie de son époux bien-aimé l’avait parfaitement éduqué à ces difficultés et ces alarmes, et le fait de ne pas dormir, de ne pas manger, de veiller constamment ne l’affectait pas le moins du monde.
Don Manuel passa fort bien l’après-midi, et le soir, il appela ses domestiques pour qu’elles l’accompagnent et bavardent avec lui, car l’habitude, deuxième nature, réclamait de la fréquentation sociale, de la conversation, du divertissement. Catalina se cacha derrière la porte pour l’entendre, craignant qu’il ne recommence à délirer. Constantina et Asunción, car c’est ainsi que s’appelaient la gouvernante et la nièce, lui dirent qu’on pouvait le considérer comme rétabli de ce malaise, et qu’il n’aurait besoin que de quelques jours de repos pour pouvoir se livrer à ses occupations habituelles. Ce à quoi le prêtre leur avait répondit avec sérénité :
– Il est possible que vous ayez raison, mais au cas où, je me prépare au pire, et tout bien considéré, je vais dire dans le meilleur des cas, c’est-à-dire, à la mort, fin de cette vie misérable et début de la vie éternelle.
Et comme elles lui avaient dit que, comme il était un saint, il n’avait rien à craindre, il prit une voix grave pour leur répondre :
– Je ne suis pas un saint, et vous, vous ne savez pas ce que vous dites, pauvres femmes routinières, pauvres âmes simples et communes. Je suis à votre niveau…, non, ce n’est pas cela, à un niveau plus bas. Parce que vous, vous avez souffert ; toi, Constantina, avec la vie dure que t’a fait mener ton mari ; toi, Asunción, avec tes maladies et tes infirmités douloureuses. Vous, vous avez eu l’occasion de pardonner des offenses ; moi, pas. Vous, vous avez souffert de la pauvreté avant de vivre à mes côtés ; moi, j’ai toujours vécu dans une douce et commode modestie, sans manquer de rien, aimé de tout le monde, enfant gâté et choyé de la société. Vous, vous avez lutté ; moi, non, parce que j’ai tout trouvé tout fait. Ne m’appelez pas saint, parce vous tournez la sainteté en dérision, en me l’appliquant à moi.
Les deux femmes commencèrent à pleurer, et l’invitèrent à changer de conversation, parce que ce n’était pas la plus appropriée pour quelqu’un qui était mal dans sa tête.
– Non, non –dit Flórez, en s’obstinant-. C’est justement de cela que je veux parler. Je ne suis qu’un pauvre médiocre ; mais abdiquant en ce moment crucial mes ridicules prétentions, et foulant devant vous, et devant le monde entier, mon orgueil, je me remet à la miséricorde de mon Père Céleste pour qu’il fasse de mon insignifiance ce qu’il voudra. Mon âme n’est pas noircie d’infâmes péchés, et ne brille pas non plus d’héroïques vertus. Je suis ce que, en langage courant, on appelle un brave homme. Je suis… sympathique…, ah ah !, sympathique. Dans le monde il ne restera pas une trace de moi, et la Société aujourd’hui est exactement la même que si Manuel Flórez y del Campo n’ y avait pas existé. Comment pouvez-vous appeler saint un homme qui se fâche, quoique pas beaucoup, quand quelqu’un l’ennuie ? Toi, Constantina, ne t’ai-je pas grondé parfois parce que la soupe était froide, ou le chocolat très chaud, ou le riz collant, ou le café pas assez fort ? Tu vois bien, en voilà de la sainteté… ! Et toi, Asunción, tu as eu de beaux savons… parce que les boucles de mes chaussures n’étaient pas assez reluisantes ! Tu vois bien, comme si le fait que mes boucles brillent ou non, avait une importance quelconque !… Si vous vous attristez beaucoup de ce que je suis en train de vous dire, je vous confesserai que dans ma sphère, une sphère qui semble très vaste et qui est fort réduite, j’ai fait tout le bien que j’ai pu, et que le mal, ce que l’on appelle le mal, je ne l’ai jamais fait à personne volontairement. Mais de là à être rien moins qu’un saint, comme vous croyez, pauvres sottes, il y a un bon bout de chemin… Les saints sont différents, le saint est différent… Et de ce que disent les gens, que maintenant il n’y a plus de saints, j’en ris… Il y en a, il y en a, croyez-le parce que moi je vous l’affirme… Mais ne me considérez pas comme tel, grandes ânesses ; et sinon, répondez-moi quels mérites extraordinaires voyez-vous en moi ? Quelles infortunes et quelles difficultés ont trempé mon âme, quelles injures ai-je eu à supporter et pardonner, quelles grandes campagnes pour le bien humain et pour la foi catholique ont été les miennes ? Est-ce que par hasard, la Justice m’a poursuivi, et traité comme les malfaiteurs ? Est-ce que d’aventure, on m’a outragé, raillé, couvert de mépris ? Est-ce une contrariété que d’aller de maison en maison, faisant la fête et adulé, toujours invité à déjeuner, parlant de toutes sortes de vanités ecclésiastiques et mondaines, entrant et sortant sous prétexte de donner des aumônes, de porter secours et de faires des collectes, qui sont à la véritable charité ce qu’est le théâtre face à la vie réelle ? Ah ! Si vous pleurez parce que vous me voyez rabaissé de cette catégorie dans laquelle votre innocence a voulu me placer, pleurez, oui, pleurez avec moi, pleurons ensemble pour que le Seigneur ait pitié de vous et de moi, et nous tienne également tous les trois en sa sainte grâce.
Il ne dit pas plus, parce que la gouvernante et la nièce, se mouchant et surmontant leur douloureux chagrin, l’exhortèrent à se taire, et à ne pas penser à des choses qui devaient être désagréables au Divin Jésus et à la Vierge. C’est bien l’humilité, mais pas autant, Seigneur.
6
L’incomparable Catalina pleurait aussi en entendant les cris de la conscience de son cher ami, et toutes les trois s’accordèrent ensuite sur le fait que, plus le très cher don Manuel s’humilierait en se prosternant devant le Dieu de Justice, plus Celui-ci l’estimerait en lui donnant le prix qu’il méritait à cause de toutes ses qualités. A onze heures du soir, après qu’eût été enlevée la nappe du frugal dîner, alors que la comtesse se trouvait dans la salle à manger, plongée dans la lecture de ses dévotions devant une lampe ornée d’un abat-jour décoré, José Antonio entra. Comme il ne pouvait passer un jour entier sans la voir ni lui parler (si grande était la force de son adhésion passionnée qu’elle ressemblait plus à celle du chien qu’à celle d’un être humain), il s’accrochait à l’obligation d’avoir des nouvelles de l’état du malade pour entrer dans la maison et s’approcher de sa bienfaitrice.
– Notre don Manuel n’est pas bien –dit Halma, en fermant le livre et en marquant la page avec un doigt-. Nous devons demander à Dieu de toute notre âme qu’il nous conserve cette vie si précieuse, si nécessaire. Il faut prier, prier sans arrêt, Pepe, et toi aussi… Mais, certainement, tu ne sais pas, tu as oublié… Si moi je voulais te l’enseigner, tu apprendrais ?
– Tu obtiendras de moi tout ce que tu voudras, et je ne considère rien comme impossible si c’est toi qui me l’ordonnes –répliqua le jeune homme avec joie-. Je suis une de tes créations ; je suis un homme nouveau, que tu as modelé entre tes doigts, et ensuite tu m’as donné une vie et une âme nouvelle…
– Entre parenthèses, dis-moi une chose : on nous critique beaucoup dans ce milieu ?
– Horriblement. Mais ta grande âme m’a enseigné ce qui me paraissait plus que difficile, impossible : mépriser ces infamies et ne pas les punir immédiatement.
– Dieu est notre juge, et il nous accuse ou nous absout par le biais de notre conscience. Fais bien attention à ce que je te dis, et fixe-le bien dans ta pensée. Tu es un enfant, et comme tel je te fais la leçon.
– Et moi j’apprends tout. Tu n’auras pas à te plaindre de moi. Mais je voudrais, ma chère Halma, que tu m’ordonnes des choses difficiles, très difficiles pour que tu puisses éprouver mon aveugle obéissance.
– Par exemple, que tu te lances dans un four allumé, ou que tu te jettes par la fenêtre.
– Ce n’est pas ça, quoique je le ferais si tu me le demandais. Des choses difficiles, je veux dire, de celles qui mettent à l’épreuve la volonté d’un homme. Tant que tu ne m’auras pas commandé cela, et que je ne t’aurai pas obéi, je ne me croirai pas digne de ce que tu fais pour moi. Tu es extraordinaire, incroyable, invraisemblable. Mon amour propre est piqué au vif, et je voudrais aussi sortir un peu du lot commun.
– Ne t’en fais pas, chaque chose en son temps. L’invraisemblable, c’est toi : depuis que nous avons commencé à soigner ton âme avec une médecine dont tout le monde se moquait, tu as complètement changé. Jusqu’à présent, on dirait que je gagne, et que mon extravagance avait et a en elle un peu d’efficacité divine. Mais il y a encore beaucoup à faire, José Antonio, et si tu abandonnes dans la partie la plus ardue du chemin, ma réputation en souffrira.
– Je n’abandonnerai pas. J’irai avec toi jusqu’au bout du monde, que tu me tires par un petit fil de soie tout fin, ou par une grosse corde. Tire sans peur, je ne ferai rien pour me libérer.
– Je t’avertis que même si tu me lâches, même si en tirant la corde tu me blesses et me fais mal, je ne me repentirai pas de ce que j’ai fait.
– Parce que tu es… je ne vais pas dire une sainte ni un ange, des expressions vagues que les poètes et les prédicateurs ont discréditées…, mais une femme supérieure à toutes celles qui existent au monde ; la meilleure, le féminin au degré du sublime.
– Eh !…. Ça suffit. Tu as là une autre manie qu’il faut que je t’enlève : la flatterie.
Aux motifs de gratitude qui subjuguaient le parasite converti en en faisant un esclave soumis de la comtesse de Halma, s’était ajouté dernièrement un autre qui était, certainement, le maillon le plus solide de sa chaîne. La pénétration de la réformatrice ne pouvait ne pas voir les misères cachées et les vilenies de la vie d’Urrea, ulcères de l’âme qu’on ne pouvait montrer tellement ils étaient indécents. Mais la sagace docteur les connaissait par intuition et, croyant en toute conscience, que pour les guérir complètement il fallait attaquer ce désordre secret, avant qu’il ne corrompe la partie de son être qui recouvrait peu à peu la santé, elle incita le malade, comme on fait en morale médicale, à la confession ou à la sincérité les plus absolues. Lui, résistait, croyant que tout ce qui avait trait à cette affaire ne pouvait se dire en présence de la sainte et pure dame, de même qu’à l’église il n’est pas permis de dire des gros mots, ni de fumer, ni de garder son chapeau. Mais elle, courageuse et sereine, comme sainte Isabelle de Thuringe qui mettait ses mains sur la tête des teigneux, lui ouvrit le chemin à l’explication qu’elle désirait, en brisant le secret de cette façon :
– Il ne faut pas être grand clerc, mon cher Pepe, pour savoir que dans ta vie de pauvreté honteuse, difficile et miséreuse, il doit y avoir, outre les crapauds que nous avons déjà sortis de la boue, d’autres couleuvres que nous devons extraire pour te guérir complètement. Il est inutile de me le nier. Ah, idiot, comme on voit les vers qui se nourrissent de la putréfaction, je vois autour de toi un essaim de femmes, que j’appellerai malheureuses, parce qu’il n’y a pas de plus grand malheur que celui de perdre la pudeur.
– C’est vrai. Comment le nier, si tu sais tout ?
– Il faut te nettoyer de cette pourriture, Pepe, parce que, dans le cas contraire, tu t’exposes à rechuter de nouveau.
– Oui, oui.
– Mais, vite, vite. Je devine que ce n’est pas facile et que pour en finir avec ce honteux péché, il y a des obstacles matériels. Raconte-moi tout, dis-moi tout, aie avec moi la confiance que tu aurais avec un camarade de ton sexe. La vie humaine offre tellement d’anomalies que même pour se libérer de la ruine il faut de l’argent, et qu’on ne peut fuir le vice sans se montrer grand seigneur et généreux et à son égard.
– C’est vrai. Tu es la connaissance humaine et divine –répondit Urrea très ému.
– En clair : pour couper les vils liens avec ces malheureuses tu as besoin d’argent. En faisant le compte de tes embarras financiers et des engagements qui empoisonnent ta vie, tu as caché celui-ci par délicatesse, par respect envers moi. N’est-ce pas vrai ?
– Oui
– Peut-être te trouves-tu obligé et lié par des faveurs que tu as reçues.
– Oui
– Peut-être a-tu fait des dettes… en commun. Ne t’en fais pas. Nous parlerons de cela le moins possible pour t’épargner la honte qu’implique l’affaire. Promets-moi de couper complètement et pour toujours, avec la volonté de ne pas recommencer ces relations infâmes, et je te donne l’argent dont tu as besoin pour ta complète libération. Comme ça, comme ça, on dit les choses clairement, et on le fait avec courage.
– Oh Halma ! –s’exclama, écrasé, le débauché, en s’agenouillant devant sa cousine et en essayant de lui baiser les mains-. Si je ne te dis pas que je te considère comme un être surnaturel, je n’exprime pas ce que je ressens.
– Lève-toi. Aujourd’hui même tu vas t’occuper de cela. Dis-moi tout, ne me cache rien. Demain, tu liquides tes dettes d’ignominie. Si jamais tu sentais des doutes ou des scrupules, parce qu’il y aurait une relation un peu difficile à couper, même avec des ciseaux en or, tu me le dis, et je te donnerai du courage, des raisons… et on verra à arranger cela.
Stimulé par un aussi puissant encouragement, Urrea en finit avec des relations peu honorables, dont quelques-unes le gênaient horriblement, remplissant son âme de lassitude ; et d’autres qui, si elles touchaient quelque fibre de son coeur, n’avaient pas de racines si profondes qu’elles ne puisent être arrachées avec un petit effort. Et comme il se sentit libre, ouvert, et à l’aise après ! Avec quel plaisir il voyait les jolis visages souriants se perdre dans la brume qui précède les ténèbres de l’oubli ! Une seule des secousses qu’il dut donner lui fit mal. Mais se souvenant de sa cousine, il la supporta vaillamment, et même il aurait résisté avec héroïsme si elle avait été de celles qui sont profondes et blessantes. Mais tout se limita à un tout petit peu de chagrin ou d’affliction, et deux jours suffirent pour que la figure galante qui motivait cet état psychique s’évanouisse aussi avec les autres dans une brume d’indifférence. Quand tout fut terminé, la comtesse de Halma prit dans son esprit apaisé des proportions tota lement entièrement divines. Ce que sentit Urrea ne pouvait se comparer qu’avec la joie inénarrable du naufragé qui touche terre après une lutte angoissée avec les vagues. Cette lumière, phare ou étoile de la mer le sauvait, et devant elle il faisait l’offrande de sa vie future.
Non satisfait de s’enquérir le soir de l’état de don Manuel Flórez, José Antonio y allait aussi le matin. En général, entre neuf et dix heures. Catalina était revenue de la messe, et était en train de balayer le salon et le cabinet, tandis que la gouvernante et la nièce s’occupaient du malade. La Comtesse couvrait sa taille d’un tablier de Constantina, et maniait le balai avec une rare habileté. Qui l’aurait dit, en voyant ses mains aristocratiques, fines, blanches comme des lys, d’une très jolie forme ; ses doigts longs, grassouillets et pointus, véritables mains de sainte Isabelle, celle de Murillo, qui même sur les têtes couvertes de maladies ne perdaient pas leur pureté virginale et leur propreté ! Urrea n’osa pas demander la permission de lui baiser les mains, pour ne pas les profaner de ses lèvres de pécheur. Il ne méritait pas un si grand honneur. Vraiment, ces doigts qui prenaient le balai, étaient dignes de prendre l’Hostie consacrée.
– Et don Manuel, comment va-t-il ?
– Mal. Il n’a pas passé une bonne nuit. Il n’a pas pu dormir, il avait très mal à la tête. Il n’a pas déliré ; au contraire, il parle comme un saint qu’il est. Aujourd’hui on lui administre le Saint Sacrement. Il se prépare à le recevoir avec onction et allégresse. Sais-tu à quoi je vois que notre brave don Manuel est en train de mourir ? Au fait que son âme ne soit que candeur. Il pense et il parle comme un enfant. Autant de simplicité démontre que son âme s’est dépouillée de tout ce qui est terrestre. Que c’est beau de mourir ainsi ! Apprends, mon cousin, apprends, et pour que tu meures comme un juste, vis dans la justice et la vérité.
– Je vis là où tu m’ordonnes de vivre –dit le parasite, en s’écartant pour ne pas la gêner dans son balayage-. Là où tu me mettras, je resterai. Et maintenant, laisse-moi te poser une question. On dit chez toi que tu va aller vivre à Pedralba.
– C’est ce que j’avais décidé ; mais la perte de cet ami incomparable trouble mes plans, et je ne sais pas encore ce que je vais faire.
Et moi je reste ici ! –fit remarquer Urrea chagrin-. Moi ici tout seul. C’est vrai que nous ne sommes pas loin, et que je puis aller te voir fréquemment. Mais je ne sais si tu accepteras. Il faut que je reste à Madrid pour t’éviter des ennuis, pour que l’envie et la méchanceté ne se repaissent pas de toi.
– Cette raison n’en est pas une. Tu sais que les racontars des gens frivoles et vaniteux ne m’affectent pas. La calomnie même, qui fait si peur aux autres, peut venir vers moi, pour m’attaquer et me mettre en pièces. De ses attaques, je sortirai plus forte que je ne le suis. C’est la forme moderne du martyre, maintenant que nous n’avons pas de Dioclétien pour persécuter le Christianisme, ni de sectaires furibonds pour couper les têtes des croyants… Mais si la calomnie n’est pas une raison pour que tu restes ici –ajouta-t-elle, en laissant le balai et en remettant les meubles à leur place après avoir essuyé le bois, tâche dans laquelle son protégé l’aida avec plaisir-, tu resteras à Madrid tout seul, à cause de tes travaux. N’oublie pas la deuxième partie de notre accord. Tu dois devenir un homme utile, qui vive honnêtement, sans dépendre de personne.
– Oui, oui, je réaliserai ta belle idée. Tu es comme une mère pour moi, et je dois te vénérer, parce que tu me donnes l’être.
– Et je dois croire que ce fils à moi est maintenant assez grand, avec une force suffisante pour se débrouiller tout seul et assez de jugement pour gérer sa vie tout seul.
– Il en sera ainsi si tu le désires. Et maintenant, qu’est-ce que tu m’ordonnes ? Je me retire ?
– Oui, nous avons beaucoup à faire. Ensuite nous devons préparer la maison et la décorer pour recevoir le Visiteur Divin, que nous aurons aujourd’hui. Rentre chez toi, et reviens cet après-midi, à l’heure du Viatique. Je veux que tu sois là.
– Je serai là –dit Urrea, en baisant le bord du grossier tablier qui ceignait le corps de la noble dame, et il se retira tout triste… Qu’Halma doive partir, et que lui doive rester! Cette séparation du fils et de la mère, du disciple encore très fragile et de la maîtresse sainte et forte, allait exiger une énorme effort de volonté !
7
Ce jour-là, le marquis de Feramor, qui n’avait échangé que quelques mots avec sa sœur, ne manqua pas de venir. Dans son langage recherché anglais, parlementaire et économique, il dit que les hommes craignent la mort comme les enfants d’entrer dans une pièce obscure. Cela, c’était Bacon qui l’avait écrit, et lui le répétait, ajoutant que les chagrins qu’occasionne la perte d’êtres chers ont les limites imposées par la Nature à toutes choses. Le monde, la collectivité, survivent aux plus grands malheurs personnels et publics. Nous ne devons pas nous abandonner à la douleur, ni voir en elle une amie, mais une visiteuse inopportune à qui il faut refuser toute forme d’accueil pour qu’elle prenne congé le plus vite possible.
La cérémonie religieuse fut belle et pathétique, et y prit part un grand nombre de personnes ecclésiastiques et laïques, parmi ce qu’il y a de plus distingué que possède Madrid dans l’une et l’autre sphère. Le malade reçut le pain eucharistique avec une patience et une onction chrétienne, manifestant une gratitude ineffable au Dieu qui pénétrait dans son humble demeure, et il resta si serein et maître de lui tant que dura la cérémonie, qu’il semblait remis de sa grave maladie. Ensuite, il parla avec enthousiasme à ses amis de la joie qu’il ressentait, et des espérances que la sainte communion éveillait dans son âme. Le soir, après un court moment d’un sommeil tranquille, il appela sa gouvernante et sa nièce, et leur dit :
– Je sais que madame la Comtesse est chez moi, et en vérité, je ne sais pas pourquoi elle se cache. Sa présence m’est d’un grand réconfort. Qu’elle vienne, car j’ai quelque chose à vous dire à toutes les trois.
Catalina baisa la main du prêtre, et s’assit près du lit, tandis que les autres restaient debout.
– En vérité, je vous dis que je suis tranquille. Je me suis prosterné devant Dieu, et pleurant amèrement je lui ai offert la confession de toute ma vie passée, qui, à cause de mon incurie, de mon égoïsme, de mon inconsistance, n’a pas été très méritoire que je sache. Ce que je possède est pour vous, Constantina et Asunción : vous le savez déjà. Assurez vos besoins, en les réduisant à la mesure d’une sainte modestie, et employez le reste au service de Dieu ; secourez tous les nécessiteux que vous verrez à votre portée, sans vous demander s’ils le méritent ou non. Toute personne dans le besoin mérite de cesser de l’être. Et à vous, madame la comtesse de Halma, je ne vous dis rien, parce que, à celle qui est plus que moi et qui vaut plus que moi et qui en sait plus que moi sur les choses spirituelles et temporelles, que pourrait dire ce pauvre moribond ? J’en ai fini avec toute vanité, et je vous demande seulement de recommander à Dieu votre brave ami. Celui qui m’a éclairé n’est pas ici ; et s’il l’était, je lui dirais : ami pasteur, je voudrais échanger contre ta robuste houlette la mienne, qui n’est qu’un roseau, orné d’ivoire et d’or. Toi, tu pais tes brebis, pas moi ; toi, tu fais, moi je fais de la figuration.
Il continua à murmurer à voix basse des mots que les trois femmes ne comprenaient pas. Elles ne cessaient de lui recommander le silence et la tranquillité. Peu après, tous les quatre priaient, et c’était Halma qui conduisait le rosaire. Avant de terminer, le malade parut s’endormir. Asunción resta de garde, et Constantina et la comtesse sortirent sur la pointe des pieds.
Dans l’entrée elles avaient comme garde la petite fille de la concierge, pour qu’elle ouvre en entendant le pas des visiteurs, précaution indispensable parce qu’on avait enlevé la clochette. Peu après être sortie de la chambre à coucher, la gouvernante dit à la comtesse.
– Une femme est entrée qui veut parler à madame. Ça doit être une pauvre… de celles qui harcèlent et embêtent avec leurs demandes. Moi si j’étais madame, je lui donnerais la moitié d’un petit pain et je la mettrais dehors, parce que si nous sommes trop généreux avec les aumônes, cela va se transformer en l’auberge du père Castagnettes, et elles vont nous rendre folles. Elle tient une gamine par la main, et ça sent l’embrouille, je veux dire une manière de vous taper de l’argent qui va au fond de la bourse. Donc, que madame la comtesse soit sur ses gardes, parce que, savoir donner ou non, c’est en quoi consiste tout l’art, comme dit notre pauvre don Manuel, de la vraie charité.
Catalina savait déjà qui était la visiteuse, et sans rien dire, elle alla au salon, où attendaient debout une femme avec un châle et un fanchon sur la tête, et une petite fille d’environ six ans, emmitouflée dans un fichu.
– Beatriz –dit Halma, très affectueusement, en lui tendant ses deux mains, que femme et enfant embrassèrent avec amour-, j’étais déjà toute impatiente parce que tu ne venais pas. Est-ce que Prudencia t’a dit de venir ici ?
– Oui, madame ; mais je ne voulais pas venir, pour ne pas gêner –répliqua Beatriz en s’asseyant sur le bord d’une chaise-. A la fin, ce soir, j’ai pris la décision, et j’ai amené cette enfant pour qu’elle m’indique les rues, que je ne connais pas bien. Rosa connaît sur le bout des doigts ces quartiers, parce qu’elle aidait ses parents à distribuer le lait, quand ils ont eu les biquettes… Ah !, un très mauvais commerce, dans lequel s’était lancée ma cousine avec les voisins du rez-de-chaussée à droite, pour aider Ladislao, qui en accordant les pianos ne gagnait pas assez d’argent pour donner à manger à sa famille. Le pauvre Ladislao a vécu d’horribles désespoirs, en voulant gagner son quignon de pain et en rêvant toujours de l’opéra à moitié terminé, dans sa tête. Il a tout essayé ; il a joué du trombone dans un théâtre, et il distribuait des prospectus dans la rue. Les biquettes les ont endetté encore plus qu’ils ne l’étaient. J’ai vu la misère de cette maison, une misère noire, comme il y en a tant à Madrid, sans que personne ne la voie ni ne lui porte secours, parce que ce n’est pas possible, Seigneur, ce n’est pas possible… Madame le sait bien, qui l’a vue de ses propres yeux, parce qu’avec madame c’est Dieu qui est entré dans leur maison… Et je peux vous dire que ses paroles affectueuses ont fait plus plaisir à ces malheureux que l’aide qu’elle leur a donné pour manger et avoir un toit. Madame est… non seulement la charité, mais aussi l’espérance.
– Et le pauvre Ladislao, il est content ?
– Si content qu’il n’arrive plus a dormir tellement il est joyeux. Il dit que son desiderato serait la place de maître de chapelle ; mais si madame n’a pas de chapelle sur ses domaines, il la servira comme cocher ou il pourra aussi bien aller chercher du bois dans la forêt, si l’occasion se présente.
– Qu’il ne pense pas à cela, et qu’il attende –dit la comtesse, impatiente de parler d’autre chose-. Bien, Beatriz, et alors ?…
– Rien, l’affaire est résolue. Je suis venue ici pour que madame la comtesse soit vite au courant qu’aujourd’hui deux curés, qui doivent être du Tribunal ecclésiastique sont allés le voir à l’hôpital. Ils lui ont dit que son Ilustrissime lui proposait deux façons de l’assister et de le soigner. Ou bien lui donner un billet perpétuel pour un asile réservé à messieurs les prêtres, ou bien être recueilli dans une maison bien réputée de gens nobles et très chrétiens. Ils lui ont donné à choisir, et, évidemment, il a choisi la deuxième solution. Je l’ai su par lui-même : cet après-midi je suis allée là-bas, et j’ai trouvé dans la cellule le jeune monsieur de Urrea, qui lui conseillait de sortir de cette réclusion, parce que maintenant il est libre. Mais notre cher don Nazario ne veut pas jouir de la liberté, tant que la personne qui le prend sous sa protection ne le lui permet pas et lui dit quand, comment et où il doit aller, lui et sa pauvre personne.
– Eh bien, écoute ce que tu dois faire, Beatriz, et fais attention à ce que je t’ordonne. Demain viendra une charrette avec trois mules que j’ai fait venir de Pedralba. A l’aube du jour suivant, tu l’auras dans ta rue, et le charretier, qui est un vieil homme appelé Cecilio, un peu bavard et ami des proverbes, mais brave homme, montera chez toi pour t’avertir. Dans la charrette, tu mets Ladislao et Aquilina avec ses trois enfants et Nazarín, et toi en plus. Vous y tiendrez parfaitement, et si vous êtes un peu à l’étroit, les hommes pourront aller parfois à pied… Enfin, arrangez-vous de la meilleure manière possible. N’emportez pas de meubles, ni de literie. Distribuez tout cela aux voisins les plus pauvres. Vous pouvez emporter des vêtements… Ah ! J’oubliais le piano de Ladislas Dis-lui que je désire qu’il en fasse cadeau à l’aveugle, qui est aussi accordeur, qui vit dans la petite pièce d’à côté. Il peut aussi emporter dans la charrette ce tas de papier à musique qu’il a au-dessus de la commode. Vous aurez besoin de toute la journée pour le voyage, parce que les mules marcheront au pas, pour que ceux qui seraient fatigués de l’étroitesse de la charrette puissent faire un peu d’exercice et que puissent y monter un moment pour se reposer de la marche, ceux qui feraient partie de l’infanterie. Cecilio vous mènera jusque chez moi, et il vous y logera jusqu’à ce que, après quelques jours, quand je le déciderai, Cecilio et les trois mules reviennent me chercher.
– Madame, dans une charrette ! –s’exclama Beatriz, en portant ses mains à sa tête.
– Comme vous allez, j’irai. Qu’est-ce que cela peut faire ? C’est même plus commode, et plus gai. N’y vois pas du mérite, et encore moins de l’affectation de pauvreté : je déteste jouer des rôles. En plus, j’établis dans mon petit royaume toute l’égalité qui sera possible. Je n’ose pas encore dire, avant que la pratique ne me l’enseigne, à quel degré d’égalité nous parviendrons.
– Royaume a dit madame –affirma la nazariste avec joie- et même si vous ne l’aviez pas appelé ainsi, vous serez toujours notre reine et notre dame.
– Je ne sais pas non plus quel degré d’autorité j’aurai sur vous. Peut-être ne pourrais-je pas l’avoir ou abdiquerai-je dès le premier instant. Mais ne pensons pas encore à ce qui sera, et occupons-nous seulement du présent. Avec l’argent que je t’ai donné et que tu garderas par devers toi…
– Oui, madame ; moins ce que, à la demande de madame, j’ai dépensé dans le petit vêtement d’Aquilina et les bottes de Ladislao.
– Eh bien, il t’en reste pour acheter des chaussures et des espadrilles aux trois enfants et pour ce que vous dépenserez durant le voyage, qui sera bien peu. Je n’ai pas besoin de te dire d’économiser, parce que je sais que tu sais le faire. Comme la fille de Cecilio s’occupera de vous donner à manger en attendant mon arrivée, tiens la bourse bien fermée, Beatriz, et ne dépense pas un centime de ce qui pourrait rester quand tu arriveras là-bas ; n’oublie pas que nous sommes pauvres des vrais pauvres… Ne crois pas que notre petit royaume soit un pays de Cocagne.
– Si cela était, madame ne nous aurait pas comme vassaux…
– Tu as bien compris ?
– Oui, madame –dit Beatriz en se levant- : n’ayez crainte, tout se fera exactement comme madame le désire.
Elles prirent congé en lui baisant la main ; la comtesse les embrassa sur le visage, et en prenant congé d’elles sur le pas de la porte, elle les appela pour leur faire une remarque
– Écoute, Beatriz. Mon brave Cecilio souffre d’une maudite soif dont il ne se débarrasse qu’avec du vin. Il est maintenant si cassé le pauvre, que ce serait une cruauté de l’empêcher de satisfaire son petit péché. Pendant le voyage, tu lui permettras de boire un verre dans l’une des auberges par où vous passerez, pas dans toutes… Ecoute bien : avec trois ou quatre verres de gros rouge pendant tout le voyage, il en a assez ; mais rien de plus, rien de plus… Allez ! Au revoir, et bon voyage.
8
Peu après arriva un homme d’église, ami intime de Flórez, don Modesto Díaz, qui jouit d’une renommée d’excellent prédicateur, l’un des premiers de Madrid. Trois ou quatre fois par jour, il venait s’enquérir de l’état du malade, qu’il aimait profondément, car ils s’étaient connus dans leur enfance, et à Madrid, ils avaient vécu pendant de longues années en relations très cordiales, quoique chacun travaillât dans une sphère distincte à l’intérieur du monde ecclésiastique, car si Flórez était relativement riche et n’avait pas à réfléchir pour pourvoir décemment à sa subsistance, Díaz, ouvrier infatigable, avait travaillé toute sa vie propter panem. Tout jeune, il avait dû le gagner pour sa mère, et à l’âge mûr, il éleva et éduqua une ribambelle de neveux orphelins, qui devaient souffrir d’une faim canine, vu la façon dont se démenait le pauvre curé pour les nourrir, car il donnait des leçons de latin et de morale dans les collèges et chez des particuliers ; de rhétorique et de poétique, dans un lycée ; il traduisait du français des œuvres religieuses pour un éditeur catholique, et avec cela et la célébration et ses sermons, qui finirent par lui constituer des rentrées importantes, notre homme avait réussi à aller de l’avant avec toute sa famille, et il lui restait même un petit quelque chose pour aider les pauvres.
L’atmosphère différente dans laquelle Díaz et Flórez vivaient, et le chemin distinct suivi par chacun, n’avaient pas empêché qu’ils se rejoignent sur le terrain d’une amitié aussi ancienne qu’affectueuse. Ils étaient voisins ; souvent l’après-midi, ils se promenaient ensemble, et, parfaitement d’accord dans leurs idées et dans leurs goûts, jamais n’avait surgi entre eux ni dispute ni désaccord sur un point dogmatique ou de société. Tous deux étaient bons et estimés de tout le monde ; tous deux étaient pieux et en bonne entente avec leur conscience. Ils se ressemblaient même un peu physiquement ; simplement que Díaz ne s’habillait pas aussi bien que l’autre, et il n’était pas aussi soigné ou, si l’on veut, aussi élégant.
Avec des mots de douleur sincère, don Modesto s’apitoya sur l’état de son ami, se montra étonné de ce mal soudain qui était arrivé comme un coup de fusil.
– Mais il y a trois semaines Don Manuel avait de la vie à en revendre ! Un après-midi que nous étions allés nous promener vers la Moncloa, nous avions fait le compte des années que nous avons derrière nous et, calculant celles que nous avions à vivre si le Seigneur nous conservait la santé, nous allions très tranquillement vers les quatre-vingt. Et du jour au lendemain, ce coup de vieux tombe sur Manuel… Mais, pourquoi ? Ces derniers après-midis, quand nous nous promenions, je l’avais trouvé très renfermé, chose étrange, parce que c’était un homme si sociable qu’on voyait toujours son âme en train de voltiger allègrement hors de sa cage… Enfin, Dieu en décide ainsi. Que sa sainte volonté soit faite.
La comtesse ne commenta ces mots que d’un un profond soupir, et le brave prêtre, après s’être essuyé une larme, changea de ton pour dire :
– Entre parenthèses, madame la comtesse, je sais que vous allez à votre propriété de Pedralba, près de San Agustín, et il faut que vous sachiez que le curé de ce bourg est mon neveu Remigio, auquel je vais écrire pour qu’il se mette à votre disposition et vous aide dans tout ce que vous trouverez bon de lui demander. C’est un brave garçon, madame, qui connaît son métier et qui possède, en outre, de l’entregent, chose qui n’est pas donnée à tout le monde. C’est moi qui l’ai élevé ; c’est mon œuvre, et il me doit sa double carrière, car outre son titre en théologie et en droit canon, il est licencié en droit. Il m’a donné du fil à retordre pendant ses études, il a failli mal tourner à l’Université. Il était plus attiré par la philosophie que par la théologie, et sa facilité à comprendre, sa flexibilité d’esprit lui firent prendre goût plus qu’il n’était de raison, pour l’étude des très nouvelles matières philosophiques et sociales. Il est bon de savoir de tout et connaître toute l’extension des idées humaines; mais j’ai dit : « Arrête, mon garçon. » Et lui qui s’obstinait à m’échapper, et moi, à le remettre dans le droit chemin. Naturellement, c’est moi qui ai gagné ; le garçon était docile, respectueux, et m’aimait à la folie. Il a chanté la messe il y a dix ans, le jour de la Chandeleur, et le voilà maintenant devenu un prêtre modèle, en retrait, c’est vrai, dans un bourg peu peuplé, mais avec l’espoir de passer à une paroisse de la Capitale ou d’avoir un poste de chanoine.
Halma répondit avec les phrases courtoises que la situation réclamait, et la conversation, par son propre mouvement, retomba sur don Manuel et sur la difficulté à le sortir de ce mauvais pas, si Dieu ne faisait pas un miracle.
– Pour moi –dit Díaz avec une profonde tristesse- c’est une perte irréparable, car je n’ai aucun ami à qui je puisse le comparer en gentillesse, affection et serviabilité. Chaque fois que j’avais besoin d’une lettre de recommandation, il me la donnait. Ses bonnes relations avec les gens importants étaient une vraie bénédiction de Dieu pour nous qui nous trouvions dans une sphère plus basse. Comme l’aristocratie le chérissait ! Voilà un homme qui aurait pu être évêque. Mais ce qu’il disait avec toute la modestie de Dieu : « Ce n’est pas pour moi, ce n’est pas pour moi ; c’est beaucoup de travail. » Chacun sa voie, et celle de Manuel était de développer la piété dans les hautes classes de la société et de les diriger dans leurs campagnes de bienfaisance… C’était un homme avec un entregent si extraordinaire, que sa façon d’être séduisait le riche comme le pauvre et avec son habileté, il enseignait la bonne doctrine à tout le monde… Dieu sait à quel point je me trouve seul et triste sans Manuel dans cette vallée de larmes !… Parce que c’est à peine si l’on peut mettre une date à notre amitié ! Lui est de Piedrahita ; moi de Muñopepe, dans le même district. Ensemble nous avons grandi, ensemble nous sommes allés à l’école, ensemble nous avons reçu l’investiture sacrée. Lui, était presque riche, moi, pauvre ; lui, vivait de ses rentes ; moi, de mon rude labeur. Chaque fois que j’ai eu besoin de quelque secours, parce qu’il y a des mois cruels, madame, surtout en été, quand Madrid se dépeuple, j’avais recours à lui…, hélas ! et toujours je le trouvais. Quel excellent ami ! Il me donnait des petites sommes, sans aucun intérêt… Ave Maria Purissima, surtout ne pas lui en parler ! Il m’aurait battu, Entre amis !… L’hiver arrivait, et je le payais religieusement. A Noël, de tous les cadeaux qu’il reçoit, il y en a toujours un pour moi. Le Seigneur le récompense de tant de bonté, car ses terres de Piedrahita lui donnent toujours de bonnes récoltes… C’est ainsi que, vivant avec décence et sans ostentation, comme un bon prêtre, il a des excédents, avec lesquels il a pu payer une excellente école à Piedrahita. Oui, madame, une plaque en marbre dit à la postérité le nom du fondateur. Eh bien, avec ces générosités, il lui en reste encore, et il ne se passe pas une année qu’il n’achète un terrain limitrophe de sa propriété. Propriétaire généreux et bon chrétien, il ne bouscule pas ses fermiers et ne lésine pas sur les salaires en périodes de misère. Enfin, des hommes comme cela, il y en a peu. Le Seigneur le veut pour Lui ; respectons sa volonté suprême, et reconnaissons que toutes les grandeurs terrestres sont cendre, poussière, rien.
Doña Catalina se montra d’accord avec tout ceci, et ils continuaient à parler sur la vanité des grandeurs humaines, quand le malade poussa un grand cri en disant :
– Est-ce que Modesto est venu ? Qu’il entre ici Modesto ! Modesto !
Monsieur Díaz accourut, et les deux amis s’embrassèrent avec une chaude tendresse. L’homme en bonne santé ne pouvait retenir ses larmes ; le malade, faible et la tête incertaine, perdant et récupérant à chaque instant le sens de la parole, ne faisait que lui donner des petites tapes sur l’épaule, et ses yeux, hagards, tantôt reconnaissaient don Modesto, tantôt le regardaient avec étonnement et stupeur.
– Mon cher ami –lui dit-il dans un moment de lucidité-, je t’ai entendu, et j’ai voulu que tu entres pour te faire part de la grande nouvelle. Je ressens maintenant un grand soulagement dans mon âme. Ma conscience a des ailes, et regarde comme je monte vers le ciel. Tu ne sais pas ? Ah, Modesto, quelle joie ! Je viens de décider que ma vigne de Barranco de Abajo, la meilleure que j’aie, sera pour toi. Il est temps que tu te reposes, mon ami. Quel lion au travail !… Maintenant avec ta vigne, qui peut te donner tes mille jarres, qu’il te vienne des neveux. Ces sottes en ont bien assez avec tout le reste de Piedrahita, et moi je n’ai besoin de rien désormais, car je veux être pauvre le reste de ma vie… Ne t’en va pas, Modesto ; accompagne-moi, parce que je suis à nouveau pris d’angoisses… et j’ai l’impression que je suis mort, et qu’on m’a enterré vivant… Je suis pauvre…, très pauvre ; je ne veux pas de mausolée ni qu’ils mettent sur moi une de ces pierres énormes avec des lettres d’or… Non, je ne veux pas de lettres d’or ni de boucles d’argent. Et quant à ma grande croix d’Isabelle la Catholique, je vous demande de ne pas me la mettre quand vous me mettrez dans mon linceul… le jour de ma mort. Je ne veux pas d’autre croix que celle de mon Rédempteur…, auquel je ne ressemble en rien, mais en rien… Lui était tout amour du genre humain ; moi, tout amour de moi-même. N’est-ce pas vrai, Modesto, que je ne ressemble en rien…, mais en rien ?
Ils essayaient de le calmer ; mais ils ne pouvaient pas, malgré l’aide de monsieur Diaz, le tenir dans son lit, car deux ou trois fois, il avait voulu en sortir, développant une force nerveuse incroyable dans son épuisement.
– Laissez-moi –disait-il-, ne soyez pas pénibles. Je fuis ce que j’ai été… Je ne veux pas me voir, je ne veux pas m’entendre. Il y a un homme dans le monde qui s’est appelé Manuel Flórez. Vous savez comment je l’appellerai moi ?… Le saint de salon. Je ne suis pas lui ; je veux être comme mon Dieu, tout amour, toute abnégation, toute charité… Je n’entends rien aux intérêts. Celui-là faisait des comptes, je les défais ; celui-là a vécu au milieu de mille vanités, moi je cours derrière la vérité, je la touche maintenant, et vous, misérables casse-pieds, vous ne me laissez pas…
Le médecin, qui était apparu au milieu de cette crise, ordonna des remèdes qui n’avaient d’autre objet que de rendre l’agonie moins douloureuse. La paralysie de la partie inférieure du corps était absolue. L’épanchement avait commencé sur la moelle épinière, laissant libre le cerveau. Don Modesto Díaz décida de resta là toute la nuit. Après minuit, le moribond, immobile, rigide, le visage décomposé, la voix profonde et faible, les yeux à moitié fermés, appela son ami et lui dit :
– Modesto, fais-moi le plaisir de me lire ce chapitre des Soliloques de notre Père Saint Augustin… Confession de la vraie Foi.
– Je n’ai pas besoin de te les lire, mon cher Manuel –dit don Modesto, ses mains sur celles du moribond-, car je le sais pas cœur : « Je vous rends grâce, lumière, parce que vous m’avez éclairé et je vous ai reconnu. Je vous ai reconnu Créateur du Ciel, et de toutes les choses visibles et invisibles. Dieu de vérité, tout-puissant, immortel, interminable, immense, infini, principe de toutes les créatures visibl et invisibles, par qui toutes choses sont faites, et tous les éléments persévèrent dans leur être, dont la Majesté, de même qu’elle n’a jamais eu de début, n’aura jamais de fin… »
Et il continua à réciter de mémoire pendant un long temps, jusqu’à ce que Flórez, qui comme en extase écoutait, en répétant quelques mots, l’interrompe en lui disant :
– Plus loin, plus loin, Modesto, quand il dit… Ah ! Maintenant je m’en souviens : « Je vous ai connu tard, lumière véritable, je vous ai connu tard, parce que j’avais devant les yeux de ma vanité un grand nuage obscur et ténébreux qui ne me laissait pas voir le soleil de justice, et la lumière de la vérité. Comme fils des ténèbres… »
On n’entendit pas le reste. Ce fut seulement un murmure inintelligible, un petit mouvement des lèvres, comme s’il savourait quelque chose.
Doña Catalina et don Modesto priaient, et la gouvernante et la nièce auraient fait la même chose si leurs larmes abondantes le leur avaient permis. Beaucoup d’amis arrivèrent, et à l’aube, alors que le malade conservait sa connaissance, bien que troublée, on lui donna l’Extrême Onction. Il prononça ensuite quelques phrases incohérentes, sans reconnaître personne ; mais quand il faisait déjà jour, comme si la lumière solaire encourageait la dernière étincelle de la pensée qui s’éteignait, il regarda et reconnut madame la comtesse, et allongeant lentement le bras jusqu’à lui toucher la manche de son vêtement d’une main tremblante, il lui dit d’une voix éteinte :
– Ne m’oubliez pas dans vos prières, ma chère et sainte amie, Dieu aura pitié de moi, le plus inutile soldat de la chrétienté militante. Je n’ai rien fait de grande utilité : entrer sortir, saluer, des conseils vains…, une pâle bonté. Souffrir ? Rien… Des sacrifices ? Aucun… Des épreuves ? Fort peu. Ah ! chère madame et ma sœur, de tout ce que vous ferez de grand dans la vie mystique que vous commencez, demandez au Seigneur de m’en attribuer une petite partie, à cause de la bonne foi avec laquelle je servais vos idées, en m’imaginant que c’était moi qui les inspirait ! Je n’ai rien inspiré, rien, rien… Tout a été tout petit, commun… Je n’ai pas été bon, je n’ai pas été un saint ; j’ai été sympathique… pauvre de moi !, sympathique. Que ma simplicité, ô mon Rédempteur, me serve maintenant, ce chagrin de n’avoir pas su t’imiter, de n’avoir pas été comme Toi, simple, aimant, doux ; de n’avoir pas su créer avec mon propre bien le bien d’autrui, le bien d’autrui !, le seul qui doive réjouir une grande âme ; le chagrin de n’être pas mort à toute vanité, et de ne pas avoir vécu seulement pour m’embraser dans ton amour, et communiquer ce feu à mes semblables.
Cette flamme d’éloquence fut la dernière, et précéda l’extinction tranquille et lente de la vie, sans souffrance. Diverses phrases fluctuèrent entre ses lèvres, comme des bulles : une invocation à la Vierge, et l’idée, l’idée tenace qui ne voulait pas le lâcher jusque sur le seuil même de l’éternité, qui peut-être le suivrait plus loin, devenant éternelle : « Je ne suis rien, je n’ai rien fait… Vie inutile, le saint de salon, le prêtre sympathique… Oh , quelle douleur, sympathique, une farce ! Rien de grand… Amour, non ; sacrifice, non ; annulation, non… Des boucles, de la petitesse, de l’égoïsme… Celui-là m’a appris… Celui-là, oui… »
En s’approchant très près de son visage, notre brave Díaz put percevoir ces phrases… La vie s’éteignit si doucement, que les témoins attristés ne purent déterminer le moment précis où le vertueux don Manuel Flórez remit son âme au Seigneur ; mais cette toute petite portion de temps, point de départ vers la mystérieuse éternité, se cachait dans les quinze minutes qui avaient précédé neuf heures du matin.
[1] C’était le chef du gouvernement de droite.
[2] Joaquín Sorolla y Bastida (1863-1923), peintre impressionniste espagnol. José Moreno Carbonero (1860-1942), autre remarquable peintre. Sorolla avait fait le portrait de Pérez Galdós en 1894.
[3] C’était la prison pour femmes à Madrid.
[4] Âme se dit « alma » en espagnol, d’où la similitude sonore.
[5] De son nom Tinoco. Personnage de Nazarín qui se trouva prisonnier en même temps que le célèbre prêtre de la Manche.















