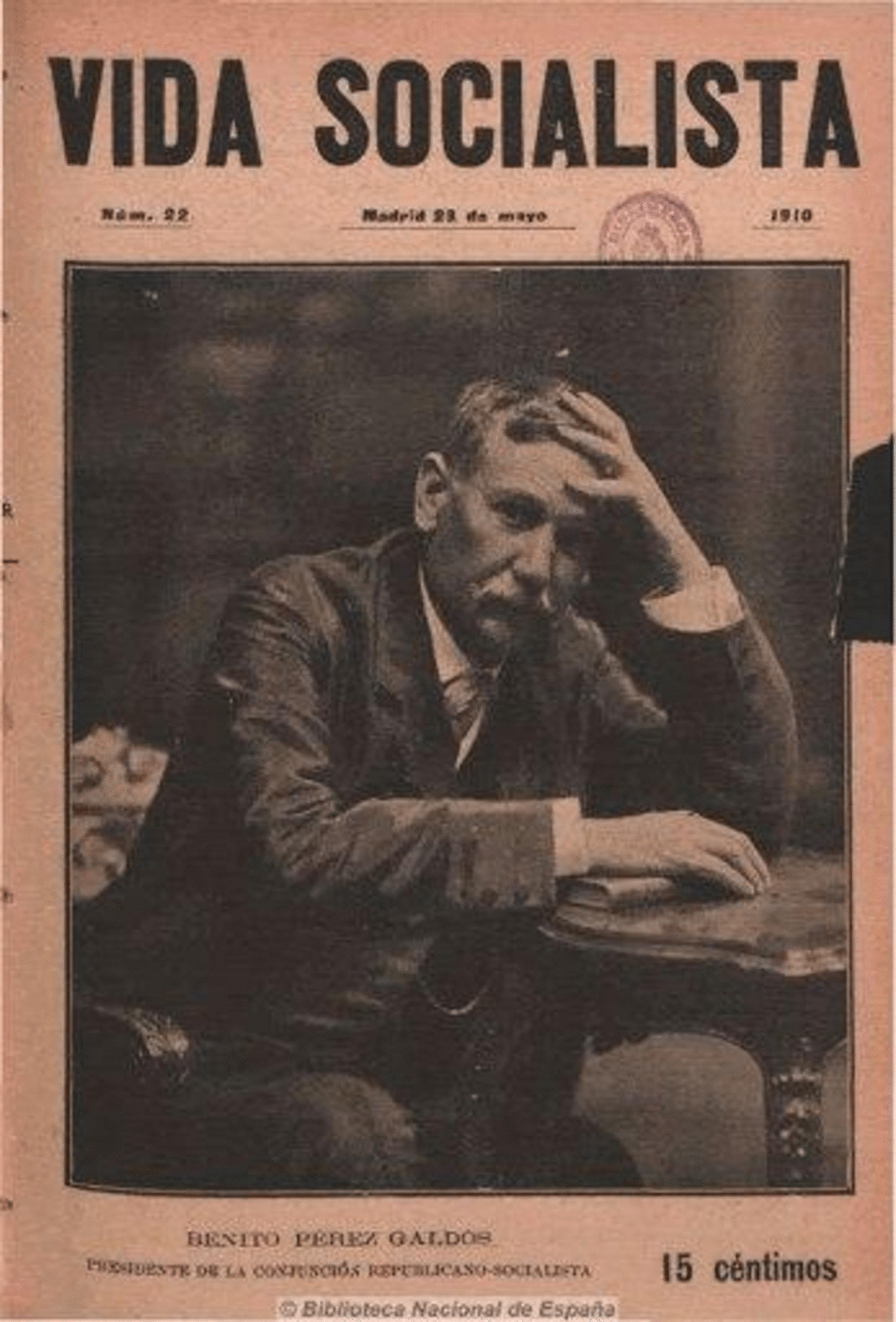No hay productos en el carrito.

Traduit par Daniel Gautier
1
Au bout d’une demi-heure de marche, le vieux mendiant, fatigué de son silence, se mit à discuter avec don Nazario.
– Camarade, vous devez être habitué à tous ces petits voyages, non ?
– Non, monsieur, c’est la première fois.
– Eh bien, moi… si on compte celui-ci, ça doit être mon quatorzième. Si les kilomètres que j’ai dans les jambes étaient des pièces de monnaie !… Je vous le dis à vous, en toute discrétion : savez-vous à qui revient la faute de tout cela ? A Canovas… non, non, je n’exagère pas.
– Enfin, voyons !
– Vous avez bien entendu. Parce que si don Antonio Canovas n’avait pas abandonné le pouvoir le jour où il l’a abandonné, à cette heure-ci, je n’en serais pas là, mais au poste que les modérés m’ont retiré à force d’intrigues en 42. Oui, monsieur, ils m’ont piqué ma place de secrétaire à six mille pesetas. Ma branche, c’était les Impôts Directs, bureau des recels. Eh bien, don Antonio, à ne pas vouloir rester un jour de plus m’a tout mis par terre : l’ordonnance était déjà envoyée à sa Majesté pour qu’il la signe… Mais, tout n’est qu’intrigue !… On a préféré renverser le Gouvernement plutôt que de me donner le poste.
– Quelle méchanceté !
– Comme vous voyez là, j’ai deux filles : l’une est mariée à Séville avec un homme riche comme Crésus. L’autre s’est marié à mon gendre, une méchante personne évidemment puisque c’est lui le responsable de mon procès… Parce que l’héritage de mon frère Juan qui est mort en Amérique et qui monte à trente-six millions de pesetas, sans exagérer, je ne pourrai pas le toucher avant l’année prochaine et comme… le contentieux, le Consulat de là-bas et mon gendre ont tout brouillé pour me causer des histoires… Ah ! Quelle canaille ! Le premier petit tripot que je lui ai confié m’a coûté six mille douros, au bas mot. Et c’est lui qu’il l’a transformé en maison de jeux. C’est pour ça que j’ai dû faire six mois de prison jusqu’à ce qu’on reconnaisse que j’étais innocent, mais… voyez, le manque de chance : le jour même où j’allais sortir de prison, j’ai eu une dispute avec un collègue qui voulait me piquer presque trente-deux mille réaux et là, j’en ai pris encore pour six mois, sans exagérer.
Voyant que Nazarín ne s’intéressait pas à son histoire, il passa à un autre sujet.
– J’ai entendu dire que vous êtes prêtre… C’est vrai ?
– Oui, monsieur.
– Dites-donc !… J’en ai vu des gens au cours de mes voyages, mais je n’avais jamais vu un ecclésiastique en prison.
– Eh bien, c’est fait. Vous avez là de nouveaux éléments à ajouter à votre histoire.
– Mais, pourquoi êtes-vous là, mon père ? Peut-on savoir ? Un petit dérapage. Je vous vois en compagnie de femmes et ça ne me dit rien de bon. Il faut savoir que celui qui s’enferme trop dans des histoires de jupes est un homme perdu. Parlons-en, moi j’ai eu des relations avec une dame de la plus haute société, de la plus haute aristocratie. Ah ! Les problèmes que j’ai eus ! Elle et une marquise de ses amies m’ont volé quelque chose comme soixante-dix mille douros, sans exagérer. Et le pire c’est qu’elles m’ont fait un procès. Les femmes ! Ne m’en parlez pas, ça me met hors de moi. A cause d’une cousine de mon gendre, qui possède un petit bar et qui est l’amante d’un lieutenant général, me voilà dans cette mauvaise passe. Ils m’ont confié cette petite pour que je l’emmène chez des oncles à elle à Navalcarnero et les oncles n’ont pas voulu la prendre sauf si moi je leur effaçais six ans d’impôts, sans exagérer…. Les femmes c’est toujours un problème. Ah ! Le beau sexe ! C’est pour ça que, si j’ai un conseil à vous donner, débarrassez-vous d’elles, allez voir votre évêque, demandez-lui pardon et ne vous fourrez plus dans ces sectes protestantes ou hérétiques… Qu’est-ce que vous dites ?
– Je n’ai rien dit, mon brave. Parlez autant qu’il vous plaira et laissez-moi tranquille. Je ne peux rien vous dire, vous ne comprendriez pas.
Pendant ce temps, Beatriz demandait à la petite comment elle s’appelait et comment s’appelaient ses parents. Mais la pauvre avait l’air un peu idiote et ne répondait rien. Ándara passa au premier rang, avec la permission des gardes pour pouvoir distraire un peu Nazarín et parler avec lui, alors le vieux mendiant s’approcha de Beatriz. A la première pause, les criminels qui étaient attachés adressaient des propos galants aux deux filles sous forme de grosses plaisanteries obscènes. Ils mangèrent tous assis par terre et Nazarín partagea entre tous ce que le maire lui avait mis dans sa besace. Les gardes, surpris par la douceur imperturbable et soumise du malheureux prêtre, lui proposèrent de boire un coup, mais il ne voulut pas accepter, tout en les priant de ne pas se vexer. Il faut dire qu’au début l’opinion des deux militaires n’était guère favorable au mystérieux prisonnier qu’ils emmenaient. Ils le considéraient comme un bel hypocrite, mais au cours du voyage, ils commencèrent à avoir des doutes sur la véritable condition morale du personnage. Enfin, l’humilité de ses réponses, la patience avec laquelle il endurait tous ses ennuis, sa bonté, sa douceur les étonnaient et ils finirent par penser que si don Nazarín n’était pas un saint, du moins il en avait toutes les apparences.
La première journée fut une rude journée car, comme il ne pouvait faire halte à Villamanta, où l’épidémie continuait, ils durent aller d’une traite jusqu’à Navalcarnero. Les deux criminels étaient vraiment des possédés du diable et il arriva que, couchés sur la route, ils refusèrent de continuer, obligeant les gardes à utiliser la menace comme aiguillon. Le vieux se traînait péniblement jurant tout ce qu’il savait par sa bouche édentée. Nazarín et ses deux compagnes cachaient leur fatigue et ne proféraient aucune plainte, elles portaient pourtant la petite à tour de rôle dans leurs bras. Ils arrivèrent enfin à demi-morts bien après la tombée de la nuit. L’excellent état de la prison de Navalcarnero permit aux gardes d’alléger leur surveillance et, les prisonniers, après avoir reçu leur pitance, furent enfermés, les hommes d’un côté, les femmes de l’autre, car on trouvait cette séparation plus confortable et plus opportune dans la majorité des cas. C’était la première fois que le pèlerin et ses deux compagnes que la bande avait surnommées pour se moquer, les disciples, ou bien les Nazaréennes, étaient séparés. Cela fut bien pénible pour elles de ne plus l’avoir à leur côté et de l’entendre parler de leurs malheurs communs mais la douleur ne fut pas moins vive pour lui de se voir obligé de prier tout seul. Mais il n’y avait rien d’autre à faire que de se soumettre !
Ce fut une nuit horrible pour Nazarín, dans l’obscurité de ce cachot, au milieu de scélérats désobligeants car, en plus de ses deux compagnons de voyage, il y en avait trois qui se mirent à chanter et à raconter des horreurs, comme s’ils avaient été poussés par une sorte de folie grossière. Dès qu’ils apprirent par les deux autres (on les appellera le Parricide et le Sacrilège, faute de savoir leurs vrais noms) le caractère sacerdotal de don Nazario, ils ne tardèrent pas les uns et les autres à lui monter une histoire d’imposteur et d’aventurier religieux. Ils faisaient tout haut des commentaires salaces sur les idées diaboliques qui, d’après eux, constituaient sa doctrine. A propos des femmes qui l’accompagnaient, l’un soutenait que c’étaient des bonnes sœurs échappées d’un couvent, l’autre que c’étaient des voleuses qui passent dans les églises pour soulager les poches des bigotes. Les horreurs qu’ils balancèrent au brave don Nazarín en pleine figure ne sont même pas racontables. L’un l’appelait le Pape des gitans, l’autre lui demanda s’il était vrai qu’il portait sur lui une fiole de poudre empoisonnée à verser dans les fontaines des localités pour déclencher la variole. Au milieu de ces mélanges de vérités et de mensonges, un autre l’accusait de voler des enfants pour les crucifier selon les rites d’un culte idolâtre, bref, tous l’accablaient d’injures aussi bêtes qu’inconvenantes. Mais le délire de cette bouffonnerie stupide et répugnante fut qu’ils lui demandèrent de faire devant eux un simulacre de messe démoniaque, le menaçant de coups s’il ne disait pas sur le champ l’office satanique, avec les gestes et les expressions latines ressemblant à ceux de la messe qu’on célèbre au vrai Dieu. Pendant que l’un se mettait à genoux devant lui en singeant de grossières prières, l’autre se donnait des coups à certains endroits comme le font les bons chrétiens qui se frappent la poitrine en signe de pénitence et tous hurlaient de manière horrible : mea culpa, mea culpa.
Devant tant de profanations bestiales qui n’affectaient plus sa personne mais la foi sacrée, le père Nazarín perdit sa religieuse sérénité. Et brûlant d’une sainte colère, il se mit debout et adressa à cette vile canaille ce sermon d’une grande dignité :
– Malheureux, vous n’êtes que des aveugles, des misérables. Insultez-moi tant que vous voudrez, mais gardez des égards à la grandeur de Dieu qui vous a créés, qui vous donne la vie, non pas pour le maudire et l’insulter mais pour réaliser des actions de piété, des actes d’amour pour vos semblables ! La pourriture de vos âmes, plongéées dans le vice et la méchanceté, déshonorent l’humanité tout entière. Ce qui sort de votre bouche n’est qu’immondice et vous empester l’air qui vous entoure. Mais, il est encore temps de vous reprendre, les chemins du repentir ne sont refusés à personne, les fontaines du pardon ne sont taries pour personne, pas même aux pécheurs les plus iniques que vous êtes. Ne vous laissez pas aller, le mal qui est en vous a laissé de profondes marques. Revenez à la vérité, au bien, à l’innocence. Aimez Dieu, votre Père, aimez les hommes, ce sont vos frères. Ne tuez pas, ne blasphémez pas, ne portez pas de faux témoignages, ne soyez pas impurs en paroles ou en actes. Les injures que vous n’oseriez pas dire à un proche parce qu’il est fort, ne les dites pas à celui qui est sans défense. Soyez humains et compatissants, ayez en horreur l’iniquité, évitez les mots qui blessent et vous éviterez les actions qui tuent. En vous libérant des actions mauvaises, vous vous libérerez du crime. Sachez que celui qui est mort sur la croix a supporté les outrages et les douleurs, il a donné son sang et sa vie pour le rachat des péchés… Mais, vous, aveugles, vous l’avez traîné devant le Prétoire et au Calvaire, vous avez couronné d’épines son divin front, vous l’avez fouetté, vous lui avez craché à la figure, vous l’avez cloué sur l’horrible bois ! Eh bien, maintenant, si vous ne reconnaissez pas que vous l’avez tué et que vous continuez à le tuer, à le fouetter, à lui cracher à la figure, si vous ne vous déclarez pas coupables et si vous ne pleurez pas amèrement vos immenses fautes, si vous ne vous en remettez pas très vite à la miséricorde infinie, sachez qu’il n’y aura pas de rémission pour vous, sachez, bande de vauriens, que les flammes de l’enfer vous attendent pour l’éternité.
Le bienheureux Nazarín avait de la grandeur dans sa courte supplique, il était terrible, fougueux, solennel dans son éloquente intervention. Dans la prison, il n’y avait pas d’autre lumière que celle de la lune qui entrait par les hautes fenêtres grillagées, éclairant sa tête et son buste qui, au milieu de ces pâles lueurs, acquéraient une plus grande beauté. La première impression que le terrible anathème, le ton et la figure mystique de l’orateur produisirent sur les criminels fut la stupeur et l’angoisse. Ils en étaient muets et tout étonnés. Mais l’intensité de l’impression n’évita pas la fugacité des paroles, et comme le mal était profondément enraciné dans ces âmes meurtries, ils retrouvèrent très vite leur perversité. On entendit à nouveau les insultes grossières et l’un des bandits, celui que nous avons appelé le Parricide, c’était le plus bravache et le plus insolent de tous, se leva et comme s’il voulait surpasser la barbarie des autres bandits par son orgueil, s’approcha de Nazarín, encore debout et lui dit :
– Moi, je suis tout simplement l’évêque de l’enfer et je vais te le confirmer. Attrape ça !
Tout en disant : «Attrape ça !» il lui donna une immense gifle qui fit rouler par terre le corps du pauvre Nazarín. On entendit un gémissement et quelques sonorités gutturales du malheureux homme tombé et outragé. C’étaient peut-être de sourds désirs de vengeance. C’était un homme et l’homme devait bien en certaines circonstances réapparaitre, car la charité et la patience, profondément enracinées chez lui, n’avaient pas anéanti toute l’énergie de sa passion humaine. La lutte entre l’homme et l’ange dut être terrible en lui, mais elle fut courte. On entendit de nouveau le gémissement, un soupir arraché du plus profond de ses entrailles. La canaille riait. Qu’attendaient-ils de Nazarín ? Voulaient-ils que, en colère, il se retourne contre eux et qu’il leur réponde, non pas par des coups car ils étaient trop nombreux, mais par des injures et des insultes comme eux le faisaient ? On aurait pu croire un moment que oui quand on vit le pénitent se redresser, se mettre à genoux tout d’abord, la tête baissée jusqu’au sol, la poitrine à terre, comme un chat aux aguets. Le buste se releva enfin, on entendit à nouveau le soupir comme arraché d’un coup des profondeurs thoraciques.
La réponse à l’outrage fut, on ne pouvait pas s’attendre à moins, divine et humaine.
– Vous êtes des brutes, en m’entendant vous dire que je vous pardonne, vous allez croire que je suis lâche comme vous… mais il faut que je vous dise. Je dois boire le calice jusqu’à la lie ! Pour la première fois de ma vie, il m’est pénible de dire à mes ennemis que je leur pardonne, mais je vous le dis, je vous le dis sans effusion, je vous le dis parce que c’est mon devoir de chrétien de vous le dire… Sachez que je vous pardonne, bande de pauvres types, sachez aussi que je vous méprise et je me sens coupable de ne pas savoir séparer en mon cœur le mépris et le pardon.
2
– Eh bien, pour le pardon, tiens ! lui dit le Parricide à nouveau en le frappant, quoique moins fort que la première fois.
– Et pour le mépris, tiens !
Tous sauf un, lui tombèrent dessus et le frappèrent au milieu des moqueries. Ils le frappaient au visage, sur la tête, dans la poitrine, sur les épaules… Plus que de la cruauté et de l’acharnement, cette attaque collective révélait le côté lourd et brutal de gens vulgaires car les coups n’étaient pas très forts bien que suffisamment quand même pour couvrir de bleus le corps du malheureux prêtre. Ce dernier lutta intérieurement avec plus de courage que la première fois. Il invoquait Dieu avec ferveur, essayant de se rappeler toute la force de ses idées, soufflant sur les braises de la pitié qui dévorait son âme. Il se laissa frapper sans dire un mot, sans protester ni se plaindre. Les autres se lassèrent de leur jeu infâme et le laissèrent là étendu, inanimé, sur les dalles. Nazarín ne disait rien : on entendait seulement sa respiration douloureuse. Les criminels se taisaient eux aussi, comme si dans leur cœur naissait une réaction plus raisonnable face aux moqueries barbares et excessives. Ce sinistre mélange de rire et de colère qui caractérise les plaisanteries brutales, parfois même sanglantes des criminels impénitents, se terminent souvent par un noir contrecoup mélancolique. Durant la pause qui suivit, on n’entendait plus que la brûlante respiration de Nazarín et les formidables ronflements du vieux mendiant qui dormait d’un profond sommeil bienheureux, étranger à toutes ces bagarres. Il rêvait peut-être qu’on lui remettait en mains propres les trente-six millions de son frère d’Amérique.
C’est Nazarín qui le premier rompit le silence. Il redressa, tous ses os endoloris, et leur dit :
– Maintenant, oui, maintenant… vos nouveaux outrages ont permis au Seigneur de me faire recouvrer tout mon être, et j’ai retrouvé la plénitude de la splendeur chrétienne, sans colère, sans instinct de haine et de vengeance. Vous vous êtes comportés envers moi en lâches, mais dans d’autres occasions, vous auriez pu être courageux et peut-être même des héros du crime. Il n’est pas facile d’être un lion mais c’est encore plus difficile d’être un agneau, ce que je suis. Sachez que je vous pardonne de tout cœur parce que Notre Père qui est aux cieux me le demande. Sachez aussi que je ne vous méprise plus parce Notre Père me demande de ne pas vous mépriser mais de vous aimer. Je vous considère comme mes frères et la douleur que je ressens à cause de vos méchancetés et à cause du danger de vous voir perdus à jamais est une douleur et un amour qui me brûlent le cœur. C’est une douleur si vive que, si ainsi je pouvais obtenir pour vous le rachat, j’aimerais souffrir les plus horribles souffrances, l’opprobre et la mort.
Il y eut un nouveau silence, plus lugubre que le précédent car on n’entendait plus les ronflements de l’ancien. Après ce bref instant solennel, sorte de moment de fermentation des consciences retournées, qui s’agitaient et se retournaient sur elles-mêmes, on entendit une voix. C’était celle du criminel que nous avons appelé le Sacrilège, le seul qui était resté muet et tranquille lors des insultes et de l’attaque. Il dit ceci, sans bouger de son coin où il était couché :
– Eh bien, moi je vous dis qu’offenser et donner des torgnoles à un homme sans défense ce n’est pas digne d’un gentilhomme. D’accord ? Je dirais même plus : ça n’est pas digne de personnes honnêtes et si vous insistez, je vais même dire que c’est le propre des canailles et des voyous. C’est bon ! Si quelqu’un se sent morveux qu’il se mouche, pour remettre les gens à leur place je n’ai pas mon pareil. Quand c’est juste, c’est juste et on doit dire les choses comme elles sont. Vous le savez donc maintenant et vous savez que je peux prouver ce que je dis ici ou ailleurs.
– Ta gueule, tu n’as pas honte, dit un des provocateurs, on te connaît. Regardez-moi ça, le voilà qui prend la défense du Ravi !
– Je prends la défense de qui bon me semble et je n’ai pas honte, répondit l’autre dans un calme inquiétant tout en se levant. J’ai toujours défendu le pauvre, même à tort, je n’ai jamais frappé un homme à terre, et quand j’ai vu quelqu’un avoir faim, je me suis privé pour lui donner un bout de pain. C’est le besoin qui a fait que nous sommes ce que nous sommes, mais prendre quelque chose aux autres n’empêche pas d’avoir de la pitié.
– Ta gueule, pauvre menteur, tu n’as du cœur que pour offenser tes amis, lui dit le Parricide, et tu fais toujours la sainte nitouche. Ce n’est pas pour rien que tu voles dans les églises, là où on ne risque pas sa peau, parce que les statues ne disent rien quand elles te voient leur piquer les sous et le Saint Ciboire et la Custode se laissent faire sans crier «Aïe, mon Dieu !» Monsieur «pas de chance», malheureux, tu serais quoi sans nous ? Le voilà à faire le beau et le fanfaron !… Arrête ton char, et vite, si tu ne veux pas que… !
– Vas-y, vas-y, fais le malin maintenant que nous sommes sans armes. Tu es toujours le même. Mais j’attends qu’on soit dehors, en terrain neutre, sans armes ni armures et là je vais te dire qu’offenser et maltraiter un pauvre sans défense, un homme bon et pacifique de nature, qui ne se mêle de rien, il n’y a que les peureux comme toi pour faire ça. Pauvre type ! Faux frère ! Vieille bête ! Tu n’es pas un homme !
Ils foncèrent l’un sur l’autre avec la même furie et les autres se précipitèrent pour les séparer.
– Laissez-le-moi, criait le Parricide et je lui arrache le cœur d’un coup de dent.
Mais l’autre :
– Tu cries parce que tu sais que les autres te retiennent… Dès que tu voudras, je te fous les entrailles à l’air et même les corbeaux n’en voudront pas.
Debout au milieu du cachot, arrogant et provocateur, il continua :
– Oh là ! Messieurs, taisez-vous et écoutez bien ce que je vais vous dire. Sachez et comprenez que ce brave homme qui est là, c’est moi qui le défendrai, comme si c’était mon père. Sachez que parmi les voyous, les scélérats et les voleurs, il y a un voleur honnête qui, en tant que chrétien, se met du côté de celui qui se tait quand vous l’insultez, qui supporte quand vous le maltraitez et qui au lieu de vous offenser, vous pardonne. Soyez au courant même si ça vous embête mais cet homme est bon et moi je vous le dis, c’est un saint. Je suis là et je réponds à celui qui mettrait ça en doute. Voyons voir, bande de voyous, y a-t-il quelqu’un pour ne pas croire ce que je dis ? Qu’il se présente et même si vous vous y mettez tous, je suis là.
Le Sacrilège parlait avec emphase et fermeté et les autres ne pipaient mot, effrayés, regardant le visage à la clarté de la lune qui l’éclairait faiblement. Quelques-uns, les moins féroces, commencèrent à éluder la question par des plaisanteries. Le Parricide se mordait les lèvres, mâchonnait des paroles insultantes et menaçantes. Il se coucha par terre comme l’aurait fait un chien paresseux, il dit seulement :
– Fais du tapage, mon gars, fais du tapage et comme ça les gardes vont entrer et vont encore me désigner comme coupable et nous, les justes, nous serons punis pour les pécheurs.
– C’est toi qui fais du tapage, sale bête, dit le Sacrilège, allant et venant, en maître des lieux. Tu fais du scandale parce que tu sais bien que les gardes me mettent toujours tout sur le dos dès qu’il y a une bagarre. Ce qui est dit est dit : cet homme est un saint de Dieu et moi, je le soutiens devant n’importe quelle canaille du monde. C’est un saint de Dieu, ouvrez bien vos oreilles et entendez bien : un saint de Dieu et celui qui touchera un seul de ses vêtements aura affaire à moi ici ou n’importe où.
Les gardes entendirent enfin le vacarme et ouvrirent la porte de leur pièce pour imposer silence.
– C’est une blague, messieurs, dit le Parricide. C’est ce maudit prêtre qui est responsable de tout ça. Il n’arrête pas de prêcher et ne nous laisse pas dormir.
– Ce n’est pas vrai, dit le Sacrilège fermement. Le prêtre n’est coupable de rien et n’a rien fait de ce qu’il dit. Celui qui prêchait, c’est moi.
Après deux ou trois insultes et la menace de prêcher à coups de crosse de fusil, toute la bande de voyous se tut et un silence disciplinaire régna sur la prison. Longtemps après, quand le Parricide et ses amis s’étaient endormis dans un sommeil stupide, puissant narcotique de leur barbarie, Nazarín se laissa tomber près de la place du Sacrilège. Ce dernier vint s’asseoir à ses côtés sans rien dire, comme si un respect superstitieux l’empêchait de parler. Le prêtre devina ce trouble et lui dit :
– Dieu sait comme je te remercie de m’avoir défendu. Mais je ne veux pas te compromettre.
– Monsieur, ce que j’ai fait m’est venu de l’intérieur, répondit le voleur d’églises. Ne me remerciez pas, ce n’est rien.
– Tu as eu pitié de moi, la cruauté qu’avaient les autres t’a indigné. C’est signe que ton âme n’est pas totalement mauvaise et si tu veux, tu peux encore être sauvé.
– Monsieur, dit l’autre vraiment sincère, je suis très méchant et je ne mérite même pas que vous me parliez.
– Si méchant que ça ?
– Très méchant.
– Bon, combien de vols as-tu commis ? Y en a-t-il… quatre cent mille ?
– Quand même pas… Dans les lieux sacrés, je n’en ai commis que trois dont un, c’était pas grand chose… juste un bâton de Saint-Joseph.
– Et des morts ? Y en a-t-il eu quatre-vingt mille ?
– Non, seulement deux : un par vengeance, on m’avait fait un affront. L’autre parce que j’avais faim. Nous étions trois à…
– Les mauvaises compagnies n’ont jamais rien apporté de bon. Et alors, si tu regardes en arrière et que tu revois tous tes délits, es-tu fier de tout cela ?
– Non, monsieur.
– Tu les considères comme si de rien n’était ?
– Non plus.
– ça te fait de la peine ?
– Oui, monsieur… Parfois, un petit peu de peine, sans plus… Quand les autres arrivent, on pense tous à des vilaines choses et… on oublie… Mais à d’autres moments, j’ai beaucoup de peine… et en particulier cette nuit, j’en avais beaucoup.
– Bon. Tu as une mère ?
– Oui, mais c’est comme si je n’en avais pas. Ma mère est très méchante. Elle a volé et tué un petit enfant cela fait dix ans. C’est pour cela qu’elle est à la prison d’Alcala.
– Mon Dieu ! Tu as de la famille ?
– Aucune.
– Et tu aimerais changer de vie… ne plus être criminel, ne plus avoir de poids sur la conscience ?
– J’aimerais bien oui… mais je ne peux pas… Je me laisse entraîner… Et puis, le besoin fait que…
– Ne pense plus au besoin, n’en fais plus cas. Si tu veux être bon, il suffit que tu dises : je le veux. Si tu rejettes tes péchés, aussi terribles soient-ils, Dieu te pardonnera.
– C’est vrai ça, monsieur ?…
– Tout à fait.
– Vraiment ? Mais que dois-je faire ?
– Rien.
– On se sauve en ne faisant rien ?
– Rien que se repentir et ne pas recommencer.
– Ce n’est pas possible que ce soit aussi facile, ce n’est pas possible. Devrai-je faire beaucoup pénitence ?
– Non. Si déjà tu supportes le malheur et si la justice humaine te condamne, sois résigné et accepte ton châtiment.
– Mais on va m’envoyer au bagne, et là je vais apprendre des choses pires encore que celles que je sais déjà. Qu’on me laisse donc libre et je serai bon.
– Que tu sois en liberté ou en prison, tu pourras être ce que tu veux être. Tu vois bien : libre, tu ne t’es pas bien conduit. Pourquoi as-tu peur de ne pas bien te conduire en prison ? C’est en souffrant que l’homme se régénère. Apprends à souffrir et tout sera facile pour toi.
– Vous m’apprendrez ?
– Je ne sais pas ce qu’on va faire de moi. Si tu étais avec moi, je t’apprendrais oui.
– Je veux aller avec vous, monsieur.
– C’est très facile. Pense à ce que je viens de te dire et tu seras avec moi.
– Il suffit de penser ?
– Cela suffit. Tu verras comme c’est facile.
– Eh bien, j’y penserai.
Ils parlaient encore quand la lumière de l’aube commençait à entrer par les grilles du haut.
3
Pendant que dans le compartiment des hommes se déroulait la scène tumultueuse que l’on a décrite, dans celui des femmes, tout n’était que paix et silence. Ándara et Beatriz étaient seules avec la petite et les premières heures passèrent à parler de la mauvaise tournure que prenaient les événements et de cette campagne errante. Mais toutes les deux se résignaient à l’adversité et pour rien au monde elles n’abandonneraient le saint homme qui les avait prises comme compagnes de sa vie méritoire. Elles firent mille conjectures sur ce qui allait se passer. Ce qui attristait le plus Beatriz, c’est qu’il fallait passer par Móstoles et se voir encadrée par les gardes civils, comme une criminelle. Elle n’avait que mépris pour toute vanité, mais l’épreuve à laquelle le Seigneur allait la soumettre devenait énorme. Elle avait besoin de tout son courage et de toute sa foi pour s’en sortir. Ceci dit, elle éclata en sanglot, versant des torrents de larmes pendant que l’autre essayait de la consoler sans pouvoir y parvenir.
– Tu es libre. Tu peux dire aux gardes que tu ne vas pas à Móstoles et tu restes ici, tu nous rejoindras ensuite.
– Non, c’est de la lâcheté, et aller à l’encontre de tout ce qu’il nous a dit tant de fois. Fuir les tribulations, jamais ! Quelle grande amertume que de passer par mon village ! Mais ce serait bien pire si don Nazario me disait : «Beatriz, tu t’es vite lassée de porter ta croix.» Et c’est sûr qu’il me le dirait. Alors je préfère tout supporter et passer par Móstoles plutôt que de l’entendre me dire ça. J’accepte la honte qui m’attend et que Dieu en tienne compte pour le pardon de mes péchés.
– Tes péchés ! dit Ándara. Allons, n’exagère pas. Que dire des miens alors ? Si je devais pleurer comme toi, j’aurais tant de larmes que je pourrais bien me baigner dedans. J’ai bien le temps de pleurer. Moi, j’ai été méchante, mais vraiment méchante ! Les mensonges, les entourloupes, n’en parlons pas. Porter de faux témoignages, insulter, gifler, mordre… arracher à l’une son foulard, ses pesetas ou autre chose de plus précieux… enfin, le péché d’avoir tellement aimé les hommes et ce maudit vice…
– Non, Ándara, répondit Beatriz sans essayer d’arrêter ses sanglots, tu auras beau me consoler comme tu voudras, tu ne peux pas. Mes péchés sont pires que les tiens. Je n’ai été qu’une méchante.
– Pas tant que moi. Allez, je ne peux pas accepter que tu aies fait quelque chose de pire que moi, Beatriz. Ecoute, des plus méchantes et des plus dégoûtantes que moi, je crois bien qu’on n’en trouvera aucune.
– Non, non, c’est moi qui ai le plus péché.
– Allons donc ! Tu parles… ! Tiens : as-tu mis le feu à une maison ?
– Non, mais ce n’est rien ça.
– Bon, qu’est-ce que tu as fait, toi ? Aimer Pinto ? Ah ! La belle affaire…
– Pire, bien pire… Si on pouvait renaître… !
– Je ferais la même chose.
– Ah ! Moi, non. Je ne recommencerais pas.
– Moi, je ferais attention, putain ! Mais, je ne dis pas… A vrai dire, ça me pèse maintenant toutes les méchancetés et les horreurs que j’ai commises mais comme nous devons souffrir parce que c’est lui qui le dit, et comme il n’y a pas d’autres solutions et bien on n’a qu’à accepter et souffrir les malheurs qui nous viennent. Moi, je ne pleure pas, on aura bien le temps de pleurer après.
– Eh bien, moi, si. Moi, si, dit Beatriz, inconsolable, moi, je pleure mes fautes. Ah ! La quantité d’offenses à Dieu et à mon prochain ! Je pense que j’ai beau pleurer énormément, ce ne sera jamais suffisant pour que tout me soit pardonné.
– Que peut faire Dieu à part nous pardonner ? Tu étais méchante et te voilà une brave fille comme les anges… Moi, il va falloir que j’ajoute un pèlerinage à Rome après celui de Santiago pour que Dieu me pardonne… Ecoute, Beatriz, chez moi le mal est enfoui tout en dedans de moi. Quand nous étions au château, j’étais jalouse de toi, parce que j’avais l’impression qu’il t’aimait plus que moi. C’est un grand péché d’être jalouse, n’est-ce pas ? Mais, après notre capture, quand j’ai vu que tu venais avec nous, alors que tu étais libre, et que tu voulais être prisonnière, criminelle comme nous, je n’ai plus eu cette idée-là. Crois-moi, Beatriz, ça a disparu et je t’aime de tout mon cœur et je prendrais bien tes misères sur moi.
– Comme moi, je prendrais bien les tiennes.
– Mais je ne veux pas que tu pleures comme ça. Les fautes que nous avons commises, moi plus que toi, nous sommes en train de les laver par tous ces soucis et ces affronts. Moi, je ne pleure pas… parce que je ne suis pas faite comme toi. Tu es sensible, moi, je suis dure. Tu ne fais qu’aimer et aimer, et moi, je pense que c’est bien de s’affliger comme ça et d’accepter peines et misères sur son ordre, mais je pense qu’il faut aussi se défendre de toute cette fripouille.
– Ne dis pas ça… Le Défenseur, c’est Dieu. Laissons Dieu nous défendre.
– Oui, c’est ça qu’il nous défende. Mais Il nous a donné des mains et une langue. Alors à quoi ça sert notre langue sinon à dire leur fait à ceux qui ne veulent pas croire que c’est un saint ? Nos mains servent à quoi, sinon à nous imposer à ceux qui nous maltraitent ? Ah ! Beatriz, moi, je suis une battante, je suis comme ça, je suis née comme ça. Crois-moi, c’est moi qui te le dis : on n’apprend rien sans mal et pour qu’ils soient tous convaincus qu’il est bon et qu’ils acceptent de dire que c’est un saint, il faut en donner des coups de bâton. On aura bien du mal, c’est sûr. Mais l’injustice, entendre des choses fausses, ça, ça me met en rogne. Non pas que je ne sache pas faire la martyre comme les plus malins, quand il le faut, mais n’est-ce pas un crève-cœur de voir qu’on le fait prisonnier, au milieu des assassins, celui qui n’a fait que consoler les pauvres gens, guérir les malades, se comporter comme un ange de Dieu et un séraphin de la Vierge ? Eh bien, je te jure, s’il me laissait, il y aurait du grabuge et avec un petit peu d’aide, je le remettrais en liberté et je mettrais au pas les gardes, les juges et les gardiens de prison, pendant que lui, direct dehors, et je dirais alors : «Voici celui qui connaît la vérité sur cette vie et sur l’autre, celui qui n’a jamais péché, qui a un corps et une âme propres comme une patène, notre saint à nous, à tout le monde chrétien et à ceux qui le deviendront.»
– Ah ! L’adorer, oui, mais ce que tu dis de nous mettre en guerre, Andara, ça ce n’est pas possible. Que sommes-nous ? Et même si on valait quelque chose. Tu sais bien qu’il y a un commandement qui dit : «Tu ne tueras pas.» On ne doit pas tuer, pas même nos ennemis. On ne doit faire de mal à aucune des créatures de Dieu, pas même aux criminels.
– Pour moi, pour ma propre défense, je n’ai pas besoin de relever la tête. On peut me tuer à coups de pierres, m’écorcher vive : pas un mot. Mais pour lui, lui qui est si bon… Crois-moi, c’est moi qui te le dis. Les gens ne comprennent la vérité que si on leur secoue un peu les puces.
– Mais tuer, non.
– Eh bien, ils nous tuent bien nous…
– Ándara, ne sois pas folle.
– Beatriz, tu es une sainte. Laisse-moi, il y a bien des manières de sauver les gens. Dis-moi, il y a des démons ou pas ?… je veux dire … est-ce qu’il y a des gens pervers qui poursuivent les braves gens et font un tas de choses injustes qu’on voit partout dans ce foutu monde ? Eh bien, serrons les rangs et sus aux démons… Il y en a qui veulent attaquer en bénissant… Je ne suis pas contre si on peut les chasser comme ça, mais pour en finir avec la méchanceté et nettoyer notre monde de toute cette saloperie, il faut des bénédictions mais aussi des épées et du feu. Crois-moi, s’il n’y avait pas eu de guerriers, mais des vrais, les démons se seraient emparés du monde. Dis-moi : Saint Michel n’est pas un ange ? Eh bien, tu vois bien qu’il a une épée. Saint Paul n’est pas un saint ? Regarde sur les sculptures, on le représente toujours avec une épée. Saint Fernando et tous les autres sur nos retables ? Tous en soldats… Alors, laisse-moi, je sais y faire.
– Ándara, tu me fais peur.
– Beatriz, tu as tes péchés, j’ai les miens. Chacun les lave comme il sait, comme il peut, chacun selon sa nature… Toi, avec des larmes, moi… va savoir ?
Elles parlaient encore lorsque la clarté de l’aube passa par les grilles du haut.
4
Lorsque les femmes et les hommes se rassemblèrent pour continuer le voyage, il faisait déjà grand jour, Beatriz et sa compagne coururent à la rencontre de Nazarín pour lui demander comment s’était passée la nuit. Inutile de dire leur incroyable déconvenue en voyant sur la vénérable face des marques de coups, d’horribles contusions aux bras et aux jambes, et tout en lui révélait un triste abattement. La fille de Móstoles devint toute pâle et elle était tellement troublée qu’elle ne demanda même pas qui avait été l’auteur de cette barbarie. Celle de Polvoranca se tordait les bras comme si elle avait eu des liens qu’elle voulait rompre ; elle serrait les poings et grinçait des dents. La caravane se mit en marche dans le même ordre que la veille sauf que Nazarín tenait la petite par la main et que Beatriz était à ses côtés. Ándara marchait devant avec le vieux. C’est lui qui la mit au courant de ce qui s’était passé la nuit précédente dans le compartiment des hommes.
– Je n’ai rien pu savoir du début de l’affaire parce que je dormais. Quand je me suis réveillé aux cris de ces brutes, j’ai vu qu’ils tombaient tous sur le pauvre prêtre et lui donnaient de nombreux coups… sans exagérer. Tous le frappaient sauf un. Ce dernier a pris ensuite la défense de Nazarín et s’est imposé à la canaille. Des deux criminels qui sont attachés par les bras à l’arrière, c’est celui de droite, le parricide, qui a maltraité ton maître et qui l’a couvert d’outrages. Celui de gauche, qui est poursuivi pour vols de chandeliers et de burettes, a pris parti pour le faible contre les forts. Il est devenu ensuite ami du prêtre et celui-ci lui a dit plein de choses de la religion pour qu’il se convertisse.
Après ces renseignements, Ándara les examina et les différencia parfaitement. Elle les fixait l’un après l’autre. Ils avaient tous les deux des mines patibulaires ; le méchant avait une tête livide, une barbe hirsute, un corps bien musclé, obésité maladive et le pas nonchalant. Le bon était plutôt maigre, allure mélancolique, le sourcil épais, la barbe clairsemée, le regard baissé, le pas décidé.
Tout en marchant, Nazarín raconta l’histoire à Beatriz sans y attacher d’importance. Il ne regrettait qu’une chose c’est que dès le premier coup, il avait failli redevenir colérique et agressif contre cette canaille, mais il avait pris sur lui, il avait étouffé la bête en colère et l’esprit chrétien était sorti vainqueur. Mais au cours des événements de cette nuit, il n’avait pas de louanges assez flatteuses pour celui des scélérats qui avait pris sa défense avec courage.
– Ce n’est pas le beau garçon qui se prévalait devant ses compagnons, c’était plutôt le pécheur dont Dieu avait touché le cœur. Nous avons parlé ensuite et j’ai vu avec plaisir que son âme était limpide et que brillaient en elle les flammes du repentir. Heureux coups que j’ai reçus, heureux outrages, si grâce à eux cet homme j’ai obtenu que cet homme soit des nôtres !
Ils parlèrent ensuite de la honte qu’elle ressentait d’entrer à Móstoles et qu’elle acceptait volontiers tout pour l’expiation de ses péchés. Nazarín l’exhorta à mépriser le qu’en-dira-t-on, sans quoi on n’avance pas dans la vie et il ajouta qu’il ne fallait pas se mettre à imaginer les événements futurs en les formant dans notre esprit sous des bons ou des mauvais jours, car on ne sait jamais même en suivant les règles de la logique, ce qui advient dans les heures à venir. On avance dans la vie en tâtonnant comme des aveugles et Dieu seul sait ce que sera demain. De sorte que, habituellement, lorsque nous croyons aller vers le mal, nous sommes surpris de trouver le bien et vice versa. Avançons donc et que la volonté de Dieu soit faite, Lui qui gouverne tout, aujourd’hui comme demain.
Beatriz se sentit ragaillardie par ces paroles et elle ne craignait plus d’entrer dans son village natal. Ándara les rejoignit pour repartir aussitôt après avoir dit un mot sur la fatigue du chemin. Elle passait rapidement de la tête à l’arrière du cortège. Elle observa que les deux criminels attachés l’un à l’autre ne se parlaient plus comme la veille. Ils n’égayaient plus l’ennui du chemin par leurs plaisanteries ou leurs chansons. Marchant un petit moment près de celui de gauche, elle se mit à parler, car les gardes n’interdisaient pas les conversations entre les gens libres et les prisonniers attachés, acte de charité qui n’entravait en rien, dans la plupart des cas, la bonne marche du groupe.
– Tu as l’air un peu fatigué, non ? lui dit-elle. Si les gardes m’attachaient à ta place, je le ferais volontiers, comme ça tu serais libre. Tu l’as bien mérité après avoir cloué le bec à ce propre-à-rien qui est à tes côtés. Dieu te le rendra. Repens-toi du fond du cœur et le Seigneur verra ton repentir comme si tout l’argent que tu lui avais volé, tu le lui rendais avec de l’or en cadeau.
Le voleur ne lui répondit rien, il semblait fatigué comme s’il portait sur lui un poids invisible. Ensuite, la délurée s’en alla de l’autre côté, près du parricide et à voix basse lui disait ceci :
– Je voudrais être une longue vipère avec tout son venin pour m’enrouler autour de toi, t’étouffer et t’envoyer en enfer, espèce de traître, grand froussard.
– Gardes, cria le bandit sans agressivité, plutôt sur un ton geignard, cette dame est en train de me casser les pieds.
– Je ne suis pas une dame.
– Bon, cette fille publique… Moi, je n’embête personne… et elle, elle me dit qu’elle est une vipère et qu’elle veut m’embrasser… Ce n’est pas le moment des embrassades et de faire la fête, camarade. Fiche le camp et laisse un homme qui ne peut pas sentir les femmes à ses côtés, pas même en peinture.
Les gardes demandèrent à Ándara d’aller marcher devant et peu après, le convoi s’arrêta dans une auberge. Une fois repartis, un peu avant la tombée de la nuit, ils virent les tours et les flèches du grand village de Móstoles. En approchant ils virent quelques habitants et une meute de gamins venir à leur rencontre car le bruit avait couru que Beatriz était avec le Maure de la Mancha, celui qui avait fait des miracles. Il restait quelques deux cents mètres quand se présentèrent trois hommes qui se mirent à parler aux gardes et à les prier de s’arrêter un instant, histoire de discuter un peu. Beatriz les reconnut tout de suite en les voyant arriver : Pinto était l’un d’eux, l’autre était son frère Blas et le troisième, un de ses oncles. La pauvre femme eut besoin de toutes ses énergies pour ne pas tomber morte de honte. Ils voulaient juste savoir si elle était en telle compagnie de son propre gré. Ils s’en étonnèrent et voulurent absolument l’écarter du groupe pour éviter l’humiliation d’entrer au village au côté de ces assassins, ces voleurs et ces apôtres. Leur étonnement s’accentua quand Beatriz assura fermement que pour rien au monde elle ne se séparerait de ses compagnons dans le malheur et qu’elle irait avec eux jusqu’à la fin du voyage sans crainte des épreuves de la prison ni même de la potence. Il est impossible de décrire la colère des trois hommes et, si les gardes ne les avaient pas empêchés, on peut supposer qu’ils l’auraient fait taire à coups de poings.
– Infâme, pécore imbécile, lui dit Pinto, pâle de rage. J’imaginais bien que tu finirais en fille publique, en crapule, mais je ne croyais pas que tu te déshonorerais à ce point… Fous le camp, ordure ! Je ne sais comment je dois dire. Je n’en crois pas mes yeux !… Toi, une dévergondée de la sorte, à courir après cet imbécile, ce charlatan dégoûtant, cet éventreur qui dupe les petites gens partout où il passe avec ses entourloupes, ses sorcelleries et ses intrigues de mahométans !
– Pinto, répondit Beatriz, avec gravité, prenant son courage à deux mains, le foulard sur la tête, très avancé sur le front pour lui faire un peu d’ombre, la main enveloppée dans une des pointes devant sa bouche. Pinto, va-t-en et laisse-moi continuer, je n’ai plus rien à faire avec toi, je ne veux plus rien savoir de toi… Si j’ai honte, ça passera : ce n’est pas ton problème. Qu’est-ce que tu viens faire, tu n’es plus rien pour moi, tu es comme un mort qu’on enterre. Va-t-en et ne me parle plus.
– Salope !
Les gardes mirent fin à la dispute en donnant l’ordre de poursuivre. Mais Pinto, hors de lui, continuait ses insultes ignobles :
– Scélérate ! Heureusement pour toi que ton foutu corps est escorté par ces messieurs, sinon je t’aurais plantée sur le champ et j’aurais coupé les oreilles à ce vaurien.
Les trois hommes en colère restèrent sur place, levant les bras au ciel, et le convoi de prisonniers avança par la rue principale de Móstoles, harcelé par la foule curieuse qui voulait les voir et tout particulièrement qui voulait voir Beatriz. Celle-ci, la conscience tranquille, sans arrogance aucune, comme quelqu’un qui boit fermement le calice jusqu’à la lie mais qui compte bien y trouver la santé, affronta le douloureux passage transitoire et s’imagina entrer dans la Gloire du Paradis en entrant dans la prison.
5
Les malheureux prisonniers étaient très mal logés dans cette prison de Móstoles (ou autre lieu, car la localité n’est pas bien définie dans les chroniques nazaristes) car la dénommée prison ne méritait un tel nom que si on se réfère à l’horreur inhérente à toute pièce destinée à recevoir des criminels. C’était une maison à un étage[1], vétuste, jouxtant la Mairie dont la façade donnait sur la rue et l’arrière sur une cour pleine de décombres, de vieilles planches et de méchantes orties. Si l’hygiène et la décence légale n’existaient pas, la sécurité des prisonniers était un mythe comme le disait le rapport de la Commission pénitentiaire qui demandait au Gouvernement des fonds pour construire une prison toute neuve. L’ancienne prison, peut-être existe-t-elle toujours, était bien connue pour ses fréquentes et scandaleuses évasions. Pour s’échapper, les criminels n’avaient pas besoin de faire de difficiles et périlleuses escalades ou de creuser des souterrains. Ils s’échappaient habituellement par le toit qui était d’une fragilité et d’une inconsistance merveilleuses car il suffisait de casser les poutres pourries, d’enlever et de remettre les tuiles à sa guise.
Depuis qu’on l’avait enfermé dans cet infâme réduit, Nazarín ressentait un froid intense, comme s’il avait été enfermé dans une glacière ou un Purgatoire gelé, et ce froid entraîna une horrible faiblesse des os, comme si on les lui brisait avec une hache pour en faire du petit bois destiné à allumer le feu. Il se laissa tomber par terre, enveloppé dans sa cape et voilà que peu après, il sentait une chaleur insupportable. Dans ce Purgatoire, il passait du froid aux flammes. «C’est la fièvre, se dit-il, une fièvre terrible, mais ça va passer.» Personne ne s’approcha de lui pour lui demander s’il était malade. On lui apporta sa pitance dans une gamelle de fer-blanc, il n’y goûta pas.
On fit sortir Beatriz pour la simple raison qu’elle n’était pas prisonnière et naturellement, n’avait pas droit à occuper un espace réservé aux personnes poursuivies par la Justice. La malheureuse eut beau supplier et gémir pour qu’on lui permette de rester, se dépeignant comme criminelle volontaire et en procès avec son propre ministère, rien n’y fit. A la peine d’abandonner ses compagnons s’ajoutait celle de devoir traverser les rues de Móstoles où elle retrouverait sûrement des têtes connues. Elle ne désirait voir qu’une seule personne : sa sœur mais d’après ce que disait une voisine avec qui elle parla à l’entrée de la prison, elle était allée à Madrid deux jours avant, sa fille étant complètement rétablie. «Comme il m’arrive des choses curieuses ! disait-elle. Les criminels haïssent la prison et ne pensent qu’à leur liberté. Moi, je déteste la liberté, je ne veux pas sortir, je n’ai qu’une envie : être prisonnière.» Enfin, le secrétaire de la Mairie qui vivait là tout près, eut pitié d’elle et lui offrit l’hospitalité chez lui, ce qui résolut à moitié le désir de la pénitente exaltée.
Don Nazario fut très peiné de ne plus avoir Beatriz à ses côtés, mais il se consola quand il apprit qu’elle passait la nuit dans la maison d’à-côté et qu’ils poursuivraient ensemble et jusqu’au bout leur chemin de croix. Il faisait nuit, le brave ermite errant ne se sentait pas bien et de manière épouvantable, il sentait monter en lui une impression de solitude et d’abandon, il faillit se mettre à pleurer comme un enfant. On aurait cru que ses forces s’épuisaient tout d’un coup et qu’une défaillance féminine allait mettre un terme dérisoire à ses aventures chrétiennes. Il demanda au Seigneur son aide pour supporter les amertumes qui étaient encore à venir et ses merveilleuses forces revinrent dans son âme, mais accompagnées d’une soudaine montée de fièvre. Ándara s’approcha de lui pour lui donner l’eau qu’il lui avait demandée à deux ou trois reprises, et ils se mirent à parler de manière confuse et incohérente, l’un comme l’autre. Il ne savait pas bien s’expliquer ou bien elle, dans ses réponses ne pouvait pas ajuster sa pensée à celle du malheureux ascète.
– Va dormir ma fille et repose-toi.
– Maître, ne m’appelez plus. Ne dormez pas. Priez à voix haute pour que ça fasse du bruit.
– Ándara, quelle heure peut-il être ?
– Maître, si vous avez froid, faites les cent pas dans la prison. Je veux que nos malheurs prennent fin le plus tôt possible. Je suis contente que Beatriz ne soit plus là, ce n’est pas une battante, elle veut tout régler à coup de larmes et de soupirs.
– Ecoute, tout le monde dort ? Où sommes-nous ? Sommes-nous arrivés à Madrid ?
– Nous sommes là. Je suis une guerrière. Ne dormez pas, Maître…
Elle s’éloigna soudain comme une ombre qui disparaît ou une lumière qui s’éteint. Ces dernières phrases incohérentes étaient à peine prononcées que le pauvre prêtre fut pris de doutes terribles : «Ce qu’il voyait et entendait, était-ce la réalité ou bien la projection externe de ses délires dus à la fièvre intense ? Le vrai ? Où se trouve-t-il ? En dedans ou en dehors de la pensée ? Les sens percevaient-ils les choses ou bien les créaient-ils ?» Douloureux effort mental pour résoudre ses doutes et tantôt il demandait les moyens de la connaissance à la logique ordinaire, tantôt il les demandait par la voie de l’observation. Mais l’observation elle-même n’était pas possible dans cette vague pénombre qui délayait les contours des choses et des personnes et rendait tout fantastique ! Il voyait la prison comme une grotte étroite, si basse de plafond qu’on ne pouvait pas s’y tenir debout, même pour un homme de stature normale. Dans la voûte, les deux ou trois claires-voies qui se transformaient en vingt ou trente, laissaient passer une faible lumière et on ne savait pas si c’était la lumière d’un soleil voilé ou la lumière de la lune. A la suite de la salle où il se trouvait, il en vit une autre plus petite qui s’éclairait de temps à autre à la lumière rougeâtre d’une lanterne ou d’une bougie. Par terre, les prisonniers gisaient, couchés sur des nattes ou des manteaux, comme des ballots de tissus ou des sacs de charbon. Vers le fond de la deuxième pièce, il vit Ándara dont, par moments, la tête renvoyait une étrange lumière, comme si ses cheveux défaits et hérissés étaient devenus de pâles rayons de lumière électrique. Elle parlait avec le Sacrilège, et celui-ci gesticulait de manière si violente et si confuse qu’on aurait pensé que ses bras à lui exprimaient sa volonté à elle et inversement. Le pilleur d’églises s’étirait jusqu’à toucher le plafond de la ceinture puis réapparaissait comme un acrobate, la tête en bas.
Pour ce qui est de l’appréciation du temps, l’esprit et les sens de Nazarín étaient encore plus confus et délirants. Après avoir cru qu’il avait passé de longues heures sans rien voir, il crut par brefs moments qu’Ándara s’approchait de lui, le soulevait et le redéposait sur le sol, en lui disant tant de choses qu’elles occuperaient la moitié d’un livre si on les mettait par écrit. «Ce n’est pas possible, ça, disait-il, ce n’est pas possible ! Pourtant je le vois, je le touche, je l’entends, je perçois tout clairement !» Enfin, sa compagne de pèlerinage le prit par le poignet et l’entraîna vivement dans la seconde pièce. Là, il n’y avait aucun doute, parce qu’il avait mal à la main à force de se faire tirer par la vaillante fille de Polvoranca. Le Sacrilège le prenait dans ses bras pour le passer par un trou qu’ils avaient ouvert dans le plafond et le jeter dehors comme un ballot lancé par d’audacieux contrebandiers.
Non, la voix d’Ándara n’était pas sa vraie voix. Elle lui dit : «Père, nous nous échappons par en-haut parce qu’on ne peut pas par en-bas.» Ce n’était pas non plus la voix du Sacrilège qui disait : «Allez, monsieur, allez… Sautez du toit dans la cour.»
Mais, si le brave chef des Nazaristes avait des doutes, il n’en avait plus, il ne pouvait plus en avoir lorsqu’il s’exprima lui-même et de manière claire en disant : «Moi, je ne fuis pas, un homme comme moi ne fuit pas. Fuyez, vous autres, si vous avez peur et laissez-moi seul.» Il ne pouvait pas douter non plus qu’il avait lutté contre des forces supérieures pour se défendre de ce fol entêtement de vouloir le jeter au plafond comme une balle. Le pilleur d’églises le posa par terre, et là, il resta inanimé, ayant perdu toute ses facultés, sauf celle de la vue, dans un brouillard d’épouvante, de colère et d’horreur de la liberté. Il ne voulait pas de la liberté ni pour lui ni pour ses proches. De la première salle vint en marchant comme les ivrognes, un des sacs de charbon, qui prit bientôt forme humaine et avait toutes les apparences du Parricide. Avec la légèreté du chat, il passa sans difficulté de la pesanteur du sac à l’agilité de l’animal, il fit un saut à l’ouverture du plafond et disparut.
Nazarín put alors faire un grand effort et articuler quelques mots, il écarta la femme qui pesait sur son épaule comme une dalle de granit et murmura :
– Que celui qui veut s’en aller, s’en aille… Celui qui fuit ne sera jamais de mes amis.
Ándara qui avait le visage tourné vers le sol se frottait la bouche et le nez sur les dalles dégoûtantes, dit en se redressant :
– Alors, je reste.
Le Sacrilège qui était monté sur le toit à la poursuite de son compagnon, revint les poings serrés, l’air sombre.
– La liberté non… lui dit Ándara d’une voix étouffée comme quelqu’un qui se noie. Il ne veut pas… non.
Nazarín entendit clairement la voix du Sacrilège qui répétait :
– Non, pas la liberté. Moi, je reste.
Ils durent le porter dans leurs bras, parce que le brave pèlerin se sentit porté dans les airs comme une plume et dans le trouble qui l’épuisait, lui ôtant les sens et les mots, il ne restait plus que la conscience de son mal qu’il manifesta en affirmant :
– J’ai une horrible crise de typhus.
6
Il se réveilla, les idées encore plus sombres et embrouillées doutant même de ce qu’il voyait. On le sortait de la prison et on l’emmenait attaché à une corde qu’on lui avait fixée au cou. Le chemin était rude, les herbes et les cailloux, coupants. Les pieds du pèlerin saignaient et à chaque instant, il trébuchait et tombait se relevant aux prix de beaucoup d’efforts et tiré par les secousses impitoyables de ceux qui tenaient la corde. Il vit Beatriz, transfigurée. Sa beauté ordinaire devenait une beauté céleste qui n’avait pas son pareil sur la terre. Un anneau de lumière très pure ornait son visage. Ses mains blanches, immaculées, ses pieds immaculés marchaient sur les pierres comme sur des nuages, ses vêtements resplendissaient des douces couleurs de l’aurore.
Il ne voyait pas les autres personnes qui l’accompagnaient. Il entendait leurs voix tantôt compatissantes tantôt haineuses et cruelles, mais les corps se perdaient dans une atmosphère vaporeuse, épaisse et suffocante où se mêlaient les soupirs, l’angoisse et les sueurs de l’agonie… Soudain, il se fit un soleil ardent et Nazarín put voir que venait vers lui un groupe de gens malveillants, des hommes à pied, à cheval, armés d’épées et d’armes à feu. Derrière ce premier groupe, il en vint d’autres, puis d’autres, jusqu’à former une formidable armée. La poussière que soulevaient les pas des hommes obscurcissait le soleil. Ceux qui emmenaient le prisonnier passèrent à l’ennemi, car toute cette troupe était une troupe ennemie. Ils venaient tous contre lui, contre le saint, contre le pénitent, contre l’obscur mendiant, avec cette rage sanguinaire, avides de le détruire et de l’anéantir. Ils l’attaquèrent avec sauvagerie, et le plus étrange, c’est qu’après avoir déchargé sur son pauvre corps des milliers de coups et l’avoir tailladé de toutes parts, ils ne parvenaient pas à le tuer. Lui, pourtant, ne se défendait pas, pas même en les égratignant comme le font les enfants, mais tant de gens aguerris ne pouvaient rien contre lui. Des milliers de coursiers passèrent sur son corps, des roues de chars belliqueux, mais ce grand tumulte qui aurait pu détruire une assemblée entière de pénitents et d’ermites errants ou sédentaires ne fit pas tomber un seul cheveu du bienheureux Nazarín, ne lui fit pas perdre une seule goutte de sang. Furieux, ils s’acharnaient, augmentant leurs coups de couteaux, et de l’horizon en tempête, venaient des hordes et des hordes de cette humanité barbare et destructrice.
La guerre féroce n’en finissait pas, car plus il résistait, plus son immunité miraculeuse tenait devant les coups féroces, plus les coups de l’universelle canaille se renforçait. Mais pouvait-elle détruire le saint, l’humilié, l’innocent ? Non, mille fois non. Lorsque Nazarin commença à craindre que la foule de ses contradicteurs allait parvenir non pas à le tuer, mais du moins le jeter en prison, il vit que de l’Orient, Ándara venait transfigurée en femme magnifique et courageuse guerrière, impossible à imaginer. Elle était vêtue d’une armure resplendissante, un casque semblable à celui de Saint Michel, d’où partaient des rayons de soleil en guise de plumes, elle chevauchait un coursier blanc dont les pas résonnaient comme le tonnerre, dont la crinière au vent claquait comme une averse terrible, et dans une telle course, elle emmenait la moitié du monde comme un ouragan déchaîné. La terrible amazone tomba au milieu de la foule désordonnée et de son épée de feu fendait et détruisait la masse des hommes. Qu’elle était belle cette femme guerrière dans un tel combat ! Elle n’était aidée dans sa lutte que par le Sacrilège qui était devenu lui aussi un jeune soldat aux allures divines. Il la suivait abattant sa massue et détruisant des milliers d’ennemis. En peu de temps ils vinrent à bout des cohortes anti-nazaristes et la guerrière céleste, rayonnante de bravoure et d’inspiration belliqueuse criait : «Arrière, foule abjecte, armée du mal, de l’envie et de l’égoïsme. Vous serez défaits et anéantis si vous ne reconnaissez pas en mon Seigneur le saint, l’unique voie, l’unique vérité, l’unique vie. Arrière, vous dis-je, je peux me surpasser et vous transformer en poudre et en fange sanglante et vos restes serviront à féconder les nouveaux sillons… C’est là que régnera celui qui doit régner, putain !»
Tout en disant cela, son épée à elle et la massue de l’autre champion nettoyaient la terre de cette plaie immonde, et Nazarín commença à marcher au milieu des flaques de sang et d’une bouillie de chair et d’os qui jonchaient le sol. L’angélique Beatriz regardait de sa tour céleste le champ de la mort et du châtiment et implorait de sa voix divine le pardon pour les méchants.
7
La vision disparut et tout reprit les allures de la triste et vaporeuse réalité. Le chemin rugueux était à nouveau comme avant et ceux qui accompagnaient Nazarín au martyre retrouvèrent leurs formes et leurs vêtements, les gardes étaient redevenus des gardes et Ándara et Beatriz, des femmes tout ordinaires : l’une batailleuse et l’autre pacifique, leur foulard sur la tête. Vint un moment où, malgré tous ses efforts, le vénérable pèlerin ne pouvait plus avancer d’un pas. Sur son front luisait une sueur d’angoisse, il avait mal à la tête comme si on lui enfonçait une hache et sur son épaule droite, il sentait un poids insupportable. Ses jambes flageolaient et ses pieds meurtris laissaient des petits bouts de peau sur les pierres du chemin. Ándara et Beatriz le portèrent dans leurs bras. Quel repos ! Quel soulagement de se sentir comme une plume qui flotte au vent ! Mais peu après, les deux femmes n’en pouvaient plus, et le voleur sacrilège, un fort gaillard résistant le prit dans ses bras comme on prend un enfant ; il disait que non seulement il le porterait jusqu’à Madrid, mais qu’il pourrait bien le porter au bout du monde s’il le fallait. Les gardes avaient pitié de lui et croyant le consoler, lui disaient :
– Ne vous en faites pas, mon père, là-bas on mettra tout sur le compte de la folie. Les deux tiers des condamnés qui passent entre nos mains échappent au châtiment, s’ils méritent un châtiment, car on dit qu’ils sont fous. Et à supposer que vous soyez un saint, on ne vous lâchera pas à cause de votre sainteté mais à cause de votre folie. On raffole aujourd’hui de la raison de la déraison[2], je veux dire que c’est la folie qui fait les sages et les ignorants, ceux qui se distinguent des autres, par le haut ou par le bas.
Nazarín vit qu’on arrivait dans une rue en pente et les gens s’arrêtaient pour le voir passer dans les bras du Sacrilège. Ses deux compagnes de pénitence marchaient à côté et derrière venaient les autres malheureux que la Garde Civile avait ramassés en chemin. Il avait des doutes, comme auparavant, toutes ces choses et ces personnes qu’il voyait sur son chemin de douleurs, était-ce la réalité ou la fiction de son esprit troublé ? Au bout de la rue, il vit que s’élevait une immense croix et s’il se réjouit un instant d’y être crucifié, il se reprit vite pour dire : «Je ne mérite pas cela, Seigneur, je ne mérite pas l’honneur extrême d’être sacrifié sur votre croix. Je ne veux pas ce genre de supplice où le gibet est un autel et l’agonie se transforme en apothéose. Je suis le dernier des serviteurs de Dieu, je veux mourir, oublié et méconnu sans être entouré des foules, sans avoir la couronne du martyre. Je veux que personne ne me voie mourir, je ne veux pas qu’on parle de moi, qu’on me regarde, qu’on ait pitié. Loin de moi toute cette vanité. Loin de moi la vaine gloire du martyre. Si je dois être sacrifié, que ce soit dans la plus grande obscurité et dans le plus profond silence. Que mes bourreaux ne soient ni poursuivis ni haïs, et que Dieu seul soit à mes côtés car Lui me recevra, sans qu’on révèle ma mort à grands renforts de trompettes, d’annonces dans les journaux, je ne veux pas être chanté par les poètes, ni qu’on fasse de ma mort un événement bruyant au grand scandale des uns et à la grande joie des autres. Qu’on me jette à la décharge et qu’on me laisse mourir ou bien qu’on me tue sans bruit et qu’on m’enterre comme une pauvre bête.»
Ceci dit, la croix disparut et la rue et les gens. Au bout d’un certain temps qu’il ne sut mesurer, il se retrouva complètement seul. Où était-il ? On aurait dit qu’il reprenait connaissance après une profonde torpeur. Il avait beau regarder autour de lui, il ne savait pas bien déterminer dans quelle partie de l’Univers il se trouvait. Etait-ce la région de la vie transitoire ou la vie éternelle ? Il pensa qu’il était mort puis il pensa qu’il vivait encore. Un ardent désir de dire sa messe et de se mettre en communion avec la Suprême Vérité emplit son cœur et se sentir et se voir revêtu des habits sacerdotaux au pied de l’autel fut tout un ; c’était un autel pur qu’aucune main humaine n’avait touché. Il célébra l’office avec une immense piété et au moment de prendre dans ses mains l’Hostie, le divin Jésus lui dit :
– Mon petit, tu vis encore. Tu es dans mon saint hôpital et tu souffres pour moi. Tes compagnons, les deux filles perdues et le larron qui suivent ton enseignement sont en prison. Tu ne peux pas célébrer la messe, je ne peux pas être avec toi en chair et en os, et cette messe n’est qu’une image de ton esprit malade. Repose-toi, tu l’as bien mérité.
Tu as fait quelque chose pour moi. N’en sois pas mécontent. Je sais qu’il t’en reste beaucoup à faire.»
Santander, San Quintin. Mai, 1895
[1] Les «casas a la malicia» étaient une manière de construire à Madrid au XVIème et XVIIème siècle, suite à un règlement qui obligeait à mettre la moitié des places disponibles à disposition d’un fonctionnaire du roi. Pour éviter cette contrainte, on construisait une façade à un étage, mais derrière, il pouvait y en avoir plusieurs…
[2] Allusion à don Quichotte, I, chap. 1