No hay productos en el carrito.

Traduit par Claire Nicolle Robin
1
José Antonio de Urrea ne se faisait pas à sa solitude, car depuis le moment de la disparition de la Comtesse de Halma, arrachée de sa présence dans un char à banc, pas un char de feu, il vivait plongé dans un océan de tristesse, sans autre passe temps que mesurer d’un œil languide l’ampleur du vide urbain qui l’entourait. Madrid, avec toute son agitation et les mille charmes de la vie sociale, avait fini par être pour lui une steppe, dans l’aridité de laquelle il ne pouvait cueillir aucune fleur, ni celle du bien ni celle du mal, pour se consoler. Il passait ses journées couché sur le sofa, ruminant son amer dégoût de la lecture, du travail, même de la méditation. Le soir, il se lançait hors de chez lui, cherchant à soulager sa mélancolie en vadrouillant sans arrêt par les rues et les places. Il n’avait pas remis les pieds ni le soir ni la journée chez ses parents, envers lesquels il ressentait une indifférence proche de l’horreur. Ses amis intimes d’antan, compagnons de débauche, lui étaient devenus antipathiques et il les fuyait comme le choléra. De ses amitiés de l’autre sexe, n’en parlons pas : elles lui étaient, plus qu’antipathiques, odieuses. Malgré tout, une nuit son ennui fut si profond et si vif son désir de trouver quelque chose avec quoi son cœur puisse se distraire, qu’il se laissa tenter par le démon des souvenirs. Il avait pu croire un moment qu’en rafraîchissant d’anciennes amitiés, il se consolerait ; mais il ne fit qu’arriver aux portes du vice et il recula effrayé. Les tentations ne faisaient qu’exciter son imagination, mais sans pouvoir vaincre la forteresse de sa volonté.
Un autre aspect fort singulier de son esprit était que toutes les personnes qu’il connaissait, s’étaient transformés dans son critère social autant que dans ses affects. Le cousin Feramor n’était qu’un pantin, une intelligence secondaire, pétrifiée dans les formules du positivisme et vernissée par la politesse anglaise ; Consuelo et María Ignacia, deux bêcheuses, chez qui on trouvait la vulgaire commère, pour peu que l’on gratte un peu la mince pellicule aristocratique qui les recouvrait ; des femmes sans foi, sans chaleur morale, ignorant tout ce qui était grave et sérieux, ne connaissant que les frivolités qui les auraient conduites à la débauche, au vice même, si le milieu social et la position de leurs maris respectifs ne les retenaient pas ; la marquise de San Salomó, une snob dans tout le sens du terme, qui voulait jouer les grands rôles avec une fortune médiocre, qui se donnait des airs de femme supérieure parce qu’elle maraudait des phrases dans des romans français et qu’elle avait dans ses soirées une demi-douzaine d’hommes à la fois politiciens et gens de lettres qui possédaient un certain chic pour dire du mal du prochain : Zárate, un savant rasoir, qui collectionnait les noms d’auteurs étrangers et les titres d’œuvres scientifiques, comme les gamins collectionnent des timbres et des boites d’allumettes ; Jacinto Villalonga, un politicien corrompu, de ceux qui empoisonnent tout ce qu’ils touchent et font de l’Administration une foire d’empoigne où chacun se sert ; Severiano Rodríguez, encore un drôle, mal revêtu d’une dignité hypocrite ; le général Morla, un Diogène dont le tonneau était le casino ; le marquis de Casa-Muñoz, une oie, digne d’habiter sur les étangs du Retiro[1] ; et de la même manière, tous ceux qui, autrefois, provoquaient en lui envie ou estime, se dégradaient à ses yeux, au point que lui, José Antonio de Urrea, considéré avec mépris et pitié, se considérait maintenant supérieur à eux tous. Pour lui, toute l’Humanité se condensait en une seule personne : la céleste Catalina de Halma, résumé de toute ce qui existe de bien dans notre Nature, le mal étant absolument exclu ; avec l’absence, que la dame elle-même lui avait imposée comme dernière étape de son processus éducatif, la figure morale et religieuse de sa maîtresse prenait des proportions colossales dans l’âme du disciple, et la vénération qu’il ressentait à son égard frisait le délire. Ses insomnies étaient un martyre et une consolation, parce que dans la solitude de la nuit, son cerveau excité savait tromper la réalité, en entendant la propre voix de Halma et en voyant entre de vagues clartés la figure même de la noble dame. « Je vais finir complètement fou » se dit-il un matin, et en le disant, il prit la décision téméraire qu’il devait mettre fin à sa solitude. Il ne s’arrêta pas pour y réfléchir davantage, afin de ne pas s’en repentir, et en l’espace de quelques heures ils vendit ses instruments de zincographie et d’héliogravure, céda la maison, arrangea un petit bagage, et une fois liquidées quelques affaires courantes, il s’en alla chercher des informations pour la diligence de Aranda. « Je n’en peux plus, je n’en peux plus –disait-il en courant de rue en rue-. Je lui désobéis ; mais elle me pardonnera, si elle veut bien. Et si non, j’affronte sa colère. Tout plutôt que ce vide dans lequel je meurs. »
La diligence pour Aranda était déjà partie, quand il arriva à l’Agence, et ne voulant pas attendre vingt-quatre heures de plus pour se lancer hors de Madrid, qui avait fini par être son Purgatoire, il prit un billet pour une diligence qui à l’aube partait pour Torrelaguna. Impatient de partir, la nuit lui parut très longue. Une heure avant le départ, il était déjà à l’Agence, craignant de rater la diligence. Ce que fit cette dernière, c’est retarder d’une demi heure le départ, mais à la fin, grâce à Dieu, notre homme se vit sur le siège avant, près du postillon, et les maisons de Madrid, les unes après les autres, restaient derrière lui, oh joie !, et derrière restèrent aussi les réservoirs de Lozoya[2], et les petites maisons des inspecteurs de l’Octroi à Cuatro Caminos et Tetuán[3] ; ensuite, tout n’était que champs, la steppe du nord de Madrid, par endroits émaillée d’un vert riant, bijou des premiers jours d’avril, et limitée par le grandiose panorama de la Sierra. Son cœur se gonflait, l’air ensoleillé et pur lui remplissait les poumons de vie. Depuis son enfance il ne s’était pas vu aussi content et n’avait pas joui d’un matin aussi heureux et splendide. Il se sentait enfant, chantait en duo avec le postillon, et la seule chose qui, de temps à autre, obscurcissait le soleil de son bonheur, était la crainte qu’Halma ne se fâche à cause de sa désobéissance.
Et à la vérité, le destin, ou pour parler chrétiennement, la Providence divine, ne lui furent pas favorable dans ce voyage, sans doute pour punir son indiscipline, parce qu’avant d’arriver à Alcobendas, l’une des bêtes de trait (l’histoire dit que ce fut la Gallarda) fit connaître son inébranlable résolution de ne pas continuer à tirer la diligence, sans doute à cause de brouilles et de frictions avec le postillon. Et ni les furibonds arguments, que ce dernier lui appliquait sous forme de coups de bâton, n’arrivaient pas à la convaincre du préjudice que son obstination causait aux voyageurs. De fil en aiguille, l’arrêt d’Alcobendas, qui devait être bref, dura une bonne heure, et ensuite, et en fin de compte, il s’avéra que le canasson qui avait remplacé la Gallarda boitait horriblement. Urrea pensait arriver à San Agustín à midi, et à deux heures il manquait encore un bon bout de chemin. Mais le pire fut que, à environ un tir de fusil au-delà de Fuente el Fresno, une des roues dit, avec un craquement formidable, qu’elle se laisserait réduire en morceaux plutôt que de faire un tour de plus, et voilà nos voyageurs debout, sans savoir s’ils devaient rester ou retourner au village par où ils venaient de traverser. Urrea n’hésita par une minute, et confiant sa valise au postillon pour qu’il la laisse à San Agustín, il se mit à marcher résolument vers ce bourg. En marchant à bonne allure, il arriverait à la fin de l’après-midi, et c’était bien le diable s’il ne trouvait pas une monture pour l’emmener à Pedralba.
Il marcha à une allure soutenue et sans ressentir de fatigue, et alors qu’il pensait avoir parcouru plus d’une lieue, il demanda à un homme qui allait dans la même direction sur un petit âne :
– Mon brave ami, suis-je encore très loin de San Agustín ?
– Environ une petite demi-heure.
– Pourrais-je trouver là-bas une monture pour aller à Pedralba ?
– A Pedralba, monsieur…, à la maison des fous ?
– La maison des fous !
– Ouais, c’est une façon de parler. Nous l’appelons ainsi depuis que s’y trouve cette dame qui a amené je ne sais combien de détraqués pour les soigner.
– Doña Catalina, comtesse de Halma, que tout le pays respectera et vénérera comme une sainte.
– Et moi, je vous affirme, monsieur, que, sauf votre respect, c’est comme je vous le dis. Savez-vous ce que l’on raconte dans le village ?
– Quoi, mon ami, quoi ?
– Que cette doña Catalina est reine, oui, monsieur, une reine ou une impératrice de l’étranger de là-bas très loin, et qu’il ya eu une rigolution, et que pour cela ils l’ont chassée du trône, et que le très Saint Père l’a envoyée ici pour faire pénitence. C’est ça qu’ils disent ; moi, je ne sais pas.
– Des histoires. Mais, enfin, pourrai-je aller à cheval à Pedralba ?
– Vous le dire pour de sûr, je ne puis, monsieur. En arrivant, vous verrez la question. Pour les chevaux, il faut voir le curé.
– Don Remigio Díaz, n’est-ce pas cela ? Je le connais de nom et par la réputation de son mérite. Et monsieur le curé pourrait me procurer… ?
– Pour en avoir, il en a : un bidet, et pour être plus précis, une ânesse, sœur de celui-ci. Et si monsieur est fatigué et veut monter un peu ….
Et sans attendre la réponse, le débonnaire paysan descendit, offrant son âne au monsieur. Urrea n’hésita pas à l’accepter, plus que par fatigue, pour ne pas refuser une attention aussi courtoise. Menant sa monture au rythme de son maître, José Antonio continua à demander des informations sur les habitants de Pedralba.
– Et celle que vous croyez reine a dû venir dans un carrosse magnifique, escortée de laquais et de serviteurs…
– Non, monsieur… Quelle rigolade ! Elle est venu dans un char. Il semble qu’elle ait fait le vœu de vivre comme une pauvre tant qu’on ne lui rendra pas le royaume qu’on lui a enlevé. D’abord est arrivé un chariot avec des meubles, des coffres de vêtements et des choses pour la toilette des grandes dames. Ils ont amené un miroir de plus d’un mètre, et beaucoup d’autres ornaments de palais royaux. Après, le chariot est revenu amenant la dame, toute habillée en noir comme la Vierge de la Solitude.
– Et ces fous qu’elle loge chez elle, ils sont arrivés avant, je crois.
– Oui, monsieur. C’est Cecilio qui les a amenés, et ils sont là, en liberté. On dit que l’un est un curé voyageur, et l’autre le premier musicien de la chapelle des palais abandonnés d’Angleterre. De l’une des femmes, on dit que c’est une folle médecin, et qu’elle guérit toutes les maladies de flatulence simplement d’un regard, et de l’autre, on dit qu’elle a la main la plus habile pour saler les cochons que la dame ait eu dans son royaume.
– Bon –dit Urrea, en s’arrêtant et en descendant du bourricot-. Je me suis reposé. Grand merci, et remontez en selle, parce que, si je ne me trompe pas, nous sommes tout près, et ces maisons que l’on voit là-bas sont les premières maisons du village.
– C’est tout à fait vrai. Nous arrivons –dit le paysan, en jetant un regard vers un groupe de gens qui, entre les arbres, à droite de la grand’route, s’en approchait-. Monsieur, monsieur… Voilà don Remigio, notre roublard de curé…Je dis roublard parce qu’il connaît plus de tours que Merlin l’Enchanteur. Regardez-le : il se dirige vers nous et vous regarde beaucoup.
Urrea vit que s’approchait de lui, se détachant du groupe d’un pas pressé, un prêtre jeune, pétulant, le manteau accroché aux épaules, un bonnet de velours noir sur la tête et portant un bâton noueux. Le madrilène ôta son chapeau pour le saluer, et le jeune curé lui demanda avec une extraordinaire vivacité s’il était don José Antonio de Urrea.
– Votre serviteur, monsieur le curé.
– Halte-là. Considérez-vous comme prisonnier –dit le prêtre sur un ton qui mêlait l’humour et la parfaite courtoisie-. Pas un mot, vous venez avec moi à la prévention, monsieur de Urrea, où je vous ai préparé un modeste lit pour vous reposer, un dîner frugal et un jument pour vous emmener à Pedralba.
– Monsieur le curé, que de gentillesse ! Mais permettez-moi de m’étonner de cette prévision qui semble surnaturelle. Je n’ai pas annoncé mon voyage.
– Mais ce que vous n’annoncez pas, parce que vous êtes venu comme un collégien qui fait un fugue, d’autres les devinent.
– Je ne comprends pas.
– Madame la comtesse m’a dit hier : « J’ai laissé à Madrid un cousin à moi un peu fou-fou, avec l’ordre absolu de ne pas bouger de là-bas, pour ne pas négliger les obligations que je lui ai imposées. Mais je le connais, il va se fatiguer, et il voudra venir me voir, sous prétexte de recevoir de nouveaux ordres. Cela sera aujourd’hui ou demain au plus tard. Quand il arrivera à San Agustín, monsieur don Remigio, faites-moi le plaisir de prendre soin de lui, de lui offrir l’hospitalité s’il arrive la nuit, et de lui procurer une modeste monture pour qu’il vienne à Pedralba. »
– Je suis ravi, monsieur le curé –dit Urrea, fou de joie-. On dirait un rêve, un conte de fées…, et vous le génie protecteur, et moi…, je ne sais à quoi je ressemble moi, le plus heureux des hommes…, et en ce moment le plus reconnaissant des voyageurs.
2
Ils se dirigèrent vers la maison rectorale escortés par les gens qui étaient allés se promener avec don Remigio, et celui-ci fit les frais de la conversation pendant le trajet, avec une pensée sincère à la mémoire du saint don Manuel Flórez, et s’apitoyant sur l’oncle Modesto qui avait dû resté tout triste et solitaire avec ce malheur. A la porte les accompagnateurs prirent affectueusement congé, et don Remigio et son ami improvisé entrèrent.
– Valeriana, Valeriana –cria le jeune curé depuis la porte, et comme était apparue une grosse
femme, qui avait pris de l’âge autant que des kilos, il lui dit- : Voici le monsieur que nous attendions, ou que nous croyions voir arriver de Madrid aujourd’hui, demain, ou après-demain. Nous allons vite dîner, Valeriana, et que monsieur dise ce qu’il voudra ; il a un solide appétit. N’est-ce pas que c’est vrai ?
Urrea remercia poliment, ajoutant avec une certaine timidité qu’il désirait arriver vite à Pedralba.
Restez calme…. Et convainquez-vous que vous êtes séquestré –lui dit le prêtre avec cet humour hospitalier dont usent généralement les riches de la campagne-. Parce que vous croyiez que j’allais vous lâcher si vite ? Monsieur de Urrea se fait des illusions. Ecoutez : il fait déjà nuit, et il n’y a pas de lune ; le chemin d’ici à Pedralba est très mauvais pour aller à pied, et à cheval c’est impossible, parce que le fils du maire a emmené ma monture à Torrelaguna, et à cette heure-ci il n’est pas encore revenu. Donc résignez-vous, et demain, à la fraîche, vous vous en irez, ; en compagnie de votre serviteur, qui doit aussi rendre visite à madame la comtesse.
Que pouvait faire d’autre l’impatient voyageur que se résigner à la volonté de Dieu, représenté à cette occasion par le bon et pétulant don Remigio ? Ils entrèrent dans une vaste pièce, villageoise, cléricale, aux murs blancs, avec des vieilles poutres apparentes au plafond, propre, qui sentait l’église et la grange, avec différents objets religieux en guise décoration, enveloppés de tulle rose pour les protéger des mouches. La fille de la gouvernante apporta une lampe, car il faisait déjà presque nuit, et don Remigio fit asseoir son hôte sur le grand sofa de Vitoria avec sa couverture de percale rouge à ramages, tandis qu’il occupait un fauteuil vert, dont les accoudoirs et le dossier étaient recouverts d’étoiles au crochet[4]. Face à face tous les deux, Urrea put observer la physionomie du jeune prêtre, qui était un homme d’environ trente-cinq ans, très maigre, de taille moyenne, la tête et les mains toujours en mouvement, car il ne parlait pas moins avec elles qu’avec la voix. Sur son visage, se détachait un nez petit, pointu et rouge, sur l’arête duquel reposait maladroitement la monture de ses lunettes, et comme il restait entre celles-ci et les yeux un espace plus grand que la normale, notre homme tantôt baissait la tête pour regarder par-dessus ses verres, tantôt la levait pour regarder au travers. La petitesse du nez l’obligeait à porter sa main vers les lunettes trois ou quatre fois par minute, non pas pour les empêcher de tomber, mais parce qu’entre la main, le nez et les lunettes il y avait cet instinctif signe d’intelligence. Tout le visage avait un teint assez soutenu, et les oreilles plus encore, et son regard révélait finesse, pénétration et un naturel bon et tolérant. Urrea trouva chez don Remigio une extraordinaire ressemblance, sauf dans l’âge, avec la physionomie expressive, inoubliable de don Juan Eugenio Hartzenbusch[5]. Et au cours de la conversation, déjà en confiance, il s’aventura à le lui dire. Don Remigio éclata de rire, et lui répondit :
– D’autres m’ont fait la même observation. Indubitablement, je ressemble à l’illustre poète, au grand érudit et académicien, honneur et gloire des lettres espagnoles. C’est un triste honneur pour moi, parce que la ressemblance du visage rend plus évidente la dissemblance intellectuelle entre un homme d’un si grand mérite et ma très modeste personnalité.
– Oh ! Ne vous rabaissez pas, mon cher –lui dit Urrea allant au devant de cette modestie, quelque peu affectée-. Nous savons, nous savons bien ce que vous valez…
– Par le Ciel, monsieur Urrea !… Et même si un homme valait quelque chose, plus par l’étude que par ses dons naturels, à quoi cela lui servirait-il dans ce bout du monde, dans cet exil ?…
Avec la rapidité de l’oiseau qui saute d’un perchoir à un autre dans l’étroitesse de sa cage, don Remigio sautait d’un sujet à un autre dans la conversation.
– Mais, vous ne savez pas, monsieur de Urrea ? –dit-il, en se levant du fauteuil pour s’asseoir sur le sofa-. Vous ne savez pas qui est mon hôte depuis deux jours ? Quelle surprise je vais vous faire ! Vous ne devinez pas ?
– Non, monsieur.
– Eh bien, le père Nazarín en personne.
Urrea bondit de son siège, et don Remigio en fit autant, et, en se levant, il imposa le silence à son hôte, en lui disant à voix basse :
– Nous allons allez le voir et l’observer sans qu’il s’en rende compte. Venez avec moi.
Il l’emmena dans un couloir tortueux, au bout duquel il y avait une porte à panneaux, petite et solide. La clarté de la cuisine, qui dans l’un des renfoncements sur la gauche se révélait par ses piquantes odeurs, leur permettait de parcourir sans encombre cette partie de la maison, qui, par son irrégularité était un modèle d’architecture paysanne. Avant d’arriver à la porte, qui dès le premier abord avait semblé mystérieuse à Urrea, don Remigio murmura quelques explications à l’oreille de son hôte.
– Dans cette pièce, que mon prédécesseur avait destinée à l’élevage de pigeons, j’ai installé ma très modeste bibliothèque. Notre homme est là. Par ce judas qu’il y a dans la porte, regardez bien, du diamètre d’un douro, vous pouvez le voir…
Le faible rayon de lumière qui venait du judas guida José Antonio, qui, y fixant son regard, vit une pièce, dont il ne put apprécier la grandeur, et au centre de celle-ci, près d’une table, face à la porte, un homme assis… La lumière d’une lampe à huile à deux becs, de ceux qui maintenant sont archéologiques, lui éclairait le visage, et tout d’abord l’observateur ne le reconnut pas. C’était un prêtre, vêtu exactement comme don Remigio, avec un bonnet en velours et une soutane. Il feuilletait un gros livre, et après avoir fixer son attention et son index sur un page, il écrivait rapidement sur des feuilles placées à même le livre.
– Mais ce n’est pas lui… -murmura le visiteur, éloignant son visage du judas.
Le curé lui dit de bien le regarder, et, en effet, après l’avoir beaucoup regardé, José Antonio reconnut et jugea que le prêtre de la bibliothèque était le père Nazarín en personne.
Le prenant par un bras don Remigio reconduisit son hôte au salon pour pouvoir parler en toute liberté, et avant d’y arriver il lui dit :
– Evidemment, vous avez mis du temps à le reconnaître, parce que vous vous le représentiez comme vous l’aviez connu à Madrid, avec une barbe et en habit de mendiant. C’est comme cela que doña Catalina nous l’a amené. A parler franchement, j’étais très curieux de voir cet homme, parce que je connais le livre de ses aventures chrétiennes inouïes qui circule, j’ai lu aussi dans la Presse une grande quantité d’informations autour du procès, et ainsi, dès que j’ai su qu’il était arrivé, je me suis présenté à Pedralba avec mon ami Laínez, le médecin du village. Imaginez notre étonnement, monsieur de Urrea, quand nous lui avons parlé et que nous avons remarqué chez lui un clair discernement, une étonnante sérénité, et une mansuétude évangélique, dont je crois qu’il n’y a pas d’autre exemple. Il est certain, en dépit de ces signes, que la folie existe. Ce n’est pas pour rien que l’on bénit l’eau, et ce n’est pas sans motif que les médecins et la Cour l’ont déclaré irresponsable des actes extravagants qui figurent dans le procès. Mais, malgré tout, monsieur de Urrea, cet homme est arrivé à m’intéresser, je me suis pris d’amitié pour lui depuis les quelques jours que nous nous connaissons, et…, comment dire, je ne le considère pas comme irrécupérable, ni tant s’en faut. La piété angélique de madame la comtesse, et notre modeste coopération finiront par triompher du mal qui s’est infiltré dans le cerveau de notre brave homme, et nous le rendrons équilibré et en bonne santé à l’Église militante, dans laquelle, ou je me trompe beaucoup, ou il peut être un élément d’une grande valeur.
– Mais cette transformation …
– J’y viens. Par mille artifices, j’avais essayé, lors de mes premières visites à Pedralba, d’éveiller en lui l’orgueil, et je n’y suis pas parvenu, non, pas du tout. Nous croyions tous qu’il se plaindrait de ceux qui, d’une manière et d’une autre, l’avaient malmené depuis quelques mois. Rien de tout cela. Ni contre la justice, ni contre la Presse, ni contre personne il n’a prononcé la moindre récrimination, et il ne considère ni cruel ni injuste ce qu’on lui a fait. Ceci est bien bizarre, n’est-ce pas ? Laínez me disait : « Il est très étrange que nous n’observions chez lui pas la moindre lueur de délire de persécution, qui est l’un des symptômes primordiaux… » Si le délire c’est d’aimer sans restriction aucune, et louer et vanter comme des bienfaits les outrages qu’il a reçus, c’est là que peut se trouver le début de la désorganisation cérébrale. Je vous dis que ce cas nous laisse stupéfaits.
– Réellement…
– Eh bien, vous allez voir. Pour le prendre en défaut, je lui dis : « Père Nazarín, ce doit être une grande contrainte pour vous de ne pouvoir maintenant aller pieds nus et en haillons sur les routes. » Réponse : « Pour moi, monsieur don Remigio, aucune situation que m’imposera celui qui doit et peut le faire, n’est une contrainte. J’ai mendié quand j’ai cru que je devais vivre comme les plus malheureux et les plus nécessiteux. Dieu, dans mon cœur, m’ordonnait d’agir ainsi, et aucune loi humaine ne me l’interdisait. Mais, en même temps que la pauvreté, ou avant peut-être, Dieu m’ordonne l’obéissance. J’errais en liberté. La loi humaine m’a barré la route et m’a ordonné de la suivre. J’ai obéis. Je me suis soumis sans mot dire à tout ce qu’il ont voulu faire de moi. J’ai répondu avec vérité à tout ce que l’on m’a demandé. J’étais d’accord d’avance avec la sentence que l’on prononcerait contre moi, quelle qu’elle soit. Ils ont décidé que je suis malade. Ils m’ont donné à choisir, pour mon repos, entre un asile et la demeure patriarcale et champêtre de madame la comtesse de Halma, et j’ai préféré cette dernière solution. Vous me voyez ici tout disposé, aujourd’hui comme hier, à la plus grande obéissance. Madame doña Catalina, et vous, monsieur le curé, par délégation de la loi ecclésiastique, qui maintenant remplace la loi civile pour ma punition, ma correction ou ma guérison, car il doit y avoir un peu de tout, vous êtes les maîtres de mes actions et de ma vie. Je ne suis pas libre, et je ne veux pas l’être, si ceux qui en savent plus que moi décident qu’on ne doit pas me donner de liberté.
– C’est étrange, oui…
– Eh bien vous allez voir. Je lui dis : « Mon cher Nazarín, si madame la comtesse y consent, vous décidez-vous a venir avec moi quelques jours dans ma modeste maison de San Agustín ? » Réponse : « Je ne décide de rien. Je vais là où on m’emmènera. »
– Comme le perroquet du conte ?
– Exactement. Avec la permission de madame, je l’ai amené ici, et chemin faisant, j’ai eu l’idée de le sonder en théologie. Étonnant, monsieur de Urrea. Il s’exprime avec simplicité, sans emphase doctorale ni littéraire, et mon homme est si fort, que je n’ai pas pu l’attraper, si peu que ce soit, pour fausseté de logique ou faux-pas hérétique. Dans ses opinions, pas la moindre trace de démence, mon cher monsieur de Urrea, d’où je déduis, et sur ce point mon ami Laínez est d’accord avec moi, que la folie, si elle existe, ne se trouve pas dans la partie des espaces cérébraux qui sert de véhicule aux idées, mais dans cette partie, dans laquelle passe tout ce torrent des actions, de la conduite, monsieur de Urrea. Est-ce clair ?
– Oui. Mais la transformation personnelle…
– J’y arrive…
La gouvernante annonça que le dîner était prêt.
– Nous y allons. Eh bien, quand il est arrivé ici, je lui ai dit : « S’il est vrai que moi je commande et vous, vous obéissez, ami Nazarín, vous allez sur le champ vous raser et vous habiller avec mes vêtements. » Eh bien, aucun problème. Moi-même je l’ai rasé. Cela a été une crise de rire… Et ma modeste garde-robe et mes chaussures, monsieur Urrea, comme s’ils étaient fait à sa taille. Quand il les mettait, je lui ai dit : « Comme la contrainte de cet habillement civilisé va vous paraître bizarre, habitué que vous êtes à une apparence sauvage et biblique, d’après les journalistes ! » encorer qu’appeler biblique… ! Eh bien, que croyez-vous qu’il m’a répondu ?
– Monsieur le curé –revint dire la gouvernante-, le dîner refroidit.
– Il a dû répondre que l’habit ne fait pas le moine.
– Nous y allons de suite… Et que lui n’avait jamais fait attention aux différences entre ce type de vêtements et les autres. Il a dit encore plus. Monsieur de Urrea, passons dans ma modeste salle à manger… Mot pour mot: « Le vêtement que vous appelez sauvage, monsieur don Remigio, je ne le considérais pas comme indécent au cours de ma vie errante et au milieu de gens très pauvres. Mais ceci ne veut pas dire que je le préfère systématiquement à tous les autres styles et manières de couvrir son corps, car ce serait de l’affectation, et, grâce à Dieu, il n’y a pas de place en moi pour l’affectation. »
– Il nous a dit la même chose un jour à l’hôpital, quand avec les journalistes et beaucoup d’autres personnes qui allions le voir, nous nous sommes permis de l’interroger… Mot pour mot : « Vous pourrez voir en moi tout ce que vous voudrez ; mais l’affectation, vous aurez beau regarder, vous ne la verrez jamais. »
3
Nazarín, que l’on avait appelé pour le dîner, prit place à gauche de notre don Remigio, après avoir salué Urrea avec les formules habituelles de la politesse, sans excès de courtoisie, et sans manifester ni joie ni peine de le voir. On aurait dit que sa présence ne lui causait pas la moindre surprise, soit parce qu’il ne s’étonnait de rien soit parce qu’il avait prévu la visite du protégé à sa protectrice. Le curé bénit le repas, et tous trois attaquèrent la soupe à l’ail, qui était fort condimentée, grasse, relevée et épaisse. Nazarín ne parlait pas sauf pour répondre à ce qu’on lui demandait, et don Remigio mettait tout l’agrément possible dans ses phrases de facile venue. La soupe précéda deux plats substantiels, de volaille le premier, le deuxième de mouton, le tout bien plein d’épices odorantes, succulent, bien fait. Le vin avait un horrible goût de poix. L’odeur de paille brûlée, répandue dans toute la demeure, semblait aller de pair avec celle du repas, et il ne déplaisait pas à Urrea de la sentir et de la mâcher. Ce n’était pas simplement la maison ; le village et la région entière dégageaient cette odeur, que l’étranger croyait porter désormais en lui.
– Pour que notre ami don Nazario ne soit pas oisif –dit don Remigio, parmi d’autres choses-, je lui ai proposé de me faire un résumé du livre très savant du maître frère Hernando de Zárate, Discours sur la patience chrétienne. L’oeuvre se compose de huit livres, chacun desquels contient au moins une douzaine de discours, tous sur le même thème. Il faut qu’il le lise tout entier, en annotant le sens particulier et les explications de chacun sur des feuilles de papier séparées. Eh bien, vous avez là, Monsieur de Urrea, un homme si appliqué , qu’en trois jours il a ingurgité quelque chose comme quarante discours, et le voilà déjà au quatrième livre qui traite…
– Des raisons que nous avons pour être patients et nous consoler dans les épreuves –dit Nazarín sans attacher d’importance à son travail. C’est facile. Nous aurons bientôt fini.
– J’ai l’impression –souligna Urrea ironiquement- que cela doit être extrêmement amusant.
– Il n’y a qu’à mettre en pratique en lisant et en écrivant –remarqua l’homme de la Manche- la vertu même à laquelle le maître Zárate consacre sa grande œuvre.
– Mais vous ne mangez rien, mon cher Nazarín –observa soudainement don Remigio-. C’est toujours la même chose. Parce que Laínez dit qu’il faut que vous mangiez…, du solide, et vous forcer à manger de la viande surtout.
– Monsieur le curé –répondit Nazarín avec timidité-, je mange ce que je peux ; je ne sais pas aller au-delà de ce que mon corps me demande pour se soutenir.
Comme Urrea voulait conduire la conversation sur le thème qui lui tenait le plus à cœur, qui était sa cousine et tout ce qui s’y rapporterait, il interrogea les deux prêtres, se réjouissant d’avance des éloges qu’il espérait entendre sur l’illustre dame.
– Moi je dis en pleine conscience –affirma le prêtre de San Agustín- que je ne crois pas qu’existe au monde une personne d’une vertu plus pure et d’idées plus hautes. Si, d’un côté, je vois en elle une image du grand empereur Charles Quint d’Allemagne et 1er d’Espagne, qui après avoir régné sur les peuples, avoir goûté jusqu’à la satiété toutes les grandeurs humaines, s’enferme dans un humble monastère pour consacrer à Dieu le reste de sa vie, de l’autre, je trouve madame la comtesse de Halma plus grande que ce souverain, car si les biens auxquels elle renonce n’ont pas autant de valeur, la pauvreté et l’humilité qu’elle accepte sont plus méritoires. Madame la comtesse est jeune, et consacre à la charité et à la prière les meilleures années de sa vie. Et je vois une autre grande différence en faveur de notre doña Catalina –ajouta-t-il avec un petit ton pédant-, et c’est que le monarque, maître de la moitié du monde, apporta à la solitude de Yuste, d’après ce que disent les chroniques, d’innombrables serviteurs, des cuisiniers, des maîtres d’hôtel, des écuyers et des laquais, et une bonne quantité de victuailles, pour que dans son exil volontaire, il ne lui manque rien de ce qui flatte le goût d’un magnat dans sa vie palatine. Mais cette dame, qui est venue à Pedralba sur une charrette, n’a apporté que les objets indispensables relatifs à la propreté et au soin d’une noble dame, qui, même dans la pénitence, veut être propre, et son escorte est une cour de mendiants et de gens misérables ou malades, auxquels elle veut consacrer ses soins. Exemple unique, messieurs, exemple inouï, et qui est la plus grande merveille de cette époque de positivisme, de cette époque d’égoïsme, de cette époque de matérialisme.
– Donc –dit Urrea avec une joie profonde- vous convenez avec moi que ma cousine est une exception, humaine, un être dans lequel se révèlent les traits de l’inspiration divine.
– Oui, monsieur, nous en convenons.
– Et notre bon curé pèlerin, que dit-il ?
– Que pourrais-je dire ? –répondit modestement don Nazario, ne voulant rien dire qui serait plus louangeux que ce qui avait été dit par son généreux compagnon-. Que pourrais-je dire après le panégyrique si éloquent que vient de faire monsieur le curé ? Mon verbe est maladroit. Permettez que je dise simplement : Bénie soit de Dieu éternellement, la grande, la sainte comtesse de Halma !
– Amen –dit don Remigio, fermant à moitié les yeux et caressant son verre de vin.
Urrea était sur le point de fondre en larmes.
– Et la décision de madame la comtesse –ajouta le curé- de passer à Pedralba le reste de ses jours est fondamentale. Quelle bénédiction pour ces pauvres lieux oubliés ! Elle m’a dit l’autre jour qu’elle bâtira à Pedralba son sépulcre et celui de ses compagnons qui ne l’abandonneront pas. Ah ! Je vois dans cette grande âme l’amour de Dieu au degré le plus ardent et le plus pur, l’amour de la Nature, l’amour du prochain, et je vois dans le plan de vie de madame une synthèse admirable de ces trois amours.
– Ma cousine a beaucoup souffert –dit Urrea à qui l’enthousiasme nouait la gorge-, elle a subi des humiliations et des tourmùents horribles. Elle a perdu son époux, qui était son grand amour, l’unique consolation de sa vie. A Madrid, comme en Orient, la vie n’avait pour elle que des épines, des tristesses, des chagrins. Sa famille, ses frère et soeur, n’ont pas su mettre un calmant sur les plaies de son âmes. Ils la poussaient vers l’ascétisme, vers l’exil, et la solitude. Ma cousine a commencé à regarder la vie sociale avec prévention et a fini par la détester. Tout cet assemblage d’artifices qui composent la civilisation lui est odieux. La Terre est vide pour elle ; elle veut le Ciel.
– Et elle l’aura –dit don Remigio, avec autant d’assurance que s’il se sentait propriétaire et administrateur des espaces infinis-. Elle aura le ciel. Parce que, pour qui d’autre est le Ciel si ce n’est pour ces êtres de choix, pour ces robustes volontés, pour ces âmes qui ne savent regarder que le bien ? D’après ce que j’ai pu comprendre, mon cher Urrea, madame la comtesse a rompu tout lien avec le monde, c’est-à-dire avec la classe à laquelle elle appartient. Mieux encore ; tout attachement mondain est mort pour elle, afin d’occuper entièrement l’espace de l’amour par l’adoration fervente des choses divines.
– Ça doit être ainsi, sans doute –dit Urrea-, et sa société avec les pauvres, qu’elle traitera comme des égaux, les élevant un peu, et se rabaissant un autre petit peu, fera une communauté prospère, pacifique, heureuse. Notre bon Nazarín ne pense-t-il pas la même chose ?
– Je pense, monsieur don José Antonio, qu’être le dernier des protégés et pensionnaires, le dernier des fils, si on me permet de le dire ainsi, de madame la comtesse de Halma, constitue le plus grand bonheur auquel peut aspirer un être humain, surtout si c’est un triste, un solitaire, un naufragé des tempêtes du monde.
Urrea était si content qu’après le dîner, il les embrassa tous les deux. Ils allèrent se coucher, parce qu’il fallait se lever tôt. Les chroniques racontent que le visiteur ne put pas bien dormir ; d’abord, parce que les draps propres, imprégnés aussi de l’odeur de la paille, étaient un peu rugueux ; deuxièmement, parce que ses idées cette nuit-là refusèrent de lui obéir, et que l’admiration pour l’ascétisme de sa cousine allumait des grandes flammes dans son cerveau. Plus qu’une femme, Halma était une déesse, un ange féminin, et en pensant ainsi, son admirateur n’allait pas plus loin parce que les anges n’avaient pas de sexe ; elle était la sainte féminité, glorieuse et paradisiaque ? Au milieu de toutes ses images, apparaissaient parfois l’austère figure de Nazarín, semblable à un portrait du Gréco, et le visage éveillé de don Juan Eugenio Hartzenbusch, transmué physiquement en don Remigio Díaz de la Robla, curé de San Agustín.
Le prêtre en personne le réveilla au lever du soleil en frappant à la porte et en lui criant du dehors.
– Debout, mon ami, il faut que nous disions la messe et que nous déjeunions avant de partir.
Le visiteur se leva à toute vitesse et quand il arriva à l’église, don Remigio était déjà en train d’officier. Nazarín écoutait la messe à genoux dans le presbytère.
Une demi heure après, ils se trouvaient tous dans la presbytère en train de déjeuner de chocolat, de biscuits et de petis pains, le tout agrémenté d’un fromage blanc très frais de la Sierra. Plusieurs amis virent les saluer avant leur départ, entre autres le médecin don Alberto Laínez et l’alcade, don Dámaso Moreno.
– Vous, monsieur de Urrea, qui êtes sans doute un bon cavalier –proposa don Remigio, avec son extraordinaire mobilité des mains, du nez, des yeux et des lunettes-, vous irez avec le cheval de Laínez, animal qui a du caractère, quoique parfaitement sûr pour celui qui saura la diriger ; moi, je prends mon petit cheval, qui marche comme un ange, et notre ami Nazarín, parce que nous l’emmenons, oui monsieur, nous l’emmenons, il serrera les flancs d’une modeste ânesse…, monture digne d’un archevêque… Donc, messieurs, en selle. Dégagez la porte. Valeriana, nous reviendrons pour le souper.
La caravane s’en alla, accompagnée des saluts amicaux d’une multitude de gens qui s’était réunie sur la place. En tête allaient Urrea et le curé ; derrière, Nazarín, sur son baudet, bien bâté et sans étriers. Les deux prêtres, à califourchon, portaient comme au village, une soutane, un bonnet en velours et un manteau. Le Madrilène dirigeait son cheval avec une grande maîtrise. Don Remigio ne cessait de recommander à sa monture la plus grande circonspection ou délicatesse du sabot dans le mauvais chemin caillouteux sur lequel ils s’étaient engagés, à l’ouest de San Agustin, et don Nazario, confiant dans l’allure parcimonieuse de son ânesse, pensait plus à admirer le paysage de la Sierra qu’à converser avec les autres cavaliers, dont il semblait être l’écuyer ou le domestique.
Don Remigio parla de choses tellement diverses, qu’il n’est pas possible de se souvenir de toutes. Il fit observer à son compagnon les beautés de la Nature, la pauvreté des villages, la négligence dans la culture des terres ; il expliqua les histoires de ruines et des vieilles demeures ; il déplora le manque de communications ; il désigna le lieu où on avait tracé un canal d’irrigation, qui ne serait jamais ouvert, et ces commentaires sur ceci ou cela finirent par des plaintes sur sa malchance, parce qu’il avait dû commencer sa carrière dans une région aussi stérile et un bourg aussi misérable. « Je me résigne, vous voyez bien… Que le Seigneur me donne la santé pour le servir, le reste n’a pas d’importance. Sachez qu’en venant prendre cette cure à San Agustín, ils m’avaient dit que ce serait pour trois mois, et ça fait déjà trois ans. Ils m’ont promis de me muter à Buitrago ou à Colmenar Viejo, et nous en sommes là Ce n’est pas que je sois ambitieux ; mais franchement, je suis licencié en droit canon et en droit civil ; j’aime l’étude, et en vérité, la vie obscure et plan-plan de ces trous n’incite pas au commerce des livres. Mon oncle, qui est le meilleur homme du monde, me remonte le moral, m’affirme qu’il ne cesse de me recommander, et qu’à la première occasion, j’aurai une cure à Madrid, hélas !, son desideratum et le mien aussi. Et surtout, ne me parlez d’autres villes. Mon Madrid de mon cœur, où j’ai grandi, où j’ai goûté le pain de l’étude et j’ai acquis mes modestes connaissances. Je n’aspire pas à jouir là-bas de l’indépendance d’un don Manuel Flórez ; je sais que je dois travailler beaucoup. Je veux que ma petite intelligence ne soit pas un terrain en friche, comme ces jachères que vous voyez autour de nous, monsieur de Urrea ; je dois la cultiver et y cueillir quelques fruits pour les offrir à Dieu, qui me l’a donnée… Je ne me plaindrais pas si je ne voyais pas ces inégalités. Des amis et des camarades à moi, que je ne dois pas, parce que je ne dois pas, allons ! considérer comme supérieurs en savoir religieux ou profane, occupent des postes dans des cathédrales ou dans des paroisses de Madrid… Mon oncle me dit : « Ne t’inquiète pas, mon garçon, et aie confiance en Dieu et en la Très Sainte Vierge, parce qu’ils vont récompenser par un avancement mérité ta patience et ta résignation… » Bien sûr, je me résigne, monsieur de Urrea, et je loue le Seigneur de ne pas me donner de plus grands maux. J’ai, grâce à dieu, un caractère capable de supporter les malheurs, les injustices et les déboires. Je me dis : « Un jour la chance me sourira, pas vrai ?, un jour la chance me sourira. »
Le visiteur essayait de raviver ses espérances, affirmant que les mérites de son interlocuteur, tant moraux qu’intellectuels, sautaient aux yeux, et ne pouvaient rester méconnus de ceux qui à Madrid tirent toutes les ficelles du personnel ecclésiastique. Et, en disant cela, il fit remarquer la différence entre les goûts et les aspirations de l’un et de l’autre car, si ce que l’on appelle les centres de civilisation, attirait don Remigio, à lui, ces centres lui inspiraient une profonde aversion, et son désir le plus profond était de ne plus les voir. Il est vrai qu’entre la situation de l’un et de l’autre, il n’y avait aucune ressemblance : don Remigio était un homme pur et vertueux, avec une intelligence pleine de fraîcheur, et à trente-cinq ans, il n’avait fait qu’effleurer la vie, tandis que lui, au même âge, se tenait pour vieux, et il se serait considéré même comme mort, si au milieu des cendres de son âme il n’avait pas senti que lui naissait une âme nouvelle. Avec ces conversations, le chemin aride, sans le moindre attrait pour le voyageur, défila. Le sol était de plus en plus accidenté, car on était sur les contreforts de la Sierra, et il étalait sa sévère végétation de petits chênes verts, de fougères et de thym. Soudain, don Remigio signala un groupe de maisons, proche de collines couvertes de verdure, et il dit à son compagnon : « Voilà Pedralba . » Le lieu sembla enchanteur à Urrea et le paysage splendide, alors qu’il regardait plus à l’intérieur de lui-même que le paysage proprement dit.. En s’approchant, ils virent des terres de culture près des maisons, de grandes bâtisses délabrées, qui étaient au nombre de trois. Ils éperonnèrent leurs montures, et alors qu’ils se trouvaient à environ cinq cents mètres, Nazarín commença à crier :
– Regardez-les, regardez-les : elles sont là-bas…, maintenant elles nous ont vus.
– Qui, donc ?
– Madame la comtesse et Beatriz.
– Où ça ?… Quelle vue il a, cet homme.
– Là-bas…, là-bas… Vous voyez ce champ de coquelicots, tout rouge, tout rouge ? Et plus loin, ne voyez-vous pas des ormes ? Eh bien c’est par là qu’elles vont…, je veux dire, qu’elles viennent, parce qu’elles viennent à notre rencontre.
– Nous ne voyons rien ; mais puisque vous le dites …
– Et maintenant, elles nous saluent de leurs mouchoirs. Regardez, regardez.
4
Non loin maintenant des maisons, ils virent les deux femmes qui avançaient au milieu d’un champ d’orge. Toutes deux regardaient en souriant, et presque moqueuses, les trois messieurs. Quand Urrea, descendant de cheval devant sa cousine, lui demanda pardon de lui avoir désobéi en se mettant presque à genoux, doña Catalina ne se montra pas très sévère à son égard, sans doute pour ne pas lui faire honte devant deux prêtres et d’autres personnes qui vinrent les rejoindre.
– S’il y a eu faute, madame la comtesse –dit don Remigio avec esprit-, j’intercède pour le coupable et je demande son pardon.
– Le coquin sait bien de quels parrains il se sert –répliqua Halma, en souriant, et tous ensemble, après que les cavaliers aient eut remis leur montures à Cécilio, ils prirent le chemin du château, car c’est ainsi que l’on appelait dans la région la grande bâtisse, quoique de château, elle n’ait eu que la robustesse de ses murs et une tour écornée, dans la partie haute de laquelle, mal recouvert de tuiles, se trouvait un pigeonnier. De l’écusson des Artales, c’est à peine s’il en restait quelques vestiges sur le balcon de dénommé château. La pierre était si sensible au froid que l’on pouvait seulement voir une serre de dragon et un bout de la légende, qui disait : Semper. Le granit des angles et des voussoirs était en meilleur état, et la brique crépie des parements n’était pas laide ; mais tous les fers, les balcons et les grilles, étaient pourris de rouille; pour cette raison, la propriétaire avait décidé de les remplacer, tandis qu’un bon maître d’œuvres de Colmenar mettait en chantier la réparation de l’ensemble de l’édifice. On voyait, en face de la maison, à l’intérieur de l’enceinte murée qui précédait l’entrée, le tas de chaux battue et les poutres pour les échafaudages et les travaux de charpenterie. Près de la tour, se dressaient les murailles décharnées que la tradition désignait comme les ruines d’un monastère cistercien, et qui plus qu’un édifice à demi détruit, ressemblait à une maison à moitié terminée. En respectant les soubassements et en utilisant le matériel de ce qui restait, la comtesse pensait construire là sa chapelle et son panthéon, avec la plus grande économie possible. À un jet de pierre de la maison-château se trouvaient les écuries, et plus bas, un troisième édifice, habité par ceux qui avaient loué la propriété jusqu’à l’année antérieure.
Ces derniers temps, Pedralba avait été à la charge de l’administrateur des propriétés de Feramor à Buitrago, don Pascual Díez Amador, lequel remit la propriété du château et des maisons et des terres à madame doña Catalina le jour de son arrivée dans la charrette, qui avait été le 22 mars de l’année mille huit cent quatre-vingt dix et des poussières.
La propriété de Pedralba était très vaste, mais on ne cultivait que les terrains proches de la maison, et d’une manière négligée, sommaire et primitive, qui produisait un faible rendement. Le reste n’était que forêt, riche en chênes vers, genévriers avec quelques châtaigniers dans le haut. La partie la plus proche de la plaine avait subi plusieurs coupes, et un des fermiers avait proposé au marquis, des années auparavant, de la défricher. Mais le coût de l’entreprise effraya le marquis et tout resta en l’état, ni forêt ni culture ; par endroits, une prairie pleine de trous, traversée de tenaces genêts. Deux sources très abondantes alimentaient Pedralba de leurs eaux potables pures et cristallines : l’une, entre la maison-château et les écuries ; la seconde, source de premier ordre, dans un vallon, à côté la forêt. Il y avait peu d’arbres pour faire de l’ombre. Ceux qu’avait mis le dernier fermier étaient morts par incurie. Des arbres fruitiers, il n’en existait que trois dans une aussi vaste propriété : un immense mûrier derrière la tour, qui se chargeait, tous les ans, de mûres noires très sucrées, et de deux abricotiers sur le sentier qui unissait les deux maisons. On n’incluait pas dans le registre des fruitiers les arbousiers disséminés dans différents endroits, à cause de leur vigueur sylvestre et l’amertume de leurs fruits. Tel était Pedralba, propriété de tout premier plan, selon l’opinion de don Pascual Díez Amador, du moment qu’on voulût bien y mettre vingt ou trente mille douros.
Tels n’étaient pas les projets de Catalina, qui s’était seulement proposé de maintenir la propriété telle qu’elle l’avait trouvée, avec les améliorations qu’imposait le fait d’y résider, et y chercher la vie retirée et humble qu’elle souhaitait adopter, sans tomber dans la tentation de la rentabilité agricole ni penser à augmenter ses revenus, ce qui aurait démenti ses idées et ses desseins d’une existence très modeste. Ce qui restait de sa dot, elle pensait le conserver en titres de rente, en en réservant les deux tiers pour l’entretien de sa personne et de la maison ainsi que de la famille de malheureux qui s’était réunie autour d’elle ; le dernier tiers, elle le consacrait aux réparations indispensables, à la construction de la chapelle et aux enterrements, à planter un potager, et s’il restait quelque chose, à améliorer la propriété.
Entrons maintenant dans le château et visitons la pièce la plus agréable, qui était la cuisine, au rez-de-chaussée et au fond de l’édifice, dans la partie Nord. Tout était grandiose dans cette pièce : le foyer, les placards, le four, le sol de béton très solide, le haut plafond et le manteau de la cheminée bien construite pour évacuer rapidement la fumée. Les autres pièces d’en bas avaient peu de charme ; elles étaient étroites, et leurs fenêtres, qui ressemblaient plutôt à des meurtrières, laissaient passer très peu de lumière. En revanche, celle du premier étage, en avaient trop. Six ou sept pièces qui, bien arrangées, auraient pu loger beaucoup de gens. A cet étage, du côté du Levant, vivaient la comtesse et Beatriz, dans des pièces séparées et voisines ; du côté de l’Ouest, le ménage Ladislao-Aquilina avec leurs enfants, et ils restaient encore, entre ces dernières et les autres habitations, quelques pièces vides. Dans la tour, en dessous du pigeonnier, Nazarín avait sa chambre, qui communiquait avec la maison-château par un étroit passage. Les meubles étaient presque tous du siècle dernier, ou du temps de Ferdinand VII, mélangés avec des sièges modernes en paille, de ce qu’il y avait de plus commun, ramenés de Colmenar Viejo. Les commodes et les consoles, les chaises d’acajou avec des dossier en forme de lyre, les lits avec des rideaux à la grecque, les gravures avec des cadres en ébène et des sujets pastoraux, offraient un aspect sépulcral, pitoyable, comme celui d’objets déterrés dont on aurait enlevé l’humus de la fosse à grand renfort de savon et de lavette.
Doña Catalina et Beatriz étaient habillées exactement de la même manière, avec les vêtements de la première qu’elle avait mis en commun : une jupe de mérinos noir, grosses chaussures, une blouse de percale à rayures blanches et noires, un tablier en retors. En adoptant la vie pauvre, madame la comtesse n’avait pas estimé nécessaire de renoncer à ses habitues de propreté ; elle disait que le soin extérieur, à cause de l’éducation et de l’habitude, touchait l’âme, et que la saleté du corps était un péché aussi laid que celle de la conscience. Elle n’hésitait pas, donc, à mettre ces idées en pratique, en maintenant dans sa chambre et sur sa personne la même exquise propreté qu’à la plus belle époque de vie à Madrid. « La propreté –disait-elle- est à la pureté de l’âme ce que le rouge est à la honte. » Elle ne comprenait pas l’ascétisme d’une autre manière.
Et comme rien ne vaut la force du bon exemple, Beatriz, qui était parvenue à régner dans l’intimité et l’affection de la comtesse, par une heureuse concordance de sentiments, assimila rapidement les habitudes de soin de son amie et maîtresse, et l’imitait sans s’en rendre compte. A propos de l’admirable sympathie ou compatibilité, qui était arrivée à effacer entre ces deux caractères la différence de classe et d’éducation, il y aurait beaucoup à dire : le phénomène avait commencé par un irrésistible attachement la première fois qu’elles s’étaient vues, par l’entremise de sa bonne Prudencia, elle avait été porter secours à l’accordeur de piano dans son pauvre domicile. Tant qu’avait duré le procès de Nazarín et de ses amis, Beatriz vivait avec sa cousine Aquilina Rubio, épouse du pauvre don Ladislao, en partageant leur pauvreté, à défaut de bien-être, qu’aucun ne possédait. Halma avait apporté le pain, la vie, la santé, à la triste demeure de la rue San Blas, et attirée par ce spectacle de pauvreté et de résignation, elle avait ajouté au secours matériel la consolation de ses visites. Elle avait parlé longuement avec Beatriz, s’étonnant de ce que savait cette humble femmes des réalités spirituelles et de nos relations avec le monde invisible et éternel ; elle s’était étonnée aussi de sa piété sans affectation, de la fermeté de ses idées et de l’éloquence simple avec laquelle elle les exprimait. La comtesse se sentait inférieure, pour tous ces motifs, à celle qu’elle considérait déjà comme une amie de son cœur ; elle avait appris d’elle de nombreuses choses bonnes, lui en enseignant à son tour d’autres sur le plan social plus que religieux, et grâce à cet échange, elles avaient fini par se trouver faites l’une pour l’autre, et toutes deux ensemble, phénomène rare à notre époque, qui offre peu d’exemples de rapprochement aussi radical entre deux personnes de classse sociales opposées. Mais cela, nous le verrons beaucoup en ces temps qui commencent, parce que ce que l’on appelle classe se décompose rapidement, et l’Humanité continue à exister, en tirant de la décomposition des vies nouvelles et vigoureuses.
Et on comprend que de l’intimité entre Beatriz et Halma était né le vif intérêt pour Nazarín et son désir de l’emmener avec elle pour essayer de le soigner et de le rendre, en bonne santé et utile, au pouvoir ecclésiastique. Une divergence accidentelle d’une certaine manière existait entre la dame et la femme du peuple, et c’était que, alors que la comtesse, sans affirmer que Nazarín était fou, avait des doutes sur un point aussi délicat à élucider, la seconde soutenait en conscience et avec une foi sincère l’ordre parfait des fonctions cérébrales de son maître.
Une fois installées à Pedralba, la concordance entre l’une et l’autre finit par être parfaite. Beatriz observait avec délicatesse la distance sociale, que la seconde, avec la même ou une plus subtile délicatesse, tentait de réduire. Toutes deux travaillaient ensemble depuis le premier jour à arranger et nettoyer le château délabré, ou à ressusciter les meubles, et à Beatriz, cela ne lui avait servi à rien de garder pour elle le besognes les plus dures, parce que la seconde envahissait son domaine, et l’égalité triomphait graduellement, par la loi du cœur de chacune qui, sans s’en rendre compte, tendait vers la même fin. Aquilina n’avait pas été encore élevée au grade de communauté de sa cousine Beatriz. C’était une femme excellente, mais sans assez d’intuition pour comprendre les idées de sa bienfaitrice. Elle se maintenait tenacement dans son rang inférieur, contente que son mari et ses enfants aient de quoi manger. Les premiers jours, elles la chargèrent de la cuisine, occupation très appropriée à ses aptitudes, et les deux autres purent se consacrer en toute liberté au nettoyage des meubles anciens, à recoudre des matelas et autres occupations ennuyeuses. Ensuite, elles alternèrent dans les différents métiers, et tandis que la nazariste cuisinait, Halma et Aquilina lavaient le linge à la fontaine voisine. Le jour qui avait précédé l’arrivée de Urrea avec don Remigio et Nazarín, Aquilina avait fait office de cuisinière, et la comtesse et Beatriz lavaient le linge à la fontaine de la colline, se répartissant également le poids du linge à l’aller et au retour. Comme Beatriz s’était obstinée à le porter toute seule, en prétextant d’être plus forte que sa compagne, Catalina lui avait dit : « Tu te trompes si tu crois avoir plus de puissance musculaire que moi. Je semble faible, mais je ne le suis pas, Beatriz, et cette vie va me rendre encore plus robuste. Et surtout, ne me prive pas du plaisir de l’égalité. C’est le rêve de ma vie depuis que j’ai perdu mon époux, et que je me suis sentie égale à tous les malheureux du monde. Fais moi le plaisir de ne pas m’appeler comtesse, ni d’employer à nouveau ce mot stupidement vain devant moi. J’ai jeté la couronne sur le pavé de Madrid quand je suis partie sur la charrette… Les balais des cantonniers ne la trouveront pas, parce que c’est la pensée qui l’a jetée, car elle n’existait pas sous une autre forme ; mais elle est restée là-bas. Appelle-moi Catalina, comme m’appellent mon frères et ma sœur, ou Halma,, comme mon cousin. Et je ne te dis pas de me tutoyer, parce que cela paraîtrait de l’affectation, et tu sais que ton maître te l’interdit. Mais on y arrivera. »
5
L’arrivée des trois amis ne devait pas altérer la marche des affaires domestiques au château, car, la comtesse le disait clairement, vu qu’ils n’aidaient pas, il ne fallait pas qu’ils gênent.
– Mon cousin, je suppose que tu vas avoir envie de connaître cette grande propriété, les domaines de Pedralba, où nous vivons retirés et modestement, sans prétentions d’ascétisme, mes amis et moi. Vous aussi, monsieur don Remigio, il faut que vous preniez connaissance du terrain que je consacre à mon œuvre. Allez, donc, faire une petite promenade, guidés par notre très bon Nazarín, qui le connaît pouce par pouce, tandis que nous vous préparons à manger. Ne vous attendez pas à ce que nous sortions de notre pauvre régime. Ici il n’y a ni ne peut y avoir de festins, car, même si je voulais en donner, il n’y aurait pas de quoi les faire. Vous mangerez notre très frugal ordinaire, avec ce petit peu d’excès que réclame l’hospitalité. Donc allez, allez visiter mon île[6] et rapportez la sauce que nous, nous ne pouvons pas vous donner, un bon appétit.
Ils s’en allèrent tous trois en promenade, conduits par don Nazario, qui les fit monter sur la colline pour qu’ils voient les robustes châtaigniers qui la couronnaient, au ravin pour qu’ils goûtent l’eau de la délicieuse source, et après avoir gambadé et s’être essoufflés en parcourant coteaux et chemins scabreux, ils revinrent à la maison à midi, heure invariable du déjeuner. Dans une pièce à côté de la cuisine, on mit la table, laquelle était d’une robustesse patriarcale en châtaignier noirci et avec des ferrures tordues dans son armature. Il y avait deux chaises de la même nature et du même âge ; les autres variaient entre le style Ferdinand VII, en acajou, et la forme et le matériau appelés de Vitoria. Mais la variété la plus grande et la plus surprenante se trouvait dans la vaisselle et le linge de table, parce que, à côté de verres en cristal très fin, on en voyait d’autres en verre le plus ordinaire, des serviettes élégantes, des serviettes grossières, des plats de fine porcelaine et d’autres en céramique rustique.
– Excusez la variété de la vaisselle –leur dit doña Catalina-. Dans ma salle à manger, règne encore une extraordinaire confusion de classes, comme dans les époques révolutionnaires. Mais cette confusion n’est pas une raison pour oublier la qualité des commensaux. Pour messieurs les deux prêtres, ce qu’il y a d’élégant, qu’ils choisiront eux-mêmes ; pour toi, José Antonio et don Ladislao, la terre plébéienne.
– Eh bien je propose –dit don Remigio avec beaucoup d’esprit- que nous n’établissions pas de différences humiliantes, et que nous nous répartissions comme des frères, comme des fils de Dieu, ce qui est mauvais et ce qui est bon. Donnez moi cette écuelle de terre terre, monsieur de Urrea.
Ce qu’il y eut de plus étrange dans ce singulier repas, fut que les femmes ne s’assirent pas à table. Toutes les trois, fonctionnant avec une égale habileté et une égale gaieté, servaient ces messieurs. Ensuite elles mangeaient à la cuisine. C’était une coutume médiévale, qu’Halma n’altérait jamais, sous aucun prétexte. Elles leur donnèrent une soupe très substantielle, faite de différentes herbes, de pommes de terre coupées en petits morceaux avec des morceaux de chorizo ; ensuite un plat de mouton bien assaisonné, du vin en abondance, en dessert un fromage blanc de la Sierra, du lait avec des biscuit de Torrelaguna, et en avant. Les visiteurs savourèrent avec délice ce déjeuner sobre et nourrissant, et ils ne cessèrent de louer les bonnes manières de Pedralba et la compétence des trois cuisinières.
Entre la soupe et le mouton, était arrivé inopinément don Pascual Díez Amador, l’ancien administrateur de la propriété, et propriétaire voisin, car c’était à lui qu’appartenaient les vastes pâturages qui sont limitrophes de Pedralba à l’Ouest. Deux ou trois fois par semaine, il rendait visite à la comtesse, monté sur son cheval pommelé, pour voir si elle avait besoin de quelque chose. C’était un homme mi paysan, mi seigneur; paysan, par son langage rude, sa chemise sans col et son chapeau rond ; et seigneur, par ses nobles actions,, sa démarche grave, qui faisait grincer les éperons. Une ceinture rouge semblait séparer le villageois du gentilhomme, ou plutôt enlacer les deux parties. Il s’était pris de tant d’affection pour doña Catalina, qu’il avait pris des dispositions afin que deux de ses gardes assermentés soient toujours présents jour et nuit dans la maison d’en bas, pour que madame puisse se reposer, persuadée d’être dans une sécurité absolue. Bien souvent, il arrivait avec son cheval, à l’heure du repas ; d’autres, à n’importe quelle heure, où il mangeait aussi. Son visage rond, épiscopal, gras et mal rasé, lançait des lueurs de patriarcale souveraineté, de conformité à son destin, sans doute parce qu’il était des plus généreux et heureux.
– Bonjour, Remigio !… Madame doña Catalina…, don Nazario…, don Ladislao, nous voici tous là…
Les salutations durèrent même après que le grassouillet gentilhomme campagnard ait prit un siège sans cérémonie, se préparant à manger tout ce qu’on lui donnerait. Parce que, ça oui, un homme avec un meilleur coup de fourchette, il n’y en avait pas dans tout l’arrondissement, avec la particularité remarquable qu’il ne savait pas se limiter quand il buvait.
– Savez-vous de quoi nous étions en train de parler, mon cher don Pascual ? –dit le jeune curé de san Agustín-. Que c’était une grande propriété, et que c’est dommage de ne pas la cultiver.
– Ah,la la, à qui le dites-vous ! Ces messieurs de Feramor sont impardonnables… J’en ai eu des bagarres avec l’actuel marquis et avec l’autre pour qu’ils investissent ici vingt ou trente mille petits douros ! Oui, je vous le dis ; c’était, les semer aujourd’hui pour ramasser demain, dans à peu près cinq ans, trois ou quatre millions. Et cela, simplement avec le bétail, parce que si on commençait à mettre tout en terres de labour…. Jésus, de l’or en barres… ! Ça, c’est une terre qu’il n’y en a pas de meilleure, même là où la Sainte Vierge a mis les pieds, allez !
Don Pacual se fâchait quand il abordait ce point et se voyait obligé de réfréner sa colère avec de copieuses libations. Et comme ils avaient continué a parler de la même chose, il finit par exprimer une idées très audacieuse.
– Moi, si j’étais madame la comtesse…., je dis ce que je sens sans vouloir offenser, allez !…, eh bien, si j’étais madame la comtesse, je laisserais tomber les chapelles et les panthéons et toutes ces histoires d’installer ici un couvent pour des observants circonspects et mendicatifs, et j’emploirais tout mon capital à…
– Doucement –répliqua avec vivacité don Remigio-, cela je ne l’accepte pas. Ce qui est spirituel passe en premier.
– Par les cornes du diable ! Et à quoi sert le spertuel sans le … sans le reste ?
– Moi, si j’étais la comtesse, je persisterais impavide dans mon plan grandiose…, contre l’avis des cul-terreux.
– Et moi, contre l’avis des enfileurs de rosaires, je dis si…, non, je dis non…, je dis si.
– Mais vous ne savez pas ce que vous dites, mon cher don Pascual.
– Allons, paix et concorde entre les princes chrétiens –dit doña Catalina, en souriant-. Par excès de considération envers mes hôtes, je me permets de leur donner une gourmandise : du café.
Après que tous eurent loué et salué le cadeau, Amador et don Remigio parvinrent à trouver une formule de transaction entre leurs points de vue opposés. En servant le café, doña Catalina s’excusa de la pauvreté et de la rusticité du déjeuner, ajoutant qu’une autre fois, ils auraient du bon pain, fait à la maison, et moins de disparités dans la vaisselle et le service de la table.
Pendant que les femmes mangeaient, les hommes sortirent dans la cour, chacun emportant sa chaise, et là, ils discutèrent en formant deux groupes. Don Remigio et Amador parlaient des affaires de Colmenar Viejo, de la mauvaise réputation du curé en titre dans le chef lieu d’arrondissement, et des efforts que faisaient les notabilités pour le faire sauter de là… Naturellement, on ferait ce qu’il faut pour que le jeune curé de San Agustin occupe la place vacante. De l’autre côté parlaient Urrea, don Ladislao et Nazarín, et le premier demandait au second s’il continuait à cultiver la musique dans cette retraite, ce à quoi répondit l’accordeur qu’on ne lui parlât pas de musique ni de contre danse, car il se sentait si content et si joyeux dans sa nouvelle vie qu’il avait pris en horreur tout son passé musical et chevrier. Le meilleur opéra ne valait trois sous pour lui, et même si on lui affirmait qu’il composerait un opéra meilleur que tous ceux que l’on connaissait, il ne voulait pas retourner à Madrid. Nazarín prit la défense d’un art aussi beau, et lui proposa de continuer à le pratiquer ici, car la musique allait fort bien de pair avec la vie champêtre. Et il ajouta qu’il se permettrait de conseiller madame la comtesse de faire amener un orgue, pour que don Ladislao compose des toccatas paysannes et religieuses, et les charme tous avec un art aussi pur et qui remue si profondément les cœurs.
Et avec ces conversations, l’heure du départ était arrivée, et Urrea était rongé d’inquiétude parce qu’il n’avait pas pu parler avec sa cousine, ni celle-ci lui dire de rester, comme c’était son désir. La crainte de se voir répondre par un refus catégorique à son dessein de rester à Pedralba, le troubla de telle manière, qu’il n’eut pas le coeur de le formuler. Une tristesse infinie tomba sur son âme quand Halma lui dit sur le ton du maître d’école :
– Maintenant, José Antonio, tu t’en vas comme tu es venu, et sans ma permission, ne reviens pas et n’abandonne pas tes occupations auxquelles tu devras une indépendance honnête.
Elle prononça ces mots avec une telle autorité, que le bambocheur repenti n’eut pas le courage de s’y opposer et d’exposer son souhait. Il se sentait si inférieur, si enfant devant celle qui le dirigeait dans ses sentiments et dans sa conduite, qu’il ne put pas même lui demander moins de sévérité, ni s’expliquer avec elle sur la lourde et cruelle condamnation qu’elle lui imposait. Il est vrai qu’ils se trouvaient devant Nazarin et les visiteurs, et il n’était pas question de jouer devant eux à l’enfant gâté. Il ne manquait que quelques minutes avant le départ, quand la comtesse dit au jeune curé de San Agustín :
– Monsieur don Remigio, si vous ne vous y opposez pas, notre ami don Nazario va rester au château parce que si l’exercice de l’intelligence est bon pour la santé, l’exercice physique ne l’est pas moins, et il faut alterner. Il finira plus tard ce grand résumé des Discours de la Patience.
– Ce que vous déciderez, madame, est une loi –répliqua don Remigio, avec le pied déjà à l’étrier-. Si notre bon Nazarín préfère rester, qu’il reste… Qu’il le dise. Avec un visage troublé, et presque avec des larmes dans les yeux, le pèlerin répondit :
– Moi, je ne décide de rien.
– Mais, que préférez-vous ?
– Eh bien, la vérité, tout en appréciant beaucoup l’hospitalité de monsieur le curé, et en lui offrant de me mettre à sa disposition pour terminer ces notes et tout ce qu’il voudra bien me commander, aujourd’hui, je préférerais rester, puisque madame la comtesse le désire.
– C’est que…, vous allez comprendre, don Remigio, comme nous avons tant à faire à la maison, j’ai besoin que m’aident mes bons amis. Il faut avoir l’œil à tout, et tous ceux qui vivent ici doivent donner un coup de main pour vaincre les difficulté. Demain, je pense essayer le four à pain, et le démonter, s’il ne nous plaît pas. Donc…
– Qu’il reste, qu’il reste. Vous, vous êtes la sainte mère, vous, vous commandez, et les enfants… qu’ils obéissent en silence. Monsieur Urrea, vous ne montez pas en selle ?
Livide et tremblant, Urrea n’arrivait même pas à prendre congé avec élégance de sa cousine. Il était une machine, pas un homme. Sa tristesse s’emparait de tout son être comme une paralysie, annihilant sa volonté. Il monta à cheval et partit avec le curé et don Amador, sans savoir qu’il existait au monde un village bien nommé, qui s’appelait San Agustín.
6
Tant qu’Amador fut en compagnie des deux voyageurs, c’était un moindre mal. Don Remigio parlait avec lui de monture à monture, laissant l’autre dans la libre solitude de ses pensées. Mais notre brave paysan prit congé à Los Molinos (carrefour d’où partait, le sentier qui menait à ses propriétés de la Alberca), et une fois seuls le curé et le cousin de la comtesse, le premier déchaîna sur le second le torrent de sa loquacité. Avec difficulté, mettant en oeuvre tous ses traits d’esprit, il parvint à lui faire dire quelques mots, et connaissant que le motif de sa tristesse était le rapide retour à San Agustín, il voulut le consoler avec des paroles compatissantes :
– Croyez-moi, monsieur de Urrea, à Pedralba, en ce moment, vous vous ennuieriez souverainement. Savez-vous ce qu’ils font là-bas, depuis le coucher du soleil jusqu’à l’heure du dîner ? Eh bien, prier, prier, et prier à en avoir des crampes, et vous, homme à piété très diplomatique, en fin homme de la grande ville, taillé à la moderne, vous fuirez la sainte prière comme les chats fuient l‘eau froide. Comme si je ne connaissais pas mes gens !… Ah !…. C’est vrai aussi que, à San Agustín, dès que nous arriverons, je vais prier le rosaire avec Valeriana, et quelques voisines. Mais vous, vous pouvez aller avec Laínez au casino et dîner avec lui, et revenir à ma modeste demeure, la vôtre, je veux dire, à l’heure qui vous arrangera. A Pedralba, avec la dernière bouchée du dîner encore en bouche, ils vont tous se coucher comme des saints. Vous auriez passé une jolie nuit là-bas ! Non, monsieur le madrilène, avec vos velléités de noceur et vos côtés de sceptique matérialiste, vous n’êtes pas fait pour ces coutumes à la fois rustiques et monastiques. La campagne ! Elle va vite vous fatiguer, la campagne ! Pour vous, vous mettre la nuit au milieu de ces déserts, ça doit être la même chose que si, moi, on me mettait dans une salle de danse. Qu’est-ce que je ferais ? M’en aller en rageant. Suum cuique, monsieur de Urrea. Donc, ne regrettez pas de venir avec moi. Au casino, je crois qu’il y a un billard, on joue aux cartes et on y parle de politique… comme à Madrid.
Notre bon petit curé n’arriva pas à le consoler, et l’âme du noceur repenti devenait de plus en plus noire, à mesure qu’ils s’approchaient de San Agustin. Arrivés au bourg, il ne voulut pas aller au casino. Depuis le salon, il entendait la prière du rosaire dans la salle à manger ; pendant le dîner, il fit des efforts désespérés pour faire semblant d’être gai, et se retira dans sa chambre à coucher, imprégnée de l’odeur de paille. Il avait mal à la tête.
La nuit fut pour lui interminable et orageuse ; il se leva très tôt, accompagna à l’église son digne ami et amphitryon, et pendant que celui-ci enlevait ses vêtements sacerdotaux, José Antonio mit en pratique l’idée qu’il avait conçue au petit matin au milieu de douloureuses réflexions, une décision qui, une fois assimilée par sa volonté, avait acquis la force d’un acte instinctif. Tel un élève puni, qui s’échappe de l’école, il prit le petit chemin de Pedralba, à pied, et en perdant de vue les maisons de San Agustín, il se sentit plus soulagé de sa mortelle inquiétude et avec du courage pour affronter ce qui pourrait lui arriver à cause d’une décision aussi audacieuse. Il devait être neuf heures quand il fut en vue du château, et avant de s’approcher, il explora les terres qui l’entouraient, hésitant entre entrer par l’allée principale ou par quelque raccourci. C’était puéril, et ses hésitations, au terme du voyage, trahissaient le collégien fugueur. Ne voyant personne dans ces parages, il continua à marcher, et sa vue prodigieuse lui permit de distinguer depuis très loin, sur une pente de la colline, deux silhouettes, deux personnes. En se rapprochant un peu plus, il put reconnaître Nazarín et Ladislao, qui étaient en train de couper du bois, et il se dirigea vers eux, en faisant un assez grand détour pour que les gens du château ne le voient pas. Parler à Nazarín avant de se présenter à la comtesse, lui parut être une démarche très opportune, derrière laquelle il vit, avec son optimisme facile, une solution satisfaisante. Lorsqu’il arriva près des deux bûcherons, Nazarín qui l’avait vu venir de loin, ne manifesta aucune surprise. Le prêtre portait des vêtements de Cecilio, chaussait de grosses chaussures, et sa tête nue rappelait davantage l’accusé de l’hôpital de Madrid que le prêtre du presbytère de San Agustín.
– Bonjour, don Nazario ! En train de travailler, hein ?… Me voilà à nouveau. Eh bien, je suis venu… Alors, vous coupez du bois ?
– Oui, monsieur… Cet exercice à l’air libre me plaît beaucoup. Madame la comtesse est en bonne santé, grâce à Dieu. On dirait que vous êtes venu à pied.
– Une petite promenade. Je ne suis pas fatigué.
– Eh bien, nous n’avons pas pu arranger le four ; les maçons doivent venir. Madame m’a envoyé promener, je veux dire, pour que je me promène, et me voilà en train d’aider notre ami don Ladislao.
– C’est bien, mon ami, c’est bien. Oui, je voulais… vous parler, mon cher Nazarín –balbutia Urrea, abordant le problème-. Vous êtes un saint, quoiqu’on dise, vous m’aiderez à obtenir le pardon de Halma d’être revenu sans sa permission.
– Madame est très indulgente.
– Mais ma faute est plus grave qu’il n’y paraît, car je suis venu avec le ferme dessein de rester ici, et je ne sortirai pas de Pedralba à moins qu’on ne me sorte en morceaux. Écoutez-moi.
– Ça, ça…, monsieur de Urrea –dit Nazarín, en laissant de côté la hache pour se consacrer à écouter avec calme les confidences du parasite amendé.
– Voilà, vous allez voir… Ma cousine veut que je reste à Madrid. Mais vous êtes déjà, au courant. J’étais un bon à rien : elle, avec son infinie bonté, maîtresse de la vertu et destructrice du péché, m’a transformé, a fait de moi un autre homme, a fait de moi un enfant ; elle m’a inculqué la peur du mal, l’amour du bien. Je ne me reconnais pas. Je la considère comme une mère, et je lui obéis dans tout ce qu’elle voudra m’ordonner ; mais je ne puis lui obéir sur une chose…, je répète que je suis un enfant, je ne puis obéir à son ordre tyrannique de vivre à Madrid, car, loin d’elle, les tentations m’assaillent, appelons-les souvenirs de ma mauvaise vie antérieure, et la réhabilitation qu’elle, autant que moi, nous désirons, ne se consolide pas, ne peut se consolider.
– Oui, oui…
– Hier j’étais venu avec le dessein de lui parler de cette affaire et lui demander de pouvoir rester ici, mais je n’ai pas eu le courage de le lui dire. Il y avait tellement de gens présents !… Croyez bien que je suis un enfant, et que mon ancienne désinvolture de noceur s’est changée en, une timidité invincible… Parole… Comme elle m’a dit de retourner à San Agustín, j’y suis retourné, le cheval m’a emmené comme une valise, et aujourd’hui, sans m’en rendre compte, poussé par une force irrésistible, je suis venu à Pedralba, mes jambes m’y ont emmené, et elles se seraient brisées en mille morceaux plutôt que de ramener à Madrid. Et je vous demande : ma cousine va-t-elle se fâcher ? Va-t-elle s’obstiner à ce que je vive loin d’elle ? Parce qu’il faut que vous sachiez que j’ai commis une très grave faute, une faute dans laquelle semblent reverdir mes anciennes habitudes, ma perversité mal corrigée. Vous allez voir !
– Voyons, voyons… ?
– Eh bien Halma m’avait arrangé à Madrid une petite activité pour que je travaille et acquière une honnête indépendance. Tant qu’Halma est restée à Madrid, très bien : je travaillais, et j’avais commencé à gagner quelque argent… Mais elle s’en va, je veux dire, elle vient ici, et adieu mon homme, adieu mes intentions de me corriger, adieu travail, adieu raison. J’ai eu un cafard épouvantable ; je ne vivais pas, je ne mangeais pas, je ne fermais pas l’œil de la nuit. Un matin…, je ne sais si ce fut un démon ou un ange qui m’a tenté. Que croyez-vous que j’ai fait ? Eh bien en un clin d’œil, j’ai vendu tout mon attirail, machines, ustensiles, papier ; j’ai tout réalisé, j’ai vendu et je suis venu ici.
– Avec l’intention de ne pas retourner à la Capitale. Pauvre monsieur de Urrea. J’ignore comme madame va prendre ce coup de cœur. Moi, sans autorité aucune pour le juger, je ne le vois pas d’un mauvais œil.
– Parce que vous êtes un saint –s’exclama Urrea avec ardeur, se levant du sol pour l’embrasser-. Parce que vous êtes un saint, et l’être le plus beau et le plus pur qui existe sur terre, après ma cousine ; et celui qui dira que Nazarín est un fou, diable !, celui qui osera dire devant moi cette énormité…
– Eh…, monsieur de Urrea ! Du calme, car nous allons croire que le fou c’est vous…
-Pour en finir, monsieur Nazarín de mon cœur, si vous intercédez pour moi, la première chose que vous devez lui dire, après lui avoir raconté ma dernière frasque, la cession de mes outils, c’est que je veux qu’elle m’admette ici comme un n’importe qui. Je veux être un pauvre recueilli, un malheureux de l’hospice. Il faut mener une vie religieuse ?… Je serai religieux comme tout un chacun. Il faut travailler aux rudes tâches de la campagne ? Eh bien, José Antonio sera le plus actif et le plus obéissant ouvrier qu’elle peut imaginer. Mettez-moi au dernier rang ; logez-moi dans l’écurie que vous ne trouverez pas assez confortable pour les montures ; rabaissez-moi autant qu’il vous plaira. Que demandez-vous ? De l’humilité, de la patience l’annulation de soi ? Eh bien ici, sous sa direction, en sentant son autorité maternelle et sa divine protection, je serai humble, patient, et je n’aurai pas de volonté. Il faudra prier durant de longues heures ? Je difrai toutes les prières qu’elle et vous, vous m’apprendrez. Les rudes besogne ne me font pas peur, au contraire, je les désire et je pense qu’elles me seront utiles tant pour mon corps que pour mon âme… Et en vous disant tout cela, monsieur Nazarín, comme vous vous pouvez et vous savez le dire, je crois que… Ah ! J’oubliais un chose très importante…
En disant cela, il mit sa main dans sa poche et sortit un petit portefeuille.
– … Voilà ce que j’ai obtenu de la vente de tout ce matériel et de la cession de mon affaire. Donnez-le lui ; qu’elle ne croie pas que je l’ai mal dépensé à Madrid.
– Non ; il vaut mieux que vous le gardiez pour le lui remettre vous-même.
– Eh bien, blague à part, il y a là la bagatelle de neuf mille et quelques pesetas avec lesquelles nous pourrions réaliser ici quelques unes des idées qu’indiquait don Pascual Amador hier.
Il dit nous pourrions avec un accent d’empressement ingénu qui fit sourire Nazarín.
– Je ne sais pas –répliqua celui-ci en se relevant du sol-. Ayez bien présent à l’esprit que lorsque madame s’est installée ici avec nous, ses pauvres amis en Dieu, ses enfants plutôt, elle a rompu toute attache avec le monde là-bas, pour employer sa vie au service de Dieu, et à des actes de charité sublime. Madame pourrait considérer que nous n’êtes pas malade, ni pauvre, ni dans le besoin, et que…
– Que l’on m’admette en qualité de fou –dit Urrea, en l’interrompant vivement.
– Oh, non ! En matière de fous, ils en ont assez avec moi –répondit don Nazario avec une inflexion humoristique, presque perceptible.
– Et comme pauvre, qui l’est plus que moi ? Et comme homme qui a besoin de se corriger, d’une atmosphère morale… Par le Ciel, mon cher Nazarín, ne m’enlevez pas mes espérances !
– Ici on n’entre qu’avec un cœur bien ouvert à la piété, mon cher Urrea, et si madame a laissé dans les rues de Madrid, comme on dit, sa couronne et les autres signes de vanité sociale, nous, nous devons jeter devant la porte de Pedralba les passions, les désordres des désirs, tout ce fatras qui paralyse la vie de l’esprit. Ce qu’il faut ici absolument c’est l’obéissance à notre mère doña Catalina, et aussi le respect inconditionnel de ses projets.
-Personne mieux que moi –affirma Urrea, avec émotion- ne saura vénérer et adorer ma cousine, en la regardant comme ce que Dieu nous permet de voir de sa présence sur cette terre misérable. Qu’elle m’admette, et personne, pas même vous, ne me dépassera en soumission ni dans le fait de considérer notre maîtresse et dame comme une mère. Si elle veut me soumettre à une épreuve d’observance, qu’elle ne me parle pas, qu’elle ne me regarde pas, qu’elle me donne ses ordres par votre entremise ou celle de quelqu’un d’autre, et je vivrai en repos et satisfait de me sentir près d’elle, sous son doux despotisme. En l’admirant, j’apprendrai l’amour de Dieu ; et sa perfection, relative parce que humaine, me donnera l’impression de la perfection divine absolue. Elle sera mon initiation à la foi : grâce à elle, je serai croyant, moi, qui ai été un mécréant et un débauché, maintenant je ne suis rien, je ne suis personne, un homme défait, comme un édifice dont on démonte les pierres une à une pour les remonter et en faire un tout neuf.
– Bon, monsieur, bon –indiqua Nazarín, vivement impressionné par cette déclaration et ressentant une grande sympathie envers Urrea-. L’heure de manger s’approche. Je vais descendre et parler à madame. Autre chose : vous ne mangez pas ?
– Comment pourrais-je manger ? Tant que vous ne lui aurez pas parlé, je ne descends pas au château. Quand vous reviendrez, don Nazario, apportez-moi un morceau de pain.
– Attendez-moi ici.
– Et je vais finir de couper ces troncs ; comme ça, j’apprends à utiliser le temps –affirma Urrea, en enlevant sa veste et en prenant la hache.
– Comme vous voudrez. Au revoir, Ladislao, c’est l’heure ; on y va.
7
Avec une ardeur enfantine, encouragé par les espérances que la médiation de Nazarín lui inspirait, le parasite s’attaqua aux troncs ; mais un quart d’heure après avoir fait ses premières armes dans le métier de bûcheron, il dut modérer ses élans, parce qu’il suffoquait et une abondante sueur lui coulait du front. Il revint ensuite à la charge, sans plus chercher à dépasser ses forces naturelles, et plus il fendait de troncs, plus vive était la joie qui inondait son âme. Ah, si on lui permettait d’entrer de plein pied dans cette vie ! il apprendrait mille choses agréables, comme labourer, semer, sarcler, soigner les volailles et les bêtes, devenir ami de la terre, sujet du royaume végétal et champêtre. Et dans une telle ambiance, la vie religieuse, ascétique, où l’on se prive de tout plaisir et même de parler avec les gens, ne lui serait pas trop pénible. Il n’aurait d’autres amis que les animaux, et esclave de la terre, il conserverait l’esprit libre et joyeux pour l’élever vers Dieu à toutes les heures de la journée. Le retour de Nazarín le surprit au milieu de ces réflexions vers une heure et demie. Quand il le vit venir avec son pas tranquille de toujours, sans anticiper par le regard des joies ou des déceptions, son cœur bondissait hors de sa poitrine.
– Madame –dit le prêtre mendiant, quand il fut à portée de voix- dit que vous descendiez manger.
– Mais…
– Rien, que vous descendiez manger. Elle ne m’a rien dit d’autre.
– Vous continuez à couper du bois ici ?
– Non ; aujourd’hui c’est jeudi, et c’est le jour du catéchisme pour les enfants. Aquilina leur a fait la classe. Quand madame aura organisé l’école, nous alternerons dans l’enseignement.
– Même cela, je le ferais bien, si elle me le demandait : dresser des enfants, et leur mettre le b a ba dans la tête. Qui est-ce qui me l’aurait dit… ! Enfin, j’y vais. Savez-vous que je tremble de tous mes membres ? Et alors ? Elle s’est fâchée quand elle a su… ?
– Elle s’est montrée plus compréhensive que fâchée.
– Ça, c’est déjà un bon signe. Je vais…. Faut-il que j’y aille maintenant même ?
– Maintenant, car on vous a préparé le repas.
– Je n’ai pas faim… Et en vrai, elle n’a pas dit que je suis une mauvaise tête ?… Quelle bonté, quelle sainteté, mon Dieu ! Pas même un reproche ! Comment ne pas l’adorer comme le Dieu qui est sur les autels ? Bon, vous verrez qu’elle me pardonne, et m’admet , et… Le cœur me dit que oui. Elle agit comme la Divinité, qui, d’après ce que vous dites, accorde tout ce qu’on lui demande avec foi et humilité. J’ai foi en elle, mon cher Nazarín, et je verse des larmes de l’âme simplement pour me sentir sous sa divine protection. Allons-y, parce que certainement que vous, qui êtes aussi un saint, vous avez dû intercéder avec brio pour le pauvre malheureux que je suis. Ce qui est dit, est dit : celui qui osera dire que Nazarín est fou, aura à faire avec José Antonio de Urrea. Je ne l’admets pas…, parole que non.
– Soyez raisonnable, mon ami.
– Une folie, la piété suprême, une folie, la passion du bien d’autrui ; une folie l’amour pour les déshérités ! Non, non… Je soutiens que non, et je le soutiendrai devant le curé, et le juge, l’évêque et le Pape, et le monde entier.
-Ne vous excitez pas, et comprenez qu’à Pedralba, ne discute et ne soutient des opinions que celui qui peut et doit le faire. Les autres qu’ils obéissent et se taisent. Et vous, qu’est-ce que vous en savez si je suis fou ou sain d’esprit ?
– Comment ne le saurai-je pas ?
– Allez ! Cela suffit… Allons vite, madame nous attend.
Ils descendirent, et quand Urrea entra dans la maison et dans la salle à manger, plus mort que vif, la première chose que lui dit sa cousine, en lui mettant le repas sur la table, fut :
– Mais, mon garçon, tu dois être mort de faim. Pourquoi n’es-tu pas venu manger avec Nazarín et Ladislao ?
Urrea se mit à genoux devant elle et lui dit d’une voix tremblante qu’il ne mangerait pas tant qu’il n’aurait pas reçu le pardon qu’humblement il sollicitait.
– Tu es un enfant –dit Halma-. Mange et ensuite nous parlerons… Mais comme tu es un grand enfant et avec d’astucieuses mauvaises habitudes, il faut te tenir un peu la bride. Mange tranquillement, pauvre petit… Tu veux du bâton ? Tu en auras. Je ne comptais pas sur toi pour cette vie, car jamais je n’aurais cru que tu pourrais y résister. On te mettra à la preuve avec toute la rigueur qu’exige ton passé et les mauvaises habitudes que tu gardes encore.
En mangeant et en soupirant, parfois souriant, parfois ému jusqu’à verser des larmes, José Antonio lui dit que la rigueur de l’épreuve, si grande fût-elle, ne le serait jamais autant que son énergie et sa fermeté à y résister, et qu’il se trouvait disposé à tout, du moment qu’il vivait sous la sainte autorité de Halma. Les côtes, si raides soient-elles, ne lui faisaient pas peur. Une côte religieuse ? On y va. Une côte de rudes travaux, comme ceux d’un bagnard ? On y va.
Comme don Pascual Amador était arrivé, on parla d’autres affaires. Le gentilhomme campagnard allait porter à la dame des documents de la Mairie de Colmenar pour qu’elle les signe, et prit congé après avoir pris un petit verre de vin.
– Don Pascual –lui dit Halma, en lui remettant le portefeuille que son cousin lui avait donné auparavant-, faites-moi le plaisir de garder ceci. Il y a…
– Neuf mille six cent cinquante douros –précisa Urrea.
– Je n’en aurai pas besoin jusqu’à ce que je commence à mettre en culture le grand pré. Parce que je me décide, monsieur, don Pascual, je me décide. Le jardin, on le commencera lundi, en labourant avec les bras dont je dispose ici. Regardez, regardez quel gentil ouvrier est arrivé chez moi.
Don Amador se réjouit beaucoup des nouveaux projets de la dame, qui concordaient avec ses idées de développement de Pedralba, et il partit pour surveiller les ouvriers qu’il avait à la Alberca.
– Pour t’ouvrir l’appétit –dit Catalina au néophyte-, vous allez m’enlever, toi et les neveux de Cecilio, ces ruines, jusqu’à ce que je puisse voir le sol.
– Tout de suite.
– Du calme. Cet après-midi tu vas au rez-de-chaussée de la tour, où provisoirement nous avons notre école, et tu entendras l’explication du Catéchisme… Comme tu as coupé du bois, cette nuit tu vas avoir des courbatures horribles. Repose-toi, et demain, tu fais ce que je t’ai dit, comme préparation pour des travaux plus pénibles.
– Pour moi, il n’y a rien de difficile si je suis ici.
– Tu vivras dans l’autre maison, avec Cecilio. Ce soir, tu feras ton lit dans la grange, comme tu pourras. Tu n’as jamais dormi sur un tas de paille ? Moi si, là-bas, très loin d’Espagne…, et dans ces jours d’abandon et de misère, cela m’avait semblé le comble de l’inconfort et de l’humiliation. Aujourd’hui, cela me serait indifférent.
– Je m’installerai très volontiers dans la grange.
– Ce soir, sur la liste des courses que doit ramener le père Valentin de Colmenar, nous écrirons : une grosse veste de drap marron pour toi, des grosses chaussures, de ce qu’il y a de plus épais ; une ceinture, un bonnet. Tu vas voir comme tu vas être élégant. Comme chez toi il n’y a pas de miroir, tu pourras te regarder dans la flaque de la fontaine. Et quand arrivera la paire de bœufs, tu apprendras à les atteler, à les conduire. Sais-tu ce que c’est qu’une charrue, et le poids qu’elle pèse ? Eh bien, tu apprendras. Tu mangeras avec nous, car ici il ne doit y avoir qu’une table pour tous les habitants de l’île. Il arrivera un jour où Cecilio et sa famille, le père Valentín, nous mangerons tous ensemble. Demain, ; si tes courbatures ne te gênent pas trop, après avoir tâté des pierres des ruines, tu recommenceras à couper un peu de bois… Je ne veux pas que tu sois un seul moment sans rien faire. L’épreuve doit être sérieuse, pour que je puisse me faire de toi une idée juste et que je te considère capable ou incapable de partager notre vie. Mais attends, parce qu’ensuite viendront les exercices religieux, se lever à l’aube, les mortifications, l’assistance aux malades… Ah ! tu n’as pas encore saisi la gravité de ce que tu désires et demandes. Toi, homme de salons, homme à principes, intelligence trop sensible à l’actualité, à ce qui est nouveau et dernier cri, tu t’es laissé influencer par des courants d’idées qui viennent de l’étranger, comme les modes de s’habiller, de manger et d’aller en voiture. La bourrasque religieuse s’est emparée de toi, car elle souffle de temps en temps, lancée par les tempêtes qui parcourent furieusement le monde, et voilà notre petit Urrea en train de délirer pour ce qui est spirituel, comme il délirerait pour un auteur nouveau ou pour la dernière forme de chapeaux ou de costumes. Et tu viens ici avec cette piété d’ aficionado, qui n’est pas ce que je veux ni ce dont nous avons besoin.
– Ce n’est pas ça, ce n’est pas ça –répliqua José Antonio, sur un ton persuasif-. Je veux croire, je désire te ressembler, en maintenant la distance entre ma monstrueuse imperfection et ta …
– Ça suffit. Je n’aime pas les paroles flatteuses.
– Mon aspiration est de recommencer ; ou plutôt : renaître. J’ai trépassé; je ressuscite comme ton fils et ton esclave. Charge-moi des métiers les plus bas et plus humiliants, et en matière de religion, du plus difficile. Assister des malades, as-tu dit ? Nazarín me montrera.
– En cela et en beaucoup d’autres choses encore, il peut être un bon maître pour toi et pour moi.
Sur ces entrefaites, Nazarín passa devant la fenêtre de la salle à manger, après avoir échangé ses vêtements de bûcheron pour ceux de prêtre. Il allait au cours de Catéchisme, et déjà l’écho du brouhaha infantile annonçait que les enfants se réunissaient dans la salle provisoirement destinée à être une salle de classe.
– J’y vais aussi –dit Urrea en le voyant passer-. Je veux être comme les tout petits. Vraiment, cet homme me semble divin, et grâce à lui, grâce à l’influence que, sans doute, il a sur toi, j’ai obtenu ton pardon. Que t’a-t-il dit, quelles raisons a-t-il invoquées en ma faveur ?
– Il n’a fait que me raconter ce que tu avais fait.
– Et toi… ?
– Je lui ai demandé son avis sur la décision que je devais prendre à ton égard.
– Et lui… ?
– Il m’a dit que je devais t’admettre.
– Ma cousine ! –s’exclama Urrea, avec exaltation, et en agitant les bras-, le premier qui me dira que cet homme est fou, je le tue…, ah !, non !
Il porta sa main à sa bouche comme pour retenir le mot et le remettre dedans.
– Non, non, je ne le tue pas, excuse-moi. Mais je le… Non plus. Ce que je ferai, ce sera de dire et de proclamer, contre l’opinion de tout le monde, qu’il n’est pas dément, qu’il ne peut l’être, que le plus grand contresens serait qu’il le soit… Et toi, tu crois la même chose, Halma, ne me dis pas non ; tu crois la même chose.
– Toi, qu’est-ce que tu en sais ?… Silence, et au Catéchisme.
– J’y vais.
Cinquième partie
1
Durant trois, cinq, dix, je ne sais combien de jours, les évènements se déroulèrent doucement et comme sur des rails au château de Pedralba et dans ses champs et dans les bois qui l’environnaient, et on remarquait en tout, dans les choses et les personnes, l’impulsion que leur avait donné d’une main ferme l’organisatrice de cette singulière famille. Mais on était loin encore de voir la réalisation totale de l’idée complète de la noble dame, parce que le manque de locaux ne pouvait se résoudre rapidement, et que dans différents détails de l’organisation, surgissaient à chaque instant des obstacles que seules la constance et la bonne volonté de tous pourraient vaincre à la fin. Le mise en culture du jardin donna beaucoup de travail, à cause de la dureté du terrain et par la difficulté de l’alimenter en eau. Comme il n’était pas facile ni économique de l’amener de la source par des conduites, on ouvrit un puits, dans le trou duquel il ne fut pas nécessaire de creuser plus de vingt et quelques pieds pour trouver de l’eau en abondance. Deux semaines après avoir commencé les travaux, il y avait déjà plusieurs carrés plantés de petits pois, haricots, choux et autres légumes de consommation courante. Provisoirement, on entoura le jardin avec des pierres et des épines. La paire de boeufs ne se fit pas attendre, et trois jours après tous ces travaux, Urrea savait déjà conduire ces animaux patients, comme s’il les avait connus sa vie durant. Très vite, il les prit en affection, et il n’aurait pas échangé leur compagnie silencieuse pour celle d’amis de l’espèce humaine, comme il en avait tant connu dans sa première vie.
Les travaux les plus rudes n’abattaient pas l’enthousiasme du noceur repenti : le constant et méthodique exercice corporel, s’il le fatiguait au début, avait fini par le fortifier. L’idée d’être un homme nouveau s’enracinait tellement dans sa conscience, qu’il crut qu’il avait un sang nouveau, en se faisant de nouveaux muscles, et même qu’on lui avait enlevé tous ses vieux os pour lui en mettre des tout neufs. De son appétit, n’en parlons pas : il ne se souvenait pas d’en avoir eu un semblable depuis son enfance. Souvent, il mangeait sur la colline avec le berger ou les neveux de Cecilio (dont on parlera ensuite) ; et il préférait cette pitance frugale et savoureuse, qu’Aquilina, Beatriz ou la comtesse elle-même lui apportaient dans une petite marmite, à tous les plats les plus raffinés des tables de Madrid. Et quand ils improvisaient un souper ou un déjeuner à l’air libre et cuisinaient avec des ajoncs et des bouts de bois sur un trépied, dans la poêle du berger, de rustiques soupes de pain ou quelque chose de semblable, notre homme appréciait d’une manière incroyable et rendait grâce à Dieu de l’avoir amené à cette vie sauvage. Et ensuit le calme de l’esprit, la paix de la conscience, la sécurité du lendemain !… Rien ne pouvait se comparer à des biens semblables, nouveaux pour lui. Tout ce qu’il connaissait du monde, d’un ordre radicalement différent, lui paraissait une mauvaise plaisanterie du Destin. Parce que la vie de la ville durant les années que, parfois sans raison, on appelle fleuries, de vingt à trente ans, qu’avaient-elles été d’autre qu’un supplice sans fin, une humiliation, une angoisse, et tout ce qui existe de mal ? Bénie soit l’état sauvage, bénie soit la barbarie qui lui permettait ce qu’il y avait de plus élémentaire : vivre !
Les Borregos, car c’est ainsi que s’appelaient les deux neveux de Cecilio, journaliers dans la propriété, furent les premiers compagnons de chambre du sauvage improvisé, et ils ne tardèrent à devenir ses amis, ses maîtres aussi dans tout ce travail rustique. Dieu n’en avait pas fait de plus primitifs ; mais pas non plus de plus simples, ni au cœur aussi noble et droit. Au début, l’épiderme moral d’Urrea se sentait un peu froissé au contact de la rude écorce de ces pauvres gens ; mais il ne tarda pas à avoir les mains calleuses, et si lui à leur contact s’endurcissait, les autres, indubitablement, s’adoucissaient. Le soir, quand ils se couchaient sur la paille, vannés, dans le bref moment qui précédait le sommeil, tous trois bavardaient, chacun s’expliquant selon ses moyens, et vous y auriez vu confondues la barbarie et la culture, le langage aisé et le baragouin maladroit, l’intelligence et la superstition. L’aîné des Borregos, un gaillard de vingt-deux ans, se distinguait par sa crânerie effrontée et un peu insolente; non seulement il se tenait pour un homme capable de se mesurer loyalement avec le plus costaud, mais dans le domaine du travail de la terre, il n’en rabattait pas même devant les plus experts. Il savait tout ; il se vantait de connaître les secrets de la terre et de l’atmosphère. La plante qu’il mettait en terre, sûr qu’elle prenait et qu’elle poussait comme pas une. Il avait inventé une infinité de règles de physiologie végétale, dont aucune ne ratait, selon lui, dans la pratique. Sur la fécondation, sur les époques des semailles et des repiquages, et l’influence mystérieuse des phases de la lune sur la vie des plantes, il contredisait avec la plus grande impudence l’avis des vieux paysans, en défendant le sien avec entêtement. Urrea était enchanté de ce caractère inflexible, tenace, fondé sur un amour propre furibond. Plus d’une fois il s’était demandé : « Dans une autre sphère, avec une autre éducation, Bartolomé, qu’est-ce qu’il serait ? » Le second Borrego était le contraire de son frère : humble, avec une volonté paresseuse, qui facilement se moulait à celle d’autrui, peu disert, un peu mélancolique, curieux et toujours à poser des questions. Il aimait qu’on lui raconte des guerres, des aventures et des évènements extraordinaires, et devenait fou devant des images, toutes les sortes de petites figurines peintes, même si c’était celles des boites d’allumettes, qui lui semblaient aussi belles qu’à nous les tableaux de Raphaël et de Velasquez. Et Urrea se disait : « Isidrico, dans une autre sphère et éduqué avec des garçons cultivés, qu’est-ce qu’il serait ? »
Avec ces réflexions, José Antonio de Urrea étudiait l’Humanité, en même temps qu’il obtenait de l’observation de la Nature d’utiles enseignements. Dans son existence antérieure, il n’aurait jamais remarqué une multitude de phénomènes qui l’émerveillaient. Même le ciel étoilé, les nuits claires et sans nuages, attiraient son attention comme une chose nouvelle et inconnue. Il l’avait vu, oui, de nombreuses fois ; mais jamais il n’avait aussi bien vu et ne s’était réjoui autant de sa beauté. Avec cela, de nouvelles idées remplaçaient les anciennes, qui, telles des feuilles mortes, tombaient et étaient emportées par le vent. Et toute la nouvelle pousse cérébrale grandissait avec force, annonçant un feuillage et une efflorescence vigoureuses. Lui, ne cessait de le répéter : c’était comme naître deux fois ; la seconde par un miracle de Dieu, à l’âge d’homme, en conservant le souvenir de la première incarnation pour pouvoir comparer et mieux apprécier les avantages de la seconde.
Halma et son cousin avaient peu d’occasions de se parler dans ces premiers débuts de la vie rustique, parce que lui travaillait loin de la maison. Le soir, après le rosaire, ou s’ils dînaient en communauté, madame l’exhortait en peu de mots à maintenir ce comportement ordonné. Cela et les saluts obligés, quand, par hasard, ils se rencontraient dans la campagne, étaient leur relation verbale. Mais en esprit, Urrea ne la séparait pas de lui ; de nuit et de jour, il pensait à elle, ou se l’imaginait, la transformant à sa guise. Il n’y avait rien de plus agréable pour lui que d’apprécier dans les actes et les expressions de ses compagnons, le grand respect que madame leur inspirait. Et ce respect s’était tellement renforcé en lui que, lorsqu’il la voyait venir, il se troublait comme un gamin timide. Et il avait beau s’apprécier dans son nouvel état de conscience, chaque jour il sentait croître la distance entre eux deux, parce que si lui, il s’élevait, elle, elle montait d’une manière démesurée.
Au bout de quinze jours d’apprentissage, le novice avait reçu de Nazarín l’ordre de déménager sa résidence. Notre bon prêtre pèlerin avait été trois jours à San Agustín, pour finir de résumer le livre divin de la Patience, employant sublimement la sienne, et de retour à Pedralba, il avait nettoyé, sans l’aide de personne, les deux chambres de la tour. Il y était resté toute une matinée, à blanchir les murs, à laver le sol carrelé et à sortir comme il pouvait toute la crasse qu’il y avait dans les coins.
– Ici tu seras mieux que là-bas –avait-il dit le soir à Urrea, en lui donnant la possession de son nouveau domicile et en lui montrant un lit propre et bien douillet, et les meubles de bois brillant-. Cela, mon cher Urrea, je le fais pour toi, qui es habitué à l’essentiel du confort, qui est la propreté. Ici, madame nous enseigne à être nos propres serviteurs, et je te donne l’exemple…
– Quel exemple ! Mais vous me le donnez à l’envers, en vous faisant mon serviteur.
– Et non, petit sot. Ce que je fais cette semaine, tu le feras la semaine prochaine.
Nazarin le tutoyait depuis les premiers jours, car c’était chez lui une vieille habitude. Et ne connaissant pas les usages de la politesse, il n’abandonnait la forme familière que devant des personnes très respectables, comme la comtesse, don Remigio et d’autres semblables.
– Bon –dit le néophyte-, je ne vois ici qu’un lit. Peut-être que vous avez le vôtre dans de ce galetas d’à côté, près de l’escalier en pierre ?
– Ce que tu appelles galetas est une jolie pièce. Vas-y et regarde-la. Il y a assez d’espace pour mon lit, qui est cette estrade bien recouverte d’une couverture… Tu vois ? Quel luxe, quelle élégance !… Et comme moi, ici, je ne vais pas donner des bals, je n’ai pas besoin de plus d’espace. Tu vois ? Couché sur ma planche, avec la tête je touche le mur d’ici et j’ai encore quelques trente centimètres pour toucher de mes pieds le mur d’en face. Et si tu voyais comme c’est douillet. Le problème, c’est qu’elle rivalise en obscurité avec la gueule d’un loup ; mais comme je ne suis pas là durant la journée, et que le soir je peux allumer la lumière si je veux, je m’y trouve très bien. Pendant longtemps, j’ai dormi dans des chambres et des lits pires que cela.
– Je le sais. C’est pour cela que vous êtes comme vous êtes, et qu’on vous prend pour un homme sans cervelle. Enfin, s’il faut distribuer des pénitences et des privations, qu’on me les donne à moi, et vous verrez comme je les accepte vite.
– Des pénitences, des privations ! Dieu te les enverra quand tu t’y attendras le moins. Pour le moment, ne disais-tu pas que tu aimais l’ample liberté de la grange ? Eh bien, tant pis pour toi. Tu ne retournes plus là-bas. Ici, dans la tour, prisonnier !, à supporter mes sermons, si j’ai envie de t’en faire avaler un, à prier avec moi, oui, pour sûr, autant que j’en aurai envie.
– C’est pour cela que nous sommes là, père Nazario ; mais dans cette maison de l’égalité, nous devons alterner dans le confort, je veux dire, dans les mortifications. Une nuit je dors dans le lit, et vous, sur l’estrade, et la nuit suivante, on change.
– Ça, on verra. Il n’y a pas autant d’égalité que tu crois, et il ne doit pas y en avoir. Pour le moment, je suis au dessus de toi en âge, en savoir et comme directeur, et si je t’ordonne de dormir dans un lit moelleux, il faudra que tu t’y fasses.
Au retour du dîner au château, et avant d’entrer dans leurs chambres, ils parlèrent encore un peu.
– Pepe –lui dit Nazarín, en s’asseyant sur son estrade-, sais-tu une chose ? Après le dîner, pendant que tu étais sorti pour fumer un petit cigare, madame m’a chargé de t’avertir…
– De quoi ?
– Rien, n’aie pas peur… Tu dois penser que c’est quelque chose d’important !… Et si ça l’est, je ne le sais pas… Eh bien, de t’avertir que si, demain, ou après demain, bon, don Remigio et don Amador te disent quelque chose de désagréable, quelque chose de blessant, tu essaies de ne pas te fâcher. Tu n’as pas encore appris à réprimer la colère, et sur ce point, il faut que tu fasses très attention, José Antonio, parce que la colère est un péché très vilain. Tu sais bien que nous tous qui vivons ici, nous devons être patients, doux, et affronter avec un visage serein les offenses, les outrages même. C’est ce que tu dois apprendre, Pepe, et éprouver ta patience dans la pratique, dans la réalité. Si non, tu es de trop à Pedralba.
– Mais, que vont me dire le curé et Amador ? Par les cornes du diable –cria Urrea, en s’emportant.
– Tu commences tôt –dit Nazarín , en s’approchant du lit sur lequel l’autre venait de coucher-. Mais, voyons, je suis en train de te faire la morale…
– A moi…, me dire à moi !… Mais, quoi ?
– Est-ce que je le sais, moi, mon cher enfant ?
– Oh ! Vous le savez, père Nazarín, et sinon, vous le devinez, parce que vous lisez dans les pensée des gens et vous pénétrez les intentions les plus secrètes.
– Je ne sais pas, je te le dis… Je fais ce qu’on m’a demandé, et je me tais. Madame m’envoit t’avertir que, quoique ce soit que tu entendes, de ne pas te mettre en colère, ni même de montrer des signes d’irritation. Elle l’ordonne.
– Eh bien, si elle l’ordonne, je préfère mourir à désobéir… Mais je ne sais pas, mon chez Nazarín, je ne sais ce qui m’arrive. Avec ce que vous m’avez dit…, je sens que mon moi ancien s’agite et trépigne, comme s’il voulait… Hélas, on ne naît pas une deuxième fois, n’est-ce pas ? On ne meurt pas pour continuer à vivre dans une autre forme et dans un autre être. Un homme ne peut être … un autre homme.
– Sans aucun doute…, un homme ne peut être un autre –dit l’apôtre, en souriant avec bienveillance-. Ne fatigues pas ton cerveau avec ces subtilités. Laisse-le reposer dans le sommeil.
– Je ne pourrai pas dormir.
– Nous prierons. Je te raconterai des histoires. Je te bercerai comme les petits enfants.
– Même comme ça, je ne dormirai pas… Ma tristesse, je ne sais quelle inquiétude lancinante, m’empêche de dormir.
– Je ne veux pas que tu sois triste, Pepe. Imite-moi, car je vis toujours dans une joie tempérée.
– Oh, si je pouvais !… Et ce n’est pas seulement la tristesse. Il me semble que j’ai de la fièvre. Je vais tomber malade.
– Si tu tombes malade -répliqua le petit prêtre de la Manche, en fixant sur lui un regard pénétrant-, je te soignerai… et je te sauverai de la mort.
– La mort !… –s’exclama Urrea, abattu, en fermant les yeux-. Pourquoi s’en défendre, quand elle est la meilleure, l’unique solution ?
– Ne t’occupes pas de ta mort. Dieu s’en ocupera. Maintenant, mon fils, dors.
– Dormir, oui… Vous me l’ordonnez ?
– Je le désire.
Ils se turent, et peu après Urrea dormait, en ayant Nazarín comme garde malade, lequel, assis près du lit, priait entre ses dents.
2
Le jour suivant, alors que notre sauvage se trouvait dans le jardin, il entendit le trot d’un cheval. Croyant que don Remigio s’approchait, il regarda avec inquiétude. Mais non ; c’était Laínez, le médecin de San Agustin, qui allait deux fois par semaine à Pedralba pour examiner tous les pauvres habitants des alentours. Madame l’avait engagé pour ce service, temporairement, en attendant que l’on puisse installer un médecin à temps complet à la maison pour faire des visites et assister tous les malades de la commune. On reconnaissait les jours de Laínez, parce que, depuis le lever du jour, sur les chemins apparaissaient d’innombrables personnes au visage hippocratique, estropiés et boiteux, les uns avec les yeux bandés d’autres avec la main en écharpe, l’un arrivant en charrette, un autre se traînant comme il pouvait. La consultation durait toute la matinée, et l’après-midi, le docteur allait voir, à la demande expresse de la comtesse, les malades qui vivaient le plus près.
Urrea salua courtoisement le médecin, quand il passa à côté de lui, et fut sur le point de lui demander : « Vous avez quelque chose à me dire de la part de don Remigio ? » Mais comme Laínez n’avait fait que répondre froidement à son salut, le jeune homme revint à son travail, silencieux et triste. « Allons causer un peu avec la terre » se disait-il, en maniant d’un bras vigoureux la pelle ou la houe. Et c’était vrai que la terre et l’homme se parlaient, lui, en lui racontant ses peines, elle, en lui disant un peu de ses mystères impénétrables. Mais comme la terre est si discrète qu’elle ne révèle rien de ce lui disent les morts ni les vivants, j’ignore ce dont parlèrent l’homme et la terre.
L’après-midi Laínez et Amador partirent ensemble. Urrea les vit s’éloigner, laissant leurs montures aller au pas. « Je suis sûr qu’ils parlent de moi », se dit-il en les regardant de loin. C’était un pressentiment, un trait de révélation de ceux qui ne trompent jamais, à cause de la mystérieuse connivence des fluides, qui, semble-t-il, nous entourent. « Ils parlent de moi –dit à nouveau José Antonio-, et ils disent du mal. C’est aussi certain que le soleil brille. » Et il recommença à raconter ses chagrins à l’argile, avec la pelle comme organe, et en remuant les mottes spongieuses et en les voyant se briser au soleil, il entendait de vagues réponses.
Amador et Laínez, en s’éloignant tranquillement de Pedralba, disaient du néophyte ce que celui-ci ne pouvait pas savoir même en le demandant à la terre.
– Eh bien vous allez voir –dit le gentilhomme campagnard- ce qui est arrivé. Monsieur le marquis de Feramor m’a fait dire par Alonso que si j’allais à Madrid, je passe absolument le voir. J’y suis allé lundi, comme vous savez, et dont Paquito m’a dit à quel ;point l’aristocratie était scandalisée de voir que ce vaurien de Urrea s’était faufilé ici. Là-bas, ils croient qu’il ne vient que pour la tromper et lui soutirer le peu d’argent qu’elle a, en jouant l’homme religieux et contrit, et en la dupant avec des bondieuseries et ces farces du retour à la terre. Moi, je crois la même chose, mon cher Laínez, parce qu’il est aussi repenti que mon bonnet ; c’est un homme avec une histoire malpropre et le premier loustic de Madrid. Nous ici, les bons amis de madame la comtesse, qui apprécions et connaissons ses imminentes qualités, nous devons lui ouvrir les yeux pour qu’elle voit le dragon, qui est entré chez elle. ..
C’est ce dont il s’agit, mon cher Amador –dit le médecin, homme petit à l’allure mesquine, avec une moustache bien lissée et grise, qui semblait tenir avec de la colle, des yeux éteints, un visage rugueux, la tête difforme et quelques cheveux sur l’occiput-. Don Remigio a reçu des lettres de son oncle don Modesto Díaz, et d’après celles-ci, ce monsieur Urrea serait un histrion…
– Un quoi ?
– Un histrion, ce qui est la même chose que dire un comédien. Il feint des sentiments, des états d’âme particuliers, il joue ses comédies avec un bagout et une mimique parfaits, et est en train de tromper tout le monde… Et oui, monsieur. Cet individu ne m’a pas plu la première fois que je l’ai regardé, et il continue … à ne pas me plaire. On a un peu de flair et on a vu beaucoup de monstruosités de la matière et de l’esprit… Et bien, voilà. Nous avons parlé de cela don Remigio et moi… Naturellement, Remigio est le mieux placé pour…
– Pour mettre les points sur les i.
– Et attirer l’attention de la comtesse sur le serpent qu’elle abrite en son sein –dit Laínez, tout content de sa comparaison-. Avant-hier, Remigio a lâché les premières piques ; mais madame, d’après ce qu’il dit, l’a écouté assez contrariée, et elle a eu la générosité, cela semble incroyable, d’affirmer que son cousin est un homme de bien.
– Vraiment ? Eh bien, elle n’échappera pas à une grosse demande d’argent, ou à quelque chose de pire… parce que cet individu n’est pas de ceux qui s’en vont sans rien dans la poche.
– Pour moi, il est venu dans un but intéressé –dit le médecin, en regardant fixement l’autre personnage-, et si on me pousse, j’ajouterai que, dans un but sinistre…
– Allons, à ce point, non !
– On verra… Le temps dira.
Arrivés au point où ils se séparaient, ils s’arrêtèrent pour se mettre d’accord sur le jour et l’heure où ils devaient se réunir avec don Remigio, afin de s’accorder sur la forme et la manière d’instruire ensemble la dame de Pedralba sur un problème aussi délicat. Une fois d’accord, chacun suivit son chemin.
Deux jours après, alors qu’Urrea se trouvait dans la forêt, il vit venir trois hommes à cheval par le chemin de San Agustin. Malgré la distance énorme à laquelle ils s’arrêtèrent, sa vue prodigieuse les reconnut tout de suite et son cœur tressaillit dans sa poitrine. Avec une rage de dément, il cogna violemment sur le tronc d’arbre qu’il était en train de fendre, et le bois, dans le gémissement qu’il paraissait exhaler en recevant les coups de hache, lui disait : Ils parlent de toi, ils disent du mal de toi. »
Urrea les regardait, en suspendant parfois son travail pour y revenir avec une terrible impétuosité musculaire, et il disait au tronc : « Plutôt que toi, c’est ces trois-là que je voudrais attaquer. » Il observa que, près de la propriété, les cavaliers s’arrêtaient, comme s’ils avaient quelque chose d’important à discuter et à mettre au point avant d’entrer dans Pedralba.
Don Remigio, se dressant nerveusement sur ses étriers, et aussi pris par son sujet que s’il se trouvait en chaire, leur adressa cette litanie, que l’on pourrait à plus juste titre appeler harangue ou sermon.
– Messieurs et amis, la chose est grave, et c’est notre devoir de recourir promptement au remède, en aidant de nos conseils désintéressés la personne qui a apporté tant de bienfaits, sur cette terre misérable. Evitons que les intentions de la sainte Comtesse ne soient trahies par un libertin. Si je l’avais connu quand pour la première fois il est arrivé à San Agustín, je lui aurai coupé la route de Pedralba… Ah, avec moi on ne joue pas ! Mais je me trouvais dans la plus grande innocence relativement à ce petit monsieur, et je l’ai accueilli dans ma modeste maison, et je l’ai amené ici. Dans la même candide innocence vous viviez vous aussi, mes bons amis, jusqu’à ce que, à la fin, grâce à des informations dignes de foi, nous sommes tombés de nos respectives montures. Maintenant…
– Que monsieur le curé me permette un moment –dit Amador, se souvenant d’une idée qui devait être ajoutée au dossier-. Un mot seulement: ce qui indigne monsieur le marquis, la famille et tous les autres nobles de Madrid, c’est que, après avoir donné à doña Catalina sa dot sans l’avoir diminué ni avoir décompté… Parce que vous devez savoir qu’une partie de la dot avait été consommée par la dame là-bas sur les terres d’Orient. Eh bien : monsieur le Marquis pour faire plaisir à don Manuel Flórez, qui était un saint homme, n’a pas voulu décompter les frais qu’il avait engagés, et a remis à sa sœur le total de l’héritage, c’est-à-dire, quarante et quelques milliers de douros, en croyant qu’il allait être employé dans des bonnes œuvres religieuses…. Qu’en est-il résulté ? Peu de jours après lui avoir remis cette fortune, ce voyou de Urrea lui a pris une obole de cinq milles douros… C’est ça : la comtesse est un ange, et parce qu’elle est an ange, on ne devrait pas la laisser aller en liberté. Moi je pense que les anges …
– Nous connaissions déjà ce coup des cinq mille douros –dit don Remigio, désireux de reprendre la parole-. Ce que vous ne savez pas c’est que, peu de temps avant que madame ne vienne à Pedralba, cet aventurier lui proposait un contrat pour ramener ici les cendres du comte de Halma, et il se chargeait de tout contre une autre remise de cinq mille douros.
– C’est un terrible coquin –indiqua Amador-. Le marquis dit, et il a raison : « Je donne mes intérêts pour cultiver la foi et développer la charité, mais non pour qu’un vaurien se moque de Dieu, de ma sœur et de moi. »
– C’est très bien dit –continua le curé, en reprenant la parole avec l’intention de ne plus la lâcher-. Eh bien moi qui, par une vieille habitude dialectique, vais toujours droit aux causes, et quand je vois un mal j’en cherche l’origine pour l’y attaquer comme fait Laínez avec les maladies, dans ce cas, ayant remarqué que les eaux sont sales, je vais à la source, et… en effet, là je vois… Enfin, messieurs, tout le mal que nous observons à Pedralba, provient des vices d’origine, de la défectueuse fondation. L’idée de madame la comtesse est belle, mais elle n’a pas su l’implanter. La première déficience, que je remarque ici, c’est qu’il n’y a pas de tête. Et cela est impossible. Pour que l’institution fonctionne et que se réalise le saint projet de la comtesse, il faut qu’il y ait à la tête de l’établissement un directeur, et pour qu’il ait beaucoup d’autorité, il faut que ce directeur soit un ecclésiastique. Je déclare que je n’aurais aucun inconvénient à remplir ce rôle, en dépit de l’énorme travail et de la responsabilité que cela entraîne. Je tenterais de donner une réalisation pratique et visible aux idées, aux sentiments élevés de charité de la sainte dame, et, modestie à part, je crois que je n’aurais pas trop de difficulté à y parvenir… Je rédigerais des constitutions, dans lesquelles les droits et les devoirs seraient clairement exprimés. Je tracerais une ligne entre le spirituel, prima facies, et le temporel, qui est secondaire… Je donnerais un nom à l’institut, en établissant un signe distinctif, qui pourrait être une croix ou plusieurs croix d’une couleur ou d’une autre, que je porterais cousues sur mon manteau…, et si ce n’est pas moi, qui que ce soit d’autre qui commanderait ici avec le titre de recteur, pasteur, gardien… Mais si c’est mon intention de convaincre notre amie de la nécessité d’une direction, il n’est pas bien, vous le comprenez vous-mêmes, que je me propose moi-même pour ce modeste poste. Et ce n’est pas par ambition, croyez bien que ce n’est pas par ambition ; en fin de compte, ce serait un sacrifice, et un grand ; mais nous en sommes là. De sorte que si madame, sur une inspiration divine, admet mes motifs et me désigne, je n’aurais pas d’autre solution que de baisser la tête, avec l’agrément de monseigneur l’Evêque, à moins que son Illustrissime ne croie pas utile de disposer de mon inutilité pour une paroisse de Madrid.
Tous manifestèrent leur accord avec des monosyllabes. Le visage de don Remigio lançait des étincelles.
3
– Eh bien, si monsieur le curé me promet de ne pas se fâcher –dit Laínez, après une pause, pendant laquelle il s’assura bien de ses idées-, je me permettrai de lui dire que si j’approuve l’idée d’une direction, car sans direction, ou appelons ça une tête, il n’y a rien, je ne suis pas d’accord pour que le directeur soit un prêtre. Qu’il y ait un ecclésiastique, ou deux ou vingt-cinq pour ce qui touche à la direction spirituelle, cela me paraît très bien. Mais, ou je n’ai pas compris de quoi il retourne, ou madame la comtesse a voulu fonder un institut hygiénique, à proprement parler, un sanatorium médico-chirurgical avec des finalités religieuses.
– Allons donc !
– Laissez-moi continuer. Secourir la pauvreté, soulager la douleur humaine, assister les malades, garder les fous, la pratique, pour ainsi dire, des œuvres de miséricorde, donne une importance démesurée à l’élément médico-chirurgico-pharmaceutique. Moi, je suis très pratique, je reconnais l’importance de l’élément sacerdotal dans un organisme de ce genre ; plus encore : je crois que cet élément est indispensable ; mais la direction, messieurs, je crois, tout en respectant l’avis de monsieur le curé, je crois, je pense…, qu’elle doit être confiée à la science.
– Allons, par le Ciel, ne soyez pas… !
– Permettrez-moi…
– Non, il ne s’agit pas de cela. Vous vous trompez sur les termes…
– Voyons, mon cher ! Je concède…
– La Science ! On serait jolis !
– Je concède…
– Mettons les choses au point, messieurs…
Et tous trois restèrent un moment à se couper la parole les uns les autres et à se lancer des bribes de phrases.
– Je concède –dit Laínez, parvenant enfin à terminer une phrase- que la piété, la foi, soient le cœur de cet organisme, mais il n’y a que la science qui puisse en être la tête.
– Par les cornes du diable ! Il faut quand même que je puisse en placer une –cria Amador, furieux, en voyant que don Remigio recommençait à parler et qu’il n’y avait pas moyen de l’arrêter-. Je peux ou non dire mon avis ? Parce que s’il n’y a que vous deux pour bavarder, moi je suis de trop ici…Eh bien, j’entre dans le jeu comme intermédiaire, et je dis que ces messieurs propinants, ne regardent que leur chapelle, chacun ne regardant que ses intérêts et son métier ; celui-ci, pour l’église, celui-là pour la Faculté. Eh bien moi je dis que ni l’une ni l’autre, saperlipopette ! et que la direction doit être administrative, oui, j’ai dit : administrative. Parce que ici la première chose est d’assurer la soupe pour tout le monde, et on n’assure la soupe qu’en travaillant la terre, et en sachant ensuite comment distribuer ce qu’elle produit entre cette bouche-ci et cette bouche-là. C’est bien que nous ayons l’élément chose…, la religion, bon ; l’élément machin…, la médecine, bon. Mais pour que tous les deux puissent s’accorder et vivre chevillés l’un à, l’autre, on a besoin de l’élément premier, qui est le travail, l’ordre, la prudence et la modération, le travail de la terre, et ça, ni l’Église ni la Faculté ne peuvent le faire.Ah ! Si vous n’arrachez pas son fruit à la terre, à force de la retourner, avec quels trucs allez-vous maintenir l’institution ? Et même d’où sortiront-ils ? A Pedralba, la première chose à faire c’est de remettre la propriété en état, car … Aujourd’hui le rendement est de quatre ; elle doit et elle peut donner quarante, et quand elle les donnera, ils pourront arriver les pauvres, les estropiés, les fous, les teigneux, les aveugles, pour qu’on les soigne tous. Tout le reste, c’est tourner autour du pot et vouloir commencer par la fin. La direction doit être agricole et administrative, et ici il n’y a pas d’autre pape de la campagne que votre serviteur, moi-même, et pour terminer, sachez que ce sont les vœux de monsieur le marquis de Feramor, d’après une lettre que j’ai ici et que je peux vous montrer.
Le médecin et le prêtre se turent un moment, comme écrasés sous le poids du dernier argument présenté par Amador ; mais l’astucieux don Remigio ne tarda à se reprendre, et avec de nouveaux et subtils raisonnements, il se mit à discuter de cette manière :
– Mais, mon cher Amador, ce n’est pas monsieur le marquis qui doit décider ! Je ne nie pas sa respectabilité, ni son autorité, ni l’excellence de ses désirs ; mais détrompons-nous : monsieur le marquis n’a pas voix au chapitre, et ne peut l’avoir, dans une affaire qui est de la seule compétence de madame sa sœur.
– Nous avons convenu, mon cher don Remigio –dit Amador-, que la comtesse est un ange…
– Un ange du Ciel…
– Ceux du Ciel, je ne sais pas ; mais ceux de la terre ont besoin d’un curateur. Laissons la très vertueuse, la très céleste doña Catalina livrée toute seule à ses dévotions et aux tendresses de son cœur, et dans deux ans, la propriété sera hypothéquée.
– Vous vous trompez, Amador. Madame sait s’occuper de ses intérêts.
– Mais madame ne laboure pas les champs, elle croit qu’en labourant le ciel, cela suffit, et le blé et l’orge, saperlipopette !, et les pois chiches et les pommes de terre, je ne crois pas qu’ils poussent au-dessus des nuages.
– Ils poussent aussi au-dessus, monsieur don Amador, et notre Père céleste, qui donne cent pour un, répand ses dons sur ceux qui l’adorent avec ferveur.
– Si je ne sème pas, je ne récolterai rien, même si je passe mes journées et mes nuits à enfiler des rosaires et des trucs. Don Remigio, toutes ces histoires de mysticisme ecclésiastique et de la très sainte foi catholique, c’est une très bonne chose, mais il faut du blé pour vivre. Messieurs, mettons-nous sur le plan du positif. Plaçons-nous sous l’éclairage qui veut que le premier des dogmes sacrés soit l’alimentation.
– Allons donc !…
– L’alimentation, j’y tiens, saperlipopette ! Dites-moi, là où il n’y pas de quoi se sustanter, qu’est-ce qu’il y a ?
-N’exagérons pas –répliqua Laínez, qui était resté silencieux pendant un long moment-. En reconnaissant toute l’importance de l’aspect administratif, je crois que la direction…, ne nous écartons pas du sujet, messieurs, je crois que la direction ne doit être ni agricole ni administrative. Ceci n’est pas une ferme.
– Moi, je dis que si, une ferme hospitalière et monacale.
– Ce n’est pas cela.
– Et même si cela’était –ajouta le médecin-, la direction doit être à la charge de la science, qui embrasse tout ; la science, messieurs, qui…
– Allez, ne nous cassez pas les pieds avec votre sempiternelle science ! Parce que, franchement, si dans ces choses vous nous mettez la religion sous la férule d’une écervelée comme la science, la religion devra s’abstenir et dire : « Débrouillez-vous. »
– Non, monsieur ; mais la science…
– En résumé –cria don Remigio, un peu agacé-, vous allez proposer à madame de vous nommer le chef absolu de Pedralba, avec autorité sur le directeur spirituel et tout ce qui respire.
– Oh, je ne viens pas ici travailler pro domo mea ! Mais si doña Catalina de Halma daigne prendre mon avis en considération, et après aviu instauré une direction scientifique, si elle me fait l’honneur de me désigner pour ce poste, je ne refuserai pas, non, certainement pas , ce serait pour moi un grand honneur d’assumer cette charge.
– Mais comme madame n’acceptera pas une telle folie, mon cher Laínez… Ne vous fâchez pas, je ne veux pas vous offenser…
– Du calme, messieurs, du calme –dit Amador, en remarquant chez Laínez des tremblotements de la petite moustache gominée, et chez don Remigio, une vertigineuse mobilité des yeux, des lunettes, du nez et des mains-, et puisque nous ne nous mettons pas d’accord, n’amenons pas à madame, au lieu d’un conseil sain et prudent, une question archi embrouillée.
– Notre ami Amador est dans le vrai –indiqua don Remigio, en retrouvant son habituelle placidité- ; la vérité, c’est que nous avons oublié le problème concret, sur lequel nous sommes d’accord, pour nous fourrer dans un problème constituant, que nous n’avons pas à résoudre ; au moins jusqu’à présent, l’illustre dame ne nous a pas consulté sur la manière d’organiser l’Institut de Pedralba. Sommes-nous d’accord sur le fait que nous devons lui conseiller l’élimination (je ne dis pas expulsion), l’élimination du refugié don José Antonio de Urrea ?
– Oui –répondirent les autres.
– Eh bien, il n’y a plus rien à dire. Je prendrai la parole au, nom de nous trois.
– D’accord.
– Et si au cours de la conférence, apparaît l’autre problème, le grand problème, nous en parlerons, nous en discuterons, chacun dira son avis, et que madame la comtesse décide. Il est regrettable que sur le grave problème de l’organisation, nous ne lui apportions pas une idée commune. Voyez-vous mêmes : aucun d’entre nous n’est ambitieux, et, pourtant, nous semblons l’être. Si chacun exprimait devant la fondatrice de Pedralba ses opinions de la manière que nous l’avons fait pendant le trajet, loin de l’éclairer, nous la remplirions de confusion, et nous troublerions la tranquillité de sa grande âme. Laissons-la, car elle seule, avec l’aide du Saint Esprit, sans écouter nos propositions radicales et un tantinet intéressées, doit arriver à la possession de la vérité. Les difficultés que la pratique lui auront offert, lui feront comprendre, même si l’Esprit Divin ne lui dit rien, la nécessité d’une direction masculine, et le caractère que cette direction doit avoir.
De si justes et intelligents propos furent très bien accueillis par les autres messieurs, et comme ils étaient à peu de distance du château, ils mirent un point final à leur conversation et s’approchèrent, le visage souriant, en voyant que la comtesse elle-même sortait pour les recevoir avec affabilité.
4
L’après midi, Urrea et l’aîné des Borregos labourèrent avec la charrue la terre de l’un des champs à ensemencer près de la maison. Nazarín et le cadet des Borregos arrosèrent les nouvelles plantations du jardin à la main, avec des seaux et des arrosoirs, et ensuite sarclèrent les platebandes, qui, à cause des arrosages abondants des jours précédents, avaient formé une croûte. Silencieux et attentif à son travail, le prêtre n’échangeait avec son compagnon que les mots strictement nécessaires. Ladislao avait été à la source de la colline pour rapporter le linge lavé par Aquilina, et les enfants, après que Halma leur ait fait la classe, étaient allés jouer avec les petits-fils de Cecilio dans le champ devant la maison d’en-bas. Dans la cuisine se trouvaient la comtesse, avec son tablier, en train de laver la vaisselle, quand Beatriz, qui s’affairait en haut, descendit pour lui annoncer l’arrivée des trois messieurs à cheval.
– Ah ! Je ne les attendais pas si tôt –dit la maîtrese de maison, se préparant à les recevoir dignement-. Ils arrivent comme s’ils venait pour me chapitrer ou me conseiller. Tu ne sais pas à quel propos ? Tu le sauras après.
Je suppose que cela doit être pour que nous admettions les trois petites vieilles malades de Colmenar, qui désirent venir à Pedralba. Je crois que nous aurons de la place, si je déménage dans la chambre d’ Aquilina.
– Il ne s’agit pas de cela : les trois petites vieilles arriveront lundi. Nous les installerons comme on pourra, jusqu’à ce que le maître maçon nous répare les pièces qui donnent au Nord. Nos trois amis viennent pour un autre problème, très délicat, certes, dont m’a parlé don Remigio avant-hier. Dieu veuille les éclairer pour qu’ils reconnaissent à quel point c’est injuste… Enfin, je ne puis rien te raconter maintenant ; c’est trop long.
La maîtresse de maison alla à la rencontre des voyageurs, et tous les quatre montèrent à la seule pièce de la maison réservée aux visites et même aux conclaves aussi solennels que celui qui se tenait ce jour-là à Pedralba ; en effet elle avait un lot de chaises pour six personnes, et un sofa qui de loin sentait le meuble ecclésiastique et capitulaire. La comtesse et les trois amis enfermés là, discutèrent et pérorèrent autant qu’ils voulurent, sans qu’en dehors de la pièce, on puisse entendre le moindre bruit, et il n’y avait personne non plus pour l’écouter. Au bout d’une heure et demi, plutôt plus que moins,, ils sortirent et s’en allèrent comme ils étaient venus. Personne ne sut de quoi on y avait parlé avec autant de discrétion, et aucun hôte de Pedralba, en dehors de Urrea, n’avait envie de savoir le pourquoi de cette réunion inusitée. Le soir, pendant le rosaire et le dîner, l’ex-noctambule remarqua les yeux très rouges de sa cousine. Sans doute, avait-elle pleuré. Après le souper, et quand tout le monde prenait congé pour aller chacun dans sa chambre, la maîtresse de maison dit à Urrea :
– Tu n’auras pas joui longtemps de la bonne commodité de la petite chambre dans la tour : toi et le père vous devrez vous en aller à la maison d’en bas, parce que nous avons besoin de loger ici trois vieilles femmes. On vous portera vos lits là-bas. Prends patience, Pepe. Pour cela et pour tout, je te recommande la patience, sans laquelle nous ne ferions rien de bon.
Et elle ne dit rien de plus ni lui ne s’enhardit pas non plus à dire quoi que ce soit, car quand il essayait, il avait un nœud dans la gorge. La maîtresse de maison, après avoir dit à chacun ce qu’il devait faire le lendemain, se retira. C’était Beatriz
qui devait exercer les fonctions de concierge cette nuit-là : fermer les portes et les fenêtres, éteindre les feux et les lumières, en prenant soin que tout le monde, une demi-heure après, soit entré dans sa chambre respective. En la suivant pour se trouver seule avec elle, Urrea put échanger quelques mots avec elle, au moment où elle verrouillait la porte du Nord, après avoir fermé le poulailler.
– Beatriz, au nom de tout ce que tu as de plus cher au monde, dis-moi de quoi sont venus parler avec ma cousine ces trois bandits.
– Mon Dieu, je ne sais pas !
– Si, tu le sais. Dis-le moi, par le Ciel.
– Tu as oublié l’une des principales règles que madame nous a imposées. Ici il est interdit de raconter ce qui se passe et ni de colpolter des on dit. Que chacun s’occupe à ses affaires, sans s’occuper de ce que diront ou feront les autres
– C’est vrai… Mais comme il s’agit certainement d’une conspiration contre moi, il faut que je me défende.
– Je ne sais rien, José Antonio, ne me pose pas de questions.
– Eh bien, dis-moi simplement une chose. Est-ce que ma cousine a pleuré ?
– Ça, je ne peux pas le nier, parce qu’on le voit bien à ses yeux.
– Et tu en sais la raison ?
– Oh, la raison !… Qu’elle ne peut pas faire tout le bien qu’elle veut. Son âme a de grandes ailes, mais la cage est petite… Et rien de plus. Silence, te dis-je, et retire-toi.
Le pauvre novice n’eut d’autre solution que d’entrer dans sa chambre de la tour, où il trouva Nazarín à genoux devant une statue du Crucifié. La petite lampe qui éclairait la pièce se trouvait sur le sol : comme les personnes présentes et les meubles extravagants étaient éclairés par en dessous, tout prenait un aspect sépulcral. A cause du profond abattement de son esprit, Urrea se crut dans un panthéon. Se jetant sur son lit, comme pour prendre la posture du sommeil éternel, et sans que l’apôtre ait terminé ses prières, il lui dit :
– Mon père, avez-vous remarqué les yeux de ma cousine ?
– Oui, mon fils –répondit le prêtre, toujours à genoux et tournant simplement la tête pour le regarder-. Madame la comtesse, notre reine, notre mère, hélas ! a beaucoup pleuré.
– Êtes-vous au courant du conciliabule ?
– Je sais que ces trois messieurs sont arrivés ensemble et qu’ils sont restés ici un bon moment. Comme cela m’importe peu et que ce n’est pas de mon ressort, je n’ai rien d’autre à dire.
– Je crois fermement qu’ils se sont réunis pour m’expulser d’ici, et qu’ils obéissent à des intrigues de mon cousin Feramor. Le cœur me le dit, la terre me le dit quand je la travaille, les troncs, quand je les frappe de ma hache ; les bœufs me le disent quand je leur mets le joug. Il ne peut y avoir d’erreur ; vivre au milieu de la Nature, entouré de solitude, vous rend devin.
– Si c’était vrai –dit Nazarín en se levant et en se dirigeant vers lui avec un geste affectueux-, si, en effet, pour un motif ou un autre, on t’ordonnait de partir de Pedralba…
– Je sais déjà ce que vous allez me dire… Que je m’en aille, c’est-à-dire que je meure.
– Nous sommes ici pour obéir, pour nous résigner, non pas pour avoir une volonté propre. Tu vois bien comme je fais : prends exemple sur moi.
– Mais, vous ne voyez pas que me lancer hors d’ici c’est me mettre dans les bras de la mort ?
– Pourquoi ? Dieu veillera sur toi.
– Et où irai-je, mon père ?
– Dans le monde, dans un autre endroit solitaire comme celui-ci, que tu trouveras facilement. Cherche-le car rien n’abonde autant sur terre que les endroits solitaires.
– Non, non ; moi, hors d’ici, je suis un homme fini. Halma doit comprendre que mon expulsion de Pedralba est mon arrêt de mort. Dites-le lui.
– Je ne puis dire cela à madame, ni rien. Pensionnaire comme toi, la règle m’interdit de parler au supérieur quand celui-ci ne m’adresse pas la parole. Je réponds à ce que l’on me demande, et rien de plus.
– Eh bien, moi je le lui dirai, je lui dirai de se méfier de ces gens infâmes…
– Ne dis pas de mal, ne dis pas d’injures, ne déteste personne.
– Ah ! Nazarín est un saint ; moi, je voudrais l’être, mais mon imperfection d’avant, celle qui existe là, dans les sédiments du cœur, ne me lâche pas.
– Parce que tu veux bien. Lute contre tes mauvaises passions, demande de l’aide à Dieu et tu seras vainqueur. C’est moins difficile qu’il n’y paraît. Si quelqu’un t’offense, pardonne-lui ; s’ils t’injurient, ne réponds pas par des injures ; et s’ils te blessent, résiste et tais-toi ; s’il te poursuivent dans une ville, fuis dans une autre ; s’ils t’expulsent, tu t’en vas, et où que tu sois, arrache de ton cœur le désir de vengeance pour y mettre l’amour de tes ennemis.
– Je ferai tout cela, car c’est beau; oui, très beau –dit Urrea, avec une légère inflexion ironique- ; mais avant d’adopter une vie aussi sainte, je veux m’en aller du monde avec une satisfaction : je couperai la tête de don Remigio, qui est l’âme de cet indigne complot.
– Mon fils, on dirait que tu es fou –lui dit Nazarín, en lui posant la paume de sa main sur le front brûlant du noctambule réformé-. Mais quelles idées absurdes te passent par la tête ! Tuer !
– Mais est-ce que eux, ne me tuent pas ?
– Te priver d’être ici, ce n’est pas te donner la mort.
– Je me la donnerai s’ils me chassent.
– Bah ! Tu es un enfant, mais je dois m’occuper de toi et j’essayerai que tu ne fasses pas de bêtises.
– Je ne peux pas, je ne pourrai pas vivre en dehors d’ici… Quand je sortirai, ou je me jetterai avec une pierre au cou dans le premier rivière que je trouverai, ou je chercherai un précipice très noir et profond qui voudra bien recueillir mes pauvres os.
Sa poitrine se gonflait. Une forte pression sur la cage thoracique l’empêchait d’expulser tout l’air absorbé par ses poumons avides. Il étouffait ; la voix lui manqua, et de sa gorge sortit un gémissement d’angoisse. A la fin, il éclata en larmes comme un enfant.
– Pleure, pleure tout ce que tu voudras –dit le petit prêtre de la Manche, en s’asseyant à ses cotés-. Ça, ça fait du bien. Les chagrins de l’enfance, avec les larmes sont réduits à néant.
– Ah, bienheureux Nazarín –s’exclama Urrea au milieu de sanglots, en lui serrant la main-, je suis très malheureux ! Reconnaissez qu’il n’y as pas de malheur plus grand que le mien !
– Eh bien, mon fils, tu te plains pour peu de choses. Tu étais plein de défauts, de gros défauts, toi-même tu l’as dit. Madame la comtesse a voulu te perfectionner et elle y est parvenue jusqu’à un certain point au-delà duquel elle n’a pas pu passer. Mais Dieu arrive ensuite pour compléter le travail, il te prend en main et il t’envoie des malheurs et des chagrins pour que, grâce à eux, tu puisses arriver à une régénération complète. Bénis la main qui te blesse, annule-toi, et tu sentiras dans ton âme un grand soulagement.
– Je ne pourrai pas…, je ne pourrai pas… -répondit José Antonio, en proie à une grande inquiétude nerveuse-. Vous, comme vous êtes un saint, vous voyez tout cela très facile…, et naturellement, parce que vous êtes comme cela, on dit que vous êtes fou… Vous ne l’êtes pas, je sais que vous ne l’êtes pas… Façonnez-moi à votre image et ressemblance, rendez-moi divin, et alors… ah !, alors, moi aussi, je pardonnerai les injures, et je bénirai la main noire de don Remigio, qui me blesse, la bouche sale de Laínez qui crache sur moi.
Et comme si on l’avait pincé, il bondit du lit, en criant :
– Je ne peux pas, je ne peux pas rester sur ce chevalet de torture… J’ai besoin de sortir, de respirer de l’air, de voir les étoiles…
– Sortir dans la campagne est impossible : la règle ne le permet pas, et, en plus, la porte est fermée.
– Eh bien, je veux sortir, courir…, voir le ciel.
– En ouvrant la fenêtre, tu le verras. Viens : le voilà. Comme la nuit est belle !
Tous deux contemplèrent un instant le firmament étoilé, et devant l’immensité muette, indifférente à nos malheurs, Urrea sentit grandir son immense chagrin. S’éloignant de la fenêtre, il dit, en soupirant :
– Père Nazarín, si vous m’aimez, parlez-en à ma cousine.
– Je ne puis lui parler de cela ni de rien d’autre. Que suis-je ici ? Rien, un triste réfugié. Je n’ai ni autorité, ni voix, ni opinion, et seulement dans le cas où madame me poserait des questions, je lui ferais connaître mon humble avis. Qualifié de dément, ils m’ont mis dans cette sainte maison, sous la protection de la sublime charité de la comtesse de Halma. Imagine s’il est possible que cette dernière demande conseil à un homme dont on croit l’esprit troublé et si moi, j’osais le lui donner, imagine le cas qu’elle ferait de moi .
– Catalina, comme moi, ne croit pas notre cher Nazarin souffre d’aliénation. Ce sont des vulgarités dans lesquelles un esprit supérieur comme le sien ne peut pas tomber. Elle sait que vous possédez la divine vérité et que votre voix est la voix de Dieu.
– Ne dis pas de sottises, Pepe. Résigne-toi à ce que le Seigneur disposera à ton égard. Ne lutte pas contre son pouvoir… livre-toi.
Urrea se jeta sur une chaise, en laissant tomber ses bras comme un homme fatigué de lutter.
– Quoique vous sachiez tout et que vous pénétriez tout –dit-il après un long moment de silence-, j’ai besoin de vous dire tout ce qu’il y a à l’intérieur de moi. Plus que par devoir, je le fais par nécessité, parce que mon cœur ne tient pas dans ma poitrine, parce que je vais étouffer si je ne raconte pas à quelqu’un mon chagrin, la cause de mon chagrin, et l’impossibilité de trouver une solution à mon chagrin.
– Eh bien, asseyons-nous ici, et raconte-moi tout ce que tu voudras, parce que si tu n’as pas sommeil, moi non plus, et ainsi, nous passerons la nuit.
Urrea parla tellement et tellement que quand il s’arrêta, déjà pâlissaient les étoiles et dans le ciel, se répandait la pure lumière du jour.
5
A neuf heures du matin, Halma et Beatriz, dans les chambres du haut, finissaient de coudre les draps et les édredons pour les lits des vieilles femmes qui bientôt entreraient dans la communauté de Pedralba. Ayant du temps devant elles, du travail entre les mains et sans témoin pour les intimider, elles parlèrent longuement.
– Donc, tu vois –disait la comtesse-, alors que je pensais que dans ce désert, les passions que nous avons laissées là-bas ne viendraient pas nous troubler, il ressort que la Société s’infiltre par tous les bouts ; alors que nous croyions être seules avec Dieu et notre conscience, le monde arrive aussi, arrivent aussi les intérêts profanes pour dire : « Je suis là, nous sommes là. Si tu vas dans le désert, nous te suivrons dans le désert. »
– Allons donc, vous parlez d’une manie que celle de ces messieurs ! -répondit Beatriz-. Quel mal leur fait le pauvre José Antonio ?
– Tout ce remue-ménage, en sont à l’origine mon frère et les autres personnes de la famille, qui ne voient jamais que le côté mauvais et grossier des choses humaines. Les âmes ont des yeux : il y en a d’aveugles, il y en a des myopes, il y en a de malades de la vue… Chez mon frère se réunit toute une société frivole et vaine. Je leur pardonne les mille choses ridicules qu’ils ont dites sur moi ; j’avais cru que jamais plus je n’aurais à penser à de telles méchancetés même pour les pardonner. Mon frère et ma sœur, je les plains d’ignorer que le mal ne prévaut pas toujours dans les âmes et qu’une conscience salie, peut se purifier. Ils ne sont pas croyants; ils parlent beaucoup de Dieu, ils admirent ses œuvres dans la Nature, mais ils ne savent ni les admirer ni les comprendre dans la conscience humaine. Ils ne sont pas mauvais, mais ils ne sont pas non plus bons ; ils vivent à ce niveau moral moyen auquel on doit toute la vulgarité et la fadeur de la société actuelle. À ces gens-là, fais-leur comprendre que notre pauvre José Antonio s’est amendé, que ce n’est plus l’homme d’avant, mais un autre. Un semblable prodige n’entre pas dans ces têtes bourrées de politique, de fausse piété et d’une morale pomponnée et jolie à l’usage de familles élégantes.
Avant de rapporter ce que dit Beatriz, il faut signaler que, comme la comtesse lui avait ordonné de la tutoyer, elle fit l’impossible pour lui faire plaisir, mais en n’y parvenant qu’à moitié. L’obéissance et le respect se bousculaient sur sa langue donnant lieu à des phénomènes très bizarres. Quand elles se trouvaient toutes deux à la cuisine ou en train de laver du linge, et que la conversation naissait à propos de n’importe quel sujet domestique, la femme du peuple tutoyait sans effort la dame noble. Mais quand elles se trouvaient à l’étage supérieur de la maison, et que la conversation tombait sur un point qui ne concernait pas les besognes journalières, elle n’arrivait pas à utiliser la forme familière, il faut le dire, et avec la meilleure volonté du monde, elle ne pouvait pas, Seigneur, elle ne pouvait pas.
– Et à cause des méchantes pensées des gens de Madrid –dit Beatriz-, il faudra que madame mette à la porte son cousin ! Quelle pitié, parce que le pauvre fait bien son travail, et il est si content de cette vie à la campagne.
– Le mettre à la porte ! Je n’y ai jamais pensé. Ce serait une cruauté ; je le défendrai tant que je pourrai, et je crois qu’ils se fatigueront plus vite de l’attaquer que moi de le défendre. Mais je présume, ma chère Beatriz, que cette affaire de mon cousin va occasionner quelque bouleversement dans notre île, si ces messieurs persistent à le désigner comme un danger pour moi et pour Pedralba. Je méprise l’opinion méchante et calomnieuse ; mais il se peut que celle qui s’est constituée à Madrid à mon encontre, parce que j’ai admis ici le pauvre Pepe, sera telle qu’il n’y aura pas d’autre solution qu’en tenir compte. Il pourrait arriver des évènements qui feraient échouer notre humble royaume parce que les autorités ecclésiastiques me retireront leur protection, en me laissant toute seule ; l’autorité civile me regardera aussi d’un mauvais œil, et adieu Pedralba, adieu notre heureuse solitude, adieu nos journées sereines consacrés à Dieu et aux pauvres !
– Cela est impossible –dit Beatriz, très convaincue-. Le Seigneur n’acceptera pas cela.
– Le Seigneur acceptera pour me donner une souffrance supplémentaire et finir de m’éprouver. Le Seigneur, qui m’a affligée, quand il en a eu envie, avec tant de malheurs, m ‘envoie maintenant le plus grand et le plus douloureux : mon honneur mis en doute, Beatriz, et …
– Ton honneur ! –s’exclama Beatriz en se dressant avec orgueil et employant pour la première fois le tu dans une affaire grave-. Non, je dis que c’est impossible et si l’honneur de la femme la plus sainte qui existe au monde ne brille pas comme le soleil, je dis que la Terre est devenue un Enfer.
– Du calme, du calme. L’Enfer est là où il était ; les gens frivoles et qui mentent, font aujourd’hui ce qu’ils ont toujours fait, et ma conscience, transpercée de part en part par le regard de Dieu, resplendit de bonheur devant tous les enfers et tout le mal venu et à venir. Voilà ce que je dis.
– Et moi –s’exclama Beatriz, en proie à une soudaine exaltation et en se levant- je dis que tu es une sainte et que, je t’adore !
Elle tomba à ses pieds comme un corps mort, et les baisa plusieurs fois.
– Lève-toi…, laisse-moi… Je n’aime pas ces manifestations –dit Halma-. Ecoute moi tranquillement.
– Je ne peux pas, je ne peux pas… L’idée qu’ils outragent ma reine et ma dame me rend folle !
– Sois calme et tranquille. Qu’est-ce que cela peut te faire ou me faire qu’on m’outrage ? Est-ce que Dieu aussitôt ne nous dédommage pas en nous donnant la joie de la souffrance, ce bonheur qu’ils ne connaissent pas ?… Laisse-moi continuer et que je finisse de t’expliquer la cause de mon trouble aujourd’hui.
– J’écoute –dit Beatriz en s’asseyant, mais sans reprendre la couture.
– Eh bien, si l’on réduit le cas de José Antonio à une pure question de conscience, je ne crains rien. Je suis innocente ; lui, aussi, et Dieu le sait. Je méprise les jugements de la frivolité humaine, et continue impavide mon chemin. Mais comme nous ne sommes pas libres, comme nous dépendons d’une autorité, de plusieurs autorités, si je retiens mon cousin à Pedralba, notre pauvre île religieuse, cette ville, ou plutôt ce village de Dieu, que j’ai eu tant de mal à fonder, est en danger. Voilà l’horrible conflit dans lequel je me trouve. Si Dieu ne daigne pas m’éclairer, je ne sais pas comment je vais le résoudre. .. C’est triste, très triste, que pour ne pas apparaître comme rebelle à l’autorité ecclésiastique, je doive donner le coup de grâce à un innocent et l’écarter de cette vie bénie… Il ne sera jamais juste ni charitable de l’expulser ; mais, hélas, je vais devoir lui exposer la situation et le supplier de nous quitter.
Toutes deux se turent, et les aiguilles recommencèrent à fonctionner, et les coups d’aiguilles de celles-ci et les soupirs des deux couturières semblaient continuer le triste dialogue. Rentrant en elle-même, la comtesse continua à raisonner de cette manière.
– C’est bien triste qu’on ne puisse trouver la paix même dans le désert. J’ambitionnais de me créer une petite société à moi, qui se consacrerait avec moi au service de Dieu ; j’avais envie de dire à la grande Société : « Je ne t’aime pas, je t’ai en horreur, et je vais fabriquer, avec quatre pierres et une douzaine de personnes, mon village idéal, avec mes lois et mes usages, le tout indépendamment de toi… » Mais c’est impossible. L’organisme total est si puissant qu’il n’y a pas moyen de s’y soustraire. L’Église, contre laquelle je ne ferai jamais rien même en pensée, ne me laisse pas agir dans cet humble recoin, où je m’enferme avec ma piété et l’amour de mes semblables. Pour rester en compagnie de mes frères, de mes fils, je dois transiger avec les lois du dehors, venues de là-bas, de l’ennemi du monde. Je le fuis et il me harcèle, il me suit dans ma Thébaïde, en me disant : « Même au plus profond de la terre, tu ne m’échapperas pas. » Que Dieu m’éclaire pour t’échapper, grande Société ! Qu’il me donne de la patience pour te supporter, si elle n’admet pas mon émancipation !
Une heure plus tard, alors que la maîtresse de maison se trouvait à la cuisine, elle continuait son monologue, et recouvrait lentement l’admirable calme de son esprit.
– Allez, c’est à mourir de rire. J’avais cru que mon île, cachée au milieu de ces broussailles, vivrait pauvre et obscure, ni envieuse ni enviée. Et maintenant, il se trouve que les ambitions humaines l’assiègent et la harcèlent. Ma pauvre île, si isolée, si retirée, et voilà que te sortent de partout des Sanchos qui veulent être tes gouverneurs[7] ! L’Église me demande la direction de cette humble communauté ; la Science, ne voulant pas être en reste, prétend aussi s’y glisser, et, enfin, …. L’Administration demande de nous diriger et nous gouverner. Et que vais-je faire avec des intrus aussi pressants ? Le Seigneur me dira ce que je dois faire, le Seigneur ne me laissera pas sans défense et hésitante au milieu de ce conflit. Obéissance, indépendance !… Oh, entre vous deux, que le Seigneur me dise comment je dois m’arranger !
Avant le repas, Beatriz, qui pendant tout son séjour à Madrid et depuis qu’elle était à Pedralba n’avait eu aucune attaque de son caractéristique mal spasmodique, et se croyant complètement guérie par un aussi long repos, en ressentit des signes ce jour-là, sans doute à cause des émotions violentes de son dialogue avec la maîtresse de maison. Cette dernière essaya de la tranquilliser, en lui affirmant qu’avec l’aide de Dieu, tout s’arrangerait ; pour qu’elle se distraie et calme ses nerfs excités par un exercice salutaire, elle l’envoya porter à manger à Urrea et Nazarín dans la forêt où tous les deux travaillaient. Aquilina, qui était celle qui devait faire cette commission, resta à Pedralba, et Beatriz, avec son panier sur la tête, se mit en route, contente de prendre l’air et de marcher dans la campagne.
L’après-midi, don Remigio arriva en se promenant ; il se montra plus aimable que jamais avec madame la comtesse, lui donnant des petites tapes sur l’épaule, en lui disant qu’elle ne s’inquiète pas de ce que les trois amis et voisins lui avaient dit le jour précédent ; qu’elle n’agisse pas avec précipitation à propos de José Antonio, et ne se fâche pas de devoir le congédier définitivement, parce que lui, don Remigio, avec toute sa prudence et son habileté, en l’invitant à une chasse à Torrelaguna ou à la pêche dans le Jarama, le convaincrait de la nécessité de présenter sa démission de pensionnaire de Pedralba… Et ainsi, il conciliait tout, évitant à madame le chagrin de le renvoyer… Et prenant résolument le ton badin, il sauta sur un autre sujet. Oh ! Cette histoire de la direction médico-pharmaceutique proposée par Laínez est un sottise fort amusante… Et puis, cette direction oratoire et bureaucratique, sortie tout droit de la caboche de don Pascual Amador ? Il avait bien compris que la comtesse se tordrait de rire, dans son for intérieur, en entendant de telles âneries. La direction religieuse, sur la base d’une parfaite concordance entre le prêtre et la fondatrice, allait de soi, et avec un tel organisme il n’était pas difficile de mener Pedralba sur de chemins glorieux.
Halma l’écouta avec bienveillance, sans rien manifester dans une affaire aussi délicate, et ils parlèrent ensuite des travaux d’installation, de ce qui n’avait pas encore été fait et de ce que l’on ferait bien vite pour compléter et parachever l’idée première. Don Remigio trouva que tout était très bien pensé, admirable, supérieur. Et comme la conversation était retombée sur Nazarín, il se rappela qu’il avait reçu une lettre pour lui.
– La voici –dit-il, en la mettant entre les mains de la maîtresse de maison-. Bien que vous et moi soyons autorisés à la lire, je vous la remets sans l’ouvrir. Il y a le sceau d’Alcalá, et elle doit être de ces pauvres infortunés de Andara et de Tinoco (le Sacrílego), qui sont en train de purger leurs peines dans la prison de cette ville. Sans aucun doute, les pauvres ! ils doivent l’appeler, et si cela dépendait de moi, je lui permettrais d’y aller et de les consoler, en leur donnant de la force et de la santé à leurs pauvres âmes. Mais je crains une réprimande de mon Supérieur si je consens à ce voyage, même pour quelques jours. Réfléchissez-y, cependant, et si madame la comtesse en prend l’initiative et en accepte la responsabilité…
La maîtresse de maison, refusa de se prononcer sur ce point, et puisqu’ils parlaient de Nazarín, tous deux le couvrirent d’éloges.
– Il est si humble –dit don Remigio-, et son comportement si exemplaire, son obéissance si absolue, que si cela dépendait de moi, je ne verrais aucun inconvénient à le déclarer guéri. Avez-vous remarqué, depuis qu’il est ici, quelque chose qui confirme ou corrobore le diagnostic de démence?
– Rien, monsieur don Remigio. Tous ses actes, son langage, sont d’une parfaite sagesse.
– Pas même un léger signe de dérangement, quelque chose qui indiquerait, pour le moins, une irrégularité dans l’idéation ?…
– Absolument rien.
– C’est bizarre. Il vit comme un saint, il n’occasionne pas le moindre trouble, il parle bien quand on l’incite à parler, il se tait quand il doit se taire, il obéit toujours, travaille sans cesse, et, pourtant…., je ne sais pas je ne sais pas… Laínez dit que son intelligence s’affaiblit peu à peu.
– Je ne le pense pas .
– La Faculté doit savoir ce qu’elle affirme. Si ce symptôme s’amplifie, il finira dans un état d’imbécillité… C’est Laínez qui le dit… Avez-vous remarqué quelques indices d’affaiblissement cérébral ?
– Aucun.
– Une difficulté à coordonner les idées, une lenteur pour les exprimer ?…
– Non, monsieur.`
– Lui parlez-vous souvent ?
– Très peu.
– Eh bien, il faut sonder cette intelligence en lui présentant des problèmes difficiles sous forme d’exercices. Comme cela on verra la vigueur ou la faiblesse de ses facultés. J’ai déjà employé ce procédé il n’y a pas longtemps avec un cousin à moi qui avait commencé à souffrir de troubles de l’esprit, et le résultat fut désastreux.
– Eh bien, dans ce cas, je pense qu’il sera flatteur. Mettez-le à l’épreuve.
– Que oui, que oui. Envoyez-le moi demain.
– Il ira ; mais… Si vous me permettez… -dit la comtesse de Halma, ayant subitement une idée.
– Oui ?
– Avant de vous l’envoyer là-bas je ferai, moi-même, un petit examen.
– D’accord. Et ensuite, c’est mon tour, et je serai dur, un examinateur implacable. Voyez : je lui proposerai, pour qu’il me les développe, les points les plus difficiles des Summas et des…
– Le pauvre ! Pas si dur…
– Comme il ne s’agit que d’une épreuve, on verra vite si son intelligence décline.
– Et même si elle déclinait un peu, à cause de l’âge, des ennuis, sa raison peut conserver toute sa clarté, et s’il en est ainsi, le supérieur devrait lui rendre les licences .
– Nous verrons. Je ne dis pas non …. Madame, au revoir.
– Don Remigio, grand merci pour tout. Ne voulez-vous rien prendre ?
– Oh, merci ! En dehors de mes heures, vous savez que je ne…
– Pas même un chocolat ?
– Oh, des friandises de vieillards ! Madame, nous, nous venons de la fournée moderne, de la Faculté de Droit…. Au revoir, il est tard. Reposez-vous.
– A votre service, monsieur le curé
6
Ils prièrent, ils dînèrent. Au moment de donner les ordres pour les travaux du lendemain, elle dit au bon don Nazario :
– Mon père, demain vous n’allez pas à la forêt , ni au pré, ni au jardin, je ne veux pas que vous remuiez des pierres ni que vous coupiez des troncs.
– Alors que ferai-je, madame ?
– Demain le corps se repose, et vous travaillez avec l’intelligence.
– Il faut que j’aille à San Agustín ?
– Non, monsieur. Vous allez bientôt passer un mauvais quart d’heure avec les Summas !…
– Alors…
– De neuf heures à dix heures, à l’heure où je termine mes tâches du matin, je vous attends là-haut, dans la pièce à couture, qui est pour le moment notre salle capitulaire.
– D’accord.
Le jour se leva, et Nazarín, après avoir rempli ses obligation de prières du matin, se lava et se fit une toilette soignée, en mettant ses vêtements de prêtre que don Remigio lui avait donnés. Lui, il disait, en distinguant avec sagesse entre une chose et une autre, que si au milieu du peuple et en menant une vie errante, il n’attachait aucune importance à son allure personnelle, en se présentant dans la pièce d’une dame aussi importante et sainte , appelé expressément par elle, il devait s’habiller de la manière la plus présentable, sans se départir de son habituelle simplicité. A neuf heures et demie pile, il se trouvait sur le lieu du rendez-vous. Sa disciple lui dit de l’attendre, parce que madame ne tarderait pas à monter, et quelques minutes après, doña Catalina entra. Cette dernière, à la grande surprise de Beatriz, lui ordonna de rester. Tous trois s’assirent. Une pause et une petite toux. Halma rompit le silence, en disant
– Père Nazarín, je vous appelle pour que vous me donniez votre opinion sur des choses très graves qui m’arrivent… ; non, qui menacent notre pauvre Pedralba. Nous venons à peine de naître, et il semble que nous soyons déjà menacés de mort. Je ne trouve pas la solution au conflit dans lequel je me vois ; mon intelligence est très limitée ; j’ai besoin d’aide, des lumières d’autres intelligences plus illustres que la mienne. J’ai besoin de votre conseil.
– C’est un immense honneur pour moi, madame la comtesse –répondit le pèlerin d’un voix grave, en restant dans une immobilité de statue-. J’estime votre confiance, et j’y répondrai en vous disant ce que je croirai opportun, juste et bon, conforme à la loi de Dieu. Dans ce cas, comme dans d’autres, de mes lèvres ne sortira que la vérité, la vérité telle que moi je la sens.
– Devinez-vous à propos de quoi je veux vous consulter ?
– Oui, madame. Ce n’est pas divination. J’en ai entendu un peu parler.
– Un terrible conflit.
– Pour moi, il ne l’est pas.
Autant de certitude déconcerta la maîtresse de maison, et franchement, dut l’inquiéter aussi un peu le fait que Nazarín, en se voyant demander conseil, n’ait pas commencé par un exorde de modestie, en s’appelant indigne et protestant, comme il est de rigueur dans des cas semblables, de son incapacité, etcetera…
– Parce que ce n’est pas une terrible conflit
– Je dis que je ne le considère par comme tel.
– Et cela fait deux jours que je demande en vain au Seigneur et à la très Sainte Vierge de m’éclairer pour le résoudre.
– Et ils vous ont éclairée, vous –dit Nazarín avec un aplomb qui déconcerta encore plus, la comtesse-. Et ils vous ont dit : « Dans ta conscience, dans ton cœur, tu as la clé de ce que tu appelles conflit et qui ne l’est pas. » Mais il est résolu. C’est évident comme la lumière ! Pardonnez-moi, madame, si je vous parle avec une fermeté que vous pourrez considérer comme arrogante et même irrespectueuse. C’est que, lorsque je crois posséder la vérité dans une affaire grande ou petite, je ne peux m’empêcher de la dire, pour que celui qui en a besoin, l’entende et la comprenne bien. Si vous n’avez pas encore vu cette vérité, il faut que je vous la mette devant les yeux. La voilà : expulser José Antonio ! Jamais . Le supplier qu’il s’en aille ! Non plus. Ce serait une cruauté, une faiblesse, un péché de barbarie presque homicide, que Dieu punira, en déchargeant sur Pedralba sa main justicière.
– Mais je ne veux pas qu’il s’en aille, non, non –dit Catalina, déconcertée devant l’énergie à laquelle elle ne s’attendait pas, sans doute, chez un homme aussi doux.
– Qu’il ne s’en aille pas, non –répéta à voix basse la nazariste, qui, assise sur une chaise basse, à l’autre extrémité de la pièce, écoutait et se taisait.
– Bien ; il ne s’en va pas –continua Halma-. Vraiment, ce serait injuste. Le pauvre se conduit bien, c’est un autre homme. Mais je continue à voir mon conflit,
monsieur don Nazario, parce qu’en gardant ici José Antonio, je contrarie les désirs de personnes très respectables, dont le courroux pourrait être fatal pour Pedralba. La bienveillance de ces personnes, qui sont presque des institutions pour moi, nous est nécessaire. Je vois difficilement comment on pourrait vivre en les ayant contre nous.
Madame peut mener à bien son projet caritatif à l’égard de notre brave Urrea sans que les personnes qu’elle considère comme des institutions aient à intervenir en rien dans les affaires de Pedralba.
– Mais, comment cela est-il possible ?
– II n’y a rien de plus simple, et c’est bizarre que vous ne le voyiez pas.
– Ce qui me semble très bizarre –dit Halma, agitée et nerveuse- c’est la tranquillité avec laquelle vous niez l’existence du conflit, sans donner de raisons pour que je voie facilelent faisable ce que je considère comme difficile, sinon impossible. J’attends de vous un éclairage plus lumineux pour me convaincre que le conseil que vous me donnez n’est pas, une vaine formule. Croyez-vous qu’il faut que je me fâche avec don Remigio ?
– Non, madame ; don Remigio est notre chef spirituel immédiat, et nous lui devons respect et soumission. Je ne dirai pas une parole offensante à son égard ; je le respecte beaucoup ; je suis sous son autorité, qui est paternelle et douce. Les autres ont moins d’importance pour moi… ; mais, enfin, je les respecte, et quand j’ai dit que le conflit se résoudrait facilement, je n’ai pas voulu dire que madame devait se brouiller avec d’aussi dignes personnes. Au contraire, vous pouvez continuer à entretenir avec elles des relations cordiales.
– Don Nazario –dit la comtesse, non plus agitée mais suffocant en se levant-, je ne vous comprends pas.
– Il semblait naturel que, en voyant ce mouvement d’impatience chez la maîtresse de Pedralba, Nazarín se trouble et s’excuse, considérant que le conseil était terminé. Il se leva aussi respectueusement, et avec un très grand flegme en touchant doucement l’épaule de la comtesse il lui dit :
– Restez calme. Nous n’avons pas terminé.
Une pause. Assis tous les deux à nouveau, on entendit encore une fois les petites toux, et Nazarín continua de cette manière.
– Je suis certain, absolument certain, que vous allez bientôt me comprendre. Vous vous dites à vous-même : « Mais, est-ce là l’homme qui allait par les chemins, errant, pieds nus, en vivant d’aumônes, pratiquant la loi de pauvreté donnée par le Christ ? Est-ce le même qui maintenant s’approche de moi, et qui me parle avec dureté, et me dis assieds-toi, comme il le dirait à un gamin de notre école ?… » Eh bien, je suis le même, madame. J’ai vécu d’aumône, d’aumône je vis. Je suis comme les oiseaux qui, libres, chantent, et en cage, aussi… Le milieu dans lequel on vit… et on chante… doit avoir un sens. Avant je chantais pour les pauvres, et j’étais comme eux, pauvre et humble ; maintenant je chante pour les riches, et je dois le faire sur un ton différent. Mais dans ce cas, comme dans l’autre, devant dire une vérité que je crois utile pour les âmes, la manière austère n’est pas de trop. Je faisais alors la même chose : Beatriz peut en témoigner. Il est vrai que vous êtes une personne importante et connue pour sa morale ; mais comme maintenant vous vous trouvez dans la situation de devoir prendre de graves décisions, moi, votre conseiller en ce moment, je dois me revêtir de l’autorité, et la même autorité que j’ai dû employer devant la pauvre femme ignorante et pécheresse.
– Vous me traitez, donc- dit la comtesse au comble de la confusion-, comme une pécheresse…
– Je sais bien que non ; je sais bien que vous êtes une personne vertueuse ; mais vous pourriez cesser de l’être, si vous ne preniez pas dès maintenant la décision de changer d’idées sur des points fondamentaux. Il faut que vous modifiez radicalement votre façon de pratiquer la charité et votre système de vie. Si jamais vous ne le faisiez pas, vous pourriez perdre votre tranquillité, et avec la tranquillité…, même votre moralité.
– Je ne vous comprends pas, je ne sais ce que vous voulez me dire –répliqua Halma, non plus inquiète, mais angoissées par les idées extraordinaires et inattendues que le mendiant errant se permettait d’exprimer-. Vous voulez dire, peut-être, que je n’ai pas su donner à mes projets de vie chrétienne la forme la plus acceptable.
– Non, madame, vous n’avez pas su.
– Vous le dites pour de bon?
– Comme je dis que depuis assez longtemps, madame vit dans une erreur lamentable…, mais depuis longtemps. Ne croyez pas que, prononcer devant vous la vérité que je sens, me fait mal. Au contraire, je suis heureux de la dire, et je la dirais même si je voyais que vous ne l’entendiez avec plaisir.
– Je vous assure que, en vérité…, je n’aime pas beaucoup ce que vous me dites… D’après cela, le chemin que je prends n’est pas le meilleur…
– C’est un bon chemin, et grâce à lui on peut parvenir à la perfection. Mais, vous, vous n’y parviendrez pas, non, madame.
– Pourquoi ?
– Parce que c’est ainsi…, parce que votre chemin est autre…, et là, est votre erreur. Et j’arrive au bon moment pour vous dire : « Madame la comtesse, votre chemin n’est pas celui-ci, mais celui-là. »
7
Perplexe et ébahie Catalina entendit ces paroles qui, à son avis, au milieu des impressions de cet instant, détonnaient horriblement. Elle crut entendre une voix venue de très loin, et Nazarin se déformait dans son imagination et lui faisait peur. Présumant qu’il avait encore à lui dire des choses encore plus déplacées et étranges, elle se repentait de lui avoir demandé conseil, et désirait clore ce chapitre le plus vite possible. Beatriz, inquiète, ne quittait pas des yeux la maîtresse de maison, dont elle lisait l’effarement sur son visage expressif, et ne pouvant mettre en doute l’intelligence et la sincérité du maître, elle attendait que celui-ci explique ses vérités pour que l’illustre fondatrice se déride.
– Le chemin de la comtesse n’est pas celui-ci, mais celui-là –répéta Nazarín, et maintenant vous verrez comme je vais vite vous le faire comprendre. La première chose : l’idée de donner à Pedralba une organisation publique semblable à celle des institutions religieuses et caritatives qui existent aujourd’hui est une très grande sottise.
– Alors, quelle organisation aurais-je dû donner… ?
– Aucune.
– Aucune ! De sorte que, selon vous, le meilleur système… ?
– C’est le refus de tout système dans le cas concret de Pedralba et du vôtre.
– Et comment faut-il comprendre cette organisation… négative ?
– D’une manière très simple et qui n’est pas la désorganisation, loin s’en faut. La même chose que ce que vous essayez de faire ici au service de Dieu et des humbles sans défense, vous pouvez le faire, et vous le ferez mieux, en vous établissant sous une forme de liberté absolue, de sorte que ni l’Église ni État, ni la famille de Feramor, ne puissent intervenir dans vos affaires ni demander des comptes de vos actes.
– Eh bien, si vous me donnez la clé de cette organisation désorganisée et libre –dit la comtesse ironiquement, je vous déclarerai la première intelligence du monde.
– Je ne suis pas la première intelligence du monde, mais Dieu veut qu’à cette occasion je puisse dire des vérités qui dominent et captivent votre grande intelligence, en lui permettant de réaliser les buts que vous vous proposez. Vous n’avez pas compris le concept de liberté que je me suis permis de vous exposer. Nous savons bien que toute liberté entraîne un esclavage. Maintenant vous êtes esclave de la société. En vous émancipant de celle-ci, vous changerez la forme de votre liberté et aussi celle de votre chaîne…
-Monsieur Nazarín –dit Halma, en se levant pour la seconde fois, ou vous vous moquez de moi, ou…
– Laissez-moi continuer. Prenez patience. Faites-moi le plaisir de vous asseoir et d’écouter ce qu’il me reste encore à vous dire. Ensuite, vous suivez mon conseil ou vous le rejetez, à votre gré. A quoi pensiez-vous en créant à Pedralba un organisme semblable aux organismes sociaux que nous voyons ça et là détraqués, des machines usées et vieilles qui ne fonctionnent pas bien ? A quoi conduit cette idée que votre île ne soit pas la vôtre, mais la province d’une île totale ? A partir du moment où madame se met d’accord avec les autorités civile et ecclésiastique pour admettre tel ou tel malheureux, elle donne le droit aux autorités pour qu’elles interviennent, surveillent et prétendent diriger ici comme partout ailleurs. Dès que vous bougez, l’Église arrive et dit : « Halte-là », et arrive l’État intrus et il dit : « Halte-là ». L’une et l’autre veulent inspecter. La tutelle vous enlèvera toute initiative. Combien il serait plus simple et plus pratique, ma chère madame, de ne rien fonder, de vous passer de toute constitution et de tout règlement, et de vous constituer en famille, en maîtresse et reine de votre maison particulière ! A l’intérieur des frontières de votre maison, vous serez libre de protéger les pauvres que vous voudrez, de les asseoir à votre table, et de vous conduire selon les inspirations de votre esprit de charité et de votre amour du bien.
La comtesse, enfin, se taisait, et écoutait avec une profonde attention.
– … Et cette vérité une fois dite –continua Nazarín-, je vais en exprimer une autre, parce qu’il n’y en a pas qu’une qui doive vous guider sur le bon chemin : il y en a deux, ou trois peut-être, et puisque c’est à moi de les dire, j’irai droit au but sans m’inquiter de vous fâcher ou non. Même si je savais que je serais renvoyé de votre île, où je me trouve si bien, je ne tairais pas les vérités qui me restent à dire. Nous y allons. Madame la comtesse est jeune, et dans sa vie relativement courte elle a souffert plus que d’autres dans une longue vie ; en peu de temps, elle a subi, oui, de grandes épreuves et des souffrances. Elle a vu très tôt sa jeunesse flétrie par des désaccords avec sa famille ; elle a vu mourir sur des terres lointaines l’époux qu’elle adorait ; elle a souffert ensuite des contretemps, l’indifférence, des chagrins… Son âme, dégoûtée des choses de ce bas monde, s’est tournée vers Dieu ; elle a aspiré à lui appartenir complètement, elle a pensé qu’elle devait consacrer le reste de ses jours à la mortification, à l’ascétisme, à la charité… Parfait. Tout cela c’est très bien, et je loue ces aspirations qui démontrent la grandeur de son esprit. Mais je dois vous le dire franchement, que j’y vois une grave erreur, madame, parce que la sainteté dont vous rêvez depuis que vous avez perdu votre époux, vous n’y parviendrez pas par ces moyens. L’ardeur de la vie mystique vous ne l’avez que dans votre imagination, et cela ne suffit pas, madame la comtesse, parce que vous seriez une mystique rêveuse ou imaginative, et non pas une sainte comme vous le souhaitez et comme tous nous voulons que vous le soyez.
Halma voulut dire quelque chose, mais elle ne put ; elle avait la gorge nouée.
– … Il arrivera un jour, si madame ne prend pas une autre voie, où tout ce mysticisme se transformera en un nid de passions, qui pourraient être bonnes, et qui pourraient aussi être mauvaises. Cessez d’aspirer à la sainteté par ce chemin, et dépêchez-vous de suivre celui que je vais vous proposez. Qui vous a conseillé de renoncer à toute affection terrestre et de vous consacrer à l’amour idéal, à l’amour pur des choses divines ? Sans doute, ça été notre bon don Manuel Flórez, homme très bien, mais qui vivait dans la routine et prenait toujours les chemins battus. Le vertige social, au milieu duquel avait vécu notre sympathique don Manuel, ne lui permettait pas de voir bien les complexions humaines, ni la physionomie particulière de chaque âme, ni les caractères ni les tempéraments. J’ai eu la chance d’y voir plus clair, quoique tard, à temps, sans doute car le Seigneur m’a éclairé pour que je vous sorte du marais dans lequel vous vous êtes mise. Non, la vie ascétique, solitaire, consacrée à la méditation et à l’abstinence, ce n’est pas pour vous. La maîtresse de Pedralba a besoin d’activité, d’occupation, de travail, de mouvement, d’affection, de vie humaine, enfin, et dans celle-ci elle peut arriver, sinon à la perfection, parce que la perfection nous est interdite, du moins à une telle somme de mérites et de qualités, qu’il n’y aura personne sur terre qui la dépasse et que vous serez la joie de Dieu qui vous a créée.
Doña Catalina, toute rouge, lançait des flammes de ses joues.
-… Vous n’obtiendrez rien par le côté purement spirituel ; vous aurez tout par le côté humain… Et il ne faut pas mépriser ce qui est humain, madame, parce que nous mépriserions l’œuvre de Dieu qui, s’il a fait nos cœurs, est aussi, le créateur de nos nerfs et de notre sang. C’est un homme qui ne connaît ni l’adulation ni la peur qui vous le dit. Je ne suis rien, et si parfois je n’étais pas l’organe de la vérité, mon existence aurait peu de valeur. Aux pauvres, je leur dis de supporter et d’espérer ; aux riches, de protéger le pauvre ; aux méchants qu’ils reviennent à Dieu par le chemin du repentir ; aux bons, de vivre saintement dans les lois divines et humaines. Et à vous, qui êtes bonne et noble, et vertueuse, je vous dis de ne pas chercher la perfection dans le spiritualisme solitaire, parce que vous ne la trouverez pas ; car votre vie a besoin de l’appui d’une autre vie pour ne pas chanceler, pour marcher toujours bien droite.
Catalina de Halma, en entendant ce mot d’appui d’une autre vie, sentit ses cheveux se dresser sur sa tête. Nazarín se leva ; elle aussi, les yeux épouvantés, le visage tout rouge :
– Ce que vous voulez me dire –murmura-t-elle, en contractant ses doigts, coemme si elle voulait en faire une serre aiguisée-, ce que vous me proposez c’est … de me marier !
– Oui, madame, cela même : que vous vous mariez.
La comtesse lança un cri guttural, et portant la main à son cœur, comme pour contenir un éclatement, elle tomba sur le sol en proie à d’horribles convulsions.
8
Beatriz courut à son secours, la prit entre ses bras. Nazarín la regardait impassible. Dans son évanouissement, au milieu de phrases inintelligibles, doña Catalina prononça clairement ces mots : « Il est fou, et il veut me rendre folle. »
Nazarín sortit de la salle capitulaire, où Beatriz, aidée d’Aquilina qui était accourue promptement, essayait de ramener l’illustre dame à son état normal. Il avait suffit de dégrafer son gilet et de lui mouiller les temps avec de l’eau froide pour que Halma se revienne à elle, et de nouveau seule avec la nazariste, il se passa plus d’un quart d’heure sans qu’aucune des deux ne dise un mot pour ou contre le très singulier conseil de l’apôtre mendiant.
Catalina, en proie à une intense langueur, fut la première à rompre le lourd silence avec cette question :
– Et quand je me suis évanouie, n’a-t-il pas dit autre chose ?
– Non, madame, rien d’autre.
– N’a-t-il pas dit la troisième vérité…, que je dois me marier avec José Antonio ?
– Je n’ai rien entendu de tel.
Halma resta comme engourdie sur le sofa et alors que Beatriz la croyait endormie, voilà que notre dame se lève, très nerveuse, et que, trahissant une grande agitation dans ses paroles et ses gestes, elle dit précipitamment :
– Beatriz, cet homme est un saint, cet homme est le juste, le missionnaire de la vérité, l’émissaire du Verbe Divin. Sa voix m’apporte la volonté de Dieu, et je me prosterne devant elle. Cette idée de me marier me trottait dans la tête, sans oser entrer dans mon esprit, parce qu’il était occupé par les mille artifices de ma vanité de sainte imaginative et de mystique visionnaire… Il m’a dit la grande vérité, qui a mis du temps à s’emparer de mon esprit, abruti par les idées routinières dont je le remplis et le bourre depuis quelques temps. Où est ton maître ? Je veux le voir. Je veux qu’il me parle à nouveau et qu’il me confirme ce qu’il m’a dit avant.
Toutes deux sortirent.
– Il est là-bas –signala Beatriz, après avoir exploré depuis une fenêtre la campagne solitaire de Pedralba-. Il se promène sous le mûrier.
Elles y coururent, et s’agenouillant devant lui, Halma lui dit :
– Mon père, jamaisje n’ai jamais entendu une vérité aussi grande et aussi claire. Vous m’avez révélée à moi-même. J’étais comme le ver qui s’enferme dans le cocon qu’il tisse. Vous m’avez sortie de ma propre enveloppe. Un sentiment existait en moi, dont je me rendais à peine compte : tellement il était caché, le pauvret, dans un coin de mon âme. La voix du bon père l’a fait bondir, et le coquin a grandi d’un coup… Oh, quelles vérités j’ai entendues de cette intelligence souveraine ! Toute seule, en vain je demanderai de la sève et de la chaleur au mysticisme. Accompagnée, j’aurai quelqu’un pour me défendre, pour m’aider, nous serons deux en un seul pour continuer notre sainte œuvre. Je ne fonde rien, je ne veux pas de communauté constituée de mille petites formules qui seraient autant de brèches par lesquelles entreraient le curé et le médecin et l’administrateur pour inspecter mes actes. Mon île n’est pas, ne doit pas être une institution à l’image et à la ressemblance de l’État. Que mon île soit ma maison, ma famille. Mon mari et moi nous y sommes les maîtres et agissons, en toute liberté, selon la loi de Dieu.
– Regardez-le, regardez-le –dit Nazarín, en signalant un point au loin, ou l’on voyait une couple de bœufs et un laboureur derrière-. Voilà l’homme, le cœur grand et beau, l’être que vous, avec votre charité, mal comprise par notre bon Flórez, et reniée par votre frère, vous avez sorti de la misère et de l’abjection. Je l’ai sondé. J’ai vu son âme devant moi, claire et évidente. C’est un homme bon, et il sera un excellent maître de Pedralba.
– Nous vous bénirons, mon père, vous le saint, le juste, celui qui voit et qui découvre tout.
-Je ne suis rien de tout cela –répliqua notre prêtre de la Manche, refusant de se laisser baiser les mains et l’obligeant à se relever-. Madame à genoux devant moi ! Il ne manquait plus que cela ! Je ne suis ni saint ni juste, ma chère dame, mais un pauvre homme qui, grâce à Dieu, a su voir ce que personne n’avait vu : que madame aime son cousin, qu’elle l’aime d’amour, peut-être depuis le jour où il était venu vers elle, comme un vrai débauché, avec l’intention de lui demander l’aumône.
– C’est vrai, c’est vrai… Et moi qui avais pensé l’éloigner de moi ! Quel égarement ! J’étais arrivée à croire que la sécheresse de cœur est la première marche pour monter vers ces saintetés dont j’avais rêvé… Avec ma sainteté, j’étais comme une gamine qui a une robe toute neuve. Et le pauvre José Antonio qui brûlait d’affection pour moi, que j’interprétais comme le signe d’une reconnaissance très vive ! Je me doutais bien qu’il devait s’agir de quelque chose d’autre ; mais ma stupidité était si grande, qu’en voyant ce sentiment, j’y jetais de la terre, toute cette matière inerte, que je sortais de la fosse mystique dans lequel je voulais m’enterrer.
– Et maintenant, madame la comtesse, maintenant que les grandes vérités sont sorties, avec l’aide lumineuse de Dieu, de l’obscurité où elles se cachaient, allez à la maison, vaquez à vos occupations habituelles, et laissez-moi le soin de mettre Urrea au courant de ce bonheur, parce que si je ne lui communique pas d’une manière graduelle, il se pourrait qu’une joie soudaine lui produise une commotion trop forte et dangereuse.
Halma ne fut pas longue à lui obéir, et elle s’en alla avec Beatriz à ses besognes domestiques, qui ce jour-là, lui semblèrent plus agréables que jamais. Et l’homme de la Manche prit pas à pas le sentier qui conduisait au champ que le noble Urrea était en train de labourer. Le brave laboureur, en le voyant arriver, lui fit un grand salut, en levant plusieurs fois son aiguillon, et quand il le vit à portée de voix, il n’osa pas lui poser des questions, si grande était sa peur, sur ce qu’il désirait si ardemment savoir. Les bœufs à l’arrêt, Urrea resta immobile comme une statue. Les pieds dans la glaise, la main gauche sur le mancheron, tenant dans la main droite l’aiguillon, il était une belle représentation de l’Agriculture, sculptée en terracotta.
– Mon fils –lui dit Nazarín-, je ne sais si les nouvelles que je t’apporte te sembleront satisfaisantes. Ne te réjouis pas d’avance.
José Antonio pâlit.
– Mon fils, si tu n’étais pas si niais, tu comprendrais que les nouvelles que je t’amène sont entre les deux plutôt bonnes.
Le visage du laboureur devint tout rouge.
– Madame la comtesse ne veut pas tu t’en ailles de Pedralba. Mais…
– Mais, quoi ?
– Mais … le problème est qu’elle ne trouvait pas la manière de te retenir. A la fin, je lui ai donné une petite formule ou recette pour résoudre le conflit et éviter les intrusions probables de don Remigio, de Laínez et Amador. On va changer radicalement le régime de Pedralba. Tu comprends ?
– Je ne comprends rien.
– Parce que tu es très sot. Bon, mon fils, j’ai convaincu madame la comtesse…, je te le dis ?, qu’elle doit parachever la grande œuvre de ta rééducation, je te le dis ?…, en se mariant avec toi. Tu le crois ?
Urrea brandit l’aiguillon, et lui imprima un tel mouvement dans le trouble provoqué par l’heureuse surprise, que Nazarin aurait pu croire qu’il le traversait de part en part.
– Du calme, mon fils, ne fais pas de folies. Les choses vont là où elles doivent aller. Remercie Dieu d’avoir éclairé ta cousine. Elle comprend enfin qu’elle doit prendre le courant de la vie par son cours naturel. Sa décision résout d’une manière très naturelle toutes les difficultés qui avaient surgi pour gouverner cette île. Les maîtres de Pedralba ne fondent rien ; ils vivent chez eux et font tout le bien qu’ils peuvent faire. Tu vois à quel point c’est facile et simple ! Pour penser à cela, il faut l’intervention de l’Esprit Saint. Et, cependant, la grande intelligence de madame la comtesse de Halma, éblouie par ses propres splendeurs, ne voyait pas cette vérité élémentaire. Dieu a voulu que moi, un pauvre prêtre vagabond, prêche le bon sens aux esprits audacieux, aux âmes trop ambitieuses.
José Antonio serra Nazarín dans ses bras, et ne put exprimer sa joie que par des phrases entrecoupées :
– Moi aussi, moi aussi…. J’avais vu clair…, je ne pouvais pas le dire…, pas me le dire à moi… Je craignais de dire une sottise… Et cela ne l’était pas, par le Ciel, ce ne l’était pas ! La plus haute science ressemble à la folie ; la vérité de Dieu…, un non-sens pour les hommes.
– Maintenant, mon fils, continue ton travail, comme si de rien. Continue à labourer, labourer, car cela distrait, et en même temps que tu ouvres la terre, tu rends grâce à Dieu pour la bienfait qu’il vient de te faire. Ce bien si grand et si beau, tu ne le mérites pas.
– Je ne le mérite pas, non –dit Urrea avec émotion-. J’ai beaucoup souffert dans ce monde. Mais même si mes malheurs avaient été un million de fois plus grands, ma joie immense n’a aucune mesure avec eux.
– Travaille, mon fils, travaille. Et je te recommande autre chose. Ne vas pas au château avant la nuit…, parce que je suppose qu’on t’amènera ici à manger.
– C’est ce que je crois.
– Ne montre pas d’impatience, ne t’emporte pas, et quand tu verras ta cousine ce soir, sois calme et réservé… Toi…, tu te tais, jusqu’à ce qu’elle te parle. Et quand elle daignera t’exposer sa pensée, tu la remercies d’une façon tranquille et noble, en promettant de lui consacrer ta vie et tout ton être, et en lui faisant voir que tu ne crois pas mériter ce bonheur inouï qu’elle te donne… Allez, mon fils, à tes boeufs, et à ce soir… Avec ce sillon, tu écris dans la terre ta gratitude. Aime la terre qui nous nourrit tous et nous enseigne tellement de choses, et parmi elles, une , très difficile à apprendre. Je parie que tu ne sais pas ce que c’est. Attendre, mon fils, attendre. La terre veille à la maturité des choses, et nous la donne… quand elle doit nous la donner.
9
Ce dont parlèrent, ce soir-là, après dîner, la régente de l’île et le futur maître de Pedralba, ne figurent pas dans les archives nazaristes, d’où a été scrupuleusement tiré tout le matériel pour composer la présente histoire. Sans doute, après avoir rendu compte de la grave décision matrimoniale de la sainte comtesse, les chroniqueurs du nazarisme n’ont pas cru devoir s’étendre avec de plus amples développements narratifs sur un événement aussi considérable, ou ont considéré vides de tout intérêt religieux et social les paroles émues avec lesquelles les deux personnes donnèrent confirmation de leur dessein matrimonial. La seule chose que l’on trouve en rapport à ce fait, c’est l’annonce que José Antonio se prépara cette nuit-là même pour partir à Madrid le lendemain matin. Et un autre document nazariste corrobore que, en effet, il partit à cheval au lever du jour, et que Halma sortit pour lui dire au revoir et lui souhaiter un bon voyage, ajoutant quelques remarques qu’elle avait oubliées lors de leur conversation le soir précédent. C’est un fait irréfutable, dont feront foi, si cela était utile, des témoins oculaires, que déjà à cheval, le présumé gouverneur de l’île, alors qu’il étreignait la main de la comtesse, prononça ces mots :
– Je n’ai qu’un souci : que notre don Remigio, qui certainement sera au comble de la colère en voyant que la prébende de la Direction de Pedralba n’est pas pour lui, ne nous fasse des ennuis avec des délais et peut-être de sérieux obstacles. Je n’ai cessé d’y réfléchir cette nuit, et à la fin, ma chère cousine, ce qu’il en ressort c’est qu’il nous faut acheter sa bonne volonté.
– L’acheter !… Comment !…. Que veux-tu dire ?
– Tu vas voir. Je ne reviens pas de Madrid sans rapporter sa nomination pour l’une des paroisses de là-bas. C’est son rêve, son ambition, et si j’arrive à le satisfaire, l’homme est à nous maintenant et à jamais. J’ai pensé que personne ne peut m’aider dans cette demande aussi bien que Severiano Rodríguez, qui est, comme tu le sais, un ami intime de l’Évêque. Et comme Severiano et ton frère Feramor ont eu une formidable empoignade au Sénat, et que maintenant ils sont à couteaux tirés, j’espère qu’il m’appuiera avec intérêt, avec l’ardeur d’un sectaire. Il suffit de lui faire comprendre que le parlementaire et économiste anglais verra d’un fort mauvais œil ce qui, nous, nous plaît et nous est profitable. Crois-le, je vais labourer la terre de là-bas comme j’ai labouré celle d’ici, pour nous gagner la bienveillance du petit prêtre de San Agustín, qui est celui qui nous bénira. Laisse-moi faire, je saurai arranger l’affaire…, parole. Je ris déjà en pensant au tapage qui va éclater quand je vais leur annoncer la nouvelle. Cela fera l’effet d’une bombe ; d’ici, tu entendras la déflagration, et tu riras, tandis, que moi je ris là-bas, jusqu’à ce qu’arrive le jour, heureux où nous rirons ensemble.
Le premier jour de l’absence d’Urrea, la comtesse, dans un long et affectueux conciliabule qu’elle eut avec Nazarin, ainsi qu’il apparaît dans des documents d’indubitable authenticité, signala à l’apôtre combien il serait juste et humain de le déclarer guéri, lui reconnaissant l’entière jouissance de ses facultés intellectuelles. Si c’était à elle d’en décider, cela ne ferait aucun doute, car, quelle preuve plus évidente du parfait état cérébral de don Nazario que son incomparable conseil et avis dans l’affaire que Halma avait soumis quelques jours auparavant à son appréciation ?
Ce à quoi le pèlerin répondit sereinement que, se trouvant soumis à une observation par son supérieur hiérarchique, il n’y avait que celui-ci qui pouvait décider s’il devait ou non être réintégré dans ses fonctions sacerdotales. Il était certain qu’un bon rapport de madame la comtesse, à qui l’Église avait confié la garde du dément supposé, serait d’un grand poids et ferait autorité ; mais, selon l’avis de l’intéressé, ce rapport ne serait pas efficace s’il n’était pas précédé d’une intervention explicite de son supérieur immédiat, le curé de San Agustín. L’apôtre ajouta que sa plus grande joie serait qu’on lui rende ses licences pour pouvoir célébrer le Saint Sacrifice, et si on lui accordait la liberté, il irait sans tarder à Alcalá de Henares, où ses chers fidèles, le Sacrílego et Andara, supportaient les rigueurs de la Loi. Cela dit, sa patience de s’épuisait jamais, et il attendrait tranquillement, décidé à ne pas jouir de la liberté tellement souhaitée, tant que celui qui devait la lui donner, ne la lui donnait pas.
Avec don Remigio, la comtesse parla aussi de cette affaire, n’obtenant de lui que de vagues promesses d’étudier le cas, et le soumettant, en outre, au diagnostic médical de Laínez. Elle fit part aussi au curé et au médecin de son projet de mariage, et il n’y a pas de mot pour décrire la surprise, la stupeur de ces très dignes personnes et du voisin propriétaire de la Alberca. Don Remigio ne cessa, durant tout le trajet de Pedralba à San Agustín, de se signer de haut en bas.
José Antonio resta cinq jours à Madrid, et il revint le matin du sixième, heureux et triomphant, car il avait bien réglé toute la paperasserie que la célébration du mariage exigeait. Et quand il racontait à sa cousine le scandale qu’avait produit dans la famille l’annonce de son mariage, il était intarissable. Au début, ils avaient cru que c’était une blague ; convaincus, à la fin, que c’était vrai, une pluie de plaisanteries saignantes tomba sur les solitaires de Pedralba. La moins offensante était la suivante : « Catalina avait emmené Nazarin pour le soigner, et celui-ci l’avait rendue plus folle qu’elle ne l’était. » Halma et Urrea firent ce qu’ils avaient annoncé avant son départ : passer des bons moments à rire de tout ce tapage à Madrid, qui certainement ne leur causerait plus aucune inquiétude ni souci. A ce moment survint notre brave don Remigio, et Urrea alla droit vers lui, et le serrant dans ses bras à l’étouffer, il lui dit :
– Mes félicitations à l’illustre curé de San Agustín à qui ses supérieurs ont rendu justice en lui donnant une charge à la hauteur de ses immenses talents et ses éminentes qualités.
Don Remigio ne comprenait pas, et l’autre, le serrant à nouveau dans ses bras, dut lui expliquer la chose clairement.
– Sachez que j’ai apporté votre nomination…
– Pour une paroisse de Madrid ?
– Cela a été impossible, parce qu’actuellement, il n’y a pas de place vacante, mon très digne ami et chapelain ; mais monsieur l’Évêque, avec qui un ami à moi a parlé de vous, en vantant vos mérites, m’a affirmé que vous irez promptement à Madrid et que, en attendant, pour qu’un homme aussi plein de qualités et de savoir ne vive pas oublié dans ce trou, on vous nomme économe de Santa María, à Alcalá.
– Santa María, à Alcalá ! –s’exclama don Remigio, comme en extase. Tant sa nouvelle affectation lui paraissait magnifique et enviable.
Et une étreinte plus suffocante que les précédentes scella l’amitié impérissable entre le bon prêtre de San Agustín et l’insulaire de Pedralba.
– Et que puis-je faire pour vous démontrer ma reconnaissance, monsieur de Urrea ? Que peut faire ce modeste curé ?…
– Ce modeste curé n’a rien d’autre à faire que de nous conserver sa précieuse amitié, que nous estimons tellement. Et avant de remettre la paroisse à celui qui vient vous remplacer, bénissez-nous.
– Tout de suite…, je veux dire, demain, après-demain. Je suis aux ordres de madame doña Catalina, que je ne dois plus appeler comtesse de Halma.
– Ce sera après-demain, monsieur don Remigio –dit Halma-. Et il y a encore une chose que je dois mériter de votre bienveillance : n’oubliez pas notre cher Nazarín.
– Comme je dois allez à Madrid pour voir mon oncle, là-bas je ferai un rapport favorable. Mais c’est évident qu’il a toute sa tête ! Une intelligence lumineuse comme le soleil. N’est-ce pas, madame ?
-C’est ce que je crois.
– Je n’ai pas d’inconvénient à le déclarer guéri, sous ma responsabilité, certain que monsieur l’Évêque confirmera mon avis, et s’il veut venir avec moi à Alcalá, je l’emmène, oui, je l’emmène, et je lui donnerai une modeste chambre dans ma très modeste maison.
– Nous nous en réjouissons et nous le regrettons –affirma la dame de Pedralba-, parce la compagnie de notre bon don Nazario nous est agréable au-delà de toute expression.
– Il viendra nous voir –dit Urrea-. Et parfois nous aurons aussi ici monsieur don Remigio. Ce n’est plus une institution religieuse ni bénéfique, il n’y a ici ni règles ni réglementation, il n’y a d’autre loi que celle d’une propriété privée. Nous nous gouvernons tous seuls et nous gouvernons notre chère île.
– C’est comme cela que cela doit être… et ainsi, vous n’aurez pas de casse-tête, ni à supporter les impertinences de voisins intrus, ni l’ingérence de la direction de l’Assistance Publique ou de l’autorité ecclésiastique. Maîtres chez vous, vous faîtes le bien selon votre libre volonté, en n’en rendant compte qu’à Dieu… C’est ce que j’ai toujours dit, c’est la vérité simple, élémentaire !… Allons ! À après-demain d mon église, à l’heure que ces messieurs dames voudront.
Après avoir décidé de l’heure, don Remigio monta sur son bidet et piqua des deux. L’animal devait partager la joie inquiète de son maître, parce que d’un trait, il l’emmena au village voisin.
Dans la note d’un fort curieux document nazariste qui mérite d’être conservé comme une relique, il est dit que le jour même du mariage, le petit prêtre de la Manche partit de San Agustín, sur l’ânesse du grand don Remigio. Il prit affectueusement congé des maîtres de Pedralba et de Beatriz, qui pleurait comme une Madeleine en le voyant partir, et prenant la route vers le bac de Algete, il traversa le Jarama, cheminant sans arrêt, au pas mesuré de son ânesse, jusqu’à la très noble ville d’Alcalá, où il pensait que sa présence serait de grande utilité[8].
F I N
Santander – San Quintín octobre 1895.
[1] Grand parc à l’Est de Madrid.
[2] – Réservoirs d’eau qui alimentent Madrid
[3] – Respectivement, deux places au Nord de Madrid.
[4] En français dans le texte.
[5] Ecrivain espagnol (1806-1880), grand poète, auteur dramatique et érudit.
[6] Allusion évidente au roman de Cervantes : L’ingénieux hidalgo de la Manche, 2ème partie, chap. 42 à 53.
[7] Voir Vie de l’ingénieux don Quichotte de la Manche, 2ème Partie, chap. 42 à 53.
[8] Voir L’Ingénieux chevalier Don Quichotte de la Manche …








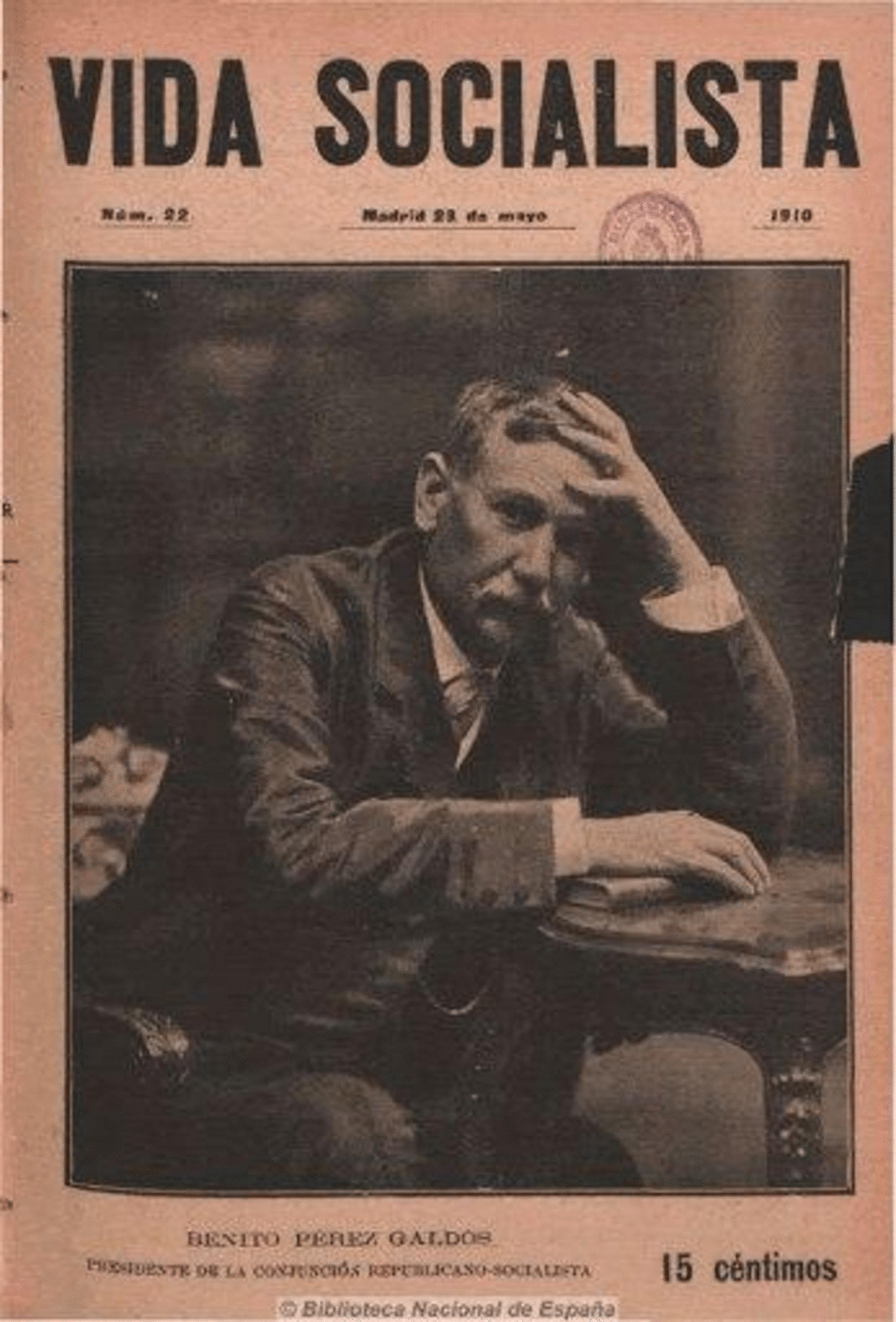






8kbetvvip, alright! Not gonna say it’s life-changing, but it’s solid. Worth checking out if you’re looking for something new. Check it: 8kbetvvip
Tried my luck with zero1bet last night. Had a decent run! The site looks modern and loads quickly, which is a big plus. Anyone else giving it a shot?
https://t.me/Top_BestCasino/130